I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Page 1 sur 1
 I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
reprise, donc, d'un "sujet à part entière", sans doute l'une des plus fécondes idées sorties de la conjoncture pandémique. Suivra un autre texte d'Étienne Balibar qui nous poussera à revenir sur le concept de "Commun" ou "Communs" (Commons) que j'avais critiqué en 2014-2015, commun et/ou communisme : révolution ou réformisme ?, mais c'était avant ma critique radicale du concept de révolution
I.
notes sur un vieux problème du communisme
LE POUVOIR POLITIQUE D'ÉTAT vs L'ADMINISTRATION DES CHOSES
29 avril 2020
notes sur un vieux problème du communisme
LE POUVOIR POLITIQUE D'ÉTAT vs L'ADMINISTRATION DES CHOSES
29 avril 2020
du 26 avril 03:31, compléments :
1) 26 avril, mon texte de 2012 sur la "positivité communiste" : les activités à maintenir, débarrassées du joug de l'État
2) 27 avril, précautions préliminaires : la "séparation du commun et de l'étatique" et le "dépérissement de l'État" chez Dardot et Laval
3) 29 avril, Balibar sur Althusser et Gramsci, 2014, à propos de réforme et révolution
c'est bien sûr une question qui mériterait un sujet à part entière, et l'on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas ouvert plus tôt. Pour l'avouer franchement, je pense que c'est une question qui m'éloignerait encore plus radicalement des anarchistes et 'communisateurs', soupçonné que je serais d'évidence de vouloir maintenir l'État, la politique et sa démocratie, puisque pour eux, l'administration sociale, sociétale, des choses, n'est pas envisageable sans l'État. Du moins l'"l'immédiateté sociale entre individus" n'y laisse-t-elle pas la place, et plutôt que repasser des robinsonnades, ils s'abstiennent d'en parler
toujours est-il que, hasard ou nécessité, le coronavirus me l'a posée
Marx a écrit:« Quelle transformation subira l’Etat dans une société communiste ? Autrement dit : quelles fonctions sociales s’y maintiendront analogues aux fonctions actuelles de l’État ? Seule la science peut répondre à cette question; et ce n'est pas en accouplant de mille manières le mot Peuple avec le mot Etat qu'on fera avancer le problème d'un saut de puce.»
Critique du programme de Gotha, 1875

une citation fausse, introuvable, ou impossible
un moindre mérite de la crise actuelle n'est pas qu'elle nous invite à reposer, au-delà de son issue à court ou moyen terme, des questions essentielles au mouvement communiste d'abolition du Capital, en l'occurrence celle du "dépérissement de l'État" au moment même où il accroît son importance dans une contradiction apparente aux nécessités du capitalisme dont il est l'instrument
dans la crise pandémique en effet, la montée en puissance de l'État national ou transnational, pour protéger les populations en tant qu'elles sont la force de travail à préserver et reproduire, ceci contre des décennies de néo- et ultra-libéralisme ayant fait oublier au capital cette fonction pour lui vitale, est aujourd'hui soutenue par l'ensemble des forces politiques au pouvoir ou dans l'opposition. Elle est soulignée par les auteurs de la critique radicale, anarchistes ou communisateurs, favorables à la révolution détruisant l'État*
* voir entre autres Coronavirus, croissance de l’État, crise de reproduction, La Canaille, mars 2020
cela relance inévitablement une question que ceux-ci n'ont pas vraiment approfondie : la distinction entre fonctions de l'État comme bras armé du capital, et celles assurant l'administration des choses, autrement dit ce qu'on appelle en France "les services publics", eux-mêmes mis à mal depuis 40 ans (thatchérisme...). Cette distinction est-elle seulement possible, non dans le capitalisme, mais pour en sortir ? N'est-elle pas vouée à n'être posée que sur le terrain de la représentation par la démocratie politique ? Dit autrement, l'administration des choses est-elle séparable de la politique et de la démocratie ? Telles sont les questions que je voudrais rouvrir en commençant par les alimenter de quelques citations
selon Alain Supiot* c'est par erreur qu'attribue à Saint-Simon cette citation selon laquelle il faut « remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses », alors qu’en accord avec la doctrine libérale, Saint-Simon enseignait au contraire qu’« il s’agit non seulement d’administrer des choses, mais de gouverner des hommes, œuvre difficile, immense, œuvre sainte. » Mais ce renversement n'est pas explicite chez Marx même, et la formule de l'administration des choses sans État attendra 1878 avec l'Anti-Dühring de Engels
* La gouvernance par les nombres, 2015
pour Henri Maler dans Retour critique sur le dépérissement de l’État, 2002, Marx dans la Critique du Programme de Gotha, 1875, se dérobe à cette question : « Le programme n’a pas à s’occuper (...) de l’État futur dans la société communiste », affirmation qui ne peut que complaire aux théoriciens de la communisation, contre tout programmatisme ou l'idée que le communisme serait un projet, mais qui ne saurait exempter de se poser plus concrètement la question de la possibilité et des formes d'une administration des choses non politique« La classe laborieuse substituera, dans le cours de son développement, à l’ancienne société civile, une association qui exclura les classes et leur antagonisme, et il n’y aura plus de pouvoir politique proprement dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l’antagonisme dans la société civile ». Marx, Misère de la Philosophie, juin 1847
« Lorsque dans le cours du développement, les différences de classes auront disparu et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, le pouvoir public perdra son caractère politique. Le pouvoir au sens strict du terme est le pouvoir organisé d’une classe pour l’oppression d’une autre . »
Marx et Engels, Manifeste du parti communiste, décembre 1847
« Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d’imposer à la société, comme loi régulatrice, les conditions d’existence de sa classe. Elle ne peut plus régner, parce qu’elle est incapable d’assurer l’existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu’elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination… »
id.
« La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'Etat et de le faire fonctionner pour son propre compte. » Marx, Préface au Manifeste Communiste , 1872
« La liberté consiste à transformer l’Etat, organisme qui s’est mis au-dessus de la société, en un organisme entièrement subordonné à elle. [...] Quelle transformation subira l’Etat dans une société communiste ? Autrement dit : quelles fonctions sociales s’y maintiendront analogues aux fonctions actuelles de l’État ? »
Marx, Critique du programme de Gotha, 1875
« L'intervention du pouvoir d'État dans les relations sociales devient superflue dans un domaine après l'autre, et s'assoupit ensuite d'elle-même. Au gouvernement des personnes se substituent l'administration des choses et la direction du processus de production. L'État n'est pas « aboli » ; il dépérit. »
Engels, Anti-Dürhing, 1878
« Les contradictions de l’utopie léniniste
En gros pour Lénine, il s’agit de « prendre possession » en l’état de l’appareil de production, sans avoir à le changer. Lénine persiste dans son utopie gestionnaire en imaginant que, lorsque l’Etat et l’autorité politique disparaîtront, « les fonctions publiques perdront leur caractère politique et se transformeront en simples fonctions administratives ». Il s’agit bien ici, non seulement du dépérissement de l’Etat, mais bel et bien du dépérissement de la politique, soluble dans l’administration des choses. Mais l’utopie libertaire se retourne en utopie autoritaire. Le rêve d’une société qui ne serait « tout entière qu’un seul bureau et un seul atelier », ne relève que d’une bonne organisation de son fonctionnement. L’« Etat prolétarien », conçu comme un « cartel du peuple entier », conduit à la confusion totalitaire de la classe, du parti, et de l’Etat, et à l’idée que, dans ce cartel du peuple entier, les travailleurs n’auraient plus à faire grève, puisque ce serait faire grève contre eux-mêmes. »
Daniel Bensaïd, Détruire ou changer l’État, 2007. On sait que L’État et la révolution fut inspiré à Lénine en 1917 par Gorter, qui en fut "remercié" en 1920 par Lénine dans La maladie infantile du communisme (le "gauchisme")
« Puisque l’‘État’ en tant que tel était défini comme l’appareil destiné à gouverner les hommes, l’appareil qui lui survivrait pourrait être accepté à condition d’être cantonné à l’‘administration des choses’ et par conséquent de n’être plus un État. La distinction entre le gouvernement des hommes et l’administration des choses était probablement tirée de la pensée socialiste qui avait précédé. Ce fut précisément Saint-Simon qui la rendit familière . »
Eric Hobsbawm, How to Change the World, Reflections on Marx and Marxism, 2011
« L'urgence : réinventer la conception de l'Etat
L’urgence c’est de restaurer et de réinventer une conception large de l’Etat, celle de Gramsci : celle qui n’est pas centrée sur la souveraineté mais sur toutes les fonctions d’organisation et de hiérarchisation à l’intérieur de la société. Et il faut savoir si toute la vie sociale doit être quadrillée par des administrations de type étatiques, même quand il s’agit de remplir des fonctions d’intérêt public indispensables... J’appartiens non pas à l’idée que nous pourrions nous passer d’Etat du jour au lendemain comme par enchantement, mais à l’idée qu’il y a d’autres capacités d’initiatives, de solidarités, d’interactions collectives que celles qui sont encadrées par la machine de l’Etat. »
Étienne Balibar, France Culture, avril 2020
on pourrait formellement mettre tout le monde d'accord, de Marx à Balibar et même les anarchistes et communisateurs, en cessant d'appeler État ce qui relèverait de cette administration non politique des choses, mais l'on voit bien que par là, on n'aurait pas même commencé d'y regarder de plus près
1) Patlotch et la positivité communiste : la reprise d'activités, connaissances, savoirs-faire, techniques, du capitalisme au communisme
tout à fait dans le sens de la question de Marx en exergue, voici ce que j'écrivais en 2012 dans Pour en finir avec mon communisme-théorique, premier pas de ma séparation d'avec la théorie prolétarienne de la communisation, et l'on y verra apparaître... le secteur de la santé27 avrilPatlotch a écrit:Un autre point de désaccord essentiel que j'ai avec cette façon de mettre en perspective une possible communisation, ce sont les éléments positifs actuels, dans l'activité humaine, à partir desquels il peut être produit comme "état" (guillemets pour éviter toute confusion avec État. Je ne trouve pas d'autre mot, et je fais aussi allusion aux mots de Marx et Engels dans l'Idéologie allemande : « Le communisme n'est pour nous ni un idéal, ni un état...»).
Je me suis trompé (je crois l'avoir déjà reconnu), en considérant qu'il était nécessaire de parler positivement du communisme comme état post-capitaliste, autrement dit de le décrire sous un jour attractif à même de lui apporter des adeptes (double idéalisme, de prévisionniste, et de militant). On a beau jeu d'y voir de l'idéalisme, ou pour le moins un moteur dans la subjectivation révolutionnaire - nonobstant la puissance de la négation (de la négation), il ne suffira pas d'agir que pour détruire, de faire "table rase", de considérer que « tout ce qui existe mérite de périr » (Faust Gœthe détourné par Marx et repris par un membre de TC). Vrai que cela vous pose comme plus radicalement radical que tout le monde : plus révolutionnaire que moi tu meures, on a déjà entendu ça sous tous les registres...
Ce qui importe à mon sens, c'est de considérer que nombre d'activités humaines actuelles, même menacées et/ou redéfinies par le contexte capitaliste, portent des potentialités de reconversion dans un contexte de monde non capitaliste, non échangiste, non marchand, selon d'autres critères de valeur, sans jeu de mot, en admettant qu'à défaut de droit, d'Etat, le nouveau monde produise ses propres valeurs déterminant les nouveaux rapports entre individus, communauté, comme on voudra...
Naturellement, et c'est en quoi je suis d'accord avec les communisateurs, ce ne sont pas des activités susceptibles en elles-mêmes de détruire les rapports sociaux capitalistes. Il importe de ne pas créer la moindre illusion en ce sens, y compris de les combattre (idéologiquement, donc) en ce qu'elles prétendraient porter, au-delà d'un mode de vie de fuite, une stratégie de fuite possible vers "un autre monde". Je ne suis pas loin moi-même d'y avoir recours à ma manière, mais je ne le confonds pas avec une activité proprement révolutionnaire.
Pourtant, cela ressort de l'évidence pour tout un chacun et sans besoin de théorie, c'est dans un premier temps sur la base de ces activités, c'est-à-dire de ces connaissances, de ces savoirs-faire, de ces techniques, de cette imagination créatrice, etc. dont les exemples sont multiples, que la communisation pourra conjuguer la destruction de l'ancien et la construction du nouveau, et faire en sorte que l'humanité, au moins survive dans le chaos et les adversités destructrices - c'est pourquoi, au demeurant, il importe que la communisation n'apparaisse pas sous un monstrueuse utopie nihiliste. Tout simplement parce qu'il y aura encore histoire, mouvement historique, transformant un existant selon une logique de survie et de vie commune, serait-elle conflictuelle.
On notera que bon nombre de ces savoirs, de ces connaissances, de ces techniques, sont le fait de catégories de la population qui ne sont pas des prolétaires directement liés à la production (de plus-value), et l'on ne peut réduire leurs activités, même si le contexte capitaliste les (re)définies dans leur intérêt marchand ou reproducteurs du système, à leur définition capitaliste. C'est évident, sous réserve d'inventaire - qu'il ne s'agit pas de faire non plus - dans les domaines de l'agriculture (manger pour vivre), du l'habitat (avoir un toit), de la santé (lutter contre les maladies, la mort) [remarque des plus actuelles], sans parler de la teneur de moult échanges inter-individuels ou collectifs désintéressés (dont ceux-là mêmes desdits communisateurs) etc. Mais il est vrai qu'à force de confondre humanisme au sens commun et humanisme-théorique, certains doivent être proprement déchirés.
Pourquoi diantre ne faudrait-il pas y voir une positivité, une capacité présente des individus humains, prolétaires ou pas, de vivre sans le joug capitaliste et la loi de ses valeurs ? Une positivité sur laquelle seront produites d'autres valeurs ? Des valeurs communistes... Une telle considération est hors champ des élaborations de Théorie communiste, soit qu'elle relève d'une évidence (ils nous diront bientôt qu'ils ne sont pas contre, que seulement ils n'en parlaient pas jusque-là... que cela n'est pas faux mais ne sert à rien... comme ils l'ont fait naguère à propos des femmes, et comme plus généralement ils sont capables de dire le contraire de l'avant-veille en le présentant comme continuité de leur théorie, du fait de son évolution objective avec le cours capital...). Voilà qui me semble relever davantage de l'amour propre que de la recherche théorique, mais celle-ci semble par moment importer moins que la réputation du théoricien... d'être quelqu'un qui a tout vu avant tout le monde et qui depuis ne se trompe jamais.
Le problème, c'est que prendre en compte de telles considérations est incompatible, sauf à ce qu'elle change de base strictement prolétariste, avec ce qui définit Théorie communisme. À trop avoir considéré, quelque part, que le communisme est "identique" au capitalisme, il faut croire que cela vaut pour la théorie "adéquate" aussi. Tel sera pris qui croyait prendre.
2) précautions préliminaires28 avrilparmi les plus recommandées, éviter de retomber dans les ornières du démocratisme radicale, et sa version des Communs ou du Commun dont Dardot et Laval représentent en France un vecteur idéologique, avec le retour à Proudhon contre Marx, que l'on trouve aussi chez Michel Onfray, sans parler de l'ultra-droite. Néanmoins, cela mériterait une véritable critique, et de ne pas se contenter, comme RS/TC affirmant en 2014, à propos de Silvia Federici et sans plus d'arguments que "L’idéologie des Commons n’est qu’une énième variante de l’increvable idéologie de l’alternative." D'accord pour discerner élaboration théorique et idéologie politique qu'on en tire, ou voire qui la sous-tend, mais encore faut-il aller y voir de près. Le passage ci-dessous ne pose-t-il pas, sous la labellisation en "commun", la même question que Marx en exergue ?Dardot et Laval a écrit:Ce qui fait de ce point de vue tout le prix de la propriété commune des anciens Germains, c'est finalement la séparation du commun et de l'étatique. Dans l'ager publicus germanique comme « commun originaire », il y aurait eu, si l'on peut dire, du « public non encore étatique » qui, en vertu de sa seule existence passée, prescrirait au commun de l'avenir d'accomplir toute les virtualités d'un public non étatique dans et par le dépérissement de l'État.
Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle, 2014
3) pour ne pas conclure29 avrilune telle question, à ce stade, il suffit de la poser puisqu'on ne peut pas ne pas se la poser, face à ce qui plus qu'en temps "normal" révèle ce qu'est une décision politique, comment elle est prise et pourquoi, avec des choix que, dans "notre camp", on ne voudrait pas avoir à faire. De telles questions, cette "conjoncture épidémique" en regorge, qui est tout sauf une "conjoncture révolutionnaire". Comme l'écrivent Tristan Leoni et Céline Alkamar dans Quoi qu’il en coûte. Le virus, l’État et nous, texte modeste mais des plus censés du moment :encore à l'agréable faudra-t-il encore joindre l'utile, et que ça marche...Qu’en serait-il dans une société (« communiste » ou « anarchiste ») où, depuis longtemps, auraient été abolis les classes et l’État ? Elle ne serait évidemment pas exempte de conflits ou de drames (une épidémie par exemple), mais qu’en sera-t-il de l’autorité ou des phénomènes de dépendance ? Comment s’effectueront les choix individuels et s’équilibreront conscience individuelle et conscience sociale, notamment en cas de crise ? Serons-nous « libres » ? Nous sommes certains d’une chose : le cadre pour en débattre sera bien plus adapté et agréable.
Balibar sur Althusser et Gramsci, 2014, à propos de réforme et révolutionGianfranco Rebucini : Ce qui est au fond aussi la question que tu posais concernant le rapport entre révolution et réforme ou de la distinction entre révolution bourgeoise et révolution communiste…
Étienne Balibar : Est-ce que Gramsci n’était pas quelqu’un qui travaillait à transformer la distinction entre réforme et révolution ? Dans notre idéologie de l’époque, dès que tu faisais un pas vers la réforme tu abandonnais la révolution. Je suis de plus en plus persuadé que l’on ne peut absolument pas poser le problème ainsi. Ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas sensible à la question de savoir ce qu’est la digestion du réformisme. J’ai un peu tendance à penser que les programmes réformistes qui nous sont présentés comme tels, évidemment ne sont en rien réformistes, ils ne réforment rien du tout. J’ai fini par faire un petit amalgame, que j’ai collé à la fin du petit volume sur la citoyenneté qui a été édité par Bollati Boringhieri17. À la fin, je me suis dit, il faut reprendre l’idée marxienne de la révolution permanente ou l’idée maoïste de la révolution ininterrompue et il faut amalgamer ça avec la fameuse phrase de Bernstein, qui lui a été évidemment mortellement reprochée par toute la tradition communiste, « le but final n’est rien le mouvement est tout ». Si l’on met ensemble les deux, on obtient quelque chose qui ne me semble pas complètement étranger aux préoccupations de Gramsci. Le problème est de savoir ce que c’est qu’un « mouvement » réel ; finalement, quels sont les objectifs réformistes, à supposer qu’il y ait des forces morales, politiques, intellectuelles etc., qui les soutiennent vraiment au lieu de lâcher prise dès que c’est difficile, qui mettent le système au pied du mur, c’est-à-dire qui l’empêchent de se transformer dans le sens où lui cherche à se transformer ? Je me souviens qu’en Italie et en France, dans les années 1960 – Magri avait écrit des textes là-dessus – c’était l’idée de réforme des structures.
F. F. : Je suis convaincu que tout le projet gramscien autour de l’hégémonie n’est pas une tentative de passer de la révolution à la réforme, mais de montrer que cette alternative est fausse, c’est-à-dire que l’opposition est fausse. Tout ça a été lu comme un passage de la révolution à la réforme. Mais la tentative de Gramsci, ça a été de vouloir toujours traduire la révolution dans les termes du monde contemporain, et il le fait parce qu’il refuse de voir le capitalisme comme une pure « réaction ». Le capitalisme est une « révolution », un mouvement continuel de révolution. On ne peut pas opposer le deux fronts, la « réaction » contre la « révolution » ; en réalité elles sont deux versions alternatives d’un projet de bouleversement de l’existant. Et du reste, ceux qui aujourd’hui se déclarent réformistes font exactement ces réformes là.
B.B. : C’est dire que la question révolutionnaire est de savoir comment on peut éventuellement imposer d’autres réformes que celles que le capitalisme est en train de faire, au moins comme point de départ, pour penser une crise qui ne soit pas subie passivement. Pour ce qui concerne le néolibéralisme, il ne faut pas se représenter le néolibéralisme comme la mise en œuvre d’un plan, d’une idée, de la mise en œuvre d’un modèle de société, il faut se représenter le néolibéralisme comme un contre-plan, c’est-à-dire que le néolibéralisme est une entreprise extrêmement violente et sectaire de démolition des institutions du compromis social construit par un siècle de luttes des classes en occident et ailleurs dans le monde. Donc, c’est effectivement une entreprise réformiste et peut-être révolutionnaire entendue en ce sens là. La question est de savoir si ce cours est fatal. Naturellement, l’alternative ne peut pas consister purement et simplement à dire qu’il faut défendre les acquis de la classe ouvrière, parce que les conditions de leur existence n’existent plus, ni les conditions subjectives ni les conditions objectives. Il faut donc arriver à inventer et à mettre en œuvre – ce qui est encore plus difficile – un autre genre de réforme que celui qui est proposé par le néolibéralisme, ce qui implique une confrontation très dure.
Entretien enregistré le 7 juillet 2014 et initialement paru dans la revue d’études althussériennes Décalages. Les questions ont été traduites par Gianfranco Rebucini. Publié par Période, septembre 2016
Dernière édition par Florage le Dim 7 Juin - 13:33, édité 4 fois
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
II.
COMMUN OU COMMUNISME : RÉVOLUTION OU RÉFORMISME ?
mars 2014 à janvier 2015
avant ma CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION
2016-2020
parlant en novembre 2014 de communs, commun, partage, collaboratif... une auberge espagnole idéologique, je ne tentais pas d'en sauver quoi que ce soit, et certainement pas un concept communiste de commun(s), alors sous la néfaste influence d'un théorichien de la révolution prolétarienne, tranchant à coups de crocs : « Inepte idéologie des Communs ! »
me voilà donc conduit à y revenir, puisque mon cheminement croise celui d'Étienne Balibar, avec cette puissante réflexion qui fait suite aux précédentes en ouverture du sujet
comme à moi il est venu à Étienne Balibar l'idée que voulant distinguer Fonction politique de l'État pour le Capital et Administration communiste des choses en héritage de Marx, on tombait assez logiquement sur le concept de commun, ou communs. Reste à savoir définir ce concept, et où l'on met les pieds, quand on ne tient pas fermement la notion de rupture avec le Capital. Les commentaires à son texte chez Médiapart nous alertent en ce sens sur une possible et probable méprise. Balibar est lui beaucoup plus prudent
questions basiques : peut-on définir le communisme comme une mise en commun ? de quoi ? comment ? Peut-on envisager le communisme sans communs ? Si non, lesquels ?
un autre question à notre programme théorique sera d'interroger la compatibilité de cette hypothèse avec celle de l'Inversion selon Jacques Camatte. À priori les présupposés socio-anthropologiques se recoupent, mais la focale historique n'est pas la même, ni vers le passé, ni vers l'avenir, et le regard sur le présent est donc différent
du pain sur la planche !
III.
L’Etat, le Public, le Commun :
trois notions à l’épreuve de la crise sanitaire
Étienne Balibar, blog Médiapart, 27 mai 2020
L’Etat, le Public, le Commun :
trois notions à l’épreuve de la crise sanitaire
Étienne Balibar, blog Médiapart, 27 mai 2020
La crise sanitaire, tendanciellement aussi économique, sociale, morale, a mis au premier plan l'importance des services publics et révélé l'ampleur du conflit qui s'y développe. Contre l'alternative binaire de l'étatique et du commun, on essaye de montrer ici qu'il pourrait s'agir du champ dans lequel se joue la transformation de la politique et la résistance collective au « retour à l'anormal ».
Le but de ce petit travail sera d’esquisser quelques réflexions de conjoncture sur l’articulation de trois notions qui occupent une place centrale dans le débat politique.[1] Elles ne nous écarteront pas de la situation de crise où nous sommes entrés, mais voudraient nous permettre, en dialogue avec d'autres, de voir plus clair dans les choix qu’elle va imposer. Cependant quelques préliminaires sont requis afin que la discussion ne revête pas un caractère trop académique.
Apprendre dans la crise
D’abord, je veux souligner l’incertitude des temps. J’écris à la mi-mai, et notre ouvrage sera disponible au milieu de l'été… C’est très proche, et cela correspond à l’intention de mettre en circulation une diversité de propositions dans le moment même où elles sont appelées par l’intensité de la crise. Pourtant il sera peut-être déjà trop tard… Nous n’avons aucune certitude que ce que nous pensons aujourd’hui sera encore soutenable dans deux mois. Nous ne savons pas si et quand vont « s’arrêter » la pandémie et la crise sanitaire qu’elle engendre. Nous ne savons pas quels seront l’ampleur et les effets de la crise économique qui en découle. Nous ne savons pas quelles en seront les répercussions, en termes de souffrances et de destructions, mais aussi de protestations, de révoltes, de mouvements sociaux et politiques. Et pourtant c’est de tout cela que dépend la référence réelle des mots dont nous nous servons, et par conséquent leur sens.
Étrange situation, qui n’a pas que des inconvénients. Car cette indétermination est la condition sous laquelle, pour peu que nous en prenions la mesure et le risque, il devient possible de décrire une crise de dimension historique pour ce qu’elle est : non une simple « interruption » dans la vie d’une société, ou l’occasion d’un renversement du pouvoir, mais un changement peut-être radical du mode de changement lui-même, obligeant donc à parier sur des mutations inconnues, tout en rassemblant ce qu’on possède en fait d’expériences et d’analyses pour en imaginer les possibilités. C’est aux signes affleurant dans le temps présent de nous suggérer peu à peu les bonnes questions, plutôt qu’à nos théories ou nos prévisions d’avant la crise de nous en proposer déjà la réponse.
Le pari que je prends, c’est d’abord d’affirmer l’irréversibilité de la rupture qui est en train de se produire. Il n’y aura pas de retour à l’état antérieur. Je me fonde ici sur la fameuse formule inventée par Lénine en 1920 : « ceux d’en haut ne peuvent plus vivre (et gouverner) comme avant, et ceux d’en bas ne veulent plus vivre (être gouvernés) comme avant ». Je ne la prends pas comme une prophétie, mais comme la description d’un état de fait. La crise révèle des conditions qui sont devenues incompatibles avec une « reproduction » du régime antérieur, et dont font intégralement partie les rejets qu’il suscite chez les « gouvernés ». Elle survient dans une situation tendue à l’extrême, où le gouvernement de la société est devenu très problématique, que ce soit du point de vue de l’efficacité des techniques administratives, des modèles de croissance économique, de la « soutenabilité » des dettes, de la tolérance aux écarts de richesse et aux discriminations culturelles, ou de la légitimité des formes d’autorité. C’est pourquoi elle enclenche un processus de transition qui ne pourra plus être bloqué, mais dont les modalités et l’orientation restent indéterminées. Tout ce que nous pouvons affirmer c’est qu’il est gros d’autres institutions politiques, d’autres modes de travail et de vie en commun, d’autres croyances collectives et d’autres choix de valeurs. Comment les civilisations changent-elles dans l’histoire ? Au prix de quelles violences, de quelles inventions et de quelles conversions ? C’est la question à laquelle, comme d’autres générations avant nous, nous allons devoir nous confronter, et à laquelle il n’y a jamais eu de réponse unanime.
Ces grands mots étant lâchés, j’apporterai deux correctifs. Le premier, c’est que bien entendu des forces puissantes et organisées croient pouvoir continuer comme avant, mettre à profit le « choc » de la crise, comme dit Naomi Klein, pour accentuer et accélérer des changements qui étaient déjà à l’œuvre dans la période précédente. A l’horizon des appels au « redémarrage de l’économie » quel qu’en soit le coût humain, il n’est pas difficile d’identifier le projet d’un accélérationnisme néolibéral et d’imaginer les effets dévastateurs qu’il pourrait avoir. Beaucoup de ces tendances – qu’il s’agisse de financiarisation et d’endettement généralisé, de révolution dans la division du travail, de marchandisation de l’environnement - vont chercher à se réaliser, mais elle se heurteront à des obstacles tout aussi puissants qu’elles. Et par conséquent les conséquences ne seront pas une « reproduction élargie » du néo-libéralisme, bien qu’elles puissent être pires. En fait les forces dominantes du capitalisme doivent réinventer une stratégie de domination et un projet idéologique. Ce qui, pour elles-mêmes, comporte un risque. Et ne peut vraisemblablement avoir lieu sans de violents conflits internes, entre différentes « hégémonies ».
Un second correctif s’impose alors : la mondialisation dans sa forme actuelle produit une interdépendance sans précédent des économies et des sociétés, mais elle n’a pas du tout uniformisé les régimes politiques, égalisé les niveaux de prospérité, ou rapproché les traditions culturelles au sein du « système-monde ». Plus que jamais elle implique des polarités très fortes entre le Nord et le Sud comme entre l’Est et l’Ouest. Plus que jamais elle est susceptible d’engendrer des affrontements, éventuellement des guerres sur différentes « frontières ». Toute analyse d’une situation locale dépend ainsi de la place qu’elle occupe dans un champ de rapports géopolitiques instables. Ce qui nous reconduit au fait que le temps où nous sommes obligés de nous situer est fondamentalement grevé d’incertitude. La crise elle-même doit nous enseigner les moyens de l’affronter et de la traiter.
Un maillon stratégique : la crise des services publics
Il me semble que ces considérations conduisent assez naturellement à essayer de définir pour l’analyse un maillon stratégique, cristallisant les problèmes présents au lieu même dans lequel nous sommes, et préfigurant des enjeux de plus longue durée. Il ne s’agit pas de politiser artificiellement des désarrois ou des engagements, mais de dégager la « politicité » immanente aux tensions institutionnelles, et par là-même d’enregistrer la coupure entre « l’avant » et « l’après » dans l’instant où elle se produit. Je pense que chez nous (en France, mais sans doute ailleurs également) ce maillon stratégique est constitué par le service public : crise du service public, fonction et fonctionnement du service public dans la crise, devenir des conflits dont il va, de plus en plus, être l’objet.
Ce qui frappe, évidemment, c’est le fait que toute la vie d’un pays, depuis son activité économique jusqu’à l’intimité de ses habitants, gravite autour de la qualité, des ressources et des insuffisances de son système de santé publique. Tout le monde est d’accord pour penser que la médecine fait irruption au centre de la politique, non seulement comme une institution chargée d’une fonction sociale indispensable, mais comme le service des services, celui dont l’interruption ou le mal-fonctionnement bloque tout, et qui par conséquent doit être préservé « quoi qu’il en coûte ». Du même coup se vérifie la pertinence de l’idée avancée par Michel Foucault lorsqu’il a proposé de repenser toute la politique, ou ses conditions de possibilité, en termes de biopolitique, pour qui le « faire vivre et laisser mourir » n’est pas un domaine particulier, mais le premier objet du gouvernement et le soubassement de tous les rapports de pouvoir. Cependant Foucault n’envisage pas vraiment les institutions médicales et sanitaires sous l’angle du service public et des contradictions qu’il comporte, en partie à cause de son attitude ambivalente envers les questions juridiques et, a fortiori, envers toute théorie de l’Etat semblant accréditer l’idée qu’il domine la vie sociale. Or c’est la nature exacte de la relation entre les politiques d’Etat (libérales, socialistes, néo-libérales), les formes historiques successives de l’Etat lui-même, et l’entretien quotidien de la société par les services publics, qui s’est trouvée mise en question par le « régime d’exception » sanitaire actuel. Et c’est le fait que la pression exercée sur les corps de soignants qui s’acquittent de ce service, ainsi que la dépendance réciproque aiguë et conflictuelle dans laquelle elle les a placés par rapport au gouvernement, soient venus frapper de plein fouet une institution en pleine révolte contre les pouvoirs publics, qui engendre un problème, dont on peut penser qu’il va commander « stratégiquement » toute la période à venir, à travers d’inévitables rapports de forces. Service public, pouvoirs publics, fonction publique, ordre public, finances publiques, tout cela gravitant autour du problème de la santé et des conditions de sa protection ou de ses usages, tel est, me semble-t-il, le nœud de questions sur lesquelles nous devons essayer de réfléchir pour articuler une urgence immédiate et une perspective de long terme. Mais avant d’en dire un peu plus, je voudrais préciser quelques points de définition et d’analyse concrète.
Premièrement, la santé est un « service » complexe, qu’on ne peut pas ramener aux seuls hôpitaux, même complétés par la médecine de ville : il ne fonctionne que s’il est étroitement couplé avec des activités productives et culturelles, dont l’ensemble s’étend quasiment à toute la société. Au premier rang desquelles figurent évidemment la recherche scientifique, l’industrie pharmaceutique et la technologie biomédicale, l’information statistique et démographique, mais aussi les transports spécialisés, les structures d’enseignement supérieur et professionnel, les organismes d’assistance et de secours populaire, les travaux de nettoyage ou de restauration accomplis par les désormais fameux « premiers de corvée », et ce qui n’est certainement pas le moindre, cette part des soins corporels et psychologiques assurée à domicile par des parent(e)s et des partenaires du « malade » qui gît en chacun de nous… Un service comme la santé publique est donc non pas une institution sectorielle, mais un « point de vue » sur la société tout entière, qui tisse des liens entre un très grand nombre de ses membres, en bref engendre du « commun ». On pourrait en dire autant, évidemment, d’autres services, en particulier l’éducation – mais peut-être pas au même degré. Ce qui m’amène au point suivant.
La définition des « services publics » par la fonction sociale qu’ils remplissent, le régime de droit des établissements qui les assurent, la modalité de leur financement, et leur incorporation ou non à la fonction publique, est une matière controversée, variable d’un pays et d’une période à l’autre. Venant après « l’âge d’or » de l’Etat national-social développé par les capitalismes réformistes au 20ème siècle, qui ont institué la « citoyenneté sociale » (T. H. Marshall) et l’ont placée au cœur de la citoyenneté politique, les politiques néo-libérales ont eu pour but de « rationaliser » leur mode de gestion, ainsi que de « privatiser » le plus grand nombre possible d’entre eux. Elles ont révolutionné « par en haut » les conditions de vie et de travail de la population, engendrant une énorme incertitude quant à la question de savoir quels services seraient intrinsèquement publics, « non privatisables ». Cette question est parallèle à celle des biens communs de la société (voire de l’humanité), qui lui est spontanément associée dans la conscience collective, mais elle peut en être dissociée si on avance un concept de « commun » distinct du « public » et même opposé à lui, comme le veulent aujourd’hui les théoriciens néo-communistes.[2] Je laisse provisoirement cette question de côté pour noter ceci qui me semble crucial : il y a une pluralité de services complémentaires, mais hétérogènes, de sorte que leur mode d’utilisation par l’Etat et, corrélativement, leur articulation avec la citoyenneté individuelle et collective sont divergentes, et même antinomiques. Je citerai deux exemples extrêmes dont la crise actuelle a en quelque sorte « testé » la qualité de fonctionnement : l’école, dont le « service » propre est l’enseignement ou la formation individuelle (mais qui vise aussi à la correction des inégalités d’origine sociale, et à l’institution de « l’égalité des chances ») et la police, dont le « service » propre est officiellement la sécurité et l’ordre public (donc la protection des citoyens contre leur propre indiscipline, avec toute la violence que recèle une telle notion, comme on le voit dans la mise en vigueur des règles de « distanciation sociale »). Ils suffisent à montrer que le rapport des services publics à l’Etat et à la société sont loin de poser les mêmes problèmes dans tous les cas. Ils sont cependant toujours essentiellement politiques, et non pas « techniques » ou « administratifs ». La phase néolibérale et les réactions de masse qu’elle cristallise illustrent l’effet de la situation politique sur la notion de service public. Ce qui doit nous intéresser ici est l’action en retour de la question des services publics sur la politique elle-même.
Enfin les services publics réels, historiquement constitués, sont le siège d’un conflit très aigu entre l’universalité et l’égalité. Il peut prendre plusieurs formes, de gravité inégale, mais toujours potentiellement déstabilisatrices. Or elles sont en train de franchir dans la crise sanitaire, avec ses conséquences économiques et sociales, un degré dans l’intolérable. Les citoyens « égaux en droits » ne le sont aujourd’hui ni devant la maladie ni devant les moyens mis en œuvre pour en protéger la société et qui font appel à la « solidarité nationale », quand ce n’est pas à l’union sacrée. On a pu observer que la différence des taux de contagion et de mortalité renvoie à des « comorbidités » qui ont une détermination de classe, déjà manifeste dans les espérances de vie extraordinairement inégales des adultes de différentes professions et niveaux de vie. A quoi vient s’ajouter l’inégalité structurelle des ressources médicales entre zones urbaines et périphériques. Ces inégalités sont encore plus frappantes du côté des règles de « l’état d’urgence sanitaire », puisque les salariés obligés de continuer à travailler au dehors et sans protection sont massivement des travailleurs manuels (souvent immigrés, parfois sans papiers), que les conditions du confinement dans des unités d’habitation exiguës s’avèrent insupportables ou inapplicables, et que le chômage forcé envoie d’ores et déjà aux « restos du cœur » la couche la plus démunie des intermittents et des précaires. La dimension symbolique autant que matérielle de la contradiction est particulièrement visible dans le cas des institutions que je présentais plus haut comme des figures antithétiques du service public : l’école et la police. La suspension des enseignements « présentiels » se traduit par le décrochage définitif des enfants des classes pauvres, auquel même le discours officiel est obligé de prêter attention. La pratique des contrôles s’accompagne dans les « quartiers » d’une perpétuation des violences racistes que le même discours, au contraire, s’efforce de camoufler. On peut rassembler tout ceci en inversant la formule dont je m’étais servi : le service public détruit le commun, et du même coup il contredit l’universalité qui, en régime républicain, constitue à la fois sa raison d’être et le ressort moral du travail de ses fonctionnaires. Cette contradiction est permanente, mais elle revêt une nouvelle intensité. Je voudrais essayer d’en interpréter le sens à la fois sur le plan des notions générales qui nomment la fonction historique du service public dans une société capitaliste comme la nôtre, et sur le plan de la dynamique politique ainsi amorcée au centre de la crise elle-même.
L’Etat et le service public
La question de l’Etat, envisagée sous l’angle de son « retour », mais aussi sous l’angle de sa constitution formelle et matérielle, est brutalement redevenue la question centrale du débat politique. Donc aussi philosophique. Une alternative la domine, héritée des conflits idéologiques du 20ème siècle : elle pose que les interventions étatiques et les activités marchandes sont antithétiques les unes des autres (après quoi on peut évidemment rechercher leur complémentarité). Les déclarations que le Président Macron a été amené à faire en évoquant des « biens publics » qui ne peuvent pas comme tels relever des « lois du marché » en procèdent directement. Elles ont pu surprendre (voire inquiéter) venant d’un tel personnage, mais surtout elles signalent d’emblée l’existence d’une profonde ambiguïté, puisque le « non-marché » incarné par l’Etat et par les actions dont il est l’initiateur peut fluctuer entre des contenus aussi éloignés que l’investissement public, la nationalisation ou même la planification d’un côté, la gratuité de services correspondant à des « droits fondamentaux » de l’autre. Autrement dit ou bien une limitation de la concurrence et du profit, qui ne touche pas à la forme-marchandise, ou bien une abolition de cette forme même au nom d’autres valeurs. Que veut dire sortir des lois du marché dans une société et dans un monde où elles ont été généralisées ? Et quels instruments le permettent ?
Il ne serait pas difficile de montrer que des ambiguïtés tout aussi fondamentales affectent chacune des interrogations qui courent en ce moment à propos du « Léviathan » étatique moderne : qu’est-ce qui est « invariant » dans sa structure depuis les origines ? qu’est-ce qui au contraire aurait subi une transformation sous l’effet des révolutions de l’histoire contemporaine, consolidant les politiques sociales au sein même du capitalisme avant d’entreprendre de les démanteler, renforçant le caractère national de l’Etat avant de le décentrer progressivement vers des institutions supranationales ? Mais les ambiguïtés ne sont pas moindres pour ce qui concerne la relation des « gouvernants » et des « gouvernés » - dans laquelle on pourrait voir la structure élémentaire de l’institution politique de forme étatique, mais qui oscille suivant les rapports de forces et les héritages historiques entre l’autoritarisme et la démocratisation, le centralisme et le fédéralisme, ou l’autonomie pour les communautés territoriales. Je n’ai pas la prétention de rassembler les termes de toutes ces discussions dans quelques formules, mais je veux suggérer que la crise en cours les déplace et les oriente dans deux directions, qui l’une et l’autre font jouer au mode d’organisation et au fonctionnement des services publics une fonction stratégique. D’un côté se pose en termes nouveaux la question de la « police » (au sens de Jacques Rancière), c’est-à-dire celle des rapports étroits qui peuvent se nouer entre la nécessité de contraintes administratives pour organiser la fourniture de services universels, et les pratiques de normalisation et de contrôle « assujettissant » ceux qui accèdent à ces mêmes services. De l’autre se pose avec une insistance renouvelée la question de savoir si le « public » et le « commun » représentent une seule dimension de l’existence sociale, ou bien s’il convient de rechercher entre ces trois notions : l’étatique, le public, le commun, une articulation plus complexe et plus instable. L’une conduit à l’autre.
Commençons par la question de la « police ». Il y a certes quelque chose de paranoïaque dans les descriptions que de grands esprits nous offrent en ce moment d’une évolution irrésistible de « l’état d’exception » que représente le confinement (à terme relayé par le traçage informatique des individus, comme condition de la suspension du premier) vers une société de type totalitaire – celle-là même que, nous dit-on, le capitalisme aurait toujours eu le projet de mettre en place pour annihiler les résistances à son ordre économique, mais qui aurait attendu la rencontre d’une révolution technologique (le smartphone et les big data) et d’une catastrophe anthropologique (la pandémie) pour pouvoir enfin se mettre en place. Et cependant, au-delà des formes de moralisation et de discipline qui ont été historiquement, dans ce que j’ai appelé ailleurs l’Etat national-social, la contrepartie de l’acquisition des droits sociaux et de la protection contre les aléas de la vie économique, l’évolution vers ce que Deleuze avait appelé une « société de contrôle » est bien l’une des possibilités qu’ouvre la reconnaissance d’une menace endémique généralisée et sans fin prévisible contre la vie des individus. D’ailleurs elle existe déjà, sous des formes qui varient d’un pays et d’un régime politique à l’autre. Elle vient donner un contenu beaucoup plus oppressif à ce que nous pouvons considérer comme la formation étatique au sens large : une formation qui ne s’établit pas « au-dessus » ou « en dehors » de la société civile, mais se trouve avec elle dans un rapport d’interpénétration évolutif, parce que la fonction de l’Etat est d’organiser la société, en recherchant le « juste » équilibre (celui qui est tenable, défendable) entre la promotion de certains intérêts de classe, de genre, de race, de culture, et la proclamation d’un « droit aux droits » pour tous les sujets. Cette question d’organisation ou, comme disait Gramsci, d’hégémonie, est sans doute en train de changer de sens. Si toute la société doit être surveillée en même temps que protégée, et si des instances de gouvernement, prolongées par un réseau de services chargés de recenser, d’éduquer, de soigner, d’informer, d’assister, de placer, de repérer et de suivre les individus, font ainsi pénétrer l’Etat au sein de chaque « rapport social », alors le champ d’action du service public s’étend démesurément et le transforme en machine d’asservissement universel. Son rapport « normatif » (comme disent les philosophes) avec l’institution de la citoyenneté se trouve perverti et en fait anéanti. Mais cette difficulté ne se résout pas par un « retour aux principes » de l’Etat de droit, puisqu’elle a son origine dans ces principes mêmes. D’où l’intérêt et peut-être la nécessité de se tourner maintenant vers ce qui, idéalement au moins, semble constituer l’alternative radicale à une telle expansion ou « socialisation » continue de la fonction étatique, et qu’incarne dans les débats actuels la promotion de l’idée du « commun ».
Du « commun » à l’effet de communauté politique
Je prendrai ces débats dans une formulation condensée, donc inévitablement simplifiée, pour faire bien ressortir l’opposition qui me semble cruciale entre une problématique binaire, dans laquelle le service public, perdant sa spécificité, est sommé de « choisir » entre l’appartenance à l’Etat et l’expression du commun, et une problématique qui lui confère une autonomie au moins relative, ou plutôt – car cette terminologie rappelant des débats anciens peut engendrer des équivoques – une spécificité irréductible et donc le statut d’un troisième terme.[3] Le fond de l’argumentation binaire, c’est au fond l’idée que la société possède des besoins « fondamentaux » (matériels, culturels) historiquement constitués et développés, dont la reconnaissance institue des droits eux-mêmes fondamentaux. Le conflit des idéologies politico-économiques engendre alors des tendances opposées à limiter autant que possible, ou au contraire élargir indéfiniment la sphère de ces besoins et de ces droits : libéralisme, socialisme ou solidarisme. Mais, pour ce qui nous concerne ici, le choix décisif oppose l’idée que l’Etat est par essence le représentant de la société et le porteur du « bien commun » à l’idée qu’il constitue quelque chose comme un « appareil de capture », usurpant une fonction dont les citoyens pourraient et devraient s’acquitter eux-mêmes, dans leur propre intérêt, en acquérant les compétences et en inventant les formes de gouvernement correspondant à cette mission. Le « public », dans ces conditions, n’a pas véritablement d’autonomie : ou bien il nomme la dimension sociale de l’Etat (ce que Léon Duguit appelait son « contenu matériel », opposé au « désordre social »)[4], ou bien il nomme la modalité sous laquelle la société devient une communauté, et celle-ci un corps politique auto-administré. On retrouve d’une certaine façon la vieille opposition entre les idées de souveraineté, de représentation, de médiation politique sans laquelle les individus et les groupes sociaux ne seraient pas capables de surmonter leurs conflits (Hobbes, Hegel, mais non pas Rousseau qui sur ce point se distingue), et d’autonomie, d’immanence, de capacité également répartie entre les citoyens quand il s’agit d’organiser leur propre vie (Proudhon et Marx, qui sur ce point se rejoignent). Et naturellement cette opposition peut être tranchée dans les deux sens, mais elle se conjugue aisément à la représentation (que je partage entièrement) d’une société dominée par des rapports d’exploitation et des mécanismes d’expropriation dont l’Etat se ferait, soit le serviteur zélé, soit le régulateur plus ou moins actif.
Or il me semble bien que l’expérience que nous sommes en train de faire nous oblige à sortir de ce binarisme trop simple. Elle autonomise la notion de service public, à la fois par rapport à l’étatique et par rapport au commun, et lui confère une spécificité, une conflictualité propre dont il faut rendre compte et peut-être, politiquement, savoir s’emparer collectivement. Non pas pour ériger une sphère juridico-politique autonome, mais plutôt pour y inscrire la concurrence même entre deux logiques, entre deux types de pouvoirs, l’un et l’autre nécessaires, mais l’un comme l’autre grevés de conflits qui s’étendent depuis le plan local et quotidien jusqu’à l’échelle internationale et potentiellement planétaire. Bien entendu cette expérience se fait dans l’urgence, mais je crois qu’elle ne se fait pas dans la sidération, ou dans l’oubli des situations qui l’ont précédée. Les « soignants » ont réussi à faire percevoir par la population ce qu’avait de « systémique » (sinon de prémédité) l’état d’impréparation, de pénurie, de mal-fonctionnement autoritaire, d’injustice et parfois de cruauté (pensons aux EHPAD) d’un service de la santé en voie de marchandisation et de privatisation accélérées. Du même coup ils ont constitué entre eux et autour d’eux un « commun », produit un effet de communauté qui n’est pas seulement moral ou sentimental, certainement pas dénué de contradictions (car il comporte lui aussi ses hiérarchies et ses inégalités), mais qui est profondément politique, conscient de ce qu’il doit exiger, des forces sur lesquelles il peut compter, et des valeurs morales qu’il doit défendre. Pour autant, il ne vise pas à substituer le commun à l’Etat. Il viserait plutôt à imposer à l’Etat - un Etat qui, dans la dernière période, s’était totalement consacré aux intérêts de la classe dominante, et même des couches les plus privilégiées de celle-ci - de servir le service public, y compris en retirant de l’économie de marché les ressources nécessaires, puis en les mobilisant de façon rationnelle, sous un contrôle démocratique. La conscience commune (et je la crois juste), c’est que service public a toujours besoin de l’Etat, depuis ses « sommets » jusqu’à ce qu’on se risquera à appeler « l’Etat d’en bas » (cet Etat que « nous sommes tous » : fonctionnaires d’exécution, soutiers de la fonction publique, et surtout « gouvernés » ou citoyens, dès lors que nous nous ingérons dans son fonctionnement et dans ses politiques).[5] Mais ce n’est pas que le service public appartient à l’Etat. Comme il ne peut en être un rouage ou une émanation, il doit s’en distinguer, même si c’est par des frontières imprécises et constamment contestées. Pour renforcer son autonomie, il a donc lui-même besoin que le « commun » s’organise, qu’il s’exprime et qu’il s’oppose à bon escient (ce qui ne veut pas dire dans un esprit de conciliation) aux pratiques de gouvernement. Arbitre des conflits à venir entre l’étatique et le commun, le service public est aussi l’enjeu de leur confrontation. Elle ne fait que commencer.
*
On l’aura compris, je ne décris pas un mouvement, pas plus que je ne dessine un programme. J’essaye de formuler une question qui serait à la fois de citoyenneté (une façon d’imaginer l’action en retour des gouvernés sur les gouvernants) et de civilité (une façon de développer les conflits à l’intérieur de la société en évitant leur détournement vers la guerre civile). J’attends de voir si cette formulation est utile, si elle est adéquate aux épreuves que nous allons traverser. Elle n’est nullement exclusive d’autres questions dont il faut débattre, que ce soit à propos du rôle économique de l’Etat et des transformations qu’il devrait subir, à propos de la « loi du marché » et de ses régulations ou de ses limites, à propos de nos modes de vie et de nos rapports à l’environnement naturel. Cependant j’ai tendance à croire qu’il ne faudrait pas l’éluder : non seulement pour faire droit à des exigences qui s’expriment fortement dans la société, mais pour que la spécificité de la crise sanitaire ou, si l’on veut parler comme Foucault, de la « biopolitique », ne soit pas occultée dans la violence des troubles qui s’annoncent, et même y représente en permanence comme une boussole. Ce pourrait être l’une des conditions permettant de déranger la mortelle symétrie de l’autoritarisme technocratique ou policier et de la « colère » populiste, qu’elle se veuille de droite ou même de gauche, dont nous sommes aussi menacés.
20 mai 2020
[1] Contribution à l’ouvrage collectif Dessine-moi un pangolin, initié par la Revue Regards et coordonné par Pierre Jacquemain, Editions Au Diable Vauvert (à paraître août 2020). Tous droits de reproduction réservés.
[2] En dépit de leurs divergences, Antonio Negri et Michael Hardt (Commonwealth, Assembly), Pierre Dardot et Christian Laval (Commun) se rejoignent sur ce point.
[3] Je m’inspire en particulier de l’exposé remarquablement clair et argumenté de Pierre Dardot et Christian Laval dans Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, Paris 2014, p. 514 et suiv. : « Les services publics doivent devenir des institutions du commun ».
[4] Les transformations du droit public (1925), cité par Thomas Boccon-Gibod, Autorité et démocratie. L’exercice du pouvoir dans les sociétés modernes, L.G.D.J., Paris 2014.
[5] Voir Marc Pavlopoulos : « L’Etat c’est nous », https://blogs.mediapart.fr/mpavlopoulos/blog/120520/l-etat-c-est-nous
Dernière édition par Florage le Sam 6 Juin - 13:49, édité 1 fois
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
du 6 juin
IV.
LA LIBERTÉ COMMUNE CONTRE LA HIÉRARCHIE DES POUVOIRS
D'ÉTAT et "LIBERTAIRES"
L'AUTORITÉ NATURELLE
vs
L'ESPRIT LIBERTAIRE DE LA DICTATURE, MIROIR DE L'ÉTAT SANS ÉTAT
pour une critique systématique du pouvoir, des pouvoirs, de la hiérarchie
IMPROVISATION ET LIBERTÉ
LA LIBERTÉ COMMUNE CONTRE LA HIÉRARCHIE DES POUVOIRS
D'ÉTAT et "LIBERTAIRES"
L'AUTORITÉ NATURELLE
vs
L'ESPRIT LIBERTAIRE DE LA DICTATURE, MIROIR DE L'ÉTAT SANS ÉTAT
pour une critique systématique du pouvoir, des pouvoirs, de la hiérarchie
IMPROVISATION ET LIBERTÉ
l'incapacité de penser l'Administration communiste des choses sans le Pouvoir d'État (du Capital) ne procède pas, comme prétendu, d'un "c'est trop loin pour le voir, le prolétariat fera preuve d'imagination", mais du désir inconscient de programmer et diriger ce qui viendra après LA révolution
ironie du sort, c'est au présent que ces révolutionnaires en montrent l'impossibilité, se réfugiant dans une utopie romantique voire nihiliste sans substance concrète, sans véritable théorisation problématique de ces problèmes*, ce qui ternirait leur pure image de "radicalité". Tout ce qui tente de le projeter sur la base du présent ne saurait pour eux que relever d'un réformisme
* "le communisme n'est ni un mode de production ni une société", ce sera "l'immédiateté sociale entre individus", tout se réglera "par la palabre", le prolétariat va le faire, ils en sont sûrs mais ne savent pas comment, et autres balivernes pas même dignes des utopistes d'avant Marx, puisqu'il ne faut pas faire de "récit", mais rêver aux jours heureux de la communisation dont les lendemains chantent comme les anges du paradis... après la fin
en attendant la fin, ils sont, en miroir de l'État du Capital, le Politique de l'État sans État, sans l'Administration communiste des choses. Telle est, éternelle, la fonction de la surenchère gauchiste et la réalité de son impuissance théorique et pratique
en attendant, il est nécessaire de nous défaire du complexe de réformisme que tentent de nous refiler ces marioles
SOMMAIRE
I. notes sur un vieux problème du communisme
LE POUVOIR POLITIQUE D'ÉTAT vs L'ADMINISTRATION DES CHOSES, 29 avril
II. COMMUN OU COMMUNISME : RÉVOLUTION OU RÉFORMISME ? mars 2014 à janvier 2015
avant ma CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION 2016-2020
III. L’Etat, le Public, le Commun : trois notions à l’épreuve de la crise sanitaire
Étienne Balibar, 27 mai 2020
IV.LA LIBERTÉ COMMUNE CONTRE LA HIÉRARCHIE DES POUVOIRS
D'ÉTAT et "LIBERTAIRES", 6 juin
pour une critique systématique du pouvoir, des pouvoirs, de la hiérarchie
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
un texte à forte connotation programmatique
déniché par Ana C. Dinerstein @CDinerstein, ce texte a sa place dans ce sujet davantage que dans ceux directement liés à la pandémie coronavirus. Son intérêt est d'en avoir tiré des réflexions théoriques. Il s'inscrit dans une sorte de démocratisation de l'État précisant ses fonctions d'organisation de la société, laquelle pour l'auteur ne sort pas d'une société d'échanges économiques (référence à Marx, Programme de Gotha...), mais qui ne déterminent plus selon lui sa nature comme capitaliste... Pour le reste ce texte s'inscrit dans les réflexions intégrant les rapports humanité-nature... Je n'ai fait que le parcourir
The Pandemic and the Need for a New Society
Raju Das, The Bullet, June 14, 2020
Raju Das, The Bullet, June 14, 2020
During the on-going pandemic, humanity’s suffering has increased enormously. To date, June 13, 2020, 7.78 million people in the world have contracted the coronavirus, and 429,000 have died.1 In the richest and most powerful country in the world, more than 2.12 million cases have been reported, with 116,929 deaths. The adverse effects of the pandemic are massive, including loss of income and employment opportunities.2 Healthcare workers have been valiantly doing their work, often without proper protective equipment, which is in short supply even if resources are potentially available to produce them in adequate amounts. Years of funding cuts have created a healthcare system that is singularly unable to face a public health emergency. In many countries, workers are being forced by their bosses to go to work under unsafe working conditions, where they are exposed to the risk of the virus.
While the more affluent classes can choose to comfortably stay at home, millions of wage-dependent women and men are caught between a rock and a hard place: stay at home and face the risk of starvation that can cause illness or death, or go to work and face the risk of infection that can cause illness/death as well. The pandemic is, in fact, forcing us to think about what kind of society we wish to live in, what kind of society is worth fighting for. This article discusses the conception of a new society in relation to production, work and needs, ecology and spatial development, and the political in the public sphere.
Production, Work, and Human Needs
Means of production – land and other natural resources, mechanical technology (e.g., tools and machines), biological technology (e.g., seeds and chemicals) and electronic technology (e.g., software and the internet) as well as the means of transportation and communication, factories, labs, warehouses, retail and wholesale stores, etc. – will be collectively owned and controlled, initially by the workers’ state, and gradually, by ordinary men and women who do the work of production and exchange.
Means of production will be used to produce things that meet human needs – the need for food, drink, shelter, clothes, energy, transportation, healthcare, education, culture and leisure, etc. – and to produce the things (e.g., machines) that are needed to produce the means of subsistence such as food, etc.3 The motive of production will be to directly meet everyone’s needs and not to accumulate things or profit. The purpose of production will not be to increase military and political power.
Resources for production will be allocated on the basis of meeting people’s needs. If more food and shelter are needed than vacation houses, more of society’s total labour capacity and its physical resources will go to the former. There will be economic planning at multiple levels of society with active participation of people who will spend a fraction of what is now their working day.
The process of production or labour process needs people and a means of production. It does not require owners of means of production. Owning does not count as productive work. Owning does not produce anything. There will be no need for wealthy profit-driven owners or their highly-paid servile managers who lord over the workers. One does not need Mukesh Ambani (India’s richest businessperson) or Jeff Bezos (the owner of Amazon) to run the enterprises owned by them. There are enough good engineers and managers who can manage the enterprises for a decent salary subject to the democratic control over the managers by common workers. Gradually, ordinary workers will perform the work of directing and superintending that is necessary in any large-scale labour process involving numerous workers working side by side.4 Common people, the workers (whether they work with their hands or their minds or both) will be their own ‘boss’, where they make the decisions about everything in their workplace in a democratic way, together.5
No one will enjoy an income because they are property owners, whether through the collection of rent or profit or interest. In a good society, a few rich people, a few corrupt politicians, and a few corrupt officers, will not loot the common people, in the name of serving people and the nation or in the name of development. Only the ordinary people will enjoy the fruits of their work (mental, manual, or both). Those who are now capitalists will be converted into common workers.
Along with nature, which directly supplies the resources for the means of production (e.g., raw materials, etc.), human beings – as performers of work – are the co-producers of wealth. Society will restore dignity to both nature and to labour. Society will recognize people’s innate abilities and natural talents. It will make sure that people freely develop their multiple abilities and interests and are free to choose any vocation/s. No one will be forced to do a particular type of work, whether based on birth or any other criterion.
No able-bodied adult should be unemployed or under-employed.6 There will be little competition, either for work or for a market or anything else. There will be plenty of work to be done and there will be high ‘demand’ (now expressed as a need to be fulfilled) for what is produced.
In a good society, everyone should be able to perform enjoyable work for a few hours every week.7 Everyone should have enough time for their family, friends, and for leisure, personal pursuits, volunteer work, enjoying nature, expressing love and affection, and so on. How much work one does in the workplace will not be governed by the principle that the more work people do, the greater the profit. A part of people’s work will be contributing to the management of common societal affairs. More and more functions of the state will be transferred to common people as they learn new ways of living.
Doing productive work will fulfill a need, and rather than a means to earning a livelihood. And when people do their work because they love doing it, they will produce more and better things/services. Society’s productivity will be enhanced. Society’s productive powers will also develop because no longer does an economic crisis put a stop to production, and production is no longer driven by profit and exploitation. When productive powers are immensely enhanced, existing unmet needs will be met and new needs will emerge and will be met. People’s leisure time will be also increased.
It is through people’s work that they will contribute to society. Society, in turn, will meet the needs of the people, the needs that can be democratically justified (not a vacation on the moon or a million-dollar car). The needs will be met in different ways. Initially, people will receive compensation based on their work, and they then will procure their means of subsistence from society.8 So, initially, some people may receive more than others because they perform a greater amount of work and/or more skilled work: an engineer or a teacher might get more than a sweeper. Over time, however, when society reaches a stage of plenty, and when work becomes a human need, people will contribute to society depending on their variable abilities, but the needs of all will be met, irrespective of how variable the needs are and how much work one does.
Unlike in the current society where for the vast majority costs of maintenance are not covered (wages are extremely low) which accounts for the millions of working poor, in the new society, living wages will be enjoyed by all. The principle of equal ‘exchange’ will be practiced: the full cost of the reproduction of labour power will be paid.
If initially, not everyone can be provided for or is willing to engage in wage-employment, all the self-employed people will be provided full assistance from the government, and their living standards will be improved. They will be encouraged (but not forced) to form cooperatives. As workers’ wages rise immensely, many of the self-employed will voluntarily switch to wage-work.
People will perform surplus labour – i.e., they will perform longer hours than necessary just for their own reproduction. But as associated producers, they will now control how much surplus is produced and how that surplus is used. The compensation that individuals receive in return for their work will not be equal to how much they produce. Deductions will have to be made from the social product that people produce.9 Society will save resources for supporting people when they cannot or are not expected to work (e.g., women during pregnancy; children; older people; people who are ill; people who have met with an accident). A part of the total social product produced by people will need to be set aside toward the cost of the means of production (e.g. raw materials and machines and energy need to be replenished) and for the purpose of expanding the productive base (for example, to establish new factories or labs or build a new bridge across a river). A part of the social product needs to be put aside for collective provisioning by the government (e.g., education, healthcare, etc.), for dealing with emergencies and natural calamities (e.g., storms, floods, earthquakes, pandemic) and for restoring ecological health.
Harmonious Spatial Development and Restoration of Ecological Health
In a good society, the gap between manual and mental labour will be gradually closed. Connected to this division is the one between villages and cities, which will be bridged.10 Rural areas will have as many amenities as urban areas, and rural living standards will match those of urban areas. New hybrid spaces will be created which will have the advantages of rural life and urban life. It will not be a curse to live in villages. Rural life will not have the stigma it has now because of relative economic and cultural under-development. A proper health center, a library, and a non-farm workplace will be built within a reasonable distance from where people live. Given that productive investment will be rationally planned, different regions of a country will develop in a more or less harmonious manner: the living standards of some people will not be lower than those of others just because of where they live. With the force of private profit gone, productive resources will not be geographically concentrated to increase profit to avoid creating geographically uneven development and forcing different regions to compete for capital investment.
As relations of cooperation among countries develop, all countries will develop in harmony with one another, sharing their resources. No country will subjugate another country in its own interest, either through economic relations or militarism. Imperialism will be a distant memory. The majority of the world’s countries which form the Global South now will achieve a higher level of economic and cultural development.
The new society, which is no longer driven by the profit motive, will live in as much harmony with nature as possible. The gap between what is extracted from nature and what is put back into it will be reduced, just as the gap between how much people contribute and how much they receive (in private wages and government benefits) is minimized. The new society, freed from the shackles of private profit, will take immediate steps to reverse global warming and other global environmental problems. It will make massive investment in public health and it will be always prepared to deal with natural emergencies such as pandemics.
This new society will not necessarily reduce total production, because increased production of useful things is necessary to meet the unmet needs of millions and to meet new needs that will arise. However, it will produce things differently (i.e., sustainably). And it will not produce polluted air or toxic chemicals as a commodity nor will it produce military weapons. More and more production, especially, in the of food and drinks, will be organic. Nature – its rivers, hills, plants and animals, seas and beaches, the skies and valleys – will be valued as a something to enjoy as a thing in itself and as a resource to fulfill humanity needs. Nature, with labour, is the co-producer of wealth. The new valuation of nature, which includes ‘compensation to nature’, will influence the compensation to people as producers and workers (as explained earlier).
Social Consciousness, Science and Religion
As the system of production changes, and as material needs are met, a gradual change in people’s consciousness will emerge as material obstacles to the expression of humanity’s goodness are removed.
In all societies, every human being wants to avoid suffering and wants happiness. In a good society, fewer reasons will exist for one to intentionally cause suffering, emotional or physical, to another person. People will contribute to other people’s happiness and reduce their suffering. The relationship among people will be based on compassion and solidarity and not on competition and animosity.
People will not hanker after money, wealth, or possessions as private property. One person will not look at another as a way of making money or accumulating power (e.g., as a source of a vote or political influence) or as a source of status. One person will perceive meeting the needs of another person as one’s own need. Inter-personal relations, including in the most intimate sphere, will be based on a commitment to the democratic rights of all. People will relate to each other in a civil and polite manner.
In the fight against adverse natural conditions or natural calamities, or against people who are exploitative and oppressive, the toiling masses of all countries will be joined by a thread of internationalism. People living in one territory or ‘country’ will develop a sense of solidarity with people living in another place, and will have mutual respect for one another.
People of a country or a region will read about their history as a part of the history of global humanity, and will enjoy and feel proud of the accomplishments of their country or region and be critical of follies committed. And they will do the same with respect to other countries and regions and with respect to the entire humanity. A country’s or territory’s political conduct will not be driven by animosity toward another country or territory.
A good society must promote scientific temper,11 without believing that only science and technology can solve people’s problems. People will be discouraged from holding views about society which are not based in reason and evidence, whether historical or contemporary. They will be encouraged to view things from the scientific standpoint of materialism and dialectics.
Society will increase investment of resources in basic and applied natural sciences and technology. It will build on the scientific accomplishments of humanity and further these accomplishments by separating science and technology from their shell of profit-motive and militarism. Government and society will also make an effort to instill ethical values among scientists who must be sensitive to society’s material and cultural needs.
Neither religion nor the government will decide the content of education. While the state will not influence the content of education, the funding for education will come only from the state (not from private individuals or religious or any other organization).12
Every child will receive free school education. For children over a certain age, education will include direct experience in the workplace, subject to the protection of children’s health and welfare. As well, every adult will be encouraged to pursue higher education. Education will emphasize natural sciences and technology as well as the study of society and its relation to nature, in a way that is scientific and is critical of power relations and inequalities, taking history and the globally interconnected character of humanity seriously.
Along with national parochialism (and sentiments against immigrants), religious identity is important raw material for fascistic tendencies that the new society will guard itself against. As long as there is a need for religion, people should enjoy religious freedom, but within limits: religion, whether it is defined as a way of life or not, will not influence politics or education, or indeed, the public conduct of individuals. Religion must be strictly a private affair. The government should be completely separated from religion and will not practice the ‘socialism of religion’: it will not practice the principle of promoting all religions equally. It will not promote, or be influenced by any religion. No person or group will be judged based on their religion, either within the government or outside. No one will view society’s problems as being caused by differences in people’s religious beliefs and practices.
Society will fight religious obscurantism through scientific education and not through persecution. Whenever there is a conflict between religion and science or between religious values and modern laws that govern the state, the latter will be prioritized.
It is the case that sometimes quasi-scientific ideas are clothed in religious ideas within ancient scriptures. Some of these ideas may have a degree of usefulness. But these ideas, before they can be shared widely and acted on, must go through scientific verification. The mention of an idea in some religious scripture is not the proof of their validity. Even then, the government has no business setting the agenda for scientific research. The scholarly community will have its independence.
Apart from external nature (the natural environment), human beings, who are a part of that nature, have an ‘internal nature’. Human beings tend to possess – suffer from – innate feelings of excessive anxiety, anger, sadness, jealousy, hatred, self-pride, lust, etc., all of which co-exist with numerous good feelings such as love, compassion and solidarity. More or less, human emotions, positive and negative, ingrained in the human brain, are products of the material conditions, including in the class society since slavery, that the humanity has lived under. The new society will not be a perfect society: people will have negative emotions. But the new social order will make available resources for human beings to reduce the impact of these afflictive emotions on the basis of scientific ideas such as brain plasticity, as advanced in, for example, affective neuro-science pioneered by Richard Davidson and others.13 It is interesting that this neuro-scientific research, which has been able to observe the link between afflictive emotions and specific neural responses in the brain, intersects with certain ideas that originally came from world’s major religions such as Buddhism.14
Material conditions where people compete with one another and where their needs remain unmet and where their lives are controlled by physical nature or those who control the social surplus are the most important reason for afflictive emotions. Yet, material deprivation is not the only reason, even if it is the dominant one. We find afflictive emotions in affluent families and individuals. Human beings will have to make an extra effort to weaken the impact of afflictive emotions on their well-being. This effort will be easier in the new society because the force of the adverse material conditions will not exist there.
Politics in the Public and Private Spheres
In a good society, everyone’s democratic right – the right to free speech and assembly, etc. – will be respected, except for a limited period when the democratic right of only those who used to exploit and dominate common people (e.g., owners of big business, big landowners, powerful government officers, etc.) and who might want to return to their previous positions and who might create disorder in the new society, will need to be restricted but in a way that is proportionate to their degree of resistance. No one will have the right or the freedom to appropriate the fruits of another person’s labour.
No one will be discriminated against, whether in the spheres of employment or healthcare or any other sphere, because of their gender, religion, sexuality, ethnicity, caste, location, language, eating habits, and so on. One person will not be allowed to lynch another because that person worships a different god or eats a certain kind of food (beef or whatever) or decides to marry someone of his or own choice. People as workers-citizens will freely debate how to run a cooperative society, one that is without wealthy business-owners and their compliant political friends, and they may even form different types of political parties which reject the right to own private property and to exploit.
The power of politicians and high-level officers will be drastically curtailed as their material compensation will be almost like that received by the vast majority of the people and they may be recalled by the people if they do not perform their service adequately and in the interest of the people. Their role will mainly comprise the work of coordination among different parts of society and the government. They will be subordinated to the people and will not be allowed to behave like kings or wealthy business owners. No member of the family- of big and medium-sized businesses, to the extent that they exist, will be allowed to stand in election or contribute to election funding.
The new society will be judged by how well it treats traditionally oppressed groups such as women, religious, ethnic and racial minorities, and children. In all societies, parents endure suffering in order to ensure the well-being of their children. Such a sense of parental love and sacrifice will permeate the whole of the new society such that the biological parents of a child will also look after the other children in a community/neighborhood. Gradually, children will be looked after by a community of parents and not primarily inside the closed doors of a family.
The nature of the family will change. Sexual relations between two individuals, whether homosexual or heterosexual, will be entirely a private matter and fully democratized. These relations will not be affected by the government or by society, as long as no one’s democratic rights are violated and as long as public health is not endangered. There will be plenty of love and romance, and gradually, jealousy and other negative emotions in love relations will lose their force. Two people will fall in love because they wish to and not because of extraneous conditions (e.g., a person needs to be financially supported by a partner; worries about childcare, inheritance). Conditions for love will be freer, subject to the fact that, once again, love relations should not have adverse impact on the physical and mental health of the partners involved. Men and women will share care work as long as, and to the extent that, they are a part of a household/family.
Conclusion
The pandemic has given humanity a great opportunity to ask fundamental questions about society. For example, why are people’s needs, including the need for good health, not being met? Why are the governments, which are supposed to meet the common needs of society, failing to do their duties, including the duty to save lives? Why is the satisfaction of human need not being prioritized over private profit? These questions, in turn, prompt us to think about what kind of society we would like to live in.
While I discuss above some of the qualities of the new society, my intention is not to suggest that people just fold their hands and wait for such a society to appear. It won’t. People must fight for those good things right now, under, and against, the present conditions. They must fight for de-commodified services such as healthcare, indexed living wages, the democratization of the state, and states’ separation from the influence of moneybags and religion. They must fight to have more and more control over what happens in their workplaces. People should make demands for the things that they need even if the business-owners and their state say that these demands cannot be met.conclusion
La pandémie a donné à l’humanité une excellente occasion de poser des questions fondamentales sur la société. Par exemple, pourquoi les besoins des gens, y compris le besoin d’une bonne santé, ne sont-ils pas satisfaits ? Pourquoi les gouvernements, qui sont censés répondre aux besoins communs de la société, ne font-ils pas leurs devoirs, y compris le devoir de sauver des vies ? Pourquoi la satisfaction de l’homme n’est-elle pas prioritaire par rapport au profit privé ? Ces questions, à leur tour, nous incitent à réfléchir au genre de société dans laquelle nous aimerions vivre.
Bien que je discute ci-dessus quelques-unes des qualités de la nouvelle société, mon intention n’est pas de suggérer que les gens se plient les mains et attendent qu’une telle société apparaisse. Ce ne sera pas le cas. Les gens doivent se battre pour ces bonnes choses en ce moment, dans et contre les conditions actuelles. Ils doivent se battre pour des services dé-marchandifiés tels que les soins de santé, les salaires de subsistance indexés, la démocratisation de l’État et la séparation des États de l’influence des sacs d’argent et de la religion. Ils doivent se battre pour avoir de plus en plus de contrôle sur ce qui se passe sur leur lieu de travail. Les gens devraient demander les choses dont ils ont besoin, même si les propriétaires d’entreprise et leur État disent que ces demandes ne peuvent pas être satisfaites.
Endnotes
1. These statistical data are from www.worldometers.info/coronavirus.
2. Davis, Mike. “The Coronavirus Crisis Is a Monster Fueled by Capitalism.” In these Times. 20 March 2020. Toussaint, E. “The Capitalist Pandemic, Coronavirus and the economic crisis.” CADTM. 19 March 2020.
3. So, the means of production will not be used any more to absorb labour in its abstract form and to maximize the extraction of labour from people to produce more surplus in the form of profit, rent, and interest.
4. In capitalism, the people who do the work of directing engage in despotic control over labourers, subjecting them to oppressive power relations, in order increase exploitation and overcome resistance to that exploitation. “The directing motive… is to extract the greatest possible amount of surplus-value, and consequently to exploit labour-power to the greatest possible extent. As the number of the co-operating labourers increases, so too does their resistance to the domination of capital, and with it, the necessity for capital to overcome this resistance by counterpressure” (Capital Volume One). All these aspects of the labour process will become irrelevant in the new society.
5. Of course, capital will resist this attempt of people to socially regulate production: “The same bourgeois mind which praises division of labour in the workshop, life-long annexation of the labourer to a partial operation, and his complete subjection to capital…, that same bourgeois mind denounces with equal vigour every conscious attempt to socially control and regulate the process of production, as an inroad upon such sacred things as the rights of property, freedom and unrestricted play for the bent of the individual capitalist. It is very characteristic that the enthusiastic apologists of the factory system have nothing more damning to urge against a general organization of the labour of society, than that it would turn all society into one immense factory.” (Capital Volume One)
6. Whether they work will not depend on whether or not they can make money for the business owners.
7. The work-week will be shorter than now, in part because the total work to be done will be shared by those who are currently employed and those who are forced to be under- and un-employed.
8. Possibly, the process will be mediated by limited market relations initially, to some extent.
9. Marx, K. 1875. Critique of the Gotha programme.
10. “The most important division of material and mental labour is the separation of town and country” (Marx and Engels, German Ideology: Progress: Moscow, pp. p 72).
11. Das, R. “The Age of Unreason: The knowledge-practice relation and its political significance.”
12. Education will not be a commodity for sale and purchase nor will it be a tool to spread obscurantism.
13. Goleman, D. and Davidson, R. 2017. Altered traits. Science reveals how meditation changes your mind, brain and body. New York: Penguin.
14. This is why it will be mistaken to automatically believe that all religious ideas serve as “the opium of the people” (Marx, K. 1843. A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right). It must be noted, however, that living a non-alienated new life, a life of solidarity in a society where there is little competition and where people look after themselves will be among the biggest antidotes to afflictive emotions. These antidotes, which are rooted in objective social practice and which will shape human thinking and the human brain, are different from the methods advanced in religious and modern scientific literatures.
Raju J Das teaches radical political economy, international development, state-society relations, and social struggles at York University, Toronto. Das is on the editorial board of Science & Society* and the editorial advisory board of Dialectical Anthropology. His most recent book, published in 2017, is Marxist Class Theory for a skeptical world (Brill, Leiden).Appearing quarterly since 1936, Science & Society is the longest continuously published journal of Marxist scholarship, in any language, in the world.
Science & Society is a peer-reviewed interdisciplinary journal of Marxist scholarship. It publishes original studies in political economy and the economic analysis of contemporary societies; social and political theory; philosophy and methodology of the natural and social sciences; history, labor, ethnic and women's studies; aesthetics, literature and the arts. We especially welcome theoretical and applied research that both breaks new ground in a specific discipline, and is intelligible and useful to non-specialists.
Science & Society does not adhere to any particular school of contemporary Marxist discussion, and does not attempt to define precise boundaries for Marxism. It does encourage respectful attention to the entire Marxist tradition, as well as to cutting-edge tools and concepts from the present-day social science literatures.
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
un entretien qui brasse plus large que ce sujet, mais comme je l'ai ouvert sur son impulsion... L'annonce d'une série de 6 livres : sur l'histoire, la passion du concept (épistémologie théologie et politique), le cosmopolitisme aujourd'hui( la guerre, la traduction, le multiculturalisme) la race et le racisme, le communisme, la critique de l'économie politique aujourd'hui
La Grande table Idées de Raphaël Bourgois, France Culture, 17 février 2020Ce volume – le premier des six recueils qui composent cette série d’Écrits d’Étienne Balibar – réunit des essais et des textes d’intervention à caractère historique, philosophique et politique, pour certains inédits, rédigés entre 1995 et 2019. Ils ont en commun de chercher à éclairer le passage d’un siècle l’autre et d’affronter la question de la « fin de l’histoire », en référence, d’une part, à l’achèvement de la mondialisation capitaliste et, de l’autre, à l’altération de notre environnement biologique et planétaire, qui a atteint le point de non-retour à la fin du XXe siècle mais demeure en partie indéterminé dans ses conséquences sociales et civilisationnelles.
Dans cette perspective, il faut arriver à penser philosophiquement un écart entre des « futurs passés » et des « nécessités contingentes », non pas de façon purement spéculative, mais en combinant d’une façon toujours singulière la mémoire et l’analyse : repérant des traces événementielles déterminantes pour notre institution de la politique (la « Grande Guerre », la révolution d’Octobre, l’insurrection de Mai 68) ; décrivant des frontières essentiellement contestées entre Orient et Occident, Nord et Sud, dans notre espace commun méditerranéen (France-Algérie, Israël-Palestine) ; conjecturant les formes et les objectifs d’une gouvernementalité stratégique, qui devrait se préoccuper simultanément de grandes régulations planétaires institutionnelles et parier sur la capacité d’invention et de rupture des insurrections locales.
Une politique d’après la politique, à laquelle conviendront peut-être encore les noms de démocratie, de socialisme et d’internationalisme.extrait
Avant-propos, Histoire et politique
table des matières
I. Traces : 1914, Octobre 1917, Mai 68
II. Frontières
III. Conjectures, « Un monde sans maître »... Régulations, insurrections, utopies...
Étienne Balibar, né en 1942, philosophe, est professeur émérite à l’université de Paris-X-Nanterre et professeur à l’université de Californie à Irvine. Il est notamment l'auteur de Spinoza et la politique, Les Frontières de la démocratie, Lieux et noms de la vérité, La Philosophie de Marx, La Crainte des masses, Droit de Cité.
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
oui, je sais, c'est un peu osé de verser ce document dans ce sujet... Ma lectorate m'a déjà pardonné
EXTRAORDINARY WORK OF ‘ORDINARY’ PEOPLE:
BEYOND PANDEMICS AND LOCKDOWNS
VIKALP SANGAM, Alternatives India, May 28, 2020 in Perspectives
EXAMPLES, LESSONS, AND SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR COMMUNITIES,
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS, AND GOVERNMENT AGENCIES
READ / DOWNLOAD THE ENTIRE DOCUMENT
BEYOND PANDEMICS AND LOCKDOWNS
VIKALP SANGAM, Alternatives India, May 28, 2020 in Perspectives
EXAMPLES, LESSONS, AND SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR COMMUNITIES,
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS, AND GOVERNMENT AGENCIES
READ / DOWNLOAD THE ENTIRE DOCUMENT
INTRODUCTION: WHY THIS DOCUMENT?
March 2020 onwards, COVID19 pandemic related crises have affected hundreds of millions of people in India. Over 90% of the country’s workforce is in the informal or unorganized sectors, and the vast majority of primary and secondary sector producers are dependent on daily marketing to earn a livelihood. The shutdown of production facilities and the inability to reach markets has meant an immediate loss of livelihoods for them. For migrant workers, there is the additional impact of being stuck away from home, and with the sudden shutdown of public transportation, they have been amongst the worst sufferers. Lack of access to basic needs like food, water, housing and so on, have affected millions.
While the immediate humanitarian crisis is visible and has generated widespread spontaneous initiatives by civil society and by several state governments to provide relief, much less common are attempts to address root causes of the suffering. The COVID crisis has sharply exposed the deep faultlines of Indian economy, society and polity. This includes the extreme vulnerability of producers and workers, and within them of women, Dalits and Adivasis, and others who are already marginalized. It also includes the folly of depending on longdistance exchanges and trade for meeting basic needs. It has shown the deep links between ecological devastation and socio-economic deprivation. Overall, the inequality and unsustainability of predominant models of ‘development’ have been clearly demonstrated.
In such a situation it is vital that not only are immediate relief and rehabilitation measures in place, but simultaneously fundamental rethinking of economic, social, and political approaches takes place. India (like the rest of the world) desperately needs to find alternative pathways of well-being, that help generate dignified livelihoods for all, and that help us move towards ecological sustainability. It needs to facilitate the self-empowerment of communities (rural, rurban, urban), the building of capacity to govern and manage food, health, water, energy, shelter, education, and other basic needs and aspirations in ways that reach towards selfreliance and where possible self-sufficiency.
A movement towards such a society - swaraj in its real sense - is not only theoretical. It is already taking place in hundreds of initiatives across India. In this series of documents we would like to present such examples, from which crucial lessons can be learnt and adapted to achieve similar results elsewhere. We show how each of the major problems faced during COVID19 (all of which have been around for much longer, of course, but are more sharply visible now), has solutions, already demonstrated by communities, civil society, or government agencies somewhere in India.
We invite you to understand and learn from them, and distribute this document in whatever media and language you can. And if you have your own examples that you think others should know about, do pl let us know!
CONTACTS
General coordination: Juhi Pandey, studiojuhi@gmail.com, 9820039110
For facilitation on transferring key lessons from these initiatives to other sites and communities (in addition to the specific contacts provided in each story):
Gijs Spoor, gijs@auroville.org.in, 9943820241 (only WhatsApp/SMS)
Dernière édition par Florage le Sam 27 Juin - 4:37, édité 2 fois
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
V. avec Marx contre Dardot et Laval :
ÊTRE CONTRE LA POLITIQUE, C'EST ÊTRE CONTRE L'ÉTAT
et réciproquement
en présentant ce sujet, qui m'avait été suggéré par les réflexions d'Étienne Balibar en relation avec la notion de Commun(s), j'avais averti que nous allions nous heurter à un problème avec la vision de Dardot et Laval dans Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle. Un problème avec nous-mêmes vu ce que j'en avais dit quand il est paru en 2014
le texte ci-dessous résume l'idée centrale de ce livre concernant le rapport de Marx et la politique. On y voit que pour s'en tirer, les deux auteurs opèrent une révision de Marx, ou du moins ne retiennent pas le processus révolutionnaire comme anti-politique, ce qui est notre position. Globalement c'est une conception plutôt réformiste de l'alternative révolutionnaire sans révolution, opposée à la nôtre comme à celle d'Inversion de Jacques Camatte, qui nous semble plus profonde et plus radicale que la révolution des marxistes
cela posé, ce sujet peut être considéré comme plus concret, tourné vers le processus d'avenir davantage que son hypothétique enracinement dans le passé lointain de la séparation entre humanité et nature. Voir mes échanges avec Adé dans CAMATTE et NOUS
quoi qu'il en soit ce texte de Dardot et Laval est très intéressant par la clarté de son exposition du problème, même s'ils ne voient pas la même solution historique, et en attendant la même résolution théorique
Présentation du dossier « Marx politique »
Pierre Dardot, Christian Laval
Cités 2014/3 (n° 59), pages 11 à 18

Pierre Dardot, Christian Laval
Cités 2014/3 (n° 59), pages 11 à 18

1
Le lien entre Marx et politique semble évident. Qui peut ignorer qu’il lui a consacré sa vie et son œuvre ? Quel sens alors y a-t-il à parler de « Marx politique » si le nom de Marx contient d’emblée la dimension politique, mieux s’il n’a pas de sens hors de la politique ? Une question se pose pourtant : que faut-il entendre par « politique » quand il s’agit de la pensée de Marx ? Et là rien n’est plus aussi simple qu’il y paraît à première vue.
2
On observe d’abord qu’une certaine habitude a été prise qui n’en fait qu’un aspect ou une partie de l’œuvre. C’est par exemple le cas dans les éditions de ses œuvres ou dans la répartition disciplinaire des commentaires et des présentations. Mais faut-il continuer à croire, comme le suggérait Maximilien Rubel dans son édition de la Pléiade, que l’on peut aisément distribuer les textes marxiens entre l’Économie, la Philosophie et la Politique ? Et si l’on considère le destin académique de Marx, devrait-on vraiment isoler un « Marx politique » du Marx des économistes, du Marx des philosophes, voire du Marx des sociologues ? [remarque à laquelle je souscris, rejoignant nombre de marxologues]
3
Nous proposons ici de considérer, sous des angles différents, une pensée entièrement politique, mais en un sens précis : que la « matière » qu’elle traite soit philosophique, économique, juridique ou sociologique, il n’y est jamais question que d’une seule chose, ou plutôt d’une seule cause : celle de la révolution en vue de l’émancipation humaine. Il convient alors de se demander comment cette finalité de l’émancipation par la révolution affecte chez Marx la conception même qu’il se fait de la politique, et en quoi cette conception peut nous concerner dans notre rapport à la politique aujourd’hui. [c'est en somme ce déterminisme d'"une seule solution, la révolution", qui pose problème chez Marx comme dans la théorie de la communisation, nonobstant leur conception différente]
Penser la praxis révolutionnaire
4
Le problème théorique et pratique de la révolution émancipatrice est ce qu’il reste de plus singulier et de plus tranchant dans la pensée de Marx. C’est cette perspective révolutionnaire qui commande chez lui l’analyse des conjonctures politiques, c’est elle qui est à l’horizon de la dynamique capitaliste et de ses crises, c’est encore elle qui oriente la conception qu’il se fait des pratiques et des luttes du mouvement ouvrier. [même remarque]C’est évidemment elle encore qui est au principe de ses engagements et au centre même de sa vie. Comme le remarquait Lacan, la révolution pour Marx a été, avec la crise économique, le « symptôme » par lequel se disait la vérité de la société et à partir duquel il a voulu élaborer une nouvelle science de l’histoire.
5
D’un côté, Marx pense le passage du capitalisme au mode de production supérieur qui doit lui succéder à partir d’une symétrie rigoureuse entre le rapport du présent au passé et le rapport du présent à l’avenir : les présuppositions du nouveau mode de production se constituent de l’intérieur de l’ancien, tout comme celles du capitalisme se sont constituées de l’intérieur du féodalisme [le terme de "symétrie" me semble fort, et quant au font, il n'y a rien là que de très matérialiste et dialectique]. D’un autre côté, il pense la révolution de l’avenir, qu’il appelle de ses vœux, qu’il prépare activement, dont il prédit imprudemment l’imminence, comme une rupture radicale avec toutes les révolutions qui ont précédé dans l’histoire de l’humanité : il y a chez Marx un côté « révolution dans la révolution ». Alors que toutes les révolutions jusque-là ont été avant tout des révolutions politiques, limitées et unilatérales, la révolution prolétarienne est absolument nouvelle en ce qu’elle est sociale et non purement politique. Mais Marx rencontre à tout moment la difficulté d’articuler une conception évolutionniste des modes de production et une conception de la révolution comme irruption consciente de l’absolument nouveau, difficulté qui ne fait qu’exprimer à sa manière la tension centrale de sa pensée.
La tension centrale
6
L’exégèse a longtemps voulu voir l’unité de sa pensée dans la convergence entre des tendances objectives du capitalisme et un mûrissement de la conscience des prolétaires, peu à peu avertis par leurs expériences des buts qu’ils doivent atteindre en tant que classe. Or, cette convergence, en réalité imposée par l’idée d’une finalité communiste de l’histoire humaine, est fort problématique chez Marx lui-même. Sa pensée cherche à articuler deux perspectives très différentes. La première est la logique du capital comme système achevé, perspective qui relève d’un effort qui se veut proprement scientifique. Elle consiste à dégager le mouvement par lequel le capital « se subordonne tous les éléments de la société » et le « jeu des lois immanentes de la production capitaliste » qui conduit le « système organique » du capitalisme à accoucher nécessairement d’un nouveau mode de production [1] [même remarque sur le processus dialectique, qu'on le nomme Aufhebung, abolition ou dépassement]
D’un autre côté, la dynamique révolutionnaire du prolétariat se développe au travers des luttes aux issues contingentes sans dépendre strictement des conjonctures économiques ou des niveaux de développement des forces productives [si la dépendance n'est pas "stricte", pure "implication réciproque" structuraliste, elle existe bel et bien]. La classe révolutionnaire se constitue alors elle-même dans l’affrontement qui l’oppose à la bourgeoisie, elle se fait dans la pratique révolutionnaire [notons que c'est la définition d'une classe comme révolutionnaire, car ne l'étant pas en soi, il faut qu'elle se constitue comme telle]. En somme, s’il tient les deux fils dans tous ces textes, Marx ne peut les concilier que par la croyance dans l’avènement inéluctable [oui] d’une société supérieure, croyance qui fonctionne comme une « colle imaginaire » permettant de souder les deux logiques ["colle imaginaire" que l'on retrouve dans le "syllogisme du prolétariat" de Théorie Communiste, Charrier 2003]. L’affirmation de la nécessité du passage au communisme sous-tend toute la démarche de Marx. La révolution, qui paraît pourtant si contingente sur le théâtre des affrontements, ne cesse de se réapparaître comme processus naturel, comme gestation et délivrance selon la métaphore obsédante que l’on retrouve partout dans les écrits de Marx, des écrits de jeunesse jusqu’au Capital. [il y a effectivement ce déterminisme chez Marx, que l'on retrouve dans la théorie de la communisation, même si le contenu de la Révolution est différent, abolition directe des classes par le prolétariat, sans étape intermédiaire de prise de pouvoir, "dictature" ou "autogestion"]
La politique : entre disparition et redéfinition
7
Cette tension rejaillit sur la conception que Marx se fait de la politique. Si la révolution est sociale, et pas simplement « politique », c’est qu’elle doit bouleverser les rapports sociaux eux-mêmes, qu’elle doit changer radicalement la manière dont s’organise la division du travail, la façon dont les classes entrent en relation pour produire les conditions de la vie. Jusque-là, explique Marx, la révolution a visé le but étroit de « l’émancipation politique ». Il s’agit maintenant de tout autre chose : de l’émancipation humaine intégrale, laquelle suppose dépassement du capitalisme et abolition de l’État. Marx, en disciple de Saint-Simon, a une propension marquée à identifier la politique et l’étatique, et par là à rejeter la politique dans la préhistoire humaine [identifier la politique et l'étatique, c'est dans l'optique de ce sujet ce que je fais aussi]. La révolution sociale est non seulement renversement de la classe dominante, elle est aussi insurrection de la société contre l’État. En ce sens, on peut dire que la révolution est à la fois politique parce que dirigée contre l’État mais qu’elle est aussi et surtout anti-politique parce qu’en s’attaquant à l’État, elle rend à la société ses propres forces confisquées par la bureaucratie. La représentation qu’il donne des buts révolutionnaires ne manque pas de frapper par sa double radicalité : « La classe laborieuse substituera, dans le cours de son développement, à l’ancienne société civile une association qui exclura les classes et leur antagonisme, et il n’y aura plus de pouvoir politique proprement dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l’antagonisme dans la société civile. » [5]
8
Il y a là évidemment une ambiguïté remarquable qui n’a pas manqué de retentir dans tous les marxismes de la fin du XIXe et du XXe siècles. S’agirait-il de réorganiser la société sur un modèle industriel, autour d’un centre coordonnateur seul apte à développer rationnellement les forces productives ? Marx et Engels ont fait dangereusement leur le mot d’ordre saint-simonien selon lequel l’avenir était au remplacement du « gouvernement des hommes » par l’« administration des choses ». En ce sens, la politique comme activité délibérative disparaît purement et simplement au profit de la gestion économique rationalisée. Mais d’un autre côté, n’ont-ils pas développé une tout autre idée de la politique regardée comme autogouvernement des hommes et ceci dans toutes les sphères de leur activité, en particulier dans le domaine économique ? L’avenir de la politique alors n’est pas dans sa dissolution dans l’administration, voire dans l’auto-gestion, il est plutôt dans l’extension de ce qu’Aristote – grande référence de Marx –, appelait la « mise en commun des paroles et des actions ». [je ne peux évidemment pas retenir ce glissement fortement réformiste, puisqu'il aboutit purement et simplement à conserver l'État et la politique]
La « politique de Marx » aujourd’hui
9
Nul n’ignore que l’effacement de la révolution, au sens où Marx pouvait l’entendre du moins, caractérise la réflexion politique dominante de ces dernières décennies. La révolution est devenue « l’objet perdu » de la politique. Beaucoup de ceux qui prétendent penser la politique sont prêts à admettre que le capitalisme, avec la brutalité retrouvée de ses origines, a fait retour un peu partout, et même à accepter de voir dans le néolibéralisme la grande revanche des riches sur les pauvres, ils ne parviennent plus vraiment à penser aujourd’hui l’avenir sur le mode d’une rupture révolutionnaire débouchant sur une nouvelle société et un nouveau système de production comme cela a été le cas jusque dans les années 70. Pour le dire autrement, même si une partie des intellectuels actuels peut reconnaître une certaine pertinence à la sociologie de Marx, à sa théorie des classes ou de l’État, et surtout à sa critique du capitalisme, il lui est pratiquement devenu impossible de penser les transformations historiques et leur inscription dans la logique de la révolution. [je suis plutôt d'accord, voir CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION. On ne peut même pas dire que les théoriciens de la communisation parviennent véritablement à penser la révolution, prolétarienne selon eux : ils la compensent en la présupposant dans le syllogisme du prolétariat révolutionnaire]
10
Et pourtant, dira-t-on, de « révolution », il n’est question que de cela. Mais, dira-t-on encore, ce n’est plus la même. Depuis trente ans, de « révolutions libérales » en « révolutions conservatrices » ou en « révolutions islamistes », il semble qu’on en soit revenu à une signification « astronomique » de la révolution, c’est-à-dire à un « retour aux origines », au plus loin donc du sens que Marx donnait aux progrès dialectiques des sociétés. La perte de l’idée de la révolution comme rupture fondatrice de nouveauté, si on l’admet définitive, conduirait alors à ce que la « politique de Marx » ne puisse plus s’entendre que dans un sens faible, comme un écho très assourdi de la grande critique radicale du capitalisme qu’il avait mise en œuvre. [ce point de vue est assez différent de celui d'Isabelle Garo, qui s'évertue à montrer l'actualité de la politique chez Marx en un sens nettement plus démocratique radical, hérité de Lucien Sève et ses considérations sur la démocratie]
11
S’il est sans doute vain de vouloir à tout prix prolonger ce qui appartient à une époque révolue, il serait tout aussi risqué de pronostiquer, comme l’avait fait François Furet, la fin de tout horizon révolutionnaire [6]
Les conséquences insupportables du capitalisme, les impasses dans lesquelles il conduit l’humanité par sa logique prédatrice et destructrice, nous font obligation de repenser l’alternative politique pour le XXIe siècle. En ce sens, renouer avec la « politique de Marx », ce n’est pas rester accroché à un ensemble de dogmes, c’est réinventer une nouvelle idée de la révolution et de l’émancipation.
Notes
[1]
Cf. K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, tome I, Paris, Éditions sociales, 1980, pp. 219 et 220.
[2]
Cf. Les analyses de Marx dans Les luttes de classes en France, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, La Guerre civile en France.
[3]
K. Marx, L’Idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 64 (nous retraduisons et soulignons).
[4]
L’Idéologie allemande, op. cit., p. 90 (nous traduisons).
[5]
K. Marx, Misère de la philosophie, Œuvres I, La Pléiade, Paris, Nrf Gallimard, 1963, p.136.
[6]
François Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris, Livre de poche, 1996, pp. 808-809.
Dernière édition par Florage le Sam 27 Juin - 4:39, édité 1 fois
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
VI. contre Jean-Pierre Vincent
L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
n'est pas la politique par le bas
trouvé sur le site consacré au philosophe Jean-Marie Vincent (1934-2004), qui avait été à l'origine de la création en 1990 de Futur Antérieur, revue théorique, avec Antonio Negri et Denis Berger
on est là dans une autre perspective que celle dans laquelle je me suis placé. Plutôt que séparer l'État comme pouvoir politique de l'administration des choses, Vincent revalorise le politique, càd les principes et la pratique du pouvoir de décisions pour toute la société, en prônant « l'hégémonie » du « biopolitique par le bas », autrement dit une forme de démocratie radicale, qui est pour lui « l'aboutissement de luttes qui inscrivent déjà dans la réalité un autre type d’État, un État en voie de dépérissement grâce à la réinvention de la politique. »
une critique intéressante d'une aporie chez les théoriciens des Conseils, impensé que l'on retrouve dans la théorie de la communisation qui ne se préoccupe pas de choses aussi matérielles et communes. Sur le plan théorique, c'est plus surprenant depuis les années 1970 qu'à l'époque des conseillistes, dans un capitalisme en subsomption réelle supposé dominer tous les rapports sociaux, sociétaux et à la nature, que les prolétaires sortis des usines, ou sans réserves n'y étant jamais entrés, seraient seuls à pouvoir prendre en charge de façon révolutionnaire. Mais ces théoriciens étriqués ne sont pas à une aporie près, puisque leur schéma révolutionnaire comme leurs méthodes sectaires reposent sur l'expulsion des problèmes qu'ils ne veulent pas se poser, parce que leur théorie ne peut pas les poser
pour le reste, et malgré le fait que Jean-Marie Vincent ait fait preuve d'une réelle originalité relativement aux autres théoriciens marxistes français, notamment avec Critique du travail en 1987, ce texte est très daté, et s'inscrit, en 2003, dans la période faste du démocratisme radical
je souligne en gras
Dépérissement de l’État et émancipation sociale
Contretemps n° 3, p. 94-104, février 2002
Contretemps n° 3, p. 94-104, février 2002
La thématique de l’émancipation sociale est inséparable chez Marx de la thématique du dépérissement de l’État. Mais la notion même de dépérissement de l’État est loin d’être claire. S’agit-il d’une marche vers la suppression de l’État ? S’agit-il d’une transformation des organes et des modes de fonctionnement de l’État ? Il n’y a pas de réponses univoques à ces questions dans les textes de Marx, pas plus qu’il n’y a de théorisations élaborées à ce propos.
Si l’on veut bien y réfléchir, cela ne devrait pas trop étonner, étant donné les incertitudes de Marx sur les analyses à faire de l’État. On remarque bien que selon lui l’État est lié aux rapports sociaux, mais la nature des liens, liens avec l’économie, rapports juridiques, rapports idéologiques, etc., est loin d’être toujours cernée de près. Il y a d’ailleurs une sorte de point aveugle dans les développements marxiens : les rapports entre le pouvoir d’État et les pouvoirs dans la société. Même si l’État est donné comme un instrument ou un ensemble d’instruments pour défendre l’ordre social, il apparaît comme une réalité spécifique s’élevant au-dessus de la société dans toute une série de textes marxiens. La question de l’articulation entre les dispositifs et institutions étatiques d’un côté et les dispositifs de pouvoir dans les rapports sociaux d’un autre côté est ainsi évitée.
C’est ce qui explique sans doute que l’État ne puisse dans ce cadre être saisi comme un ensemble d’institutions qui verrouille les rapports de pouvoir dans la société et permet leur reproduction dynamique. L’État n’est pas une réalité statique, il régule la répartition et la circulation des pouvoirs de façon à rendre possibles les mouvements de la valorisation dans leurs variations incessantes. Il contient, voire réprime, les pouvoirs de mobilisation et de coopération venant d’en bas. Par contre il favorise de mille manières les pouvoirs de coercition et d’orientation des fonctionnaires du capital et des forces dominantes dans la valorisation. Pour cela, il joue, bien sûr, sur la violence physique directe, mais plus encore sur la violence impersonnelle des mécanismes économiques (régulation des marchés, de la circulation des capitaux, de la vente de la force de travail, etc.). Il ne fait pas qu’assurer les conditions générales de la vie en société, son activité vise spécifiquement à équilibrer des échanges sociaux dominés par la valorisation capitaliste. C’est particulièrement prégnant dans son rôle de garant et de gardien de la monétarisation des relations sociales (qui n’est pas contradictoire avec l’internationalisation d’une partie des relations monétaires). La monétarisation des relations sociales est en effet indispensable à l’accumulation du capital, au devenir abstrait de la prestation de travail et aux luttes concurrentielles entre les individus qui se valorisent les uns contre les autres.
La réglementation juridique, apparemment, déroge à ce tableau, en faisant des individus des sujets titulaires de droits et égaux devant la loi. Mais tout cela renvoie à une notion d’égalité des chances qui efface les disparités entre capital et travail et ne veut connaître dans les inégalités économiques que des inégalités fondées sur des utilisations plus ou moins judicieuses des capacités de travail des uns et des autres. En réalité, les inégalités juridiques, au-delà du formalisme, sont très nombreuses : inégalités dans l’accès à la protection juridique, inégalités devant les sanctions des violations du droit. En définitive, le droit qui s’applique et que les tribunaux pratiquent est un droit de la discrimination, de la ségrégation qui stigmatise et punit de façon récurrente et systématique les couches les plus faibles de la société. Les tribunaux en remplissant les prisons reconstituent sans discontinuer une sorte d’enfer social qui sert de repoussoir, un lieu où vont se perdre tous ceux qui n’ont pas su ou voulu s’adapter à la lutte pour la valorisation. En ce sens, le droit est autant violence organisée et systématique qu’endiguement de la violence venant des rapports sociaux. On peut faire des considérations du même ordre à propos de la représentation politique et des mécanismes démocratiques. Ils sont censés permettre l’expression de la souveraineté populaire et une mise sous surveillance par la masse des citoyens des institutions étatiques les plus essentielles. À y regarder de plus près, on constate toutefois que les modalités de la représentation politique se plient elles aussi aux lois de la valorisation. Les débats politiques portent pour une large part sur la façon de se soumettre aux lois (décrétées intangibles) de l’économie. Depuis les années quatre-vingt, il est d’ailleurs question de voir quelles nuances on peut trouver entre les avis des experts et comment on peut se préparer à l’inévitable. Certes, il subsiste des domaines où la pression du capital se fait moins sentir, mais cela ne veut pas dire pour autant que la grande masse des représentants peut faire entendre sa voix. La participation à la politique, même sous une forme modeste, exige des prestations culturelles, financières, des investissements en temps dont beaucoup sont incapables. La citoyenneté est en conséquence organisée de façon inégalitaire et ce mode d’organisation produit de plus en plus d’éloignement par rapport à la politique.
La politique est en permanence menacée par l’évidement des contenus, par des simulacres d’affrontements. C’est donc tout à fait logiquement que les couches dominantes recourent au marketing, à la production massive de mises en scène spectaculaires qui masquent les véritables enjeux sociaux. À partir de là, l’État peut à peu de frais renouveler sa propre mise en scène en la démultipliant en autant de mises en scène successives : celles de l’État soucieux du bien-être général, celle de l’État qui organise son propre affaiblissement pour faire reculer les proliférations bureaucratiques, celle de l’État qui fait reculer l’insécurité et la violence, celle de l’État qui appuie les entreprises dans la guerre économique internationale, celle de l’État qui endigue les migrations, etc. Il trouve toujours ce faisant une oreille complaisante dans le système des médias qui amplifie ses discours et sa violence symbolique en leur donnant un statut d’hyperréalité. État et médias s’appuient réciproquement pour mettre en tutelle l’espace public et l’essentiel des formes politiques. Cela ne veut évidemment pas dire que des mouvements d’opinion opposés aux discours et aux pratiques dominantes soient impossibles, mais cela veut dire que tout est mis en œuvre pour les faire apparaître comme irréalistes et non pertinents ou comme incapables de bien formuler des problèmes réels. Les institutions étatiques, dans leurs pratiques, réaffirment à tout moment qu’il y a un ordre des choses qu’il faut reconnaître, qu’il y a aussi un ordre symbolique qu’on ne peut remettre en question sans semer le trouble et sans s’exposer à des démentis cinglants de la réalité. C’est d’ailleurs pourquoi elles se doivent de jouer sur des dispositifs d’alerte et de surveillance chargés de prévenir ou de signaler les dérapages dans tous les secteurs de la société.
Manifestement l’État, loin de dépérir comme le disent certains, est plus présent que jamais. Il s’instille dans tous les rapports sociaux pour signifier qu’ils ne peuvent et ne doivent pas être dépassés. Il fragmente les groupes sociaux en ordonnant de façon différentielle des espaces et temporalités en fonction des données de la valorisation. Il ne se contente pas d’agir par en haut, il verrouille à tous les niveaux, de la macro à la microphysique du pouvoir. Il délimite des champs d’action, organise des relations d’autonomie pour certaines couches privilégiées et des relations de dépendance pour d’autres. Il se ramifie dans la société, comme une sorte de réalité protéiforme qu’on ne peut identifier à une sorte de volonté unique, mais qui obéit à une logique sociale cohérente : soumettre les pratiques et les formes de vie aux machineries du capital et des bureaucraties publiques. La comparaison de l’État avec une machine ou avec une entreprise est donc trompeuse. Elle présuppose trop facilement que l’unité de l’État (et des institutions étatiques) est une donnée primaire alors qu’elle est une résultante de son fonctionnement, de convergences qui se font jour au besoin à travers des contradictions, à travers l’absorption de poussées sociales divergentes. Ainsi a fortiori doit-on se dire que la dynamique étatique n’est pas réductible à la volonté d’une classe dominante agissant comme une sorte de sujet historique conscient. L’État fait bien sentir à la masse des citoyens-administrés la pesanteur régalienne de la souveraineté, il ne s’incarne ni dans un souverain, ni dans un parti qui serait le prince moderne. En tant que puissance d’oppression, il est surtout enfermement des pratiques, limitation de l’horizon social, reproduction de méconnaissances sur la société. Ces aspects de l’État sont souvent ignorés, parce que ce dernier a une double face, la face régalienne, mais aussi la face d’unité de survie, pour reprendre la terminologie de Norbert Elias. Les institutions étatiques remplissent effectivement un rôle non négligeable dans la reproduction des individus et de leurs conditions d’existence par-delà la reproduction des rapports sociaux et des classes. Il suffit de mentionner l’importance des politiques publiques en matière d’infrastructures, en matière d’hygiène et de santé publique, de logement social, de systèmes de formation, de transports publics et de communications, etc., pour s’en convaincre. L’État, comme le dit Michel Foucault, fait de la biopolitique, agit sur les esprits et sur les corps pour qu’ils soient à même d’occuper leurs places dans les relations et la production sociales. Cela veut dire que certaines institutions étatiques (par exemple, l’Assistance publique en France) sont absolument indispensables pour l’existence quotidienne des individus. Il ne peut y avoir de vie au sens moderne du terme sans les activités interdépendantes d’administrations publiques soucieuses de faire face aux occurrences négatives dans la vie des individus et des groupes ainsi qu’aux problèmes de la reproduction biologique. Cela donne à l’État les apparences de défenseur du bien commun, d’instance socialement neutre. Il ne faut toutefois pas s’y laisser prendre : les vies que l’État s’efforce de conditionner et de promouvoir ne sont pas n’importe quelles vies. Ce sont en fait des vies qu’il s’agit de façonner pour en faire des matériaux pour la valorisation, des vies qui sont traitées en fonction des places qu’elles occupent dans les mouvements de marchandisation universelle.
C’est pourquoi, si l’État a bien une double face, il n’a pas pour autant une double nature. Les activités de type régalien ne sont pas séparées de la biopolitique par une muraille de Chine, elles se compénètrent au point qu’il est souvent difficile de les distinguer. Les techniques de dénombrement, de recensement, de classement, d’établissement de banques de données qui servent beaucoup en biopolitique peuvent facilement être utilisées pour mettre au point des dispositifs disciplinaires et des dispositifs de surveillance et effectuer des tâches de police. Tout cela a été fortement occulté de la fin du XIXe siècle jusqu’à la seconde moitié du XXe par ce qu’on peut appeler les grands récits nationaux, ces mythologies reposant sur la dénonciation d’ennemis extérieurs toujours menaçants. Aujourd’hui ces grands récits sont plus ou moins usés, mais les États cherchent à les remplacer par des dénonciations des dangers qui naissent des migrations économiques et des fondamentalismes suscités par la mondialisation. Le village planétaire est plein de dangers qu’il faut conjurer en organisant des zones de sécurité qui laissent en situation d’extériorité, voire de relégation, tous ceux qui n’intéressent pas la valorisation internationale du capital. Sous des formes modifiées, l’État national des pays dominants reprend une tradition capitaliste multiséculaire. Certes, il n’est plus question de conquêtes territoriales, mais de modalités très efficaces de subordination d’États faibles, de déstructuration de rapports sociaux et de désorganisation économique. De ce point de vue, les États nationaux dominants ne sont plus dans les rapports belliqueux qu’ils entretenaient à l’époque de l’impérialisme classique. Ils ont entre eux des rapports de vive concurrence fiscale, financière et économique, mais, en même temps, sous la houlette américaine, des rapports de coopération et de collaboration pour mettre au pas les trouble-fête. Ils sont les garants d’un ordre mondial qui prétend faire progresser des rapports humanisés (rhétorique des droits de l’homme) tout en semant le désordre et les guerres (voir la mise à feu et à sang de l’Afrique).
Il est donc tout à fait justifié de lier l’émancipation sociale au dépérissement de l’État. Toutefois, les analyses qu’on vient de faire n’indiquent pas par elles-mêmes les voies qu’il faut emprunter. Tout au plus font-elles toucher du doigt l’inadéquation de certaines notions telles que dictature du prolétariat, conquête du pouvoir, qui laissent complètement dans l’ombre le problème des rapports entre l’État et les pouvoirs répandus dans la société. Très tenace, il y a l’illusion qu’on peut s’emparer de la machine étatique et la faire servir pour des objectifs qui n’ont jamais été les siens, un peu comme s’il suffisait de changer les hommes au sommet pour amorcer la transformation sociale. Engels dans l’Anti-Dühring ne dit-il pas que l’étatisation des moyens de production est un premier pas vers le dépérissement de l’État ! Il est vrai que parallèlement à la conception de la prise du pouvoir d’État on a vu se développer des conceptions sur des pouvoirs venant d’en bas, les conseils. Mais le moins qu’on puisse dire est que les théoriciens des conseils n’ont pratiquement jamais abordé la question de l’articulation des pouvoirs dans la globalité des rapports sociaux. Leurs regards étaient surtout tournés vers les entreprises, considérées comme le lieu par excellence où tout se nouait et se dénouait. Ils étaient ainsi incapables de mesurer l’intrication, l’enchevêtrement des rapports économiques et des rapports de travail avec les autres rapports dans un cadre dominé par la valorisation. Implicitement, les travailleurs salariés de la grande industrie étaient supposés disposer potentiellement de tous les moyens nécessaires pour bouleverser les pratiques sociales. Pour actualiser ces potentialités, il devait suffire qu’ils soient débarrassés de directions d’entreprises intéressées seulement pars la plus-value et le profit.
Sur cette base, le bas et le haut des systèmes de pouvoir, leur extension et leurs ramifications horizontales, les caractéristiques de leur fonctionnement ne peuvent en conséquence être vraiment analysées. À partir de telles prémisses, il est, bien sûr, impossible de se poser la question du déverrouillage des rapports de pouvoir dans la société par le déverrouillage de l’État. Il est tentant à partir de tels impensés de recourir à des coups de force théoriques [sic]. Cela vaut en particulier sur la question de la violence. Dans la tradition sociale-démocrate, elle est essentiellement saisie comme quelque chose de négatif, comme un mal parfois nécessaire, mais qui la plupart du temps empêche l’expression démocratique et une véritable pacification de la société. Pour la tradition communiste, la violence est un moyen, une technique pour modifier définitivement les rapports de force en faveur de la classe ouvrière. Elle ne se pose absolument pas la question des déterminants sociaux de la violence, comme si cette dernière était intemporelle et transhistorique, comme si elle n’avait pas des fonctions spécifiques dans la société capitaliste. Les deux traditions sont, par suite, incapables d’opposer à la violence produite par les rapports sociaux une contre-violence qui se fixe clairement pour objectif d’éradiquer la violence ordinaire banale des relations sociales capitalistes, mais aussi le potentiel de négation de l’humain qui ne demande qu’à éclater dans les situations de crise ou d’exception. Cette contre-violence ne peut évidemment se limiter à la dénonciation de la violence en général. Elle doit se faire pratiques multiples pour contrer les multiples formes de la violence et l’alchimie particulière qui les unit et les cimente.
Dans ce domaine, la première tâche est d’arracher à la violence de la société capitaliste son masque de normalité et d’irrésistibilité. Elle est en effet au premier chef violence symbolique pour dire la « naturalité » de la violence impersonnelle, anonyme des appareils et des dispositifs de la valorisation, de la violence systématisée des appareils étatiques et juridiques, de la violence organisée des rapports de travail. Cette violence symbolique est d’autant plus forte qu’elle s’appuie sur une violence symbolique plus insidieuse, moins directement perceptible, la violence du monde enchanté de la marchandise, de ces choses sociales qui donnent une touche de normalité, d’évidence aux mouvements de la valorisation. En produisant et en consommant des marchandises, on ne s’interroge pas sur ce que l’on est et à quels types de rapports sociaux on participe. La dialectique entre individus et rapports sociaux, entre individuation et socialisation est comme gommée. Il n’y a plus que l’homme en général, transhistorique, et des rapports sociaux qui ne sont que des combinaisons d’interactions. On ne peut plus voir les violences que les individus s’infligent à eux-mêmes pour résister à l’ubiquité de la violence et pour s’affirmer dans la concurrence. Il faut être dur avec soi-même pour pouvoir être dur avec les autres.
En fonction de cette structuration pratico-symbolique, les rapports de pouvoir, sous le dehors d’une grande mobilité des individus qui occupent les positions de pouvoir, sont fondamentalement rigides. Les fonctionnaires du capital (les capitalistes), les privilégiés de la fortune, les élites de la bureaucratie et de la politique peuvent se servir de la pression permanente des mouvements de la valorisation ainsi que de la répartition asymétrique des positions d’autorité pour s’assurer de l’essentiel des décisions d’orientation des actions et des pratiques. Les élites disposent en outre pour affirmer leur prééminence de savoirs efficaces dans l’établissement de rapports de domination et de contrôle des flux d’information. Elles veillent jalousement à ce que les sphères d’autonomie des dominés et des exploités ne puissent pas trop s’étendre. Cela vaut en particulier pour les rapports de travail où les procédures managériales contribuent à dépouiller les travailleurs des puissances intellectuelles et sociales de la production en les séparant les uns des autres. La permanence de la hiérarchisation des pouvoirs n’implique toutefois pas l’immobilisme. Il y a des déplacements incessants de la division du travail sociale et de la structuration en classes. L’équilibre des pouvoirs est dynamique et donne l’impression qu’il y a circulation dans les rapports sociaux. En fait, cette circulation ne concerne que des secteurs limités de la société, les autres étant, eux, confrontés à de nouvelles formes d’impuissance et à de nouvelles difficultés pour formuler des perspectives d’action. La multiplicité des échanges de marchandises, la diversité des images médiatiques du monde et de la société ne doivent pas cacher que les échanges sociaux sont unilatéralement polarisés par la valorisation et par l’attraction qu’elle exerce sur les codes symboliques.
Loin d’être de purs rapports de force, les pouvoirs sont donc des réalités transversales, au croisement de multiples facteurs, quoique surdéterminés, et encastrés les uns dans les autres par l’omniprésence de la valeur, de la marchandise et du capital. La contre-violence qu’il faut leur opposer doit être à la fois production de contre-pouvoirs, contre-valorisation et libération symbolique. Cela présuppose, bien entendu, un renouvellement complet de la politique, puisque celle-ci, telle qu’elle est pratiquée dans la société actuelle, accepte la répartition et la structuration des pouvoirs dans les rapports sociaux comme quelque chose d’intangible. Le premier pas à franchir, pour aller dans ce sens, est de rejeter l’économisme, c’est-à-dire la soumission aux impératifs de l’économie et l’acceptation de la logique économique capitaliste comme logique sociale fondamentale. C’est en effet à partir de cette logique économique que se constituent et s’organisent les relations de pouvoir bien au-delà de la sphère économique proprement dite. On pourrait, bien sûr, objecter, et beaucoup le font, que les rapports sociaux sont des créations culturelles au sens large du terme et que culture et science prennent de plus en plus de place dans la vie contemporaine.
Mais il est facile de réfuter ce genre d’objections en renvoyant tout simplement à la marchandisation de la culture sous ses différentes formes. Les pouvoirs culturels sont largement dominés par les pouvoirs médiatiques et les productions culturelles sont de plus en plus dépendantes des débouchés marchands qu’elles peuvent trouver. Les universités elles-mêmes sont de plus en plus soumises à des procédures d’évaluation qui privilégient la production de savoirs rentables, et de diplômés pour la vie professionnelle et l’absence de distance critique par rapport aux mécanismes de la valorisation.
Tout aussi forte est l’empreinte économiste du capital sur un domaine lui aussi apparemment éloigné de l’économie : la sexualité. Au centre de ce qui est un véritable dispositif de biopouvoir, il y a la transformation du corps des femmes en marchandise consommable sous de multiples formes, vecteur d’une transformation plus générale de la vie en matériau exploitable et périssable. Malgré certaines conquêtes récentes (contraception, avortement), les femmes sont en outre soumises à une division sexuelle du travail particulièrement lourde. Elles doivent être simultanément force de travail domestique, force de travail sexuelle, force d’élevage. Même si les formes traditionnelles du patriarcat sont en déclin, les femmes sont largement prisonnières d’un univers féminin (système de différences sociales « naturalisées » avec les hommes) qui consacre leur infériorité par rapport à un univers masculin supérieur. Leur situation symbolise très bien que la valorisation est aussi dévalorisation, clivages sans cesse renouvelés entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Les femmes sont les premières à souffrir de la fragmentation sociale, de luttes concurrentielles où elles ont moins de moyens. Au-delà des combats pour la reconnaissance de leurs droits, les femmes sont en conséquence porteuses au moins virtuellement d’autres vues sur l’agencement des pouvoirs et sur les liens sociaux.
Il y a là un atout considérable dans le combat pour la transformation de la politique. Plus précisément, on peut y trouver un levier pour secouer les représentations du pouvoir et des pouvoirs comme découlant de la complexité des activités sociales et des techniques pour maîtriser cette complexité. En rejetant la conception de leur infériorité naturelle, les femmes en effet désubstantialisent, dénaturalisent les pouvoirs qu’on exerce sur elles et, à partir de là, il devient possible de désubstantialiser d’autres pouvoirs, de démonter leurs modes de construction. Cela vaut en particulier pour les pouvoirs dans l’économie et le travail que l’on essaye de présenter comme résultant du mérite et de l’intelligence comme don, mérite et audace des grands de la finance, mérite et génie inventif des dirigeants d’entreprise, mérites et haute technicité des organisateurs du travail, en refusant de voir que tout cela dépend de rapports sociaux d’apprentissage distribuant inégalement les moyens d’apprentissage (et de l’équilibre vital). Une sorte de voile technologique, pour reprendre la terminologie d’Adorno, s’étend sur la société, imposant les abstractions réelles du Capital, de la valeur et de l’argent comme références incontournables de l’organisation des pouvoirs, comme source et butoir à la fois. Si au contraire on prend en compte l’origine relationnelle de tous ces pouvoirs, on peut déconstruire les technologies de pouvoir au service de la valorisation qui ne sont certainement pas des leurres, mais sont des médiations sociales figées, cristallisées au-dessus de la tête des individus menant la danse qui conduit aux transformations techniques de la production.
Toute rupture véritable avec les conceptions substantialistes des pouvoirs, soit comme purs rapports de force, soit comme exercice de compétences, oblige à saisir la vie et les relations quotidiennes sous d’autres éclairages. Elles ne peuvent plus être interprétées comme l’autre des rapports de travail, comme lieu du privé (la famille refuge, les rapports affectifs, etc.), du recul et de la distance par rapport au travail. Il n’est pas niable qu’il y ait dans le quotidien du temps de récupération, du temps d’intimité, du temps de loisir. Pourtant cela ne veut pas dire que le quotidien, le privé échappent à la valorisation. Ils sont même littéralement happés, aspirés comme champ de réalisation de la plus-value et comme domaine d’expansion des rapports marchands. Les hommes sont forcément des consommateurs en même temps que des objets monnayables pour les publicitaires, et du matériel pour les productions médiatiques. Ils sont confrontés à de multiples formes d’appropriation de leurs vies (rôles sociaux et temporalités imposés, loisirs plus ou moins obligatoires, etc.). La vie s’ordonne et s’organise obligatoirement autour de la réussite ou de l’échec dans la valorisation. L’accomplissement des individus ne peut être que la réalisation dans la valorisation, c’est-à-dire l’hétérodétermination par la valeur.
En se mettant au service de la valorisation, les individus en fait se nient et se mutilent eux-mêmes. Leurs connexions au monde sont unilatéralement orientées vers ce qui est utile à leur combat pour la survie (pour ceux d’en bas) et à leurs succès (pour ceux d’en haut). Leurs liens sociaux quotidiens sont précaires et sans cesse remis en question par leurs activités, c’est-à-dire par leurs relations aux autres dans la concurrence. Il ne peut y avoir de solidarité par génération spontanée, mais au contraire des solidarités construites patiemment, dont la longévité et la solidité ne sont jamais garanties à l’avance. C’est pourquoi il n’est pas exagéré de dire que les échanges collectifs au sens fort du terme sont monnaie rare au quotidien. Ils n’offrent pas de véritables barrières à la fragmentation du quotidien, aux souffrances, à l’agressivité des relations interindividuelles qui répandent le mal-vivre un peu partout. Or, on ne peut vivre mal sans chercher à vivre mieux, sans se bercer de l’idée que le dernier mot n’a pas été dit, sans vouloir qu’une société meilleure permette de vivre autrement au quotidien. Et l’on voit bien quelle contribution de telles aspirations peuvent apporter à la lutte pour l’émancipation sociale. Changer la société, ce n’est pas changer seulement les rapports de travail, c’est aussi changer les façons de vivre, c’est lutter pour l’autodétermination individuelle et collective.
Il est clair qu’une politique renouvelée doit prendre en charge ce type de problèmes à peu près complètement négligés par le mouvement ouvrier, ou réduits à des problèmes matériels (habitat, transports, cadre de vie, etc.). Faire apparaître l’oppression au quotidien, c’est en effet donner plus de prégnance à la répartition et à la circulation des pouvoirs dans les rapports sociaux, c’est rendre plus visibles les mécanismes d’emprisonnement des individus, les contraintes quotidiennes au fonctionnement des grandes machineries impersonnelles. Ce qui était habituel, de l’ordre de la résignation, peut perdre alors de sa patine, de son évidence pour faire place à l’étonnement et à des interrogations nouvelles. Le monde social ne se transforme pas d’un coup de baguette magique, il prend d’autres couleurs et dévoile peu à peu ses aspérités, ses failles. La violence symbolique du capital se trouve par là confrontée à une contre-violence symbolique, qui, si elle se systématise, peut bouleverser les rapports sociaux de connaissance et les façons de penser de larges masses. Les rapports de subordination et de dépendance, en particulier, peuvent devenir d’autant plus insupportables qu’ils n’apparaissent effectivement plus comme nécessaires. Ils peuvent donc être remplacés, tout au moins en perspective, par une nouvelle organisation des relations d’autonomie et de dépendance qui diffuserait très largement les possibilités d’autonomie et restreindrait au maximum les positions de subordination, surtout en les rendant temporaires. C’est dans un tel cadre que pourraient prendre forme les individualités multilatérales dont parle Marx dans les Grundrisse (Manuscrits de 1857-1858) grâce à l’établissement de nouvelles connexions au monde. C’est également dans un tel cadre que pourrait se déployer la puissance collective d’individus en train de se transformer dans la fluidité des positions et des fonctions occupées.
Tous les terrains peuvent et doivent être investis – de l’école aux médias – par des actions qui s’épaulent les unes les autres et se renforcent réciproquement. Un peu partout les critères de sélection des orientations doivent être remis en question, dépouillés de leur « naturalité » par la mise en évidence de leur dépendance par rapport à des médiations sociales gélifiées ou gelées (par exemple : valeur, capital, monnaie). La bataille doit être menée particulièrement contre les critères d’évaluation des activités – critères d’évaluation et de mesure des activités économiques et du travail, critères d’évaluation dans les systèmes de formation, critères d’évaluation des individus –, qui tous relèvent d’une rationalité d’assujettissement à la valorisation. En menant des batailles de ce type, on peut se donner peu à peu les moyens de mettre à nu le jeu des institutions, leur connivence avec les logiques de la valorisation. Des institutions ainsi délégitimées sont forcément fragilisées et subissent de véritables processus d’usure. Cela peut, bien entendu, créer des conditions propres à l’imposition de nouvelles orientations et à de nouveaux modes de fonctionnement institutionnel. À la biopolitique des pouvoirs en place consistant à conditionner le matériel humain pour la valorisation, on peut ainsi opposer une biopolitique venant d’en bas qui, elle, se fixe pour objectif de restituer aux hommes le contrôle de leurs rapports sociaux accaparé par les abstractions du capital, de libérer les échanges symboliques et sociaux en donnant toutes leurs chances à la vie des individus et à la vie collective ainsi qu’à l’imaginaire social.
La biopolitique venant d’en bas est en même temps une lutte pour l’hégémonie, c’est-à-dire une lutte pour déstabiliser l’emprise des pouvoirs régaliens sur la culture politique et les pratiques politiques. Cette lutte pour l’hégémonie est, en ce sens, une lutte pour la politique, pour que celle-ci ne se laisse plus prendre aux pièges de la souveraineté et de ses corrélats, l’état d’exception et la raison d’État, pour qu’elle exprime la puissance multiforme sans cesse renouvelée de la créativité sociale. Ainsi conçue, la politique fait ressortir le caractère intolérable du verrouillage des pouvoirs dans les rapports sociaux. Elle met également en lumière le fait que la monopolisation par l’État d’un certain nombre de moyens de coercition et de survie n’a pas pour but de soustraire ceux-ci à des intérêts privés, mais au contraire de les soustraire au plus grand nombre. La lutte pour une politique renouvelée passe donc par une lutte pour de nouvelles formes de puissance publique. On ne peut se contenter de conquérir des institutions et des appareils, on ne peut se contenter de conquérir le pouvoir d’État, il faut au contraire déséquilibrer toute la constellation étatique, en retourner ou détourner les pratiques. C’est toute une guerre d’usure qui doit être menée avant même qu’on puisse s’emparer des leviers de commande et désarmer (au sens propre et figuré) les hommes des pouvoirs régaliens. Cela ne supprime pas le moment stratégique de la décision, du rassemblement des forces pour porter des coups efficaces aux appareils répressifs, mais cela place ce moment stratégique au point d’aboutissement de luttes qui inscrivent déjà dans la réalité un autre type d’État, un État en voie de dépérissement grâce à la réinvention de la politique.
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
VII
où en sommes-nous dans cette recherche théorique ?
L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
N'EST PAS LA DÉMOCRATISATION DE L'ÉTAT
concrétiser l'utopie concrète contre les utopies abstraites
de la démocratie radicale et de la révolution impossible*
* la révolution n'est pas impossible en tant qu'événement insurrectionnel, mais celui-ci comme tel n'aboutit en rien à une réalisation communiste de la Communauté humaine/Gemeinwesen. Voir CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION
ce qui fait tout l'intérêt de ce sujet est à mon sens que j'y prends le contre-pied d'interprétations que permettait une ambivalence de Marx quant à l'État et la politique. Nous l'avons trouvé ce glissement chez Dardot et Laval (Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle, 2014), ci-dessus chez Jean-Pierre Vincent, prônant en 2002 une « biopolitique par le bas » aboutissant au « dépérissement de l'État grâce à la réinvention de la politique. Nous le retrouvons dans ce texte de Yvon Quiniou, communiste humaniste dans la sphère pécéfixe, grand défenseur de la laïcité, Le communisme est-il possible ? Nouvelles FondationS 2007/3-4, n° 7-8, pages 157 à 163 : « la thèse du dépérissement de l’État n’a pour moi pas de sens, et il faut lui substituer celle de sa démocratisation maximale. Nous aurons toujours besoin d’un État, ne serait-ce que pour instituer et protéger tous les acquis du communisme lui-même, donc d’un État politique « gouvernant les hommes » et pas seulement d’un État gestionnaire « administrant les choses » »
j'ai eu l'occasion de mesurer le jésuitisme de Quiniou en ferraillant plus d'une fois avec lui dans le Club Médiapart, une vraie couleuvre théorique, qui nous chie des vipères même pas lubriques, pour paraphraser Vaneigem
ces trois textes, et sans doute bien d'autres à cette époque, sont marquée par l'hégémonie, dans la pensée communiste dominante, du démocratisme radical alors en vogue, que Dardot et Laval ne font que relancer après son déclin suite à la crise de 2008, dans une nouvelle variante sous le label de Commun, ce qui, nous l'avons vu avec Balibar, n'en épuise pas les potentialités,
toute la question est bien celle de la rupture avec ce qui définit le Capital et par suite la fonction de l'État dans l'économie politique, comme aujourd'hui dans l'écologie politique (voir le second sujet central de ces NOUVELLES VOIES THÉORIQUES :
II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Extrait :
quelles modifications pour le projet communiste ?La doctrine marxienne affirme que l’État doit et peut dépérir. Qu’il le doit parce qu’il constitue une source de domination sur l’homme insupportable, le soumettant à une puissance apparemment étrangère alors qu’il faudrait, au contraire, le faire accéder à l’autonomie : Marx ici, comme l’avait justement souligné Lénine dans L’État et la Révolution, est d’accord avec l’anarchisme, sauf qu’il veut mettre en place progressivement les conditions socio-économiques du dépérissement de l’instance étatique et non l’abolir tout de suite. Qu’il le peut parce que, précisément, Marx n’enracine l’existence de l’État que dans les seules contradictions de classes et qu’il n’y voit donc que l’instrument de répression des conflits socio-économiques liés à la propriété privée ; il oublie donc tout ce qui, dans cette conflictualité, pourrait tenir à des données naturelles susceptibles d’opposer les hommes les uns aux autres dans n’importe quelle société et dont les conflits de pouvoir, y compris au sein des organisations révolutionnaires qui se battent pour la fin du pouvoir d’État et la réinvention des rapports humains, donnent parfois une malheureuse illustration. Je l’indique donc : la thèse du dépérissement de l’État n’a pour moi pas de sens, et il faut lui substituer celle de sa démocratisation maximale. Nous aurons toujours besoin d’un État, ne serait-ce que pour instituer et protéger tous les acquis du communisme lui-même, donc d’un État politique « gouvernant les hommes » et pas seulement d’un État gestionnaire « administrant les choses » [23]
20
Mais la nécessité de l’État touche à une autre dimension de l’existence humaine, qui est celle du besoin de normes morales pour assurer le vivre-ensemble. On sait que Marx a cru pouvoir résoudre la question en quelque sorte en la niant : pour lui, les normes morales ne sont que l’expression mystifiée d’exigences sociales concrètes, suscitées par les antagonismes de classes, que le communisme doit satisfaire, et la nécessité d’y recourir devrait s’évanouir avec la satisfaction de ces exigences [24]
21
On aura compris que ces remarques, venant après celles concernant le prétendu échec historique du communisme, préservent l’essentiel du message d’émancipation marxien, qui tourne autour de la problématique de l’exploitation du travail et de son dépassement dans une société débarrassée des classes sociales, avec ses effets en chaîne sur la vie individuelle. Mais elles le rendent crédible anthropologiquement sans en faire pour autant un futur certain. De ce point de vue, c’est à ceux qui le déclarent dogmatiquement impossible de faire la preuve de ce qu’ils avancent.
[23] Je fais allusion à une célèbre formule d’Engels dans l’Anti-Dühring affirmant que, dans le communisme, « le gouvernement des hommes fait place à l’administration des choses » (op. cit., 3e partie, chap. 2).
[24] Cf. le Manifeste du Parti communiste, chap. 2.
[25] Cf. en ce qui concerne ce double point, l’apport décisif de Darwin et l’éclairage que lui a donné P. Tort. Je m’en suis inspiré dans mon propre travail sur la morale.
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
dessous
IX. NOUVEAUX PROBLÈMES EN PERSPECTIVE COMMUNISTE
X.
L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
N'EST PAS UNE RÉFORME DU DROIT ADMINISTRATIF
L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
N'EST PAS UNE RÉFORME DU DROIT ADMINISTRATIF
a priori et sauf incompréhension de ma part, l'appel à contribution ci-dessous procède d'une démarche inverse à la mienne : « Comment le marxisme devrait-il aborder le droit, la réglementation et l’État administratif, tant sur le plan conceptuel que stratégique ? ne critique de la forme bureaucratique de régulation ainsi qu’une appréciation du caractère de classe de l’État, contradictoire et indéterminé / une critique de la démocratie bourgeoise... »Quelles sont les forces et les limites de la réglementation, de la bureaucratie et du droit administratif d’un point de vue spécifiquement marxiste? La réglementation peut-elle constituer un défi efficace ou un rempart contre la règle du capital ? D’autres formes de réglementation (en dehors de la réglementation en tant que droit administratif) sont-elles réalisables dans les relations sociales capitalistes ? Au-delà de ces relations sociales ? À quoi ressemblent ces engagements avec l’administration et la réglementation dans des contextes spécifiques – par exemple, la discrimination en matière d’emploi, l’environnement, la santé et la sécurité, le logement, les valeurs mobilières et la réglementation financière, ou le droit international ? Existe-t-il des liens entre la forme de valeur du capital et la logique instrumentale de l’État administratif et ses lois ? Comment l’analyse de l’État administratif peut-elle donner un aperçu des débats sur la construction d’une société socialiste postcapitaliste ? Faut-il réaffirmer, réviser ou rejeter les critiques précédentes de la bureaucratie (Marx, Lénine, l’école de Francfort, etc.) ? Comment la théorie de la « société administrée » se porte-t-elle à la lumière de la persistance du néolibéralisme, malgré des décennies de crise ?
il s'agit d'une critique de la bureaucratie administrative de d'État capitaliste pouvant déboucher sur d'autres formes d'administration et d'autres contenus du droit pour un État socialiste. Dans la batterie de questions posées, aucune critique de l'État comme pouvoir, même administratif, du Capital, aucune idée de séparer ce pouvoir d'une administration communiste des choses qui, pour nous, n'est pas une démocratisation de l'État
Call for Papers
Workshop on Marx, Law, and the Administrative State
Atelier sur Marx, le droit et l’État administratif
Umui Özsu, A Forum for Marxist Analysis of Law, July 4, 2020
To be held at the Baldy Center for Law and Social Policy,
University at Buffalo School of Law, New York
Workshop on Marx, Law, and the Administrative State
Atelier sur Marx, le droit et l’État administratif
Umui Özsu, A Forum for Marxist Analysis of Law, July 4, 2020
To be held at the Baldy Center for Law and Social Policy,
University at Buffalo School of Law, New York
How should Marxism, broadly understood, approach law, regulation, and the administrative state–conceptually as well as strategically? Socialists have always been of two minds when confronted with the specific dilemmas of administration and regulation. This is no truer than today, when neoliberalism has precipitated a crisis of the administrative state, which is ill-equipped to address financial disarray, environmental catastrophe, and a global public health emergency. It is clear that the neoliberal state’s strength in imposing market discipline upon an atomized society comes at the cost of limiting its capacity to respond to crises of capitalist social reproduction. Indeed, renewed contemporary attention to political economy has often been accompanied by calls for the repair or renewal of the administrative and regulative capacities of the capitalist state. But socialist opposition to the capitalist state has always been attended by trenchant critique of the bureaucratic form of regulation as well as an appreciation of the class character of the state–contradictory and indeterminate though that character may be. This can be found in Marx’s writings, especially following the Paris Commune. The critique of bureaucracy and bourgeois democracy receives its most passionate expression in the pages of Lenin’s The State and Revolution. And for the Frankfurt School, the “administered society” is a form of domination that corresponds all too well with the domination of capital.
We invite abstracts for a conference on Marxism, law, and the capitalist state. We are especially interested in proposals that are directly concerned with the themes described above, but proposals may also address a range of related questions. What are the strengths and limitations of regulation, bureaucracy, and administrative law from a specifically Marxist perspective? Can regulation provide an effective challenge to or bulwark against the rule of capital? Are alternative forms of regulation (outside regulation as administrative law) feasible within capitalist social relations? Beyond those social relations? What do these engagements with administration and regulation look like in specific contexts–for instance, employment discrimination, the environment, health and safety, housing, securities and financial regulation, or international law? Are there links between the value form of capital and the instrumental logic of the administrative state and its laws? How may analysis of the administrative state provide insights into debates about the construction of a post-capitalist, socialist society? Should previous critiques of bureaucracy (Marx, Lenin, the Frankfurt School, etc.) be reaffirmed, revised, or rejected? How does the theory of the “administered society” fare in light of neoliberalism’s persistence, despite decades of crisis?
To submit your proposal, please send a detailed abstract, of no more than 500 words, to legal.form.contact@gmail.com by 1 September 2020. Authors of accepted proposals must submit a completed paper prior to the conference. Participants will discuss the possibility of publishing a collection at the workshop. Please note that our objective is to cover travel and accommodations for each workshop participant. However, this will be a small event with a limited budget, so it is unlikely that we will be able to accept every proposal. We aim to accommodate those who cannot travel, or who do not wish to do so. As such, in your proposal, please indicate whether you would be willing to participate via videoconference; consideration of your proposal will not be affected by your choice.
IX
NOUVEAUX PROBLÈMES EN PERSPECTIVE COMMUNISTE
NOUVEAUX PROBLÈMES EN PERSPECTIVE COMMUNISTE
il va sans dire qu'une administration communiste des choses ne s'entend pas seulement comme débarrassée du pouvoir politique, et des rapports hiérarchiques, mais foncièrement du Capital, càd de l'économie politique, et donc de la valeur et des échanges marchands, comme du salaire. Bref, cette vision ne suppose en rien de baisser la barre des "abolitions" de ce qui constitue essentiellement le mode de production capitaliste
c'est ici que commencent à se poser un tas de questions évitées généralement par les anarchistes et autres ultragauchistes, car dans mon optique pas question du "Droit à la paresse" de Lafargue ni du "Ne travaillez jamais !" de Debord, et l'on peut bien changer le terme de travail pour un autre ("activité", disent-ils dans le flou communisateur, "production sans productivité" ajoute Bruno Astarian...), ça ne résout pas grand chose, je ne vois pas même en quoi une mauvaise productivité, au sens du temps passé pour réaliser quelque chose, serait un objectif à poursuivre pour des tâches qui ne promettent pas toutes d'être joyeuses. Le mieux qu'on puisse dire et faire est que le moins agréable soit pour le mieux partagé, et qui ne les partage pas aujourd'hui est le plus mal placé pour en parler. Les Lafargue et Debord d'aujourd'hui le savent très bien, qui se taisent sur ces questions
on peut rêver de supprimer les lieux de production, en tant qu'usines et ateliers, les bureaux et guichets, mais peut-on envisager, par exemple, un suivi médical sans dossier médical ? de l'eau potable sans réseau d'assainissement et distribution ? une distribution des biens alimentaires répondant aux besoins nutritifs sans transports organisés ? des transports sans horaires et sans lieux de desserte ? des tâches bien accomplies sans métiers et donc sans formation ou quelque forme d'enseignement : sans écoles et sans enseignants ? etc.
je ne fais que le signaler, ne sachant pas trop si ces redoutables questions concrètes peuvent s'envisager sous un angle théorique hors-sol, autrement dit en l'absence d'une situation où elles se poseraient à résoudre. J'ai comme envie de ne pas aller plus loin, tout en soulignant que ne pas poser ces questions à la perspective communiste relève pour moi de l'infantilisme romantique et de l'utopie abstraite de "mesures communistes" littéraires dont, franchement, je n'ai plus rien à cirer
SOMMAIRE
I. notes sur un vieux problème du communisme
LE POUVOIR POLITIQUE D'ÉTAT vs L'ADMINISTRATION DES CHOSES, 29 avril
II. COMMUN OU COMMUNISME : RÉVOLUTION OU RÉFORMISME ? mars 2014 à janvier 2015
avant ma CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION 2016-2020
III. L’Etat, le Public, le Commun : trois notions à l’épreuve de la crise sanitaire
Étienne Balibar, 27 mai 2020
IV. LA LIBERTÉ COMMUNE CONTRE LA HIÉRARCHIE DES POUVOIRS
D'ÉTAT et "LIBERTAIRES", 6 juin
pour une critique systématique du pouvoir, des pouvoirs, de la hiérarchie
V. avec Marx contre Dardot et Laval, 23 juin
ÊTRE CONTRE LA POLITIQUE, C'EST ÊTRE CONTRE L'ÉTAT, et réciproquement
VI. contre Jean-Pierre Vincent, 26 juin
L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
n'est pas la politique par le bas
VII. où en sommes-nous dans cette recherche théorique ? 27 juin
L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
N'EST PAS LA DÉMOCRATISATION DE L'ÉTAT
IX. NOUVEAUX PROBLÈMES EN PERSPECTIVE COMMUNISTE, 28 juin
X. L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES N'EST PAS UNE RÉFORME DU DROIT ADMINISTRATIF. 5 juillet
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
sujet remonté comme essentiel parmi les essentiels, avec II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Invité- Invité
 Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Re: I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Ana Dinerstein me signale cette publication
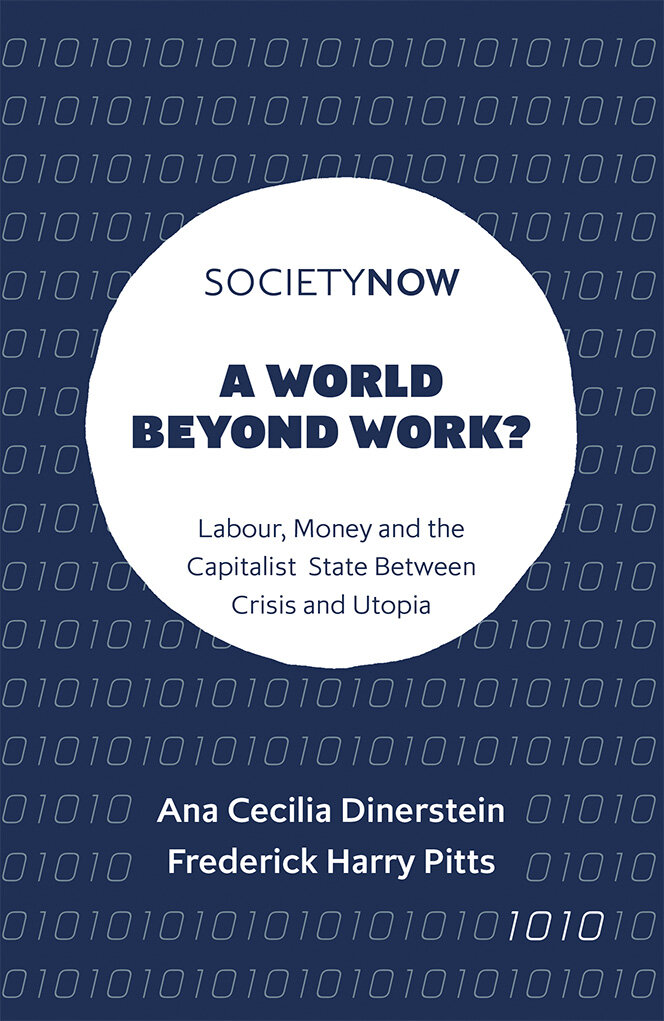
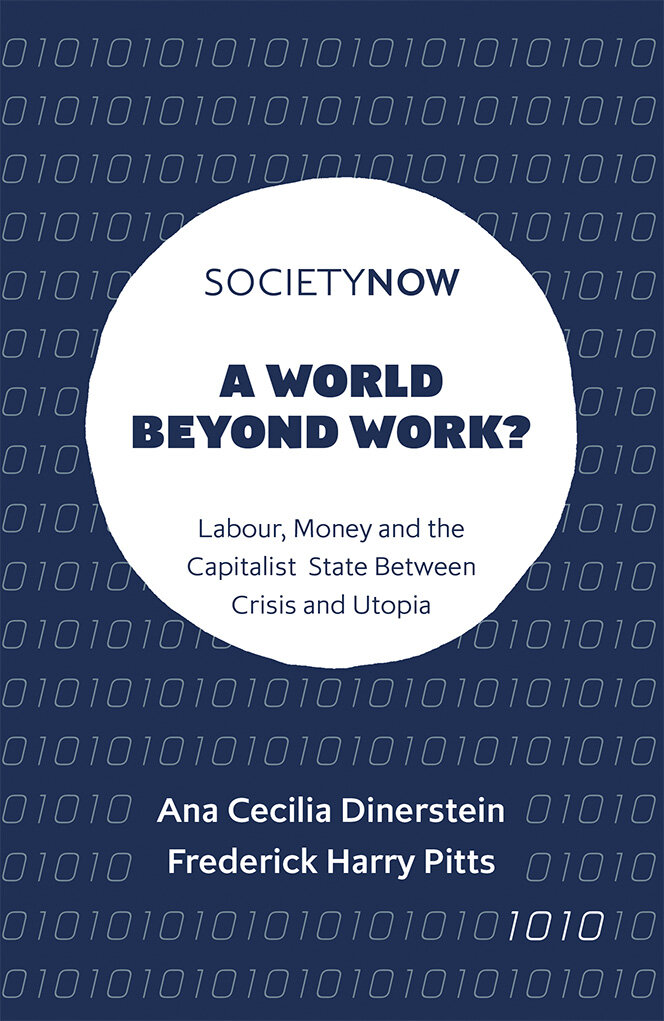
Sensing a future beyond work lurking in an age of crisis, the post-capitalist utopias of today spread the idea of a permanent escape from work aided by the automation of production, a universal basic income and the reduction of working hours to zero. By skilfully unpicking the political economy of contemporary work and its futures, this book mounts a forceful critique of the post-work society vision.
Dinerstein and Pitts reveal that transitional measures towards a world beyond work do not do enough to break away from the key features of capitalist society, and instead potentially stifle the capacity for transformative social change. Proposing an innovative alternative, the authors envision the construction of concrete utopias that shape and anticipate non-capitalist futures.
Invité- Invité
 Sujets similaires
Sujets similaires» RAPPORTS HUMANITÉ-CAPITAL-NATURE et CONJONCTURE PANDÉMIQUE / Théorisation communiste, suite
» II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
» THÉORISATION COMMUNISTE PAR TEMPS DE CORONAVIRUS
» LES CHOSES, NON LES MOTS
» LE CAPITAL À L'ASSAUT DU CIEL
» II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
» THÉORISATION COMMUNISTE PAR TEMPS DE CORONAVIRUS
» LES CHOSES, NON LES MOTS
» LE CAPITAL À L'ASSAUT DU CIEL
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum


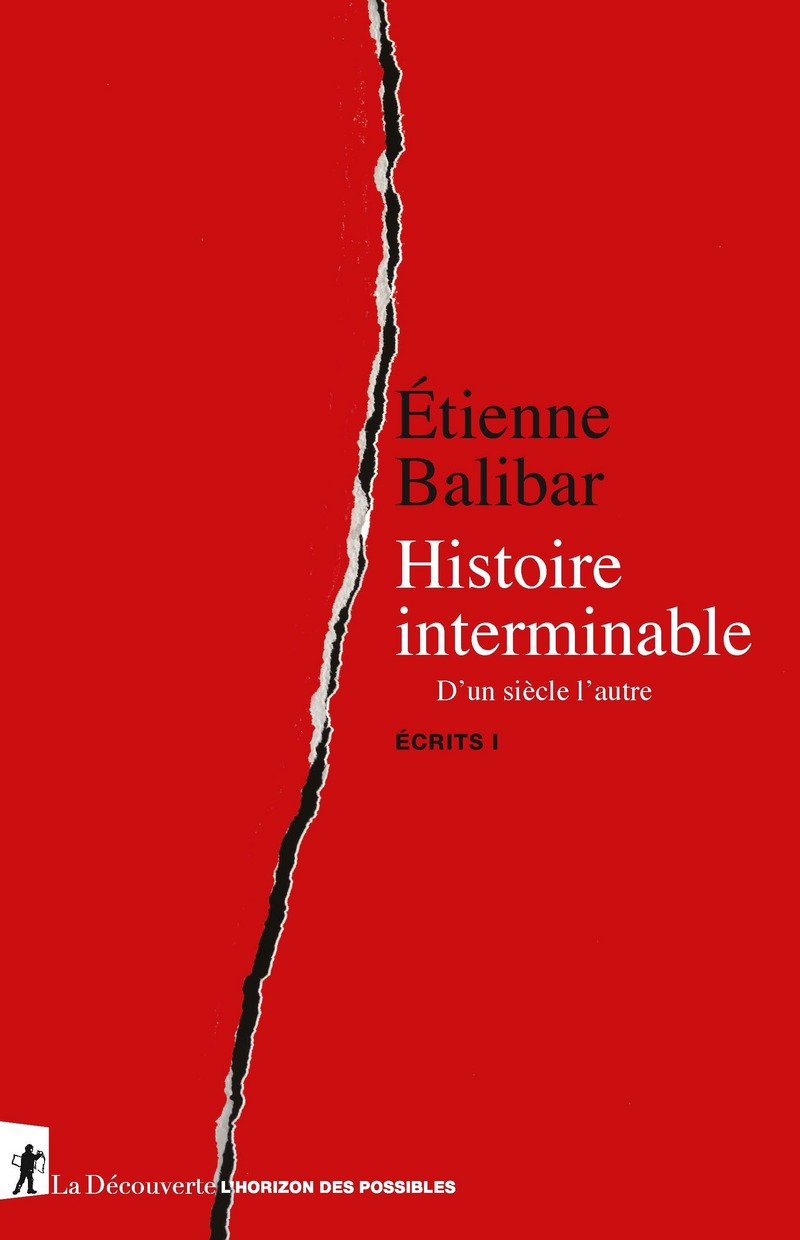
» BIEN CREUSÉ, VIEUX TOP ! Histoires d'une mare
» IRONÈMES, poésie minimaliste, depuis 2018
» MATIÈRES À PENSER
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» I 2. TECHNIQUES et MUSIQUES pour guitares 6, 7 et 8 cordes, IMPRO etc.
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» PETITES HISTWEETOIRES IMPRÉVISÉES
» HOMONÈMES, du même au pas pareil
» LA PAROLE EST À LA DÉFONCE
» KARL MARX : BONNES FEUILLES... BONNES LECTURES ?
» IV. COMBINATOIRE et PERMUTATIONS (tous instruments)
» CLOWNS et CLONES des ARRIÈRE- et AVANT-GARDES
» VI. À LA RECHERCHE DU SON PERDU, ingrédients
» CAMATTE ET MOI
» III. LA BASSE et LES BASSES À LA GUITARE 8 CORDES
» L'ACHRONIQUE À CÔTÉ
» LA CRISE QUI VIENT
» MUSIQUE et RAPPORTS SOCIAUX
» PETITE PHILOSOPHIE PAR LA GUITARE à l'usage de toutes générations, classes, races, sexes...