II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Page 1 sur 1
 II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
I. INTRODUCTION
la critique de l'écologie politique comme complément à la critique de l'économie politique
ce titre a le même sens que le sous-titre du Capital de Marx :
Critique de l'économie politique,
mais..
n'étant pas adepte du yakafokon, je m'y collePatlotch a écrit:(@JPrefereNepas), 25 mai
La pensée communiste doit intégrer la science de l'écologie contre l'État et le Capital, et leurs alternatives politiques aussi écolos soient-elles. Non pour "sauver la nature", mais que l'humanité réintègre le monde du vivant pour fonder la communauté humaine
du point de vue de la théorisation communiste, je critique l'écologie politique parce que je critique la politique, et non l'écologie comme science. Il faut dès lors faire une différence entre sciences économiques et sciences de l'écologie, puisqu'autant on peut considérer qu'abolir ou dépasser le capital, c'est sortir de l'économie (le communisme comme état réalisé n'est pas un mode de production, fondé sur des échanges marchands de valeurs), autant je vois mal comment "abolir l'écologie" ou "sortir de l'écologie", si ce n'est en tant qu'écologie politique
DISTINCTIONS PRÉALABLES
cela ne signifie pas que l'écologie comme science soit une science "exacte" ou "pure", comme les mathématiques ou la logique, qui est la science du raisonnement que l'on retrouve dans toutes les sciences, les mathématiques comme les sciences "humaines" "ou sociales", et hors les sciences la philosophie. Relevant des sciences de la vie, sciences de la nature "sciences naturelles", qui ont pour objet le monde naturel, la Terre et l'Univers. Ici se posera la question : pourquoi les "sciences humaines" ne sont-elles pas classées dans les "sciences de la la vie" ? ce qui indique déjà l'objectivation scientiste d'une séparation idéologique
il faut bien "classer" dira-t-on, mais c'est là que déjà le bât blesse, car « l'écologie comme discipline scientifique se situe au carrefour de toutes les disciplines liées de près ou de loin à la biologie, telles que la génétique, l’éthologie ou encore la géologie* et la climatologie et son objectif est principalement de comprendre la complexité des écosystèmes naturels. »**
* la géologie, comme science qui étudie la structure et l'évolution de l'écorce terrestre, enveloppe rigide, donc une partie de la nature, ne relève qu'en termes de relation des sciences du vivant, ce qui invite à penser la nature comme un tout incluant des parties vivantes et d'autres non, au sens commun où l'on parle d'"apparition de la vie sur terre", de conditions pour cette apparition, et inversement, de destruction du vivant, qui n'est donc pas une destruction de la nature. En ce sens, le Capital peut détruire la vie, il ne peut pas détruire la nature
** Écologie : définition – Qu’est-ce que l’écologie ? Un seul mot pour une double réalité, écologies scientifique et politique
classer, c'est séparer, et la France universitaire est en la matière une experte, le mauvais élève de l'interdisciplinarité. Voir Edgar Morin, La Méthode I, La Nature de la nature, 1977Nous avons besoin de ce qui nous aide à penser par nous-même : une méthode. Nous avons besoin d'une méthode de connaissance qui traduise la complexité du réel, reconnaisse l'existence des êtres, approche le mystère des choses.
La méthode de la complexité qui s'élabore dans ce premier volume demande :
- de concevoir la relation entre ordre/désordre/organisation et d'approfondir la nature de l'organisation.
- de ne pas réduire le phénomène à ces éléments constitutifs ni l'isoler (ou l'abstraire) de son environnement.
- de ne pas dissocier le problème de la connaissance de la nature de celui de la nature de la connaissance. Tout objet doit être conçu dans sa relation avec un sujet connaissant, lui-même enraciné dans une culture, une société, une histoire.
COMPLEXITÉ : L'ÊTRE HUMAIN APPARTIENT AU VIVANT, IL EST DANS LA NATURE
ceci malgré le fait que l'humanité s'en est séparée (Jacques Camatte), et que le Capital a rajouté une couche entre les deux, de telle sorte que l'anthropocène englobe sa dernière époque, inachevée, le capitalocène, concepts auxquels je me réfère ici par facilité
l'écologie comme science des interactions entre les êtres vivants dans leur milieu est pas conséquent, de façon définitoire, une science de la complexité, et donc hostile aux classements séparateurs, à commencer par celui de l'être humain du reste (sic) du monde vivant
et nous voyons déjà que notre critique de l'économie politique, même en s'appuyant sur l'écologie comme science doit aussi en faire la critique, comme Marx appuyait sa critique de l'économie politique en s'appuyant sur les découvertes scientifiques de ses contemporains ou prédécesseurs les économistes classiques , particulièrement ceux adhérant au concept de la valeur travail (Adam Smith, Ricardo...), tout en critiquant leurs erreurs selon lui. En ce sens, le terme de "critique" indique doublement le sens commun de "critiquer : mettre un jugement négatif", et son sens théorique d'élaboration positive, une théorie critique, à ne pas confondre avec la "Théorie critique" correspondant à l'École de Francfort
PRÉCISIONS CONCEPTUELLES et TERMINOLOGIE PHILOSOPHIQUE
je renvoie à l'épisode XLII. CONJONCTURE PANDÉMIQUE CONVERGENCES D'ANALYSES CONCEPTS CROISÉS concernant les courants, concepts et catégories philosophiques, la discussion sur l'existence ou non d'un "concept de nature" chez Marx, et la distinction entre matière et nature d'ont découle celle entre matérialisme et naturalisme. Je retiens celle de Marcel Conche :La nature est une donnée, non un concept ; la matière est un concept, non une donnée, (et quand Marx revient aux choses), en économie, il s’agit, il est vrai, de science, non d’interprétation.
PRÉCÉDENTES RÉFLEXIONS ET CRITIQUES, depuis 2004
j'ai intégré dans celle du communisme la problématique "écologiste" depuis 2004 avec CARREFOUR DES ÉMANCIPATIONS. Je l'ai pratiquement abandonné jusqu'en 2014, exceptée par quelques remarques critiques, en m'inscrivant dans le courant de la Théorie de la communisation, puis, de fil en aiguille, j'ai dû considérer que celle-ci était, par son structuralisme prolétarien (Jacques Camatte, 1978), incompatible avec cette intégration, ce qui se vérifie à la lecture de la réception du texte de François Danel (FD) : CONJONCTURE ÉPIDÉMIQUE, crise écologique, crise économique et communisation
j'en dirais globalement qu'on ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif, moins encore à deux ou trois. "Ânes" parce qu'ils étalent leur ignorance du sujet comme leurs certitudes de savoir quoi dire aujourd'hui, et de façon définitive, sur "la nature" et "l'écologie", alors que ce courant n'en dit rien ou le pire depuis ses origines dans les années 70. Je suis donc convaincu que la critique de cette idéologie communiste idéaliste (le prolétariat révolutionnaire comme Idée) n'est pas de nature à éclaircir une critique communiste de l'écologie politique
William Jennings Bryan & Kansas City Platform -
Dragging the Democratic Mule to the Political Trough (1904)
dans ces conditions, pourquoi ai-je critiqué sur ce point ce courant ? À toutes fins utiles pour qui ne serait pas persuadé de cette "Idée" : « Les prolétaires « se sauvent », càd détruisent tous les rapports qui constituent le capital, ils sauveront l’humanité et la nature par surcroît. » Personne dans le courant idéologique prolétariste, des fossiles du programmatisme ouvrier aux nouveaux dinosaures de la communisation, ne sait dire comment les prolétaires le feraient. Ils y croient dur comme fer, sans rien faire, et les autres iront en enfer. Il en va de l'écologie comme autrefois du féminisme, ou du racisme, qui disparaîtraient « par surcroît » grâce à la "dictature du prolétariat"
traces de cette période de transition théorique dans
le CAPITAL contre le vivant, la RÉVOLUTION pour la VIE , 2014-2016
plus récemment, les sujets :
- depuis 2016 : L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
- dans la conjoncture pandémique :
. RAPPORTS HUMANITÉ-CAPITAL-NATURE et CONJONCTURE PANDÉMIQUE / Théorisation communiste, suite
. CONTRE L'ANTHROPOCENTRISME... CAPITALISME, HUMANISME, NATURE... Anthropocène vs Capitalocène ?
. ÉCOLOGIE, ÉTAT, CAPITALISME VERT et CORONAVIRUS
on y trouve l'esquisse de ce je n'appelais pas encore CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE
Dernière édition par Florage le Dim 7 Juin - 14:04, édité 8 fois
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
II. ÉCRIT DU MONDE D'AVANT
je n'ai inventé ni la nécessité ni la formule d'une Critique de l'écologie politique, critique "marxiste", ici de Daniel Bensaïd, théoricien du communisme pour la LCR comme Lucien Sève le fut pour le PCF. Ce texte a le mérite de le rappeler, dans ses limites alors entre programmatisme ouvrier et démocratisme radical. Le mérite aussi de rappeler que l'intérêt soudain pour ces questions des structuralistes du prolétariat révolutionnaire, muets sur le sujet depuis un demi-siècle qu'il existent, devraient les inviter à une certaine modestie, dont il est vrai ils sont peu coutumiers
Critique de l’écologie politique
Daniel Bensaïd, février 2000
extrait de
Le Sourire du spectre, nouvel esprit du communisme,
chapitre II (Partie III : « Métamorphoses du spectre »)
Paris, Éditions Michalon, 2000
Daniel Bensaïd, février 2000
extrait de
Le Sourire du spectre, nouvel esprit du communisme,
chapitre II (Partie III : « Métamorphoses du spectre »)
Paris, Éditions Michalon, 2000
La crise écologique est, avec la crise du travail salarié, le grand révélateur des limites de la rationalité marchande. Les conditions naturelles de reproduction à long terme de l’humanité ne sauraient relever de critères immédiats de rentabilité financière. La mesure « misérable » de toute chose par le temps de travail abstrait atteint ici aussi ses limites. Il existe pourtant une écologie « profonde » et une écologie sociale, des écologies de droite et des écologies de gauche, qui articulent différemment question écologique et question sociale. Elles traduisent des compréhensions distinctes de l’imbrication entre mode de production et rapport à la nature. [je souligne]
Le jeu des définitions est toujours risqué. Pour Alain Lipietz, l’écologie scientifique met en évidence « les limites de l’activité de transformation du monde par les êtres humains », et l’écologie politique se nourrit de cette science pour critiquer le culte de la productivité. Le terme d’écologie désignerait donc à la fois « une science sociale et un mouvement social [1] ». Cette prétention à fonder une politique sur l’autorité rigoureuse d’une science a des antécédents de sinistre mémoire. Les deux ont à y perdre : la science, en se subordonnant aux aléas de la politique ; la politique, en faisant un usage dogmatique de la science.
L’approche de Bruno Latour est plus subtile. Dans la mesure où il n’y a pas, selon lui, d’un côté la nature et de l’autre la politique, on n’aurait pas le choix de faire ou de ne pas faire de l’écologie politique. Croire cependant qu’elle s’intéresse à la nature serait sa « maladie infantile ». Il conviendrait plutôt de se demander ce que la nature, la science et la politique « ont à faire ensemble ». L’écologie politique devrait se proposer de faire subir à la nature ce que le féminisme fait subir à l’homme : « Effacer l’antique évidence avec laquelle il passait un peu rapidement pour la totalité [2]. » L’importance des crises écologiques ne témoignerait pas d’un intérêt nouveau pour la nature, mais de l’impossibilité de maintenir désormais, sous peine de catastrophes, une séparation étanche entre nature et politique, et « l’obligation d’internaliser l’environnement ».
Fondateur de la revue Écologie politique, Jean-Paul Deléage souligne avec raison que « l’écologie politique ne peut tirer son fondement de la science, fût-elle écologique ». Face aux prétentions et aux ambiguïtés de l’écologie politique, il s’agit d’entreprendre ce qui fut fait naguère pour l’économie : une critique de l’écologie politique. [je souligne]
En 1993, Alain Lipietz proclamait péremptoirement l’avènement d’un « nouveau paradigme » écologique, « le paradigme vert, en tant qu’il englobe les aspirations émancipatrices du mouvement ouvrier et les élargit à l’ensemble des relations entre humains, et entre eux et la nature ». L’affaire est lourde de conséquences, puisque ce primat paradigmatique justifierait la prétention des Verts à « un rôle futur de direction culturelle ». On retrouve ainsi, par la voie détournée du paradigme écologique, l’idée par ailleurs condamnée d’une avant-garde éclairée et de sa vocation hégémonique autoproclamée au nom du savoir scientifique [3].
Dans un petit livre récent, Lipietz est revenu sur cette question essentielle : « Y a-t-il un paradigme de l’écologie politique ? » Définit-elle un faisceau de valeurs et d’objectifs distincts de celui que proposent libéraux, démocrates, socialistes, communistes ou libertaires ? Est-elle « capable de coaliser un certain nombre de forces sociales aspirant à des réponses nouvelles aux questions qui se posent à l’ensemble de la société » ? La réponse de Lipietz est catégoriquement « oui » ! Le noyau identitaire de cette écologie politique reposerait sur deux caractéristiques fondamentales : l’anti-productivisme et l’anti-étatisme. À première vue de bon aloi, ces deux « anti » s’avèrent aussi problématiques l’un que l’autre.
Défini comme la poursuite illimitée du programme baconien de domination de l’empire humain sur l’empire naturel, le terme de productivisme stigmatise la fuite en avant dans la production pour la production. Mais il ne remonte pas à la racine de cette course à l’abîme : la soif mortifère de profit. L’accumulation illimitée du capital n’est pas la seule forme de productivisme imaginable. Les désastres écologiques, en Union soviétique comme en Chine, sont là pour le rappeler. Encore faut-il préciser, sans l’exonérer le moins du monde, que ce productivisme bureaucratique est la forme brutale qu’a prise l’accumulation primitive dans un contexte de concurrence impitoyable dominée par la loi du marché mondial. Le productivisme réellement existant aujourd’hui est organiquement lié à la logique intime du capital. C’est pourquoi l’anti-productivisme de notre temps est nécessairement un anticapitalisme : le « paradigme écologique » est indissociable du « paradigme social » déterminé par les rapports de production.
Quant à l’anti-étatisme, pas plus que l’anti-productivisme il ne suffit à fonder une politique cohérente. Car il y a bien des façons de s’opposer à l’étatisme centraliste et bureaucratique : du non- État des libertaires à l’État allégé des libéraux, en passant par le dépérissement de l’État comme corps séparé et la socialisation de ses fonctions, qui est le fil conducteur d’un communisme critique.
La notion de paradigme écologique remplit donc avant tout une fonction idéologique. Elle est censée fournir un fondement doctrinal propre à la « troisième gauche » sans attaches de classe chère à Daniel Cohn-Bendit. Elle est assez vague pour permettre une critique feutrée de la mondialisation capitaliste en faisant l’impasse sur la question cruciale de l’appropriation sociale. Cohn-Bendit a au moins le mérite de mettre les points sur les i : « Le renversement politique n’est pas souhaitable ; les gens sont convaincus avec raison que le système qui marche le mieux, c’est le capitalisme. » L’heure serait venue pour lui de « renoncer à l’autogestion pour la gestion [4] ».
L’épreuve de la gestion tout court est, hélas, assez probante. Il s’agit de « contrarier les logiques dominantes » et de les « réorienter en profondeur », dit Dominique Voynet. En pratique, la ministre verte se contente d’une acception minimaliste du développement durable : « le meilleur rapport coût/bénéfice ». Cette « écologie faible » (ou modeste) a conduit l’écologie gouvernementale à de bien douteux compromis : sur les organismes génétiquement modifiés, sur l’ouverture des sites de stockage de déchets nucléaires, sur la poursuite de la filière mox… Solidarité plurielle oblige ! Le lobbying efficace de la branche bâtiment et travaux publics contre le projet Natura 2 000 de protection des écosystèmes a abouti en 1998 à réduire les 1 623 sites proposés en 1995 par les équipes de recherche du muséum national d’Histoire naturelle (15 % du territoire) à 800 sites (4 % seulement du territoire). Les bénéfices escomptés du marché du génie génétique à l’horizon de 2005 s’élèveraient à 110 milliards de dollars ! Et le plan Jospin de lutte contre le changement climatique avalise sans crier gare l’institution d’un marché des permis à polluer, réclamée par les États-Unis dans les négociations internationales.
À force d’avaler des couleuvres, on finit par ramper. Et le bogue retentissant des Verts devant la marée noire de l’Erika et les dégâts de la tempête de Noël 1999, au-delà des maladresses médiatiques de Voynet et de Cohn-Bendit, est révélateur des contradictions d’une écologie gestionnaire. On ne biaise pas avec le marché dont la logique est bel et bien globale : une écologie gouvernementale et technocratique, sans ambition de transformation sociale, n’est décidément pas à la hauteur des défis annoncés.
Dans la mesure où elle élargit le champ des connaissances et introduit de nouvelles temporalités sociales, l’écologie critique interpelle « le Rouge », comme le dit fort bien Pierre Rousset. Dans la mesure où elle oblige à aller au cœur du fonctionnement de nos sociétés, elle interroge aussi « le Vert ». Elle oblige l’un et l’autre à un inventaire critique : qu’en est-il du progrès ? de la croissance ? du bien-être ? Elle leur interdit le recours commode à un avenir d’abondance, permettant de ne rien choisir et de ne pas arbitrer sous prétexte que tout sera un jour simultanément possible et compatible. Ce joker de l’abondance a longtemps justifié un bond imaginaire dans un monde virtuel sans contraintes ni limites. Si tant est qu’elles puissent être transgressées un jour, ces limites sont pour longtemps encore notre lot. En attendant, toute politique reste un art des limites [5].
Nous touchons ici à la question cruciale de savoir en quoi consiste au juste la spécificité de l’écologie critique. En regroupant sous ce vaste titre fourre-tout des phénomènes sociaux relevant aussi bien de l’urbanisme, de la santé publique, des pathologies du travail, du réseau de transport ou de la consommation d’énergie, la notion perd en précision ce qu’elle gagne en extension. Au risque de perdre en route ce qui fait la nouveauté et la spécificité de la question écologique. Engels, qu’il serait exagéré de qualifier d’écologiste, critiquait dès 1845 avec beaucoup d’acuité les dégâts du progrès, liés à la course productiviste au profit, en matière de logement, de fléaux sociaux, de dégradation du paysage. Toutes proportions gardées, les catastrophes industrielles du XIXe siècle n’avaient rien à envier à celles du XXe. Qu’on se souvienne du coût humain et social du canal de Panama, de l’insécurité dans les mines, des déraillements de chemins de fer, du naufrage du Titanic, du saturnisme – maladie des taudis – et de la tuberculose – maladie de la pauvreté. On mourait de la silicose bien avant que l’on commence à mourir de l’amiante.
Si la critique d’un certain fondamentalisme écologiste indifférent à la question sociale est nécessaire, la réduction inverse de l’écologie aux souffrances sociales les plus diverses passe à côté de la question désormais essentielle des rapports des sociétés humaines à leur environnement et des limites naturelles relatives qui conditionnent leur capacité de reproduction. C’est la prise de conscience de ces limites qui fait la nouveauté de la question écologique.
Cette précision devrait aider à démêler les arguments confus, et parfois contradictoires, de certains plaidoyers écologistes. Il faut défendre la biodiversité ? Nous en sommes bien d’accord. Mais pourquoi au juste ? Par préférence esthétique pour la différence contre l’uniformité ? Pas respect de la vie sacralisée sous toutes ses formes ? Serait-il donc incompatible d’être écologiste conséquent et pêcheur, chasseur ou amateur de corrida ? Un bon écologiste devrait-il être forcément végétarien ? Pourquoi le respect absolu du vivant devrait-il s’arrêter au règne animal au lieu de s’étendre au règne végétal ? Ou commence et ou finit la vie dans un écosystème ? On voit poindre les dérives possibles d’un intégrisme écologique mêlant imprudemment des critères philosophiques ou religieux, esthétiques et sociaux.
La disparition des dinosaures (et de bien d’autres espèces) a probablement été l’une des conditions d’apparition de l’espèce humaine. Imaginons un dinosaure écologiste, partisan intransigeant de la biodiversité de son temps et du statu quo de son univers. Il aurait tout fait, légitimement, pour empêcher les modifications qui ont conduit à notre existence. Il aurait ainsi voulu priver le monde de cette bizarrerie aussi inouïe qu’improbable que constituent les sociétés humaines. De même, l’acharnement à préserver les conditions de reproduction de l’espèce terriblement prédatrice que nous sommes empêche peut-être l’éclosion de formes inédites et imprévisibles du vivant.
Une écologie naturaliste radicale, n’accordant à l’espèce humaine aucun intérêt particulier dans le règne du vivant devrait logiquement être indifférente aux arguments qui privilégient la survie de l’espèce et la solidarité intergénérationnelle. Elle pourrait même redouter que l’intervention de l’artefact humain ne vienne fausser la régulation naturelle dont participeraient aussi les catastrophes et les épidémies.
Le paradoxe n’est qu’apparent. C’est en effet en référence à notre pauvre échelle humaine, à l’échelle de notre pauvre temporalité historique, que se situe le seul argument rationnel convaincant en faveur d’une préservation de la biodiversité actuellement existante. Car la diversité elle-même n’est pas éternelle. Elle a une histoire. Il y a la diversité d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pourquoi se priver de surprises en s’accrochant à celle d’aujourd’hui, si ce n’est précisément parce que c’est la nôtre !
Si l’apparition et le développement de l’espèce humaine ont bénéficié de circonstances écosystémiques exceptionnelles, l’effet cumulatif des atteintes à l’environnement et sa modification à une vitesse dépassant celle des capacités d’adaptation risquent de produire un franchissement de seuil, de provoquer des conséquences incontrôlables, jusqu’au basculement qualitatif conduisant à une extinction de l’humanité. C’est un argument fort en faveur d’un principe rigoureux de précaution. Mais c’est, reconnaissons-le, un argument conservateur et, à n’en point douter, un argument anthropocentrique dans la mesure où il accorde une attention particulière et un statut privilégié à notre humble engeance.
L’écologie sociale est forcément une écologie humaniste. Faut-il y voir la preuve d’une nostalgie anthropocentrique du sacré, un reste de présomption de la créature divine ? Pas nécessairement. À moins d’exclure la possibilité d’un humanisme profane, ce qui soulèverait bien d’autres questions ! Religieux pour religieux, le naturalisme radical n’est pas moins suspect de relents polythéistes et de fantasmagorie païenne.
La controverse relève en réalité d’une opposition politique entre une écologie humaniste et une écologie anti-humaniste, entre une écologie sociale et une « écologie profonde » ou naturaliste. Le partage se fait sur la question de savoir si l’homme peut être considéré comme une fin actuelle de la biodiversité ou comme une espèce parmi d’autres dont l’avenir nous indiffère. Confrontés aux misères de notre temps, nous nous efforçons d’y répondre avec nos moyens en ménageant notre niche spatio-temporelle. À ce niveau, la crise écologique ne cesse de croiser la crise sociale.
Les limites imposées par notre appartenance à la biosphère et par le fait que nous restons, en dépit de la technique, des êtres naturels sont certes relatives. Mais, à notre échelle humblement humaine de quelques milliers d’années, un seuil fatal pour l’espèce que nous sommes pourrait être franchi. Nous pouvons toujours, en bons mécréants, hausser les épaules : « Et alors ? Si les dinosaures ont disparu, pourquoi les humanoïdes associés devraient-ils jouir d’un privilège de longévité ? » Si nous sommes si peu de chose, autant profiter au mieux du peu de temps qu’il nous reste, vivre sans temps mort et jouir sans entraves, avant la catastrophe annoncée : « Point de lendemain ! » Seule une écologie humaniste peut au contraire éviter l’effet démobilisateur d’un écologisme apocalyptique. Face aux conséquences désastreuses de l’effet de serre, du stockage des déchets nucléaire, du transport à moindre coût des produits polluants, des effets sur l’environnement de l’urbanisation sauvage et de l’agriculture industrielle, c’est par l’expérience du lien concret entre écologie critique et lutte de classe que la conscience et la mobilisation écologistes gagneront la force nécessaire pour conjurer les périls qui nous menacent.
C’est à cette intersection entre crise écologique et crise sociale que nous jouons en effet avec nos limites. Dans leur critique de la théorie malthusienne de la surpopulation, Marx et Engels rejetaient la notion de limite naturelle ou absolue. Sans être conscients de la question écologique telle qu’elle se pose désormais à nous, ils n’ignoraient pas pour autant la notion de limite relative à une époque et à un mode de production donnés : le capital, qui se survit au prix d’une irrationalité croissante, est bel et bien à lui-même sa propre limite. De même, les énergies dites non renouvelables le sont sous certaines formes et à une certaine échelle temporelle. Il n’y a pas, dans un avenir prévisible, péril de pénurie absolue en la matière. Par rapport au niveau actuel de dépense énergétique, les réserves que représentent l’énergie solaire et la biomasse sont considérables. En revanche, il peut se produire une rupture d’équilibre aux conséquences imprévisibles, entre la lenteur du stockage (végétal et fossile) et la rapidité du déstockage induit par notre mode de consommation.
Par son fonctionnement systémique, la biosphère permet l’épanouissement et la reproduction du vivant. Elle opère comme une sorte d’immense organisme à recyclage et à régulation complexes permettant de passer de l’organique à l’inorganique, et vice-versa. Des travaux pionniers de Marsh (1864) et Haeckel (1867) au rapport du Club de Rome (1972) ou au rapport Brundlandt (1987) a émergé l’idée d’une temporalité écologique spécifique qu’illustrent bien les notions d’énergies non renouvelables ou de développement durable. Le rapport Brundlandt définit en effet le développement durable comme « répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Il s’agit de concilier deux ordres partiellement contradictoires : celui de la biosphère à laquelle nous appartenons et celui d’un monde social proprement humain. Le principe de précaution (légalement reconnu en France à propos du « risque de dommages graves et irréversibles ») est étroitement lié à ce souci du futur et du long terme.
Apparaît ainsi la discordance entre une temporalité sociale, rythmée par les cycles d’accumulation du capital, et une temporalité écologique, déterminée par le stockage et le déstockage d’énergie naturelle. Marx a entrevu, à propos de la sylviculture, cette rupture entre la longue durée de phénomènes naturels et le court terme qui régit l’économie marchande : « La longue durée du temps de production (qui ne comprend qu’un temps de travail relativement restreint) et par suite la longueur de périodes de rotation, font de la sylviculture quelque chose de peu propice à l’exploitation capitaliste essentiellement privée [6]. » Le capital vit au jour le jour, avec pour seul horizon le profit du lendemain ou du surlendemain. Après lui, le déluge ! Seule la bureaucratie parasitaire peut rivaliser avec son insouciance et son égoïsme à courte vue.
Contre la prétention à une éternité marchande, le verdict écologique est impitoyable. Par rapport aux régulations de la biosphère, la rationalité partielle du marché fonctionne au prix d’une irrationalité globale croissante. La critique de l’écologie politique exige une révision radicale des rapports réciproques entre nature et société, science et politique. Elle impose du même coup de reformuler quelques grandes interrogations. Quelle histoire faisons-nous ? Quelle planification des ressources et des projets est compatible avec un développement durable ? Quelle démocratie peut en décider ?
Une nouvelle dialectique des temps sociaux implique un dialogue constant entre la politique comme art du présent (où les choix techniques font l’objet d’une « évaluation citoyenne ») et l’éthique comme « messagère du futur ». Il ne s’agit plus seulement de prévenir les dommages graves que nous pouvons infliger à notre niche écologique, mais de déterminer l’humanité que nous entendons devenir.
On n’échappe pas à la question de la relation entre le rapport prédateur à la nature et le rapport social d’exploitation. S’agit-il de deux domaines juxtaposés, indifférents l’un à l’autre ? Sont-ils, au contraire, étroitement imbriqués ? L’histoire des sciences et des techniques, de l’essor du capitalisme, de l’industrialisation et de l’urbanisation plaide à l’évidence pour la seconde hypothèse. La formule de Bacon définit bien un programme de domination : « La nature est une femme publique, nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l’enchaîner selon nos désirs. »
Comme l’écrit Dominique Bourg, c’est « notre mode de production et de consommation qui est en cause [7] ». « Les crises écologiques d’une époque, confirme Alain Lipietz, sont des crises des rapports sociaux de cette époque. » Crises sociales et crises écologiques sont, dans une large mesure, superposables : « À partir des temps modernes, les crises écologiques apparaissent totalement subordonnées à l’économie. » Il n’est pas fortuit que les médecins hygiénistes et les philanthropes du XIXe siècle, confrontés aux dégâts sanitaires et urbains de l’industrialisation capitaliste, fassent figure de pionniers de l’écologie moderne : le libéralisme économique a « engendré sa propre forme de crise écologique ».
Ces crises se propagent non seulement à travers l’atmosphère et les cours d’eau, mais aussi par le biais de la circulation marchande. L’essentiel des pollutions atmosphériques provient ainsi des « pratiques marchandes visant à la maximisation des profits et des rentes [8] ». L’écologie a ses raisons que la déraison capitaliste ignore. Le capital fait de la nature « un pur objet pour l’homme » et « une pure affaire d’utilité » [je souligne]. On ne saurait donc confier le soin écologique de la planète à la régulation du marché, fût-ce à un « marché vert ». Comment résoudre les crises écologiques sans changer radicalement cet ordre marchand ? Une régulation politique démocratique ne serait sans doute pas suffisante pour conjurer toute forme de crise écologique – l’expérience de l’Europe de l’Est est là pour rappeler la possibilité d’un écocide bureaucratique [9] – mais c’est certainement une condition nécessaire.
Lipietz définit l’environnement comme un bien collectif, international et intergénérationnel. Grâce à l’introduction de « régulations écologiques », la valeur des marchandises au XXIe siècle devrait parvenir selon lui à refléter « non seulement le travail incorporé dans leur production, mais la dégradation de l’environnement ». Comment cette dégradation pourrait-elle être mesurée en termes monétaires ? Les indéfinitions du principe pollueur-payeur en montrent d’ores et déjà la difficulté. Que paie, au juste, le pollueur ? Le coût social de la déforestation, de la pollution des eaux, de l’effet de serre, est « beaucoup plus diffus », admet Lipietz, que ne l’estime son évaluation marchande.
Le problème n’est pas nouveau. « Vis-à-vis de la nature comme de la société, notait Engels, on ne considère principalement, dans le mode de production actuel, que le résultat le plus proche et le plus tangible. » C’est pourquoi « la commensurabilité n’existe pas ». L’économie classique s’avère incapable de penser autrement qu’en termes d’équilibre. Elle traite les « externalités » comme des défaillances par rapport à un idéal de concurrence parfaite. Leur évaluation monétaire exprime de façon tout à fait inadéquate la « véritable valeur » sociale des coûts environnementaux. La proposition de taxes spéciales tente d’internaliser ces coûts. Mais l’improbable équivalence entre les lésions à long terme infligées à la nature et leur compensation monétaire immédiate illustre les limites de la rationalité concurrentielle et le conflit entre temporalités marchandes et écologiques [10].
L’internalisation, qui prétend évaluer les dommages en monnaie, de façon à déterminer les nuisances compatibles avec l’équilibre du marché, ne parvient pas à prendre en compte le mode de reproduction de la biosphère. Soumise aux critères de valeur marchande, elle tend à définir des optima de pollution supérieurs à la capacité régénératrice de l’environnement. C’est pourquoi la critique de l’écologie politique doit contribuer à mettre en crise la science économique et ses prétentions. L’objet de l’économie ne peut plus être l’allocation optimale de ressources selon la logique dominante du marché. Elle rencontre dans l’écologie l’exigence de normes extra-économiques. Il faut rechercher une autre rationalité, « qui se confonde avec le raisonnable [11] ». La « bioéconomie » se présente alors comme un ultime effort pour échapper à l’écologie de marché sans avoir à rallier la critique marxiste.
La question des pollutaxes et des quotas transférables (deux modalités pratiques du principe pollueur-payeur) montre pourtant les limites des correctifs fiscaux compatibles avec la régulation marchande. Elle soulève un triple problème de justification, d’effet redistributif et d’affectation du produit. S’agit-il de financer la remise en état de ce qui a été détérioré ? Elles sont alors une forme de redevance. S’agit-il de réparer un dommage particulier ? Elles correspondent alors à une indemnisation. Ou s’agit-il simplement d’affecter un prix dissuasif plus ou moins arbitraire (en tout cas politique) à la nuisance ?
Certains auteurs redoutent que les pollutaxes ne deviennent un moyen d’évacuer une contradiction tenace. Les permis négociables sur l’émission de gaz à effets de serre présenteraient en effet l’avantage de fixer un plafond global, une sorte d’enveloppe globale de pollution tolérable, mais ils auraient aussi le double inconvénient d’exiger un surcroît de contrôle bureaucratique (fort peu anti-étatiste) et surtout d’entretenir ou d’accroître les inégalités de la planète, les riches rachetant aux pauvres leurs droits à polluer pour pouvoir préserver leur propre mode de développement écocidaire. C’est à l’idée même d’un environnement-marchandise, d’une écologie de marché ou d’une écologisation du capital que doit s’attaquer l’écologie critique.
Dominique Bourg estime à juste titre que l’écologie politique est vouée à l’échec si elle prétend figer les inégalités sociales en l’état inégal actuel. Les forces productives ne sont certes pas neutres. Façonnées par les rapports de production, elles contribuent en retour à les reproduire. S’il est insuffisant pour garantir un progrès culturel et social, leur développement n’en est pas moins nécessaire pour permettre une forte baisse du travail contraint, non seulement dans les pays riches mais à l’échelle planétaire.
Pour André Gorz, le travail mort pèse désormais tellement lourd sur le travail vivant, qu’il n’est plus d’émancipation pensable dans et par le travail. Déterminant une hétéronomie irréductible du travailleur, l’industrie et la technique seraient devenues aliénantes par nature. À cette dépossession irréversible ne pourrait s’opposer qu’une « revalorisation de l’autolimitation comme valeur éthique et comme dynamique concrète de changement ». Cette « culture de l’autolimitation » et cette exhortation à une ascèse écologique nous renvoient une fois encore à l’épineuse question des limites et des seuils. S’il est vrai que le productivisme industriel et l’euphorie scientiste du capital en expansion se sont caractérisés par leur insouciance des limites, les crises écologiques, sanitaires et urbaines d’aujourd’hui soulignent l’importance des effets de seuil. Au-delà d’un certain niveau d’émission des gaz à effet de serre, les conséquences deviennent incontrôlables. Au-delà d’un certain seuil d’urbanisation barbare des mégapoles, la reconstitution d’une cité démocratique à visage humain devient difficilement imaginable.
Enchaîné par le compromis fordien à la logique productiviste du capital, le mouvement ouvrier s’est souvent montré indifférent, voire carrément hostile, à la critique écologique. Il n’est pas surprenant que cette fracture soit longue à réduire, d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de concilier à court terme l’écologie radicale et la défense de l’emploi. De grandes questions, de plus en plus urgentes, comme celles de l’agriculture, de la santé, de la ville, créent cependant un besoin pressant de convergences.
La déchirure est également flagrante lorsque certains pays du Sud, et non des moindres, refusent des mesures de limitation en matière de pollution ou de consommation énergétique, qui figeraient en l’état le développement inégal de la planète. Faut-il, comme Alain Lipietz, stigmatiser ces « raidissements nationalistes » des « élites productivistes du Sud » et réduire la responsabilité du Nord aux « abus de pouvoir du passé » ? Comme si les abus de pouvoir n’étaient pas encore ceux du présent ! Et comme si l’argument écologique ne pouvait pas aussi servir à perpétuer des rapports de domination ! Alors que la moyenne tolérable d’émission de carbone est évaluée à 600 kg par habitant de la planète, les États-Unis en émettent cinq tonnes, l’Union européenne deux et le Bangladesh 60 kg.
Justifiant par avance, au nom de l’urgence, tous les compromis gouvernementaux nécessaires, Lipietz plaide pour une stratégie écologiste faible : une politique écologiste se devrait d’être « résolument réformiste, c’est-à-dire réformer résolument et tout de suite ». Nul ne saurait faire la fine bouche devant des réformes radicales. Deux ans de ministère vert de l’Environnement n’ont guère confirmé cette ardeur réformatrice. Dans Vert espérance, constatant que les Verts les plus fondamentalistes ne savent que répondre sur l’anticapitalisme, Lipietz se montrait plus incisif : « Ils rêvent sans doute à une multitude de microruptures, à des révolutions moléculaires à jamais inachevées. » C’était avant 1997 et la conversion à la réal-écologie ministérielle. Du temps où l’espérance verte avait encore de l’ambition…
Bruno Latour va encore plus loin dans le sens d’une écologie faible. Avec la multiplication des hybrides et des intérêts, la dispersion postmoderne des collectifs en compositions variables, la dissolution des classes et l’extinction de leur lutte, l’affrontement épique entre progrès et réaction aurait perdu son sens. Droite et gauche ne pourraient plus dès lors « récapituler ces divisions » croisées. Il n’y aurait plus de front principal repérable, mais des convergences de circonstance, des alliances changeantes et des compromis kaléidoscopiques. La politique deviendrait ainsi une affaire d’opportunités sans principes.
Les lignes de front sont indéniablement brouillées et parfois croisées. « What is left of the Left ? » demandent les Britanniques confrontés à la « troisième voie » social-libérale. S’il existe bien une gauche de droite, une gauche du centre et une gauche de gauche, il n’y a pourtant pas de droite de gauche. Et si l’on cherche sérieusement la voie d’une écologie sociale et démocratique, on retrouve inévitablement les questions cruciales de la propriété et du pouvoir. Il n’y a plus alors une, mais des écologies politiques.
L’écologie des profondeurs prétend étendre à tous les êtres naturels l’impératif kantien de ne jamais les traiter comme moyens et à l’écosystème de la planète entière le respect du vivant [12]. Au nom d’une obligation inconditionnelle envers un avenir ventriloque, le philosophe Hans Jonas rend le présent indécidable et cherche des substituts antidémocratiques à la politique dans le recours à une transcendance dont le rejet constitue à ses yeux « l’erreur la plus colossale de l’histoire ». Pour la corriger, Jonas va jusqu’à souhaiter une resacralisation et « un nouveau mouvement religieux de masse ». Ce vœu risque hélas d’être exaucé, pour le pire plutôt que pour le meilleur, sans que l’écologie ait le moins du monde à y gagner.
L’autre issue envisagée par Jonas consisterait à s’en remettre au despotisme éclairé des savants dépositaires de l’écologique scientifique. Dans cette perspective, « l’heuristique de la peur » justifie la résignation aux tourments du présent comme à un moindre mal. Alors que son « principe responsabilité » prétend insister sur la solidarité entre générations, les attaques libérales contre les systèmes de retraite par répartition contribuent à détruire leur solidarité sociale : cette contradiction suffit à vérifier l’imbrication entre paradigme social et paradigme écologiste.
Il existe aussi une écologie institutionnelle tournée vers les décideurs, dont la pratique de prédilection est le lobbying auprès des gouvernements ou des conférences internationales. La voie des corridors et des antichambres est d’autant plus tentante pour certaines organisations non gouvernementales que les lieux de décision au sommet semblent hors de portée des citoyens ordinaires. Il leur paraît alors plus réaliste d’influencer les détenteurs du pouvoir que de construire une alternative radicale. Ce lobbying institutionnel est fort éloigné de la démocratie participative ou autogestionnaire. Il en est même très exactement l’opposé.
Émerge enfin l’ébauche d’une écologie populaire et militante, irriguant les mouvements sociaux, syndicaux, agraires, associatifs. Elle ne pourra se développer sans surmonter les indéfinitions théoriques de l’écologie politique actuelle. Présentant la transformation de la revue Écologie politique en Écologie et politique, l’éditorial de Jean-Paul Deléage souligne « la nécessité de repenser le projet initial » : « Bien des arguments anti-systémiques (anti-productivistes, anti-étatistes, anti-hiérarchiques) des premiers prophètes de l’écologie se sont retournés au profit du système, laissant exsangues les mouvements politiques qui avaient formé le projet de renverser la société de consommation [13]. »
Au risque de ranimer les craintes d’une planification autoritaire, René Passet est catégorique sur ce point : il est impossible d’assigner aux biens et aux coûts écologiques une valeur monétaire. Quelle autre mesure envisager, si ce n’est une mesure politique et démocratique, une évaluation collective des besoins, des moyens et des risques, éclairée par le développement de la culture scientifique générale ? Pour des écologistes critiques, la « gestion normative » par une planification des ressources à moyen et long terme devrait s’imposer.
Leur fragilité théorique condamne hélas nombre de courants écologistes à faire pudiquement l’impasse sur les questions de la propriété et de la planification, pourtant décisives lorsqu’il s’agit de gestion durable des ressources, d’aménagement du territoire, de politique des transports ou de la ville. [je souligne, comme témoignant aussi du "programme de transition" trotskiste de Bensaïd]. Quelques voix osent cependant lever le lièvre : « La planification, assimilée au modèle déchu dirigiste centralisé, est tournée en dérision au moment où nous en avons besoin pour concevoir et promouvoir des stratégies à long terme de développement durable », car « le développement viable demande une régulation accrue des marchés et la subordination des objectifs économiques à l’impératif social » [14].
Se dessinent ainsi les contours d’un écocommunisme à venir [souligné pour l'expression]. La constitution de grands groupes d’intérêts privés comme Vivendi, concentrant des fonctions aussi sensibles que le traitement de l’eau, la gestion des déchets et la production de l’information, met à l’ordre du jour l’extension du service public pour assurer la transparence de ces secteurs et leur gestion en fonction de besoins sociaux démocratiquement déterminés. Le choix de transports moins polluants irriguant équitablement l’ensemble du territoire, garantissant des conditions de travail humaines, s’oppose à la logique de services coûteux, polluants, inégalitaires, soumis au seul critère de rentabilité marchande. Plus généralement, une politique ambitieuse d’aménagement du territoire réclame la transformation des schémas actuels de services collectifs dans le sens d’une planification démocratique décentralisée. Dans certaines branches fortement internationalisées, les moyens d’une telle planification imposent d’ores et déjà d’envisager des formes d’internationalisation de la propriété publique et de gestion commune, au moins au niveau européen [15].
Le combat contre le chômage et l’exclusion passe lui aussi par l’exigence d’un mode de vie moins prédateur, plus riche en emplois, élargissant l’éventail des métiers socialement utiles. Les luttes contre les pollutions, contre les pathologies du travail, pour la défense de la santé publique et d’une alimentation de qualité, pour le développement d’une agriculture paysanne et contre la pollution des eaux par l’agro-industrie sont indissociablement sociales et écologistes. Un projet écocommuniste exigerait enfin une articulation démocratique nouvelle entre présent et avenir, comme entre espaces régionaux, nationaux et internationaux, entre présent et avenir. Car, ainsi que le dit José Bové : « Face à de tels enjeux de société, il est impossible de gagner seul. Non, Monsieur Jospin, il ne s’agit pas d’une gauloiserie franchouillarde et éphémère [16]. »
Notes
[1] Alain Lipietz, Qu’est-ce que l’écologie politique ?, Paris, La Découverte, 1999.
[2] Bruno Latour, Politiques de la nature, Paris, La Découverte, 1999, p. 71.
[3] Alain Lipietz, Vert espérance, Paris, La Découverte, 1993.
[4] Daniel Cohn-Bendit, Une envie de politique, Paris, La Découverte, 1998.
[5] Sur ce sujet, voir la critique efficace par Michel Husson du néomalthusianisme libéral comme du paradigme vert, in Sommes nous trop ?, Paris, Textuel, 2000.
[6] Karl Marx, le Capital, Paris, Éditions sociales, Livre III, tome II, p. 225.
[7] Dominique Bourg, Planète sous contrôle, Paris, Textuel, 1998.
[8] Alain Lipietz, Qu’est-ce que l’écologie politique ?, op. cit., p. 114.
[9] Il est significatif que l’écologie soviétique prometteuse des années vingt, inspirée des travaux de Vernadsky ait été l’une des premières victimes du Thermidor bureaucratique : sa critique du productivisme était difficilement compatible avec les délires de la collectivisation forcée et de l’industrialisation à marche forcée, ainsi qu’avec l’idéologie du « socialisme dans un seul pays », peu propice au souci internationaliste de la biosphère ; de même, l’exigence démocratique inhérente à une politique écologique radicale ne pouvait qu’entrer en conflit avec le volontarisme bureaucratique et ses entreprises pharaoniques.
[10] Voir, K. W. Kapp, les Coûts sociaux dans l’économie de marché, Paris, Flammarion, 1976.
[11] Jean-Paul Maréchal, le Rationnel et le Raisonnable, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1997.
[12] Poussant cette logique, certains écologistes démographes évaluent à moins d’un milliard la population de la planète raisonnablement compatible avec le respect de la diversité. On peut craindre le pire des moyens envisageables (ethnocides, épidémies, contrôle autoritaire des naissances) pour atteindre une telle réduction démographique. Voir Stan Rowe, « From Reductionism to Holism in Ecology and Deep Ecology », in The Ecologist, n° 4, juillet-août 1997. Pour une critique du néomalthusianisme, voir Michel Husson, Sommes-nous en trop ?, op. cit.
[13] Écologie et Politique, n° 15, automne 1995. Voir aussi Pierre Rousset, le Rouge et le Vert, fascicule n° 9 pour le bicentenaire du Manifeste communiste, Espaces Marx, 1998. Ainsi que les précieux dossiers de la revue Arguments pour une écologie sociale.
[14] Ignacy Sachs, l’Écodéveloppement, Paris, Syros, 1997.
[15] Voir Philippe Chailan, in Arguments pour une écologie sociale, n° 33, novembre 1999.
[16] Le Monde diplomatique, octobre 1999.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
III. DE PRÉCÉDENTES CRITIQUES
comment j'abordais la question dans le monde d'avant. Un commentaire de novembre 2018
Patlotch a écrit:Le Monde du 8 novembre 2018 publie (en édition abonnés) une tribune L’écologie est avant tout une science, pas un mouvement politique : La parole des scientifiques est assimilée à un discours idéologique, alors qu’ils ne font que présenter des résultats objectifs, estime le chercheur Sébastien Barot.... Cette affirmation/opposition laisse à désirer, l'écologie, à chacun la sienne, et le terme recouvre ces deux sens, ensemble ou séparément
on trouve par exemple l'opposition farouche de marxistes au "capitalisme vert" pour faire court, mais ils y rabattent toute lutte écologique. Exemples : Jean-Louis Roche du Prolétariat universel : L'écologie cette nouvelle imposture de l'histoire, 31 octobre 2018 ou Robert Bibeau des 7 du Québec : Prolétariat vs écologistes, environnementalistes et altermondialistes réformistes, 7 novembre 2018
j'ai montré dans l'ancien forum l'opposition irréductible entre d'une part "capitalisme vert", lui-même objet d'une guerre interne entre "transition énergétique" (Hulot, Macron...), et énergo-fossilistes (Trump, pétroliers...) et d'autre part écologie révolutionnaire
l'article ci-dessous nous donne de celle-ci une variante dont le contenu ne me satisfait pas, comme ses affirmations : « Il ne nous appartient pas de renverser le capitalisme (puisque celui-ci s’en charge lui-même) », « le mode de vie adopté par les élites, qui n’est ni durable ni universalisable » (ce mode de vie est largement partagée par toutes les classes sociales), et enfin « réorienter la démocratie en tenant compte des limites écologiques de la Terre », comme si la solution était politique, « créer une contre-société écosocialiste au sein même du monde dominé par le capitalisme » (John Holloway)... Par contre, je pense comme l'auteur que les luttes paysannes sont et seront déterminantesLe capitalisme est « l’ennemi à abattre »
Ernest London Reporterre 8 novembre 2018
Rappelant l’urgence de s’émanciper du capitalisme, qui engendre la destruction des conditions de vie sur Terre, Pierre Madelin, dans son essai « Après le capitalisme », propose des réponses mesurées et radicales, en s’appuyant notamment sur l’écologie politique libertaire.
mars 2017Pierre Madelin désigne le capitalisme « comme l’ennemi à abattre » puis se propose d’examiner les « possibilités “révolutionnaires” (au sens politique du terme) du présent », différentes stratégies et scénarios. Il prévient d’emblée : « Toute réflexion politique se voulant radicale mais ignorant la question écologique se condamne au ridicule, et toute écologie politique réformiste ou “environnementaliste” qui se limiterait, par exemple, à mettre en place des politiques de protection de la nature se condamne à l’impuissance. »
S’appuyant sur les études de penseurs contemporains, il distingue trois limites à la reproduction du système capitaliste :
- Une limite interne qui le condamnerait à disparaître car comme le résume Anselme Jappe : « La logique du capitalisme tend à “scier l’arbre sur lequel elle repose” » ;
- Une limite externe ou écologique, qui peut se résumer ainsi : « Une croissance infinie est impossible dans un monde fini. »
- Une limite anthropologique. Si le capitalisme, supposé reposer sur une société dans laquelle les individus ne seraient plus liés que par l’intérêt, est toujours vivant, c’est paradoxalement parce que sa reproduction a été soutenue par l’altruisme, le sens de la coopération et l’entraide. Mais sa puissance corrosive continue de « ronger » ces rapports « a-capitalistes » en produisant des rapports « dé-socialisants ».
Si ces contradictions permettent de penser à la possibilité d’un effondrement du capitalisme, il ne faut pas négliger sa capacité « à prospérer sur ses propres ruines ». Une nouvelle offensive du capital est en cours, nouvelle « vague d’enclosures » de ressources communes avec le brevetage du vivant. « Il ne nous appartient pas de renverser le capitalisme (puisque celui-ci s’en charge lui-même), mais il nous appartient de “préparer le terrain” pour faire en sorte que les sociétés post-capitalistes soient émancipées de l’État, du patriarcat ou de toute autre structure de domination. »
« Réorienter la démocratie en tenant compte des limites écologiques de la Terre »
Le principe du capitalisme est de priver les individus de leur capacité à satisfaire leurs besoins (passage de la propriété usufondée à la propriété fundiaire [1]) pour les forcer à le faire par la médiation du marché. Sous sa forme moderne, la séparation du travailleur avec ses moyens de production ou de subsistance s’est étendue à ses moyens de locomotion, de cognition, d’habitation, de reproduction. L’opposition au capitalisme s’élargit et dépasse les appartenances de classe, au nom d’un « choix politique contingent face à une situation singulière », en opposition à un projet écocide par exemple.
La crise écologique impose de prendre des décisions politiques radicales contraires aux intérêts du capitalisme. La transition écologique, si elle n’est pas accompagnée d’une transition politique, ne servira qu’à augmenter les inégalités et renforcer la domination des élites dirigeantes sur la société. Au nom du « capitalisme vert », EDF et d’autres entreprises ont recouvert l’isthme de Tehuantepec, dans le sud du Mexique, du plus grand champ éolien des Amériques, mais seulement 22 % de l’énergie « propre » produite alimentera des particuliers et le secteur public, 78 % seront destinés aux entreprises privées, comme Walmart et Coca-Cola. Pour Pierre Madelin, « un mot d’ordre s’impose donc : décroissance énergétique ou barbarie ! »
Village près d’un parc éolien dans l’État mexicain d’Oaxaca.
À propos de la croissance démographique, il explique que l’« espèce humaine » n’est pas en cause mais davantage « le mode de vie adopté par les élites, qui n’est ni durable ni universalisable ». Il faut donc « sacrifier l’égalité sur l’autel de la croissance économique » ou bien « réorienter la démocratie en tenant compte des limites écologiques de la Terre ».
Il consacre un chapitre au rôle que pourraient jouer les animaux dans une société post-industrielle, dénonçant la légitimité de la notion de « contrat domestique » et envisageant une profonde mutation de l’élevage avec un usage des animaux n’impliquant ni leur mort ni leur exploitation.
« La propriété privée et la propriété étatique ne sont que les deux faces d’un même processus de dépossession »
Si nous savons quelles solutions, quelles pratiques sociales et économiques permettraient d’assurer la transition écologique — de la suppression de l’obsolescence programmée à celle de l’agriculture intensive —, nous savons que le « système », qui en est parfaitement capable, n’en a aucunement l’intention. L’État moderne est le pendant politique du capitalisme, une variante dans la gestion de l’accumulation du capital, et même l’État-providence ne s’oppose que superficiellement à lui. « La propriété privée et la propriété étatique ne sont que les deux faces d’un même processus de dépossession. » Il faut admettre que nous ne vivons pas dans des démocraties mais dans des « oligarchies libérales », qui octroient à l’individu des droits et des libertés mais l’empêchent de participer effectivement au pouvoir et aux grandes décisions politiques. « Il n’y aura pas de sortie du capitalisme sans sortie du régime représentatif, car c’est fondamentalement au nom des exigences du premier que le second s’est imposé. »
Selon les philosophes du contrat social, le monde est régi par une métaphysique de l’ordre. Toutes les entités, les atomes comme les individus, sont incapables de s’organiser entre eux et ont besoin d’une extériorité fondatrice pour s’ordonner et se pacifier, les lois de Newton ou celles de l’État. La philosophie de l’écologie et l’anthropologie politique du socialisme libertaire prétendent au contraire que « les individus sont en mesure de s’organiser conformément à une puissance qui leur est immanente, sans devoir nécessairement s’aliéner, pour ne pas sombrer dans la guerre et le chaos, à la transcendance de l’État ». « Aucun élément du monde n’a d’existence en soi. […] À l’interdépendance des éléments et des êtres du monde répond l’interdépendance quasi ontologique des humains en société et, au-delà, l’interdépendance de la société des humains et du monde lui-même. »
Un mal invisible suscité par ce que Günther Anders a nommé le « décalage prométhéen » provoque « des effets délétères sur la capacité des êtres humains à être des agents moraux responsables, dans la mesure où il ne leur permet pas de se représenter les effets de leurs actes, qui s’insèrent dans des mécanismes gigantesques ». Pour y remédier, il suffirait d’associer à la décentralisation et à la relocalisation de l’économie celle de la pratique politique. C’est précisément ce que propose John Holloway avec sa « théorie des brèches » : « changer le monde sans prendre le pouvoir », « créer une contre-société écosocialiste au sein même du monde dominé par le capitalisme ». Pierre Madelin cite en exemple l’idéal libertaire des communautés utopiques, des phalanstères fouriéristes aux caracoles zapatistes et aux Zad, en passant par les communautés de la contre-culture fondées dans les années 1960, tout en mettant en garde contre le danger de l’isolement et celui de négliger l’affrontement avec le capitalisme sur son propre terrain.
La souveraineté alimentaire des sociétés paysannes garantit leur autonomie politique
En réponse à la question de l’échelle, il apporte, comme à toutes les questions, une réponse mesurée, critiquant « l’inflation tentaculaire et cancéreuse » de la ville mais en rappelant que Bernard Charbonneau avait mis en évidence comment « l’extension du groupe, en relâchant la pression sociale, avait donné naissance aux processus d’individuation, créant ainsi des foyers de savoir, de créativité intellectuelle et artistique, de cosmopolitisme », avait permis la naissance de la liberté, bien que celle-ci, pour survivre, devait désormais quitter les villes. Les mouvements politiques aujourd’hui source d’inspiration dans la lutte contre la tyrannie capitaliste reposent précisément sur des sociétés paysannes. Leur souveraineté alimentaire garantissant leur autonomie politique. Il préconise ensuite une articulation des pratiques locales d’autogouvernement dans une confédération de communes et de quartiers autonomes, pratiquant un « fédéralisme ascendant ». Il invite à radicaliser et approfondir la démocratie.
En conclusion, Pierre Madelin considère la situation désespérée et désespérante. Il est conscient que l’occultation des prises de conscience et des dénonciations précoces des risques et des nuisances, de la part des puissants de ce monde, prouve qu’ils n’ont pas déréglé et détruit les écosystèmes par inadvertance. Pierre Madelin distingue deux scénarios possibles : un effondrement économique accompagné d’un renforcement de l’État, adoptant une « gestion écototalitaire des ressources et des populations », ou alors un effondrement de l’État accompagnant celui de l’économie, soit au profit de forces armées paraétatiques de type mafieux ou terroriste, soit en laissant les populations s’autoorganiser. Ces deux dernières options pouvant cohabiter, comme les cartels de la drogue et l’EZLN (l’Armée zapatiste de libération nationale) au Mexique, Daech et les populations autoorganisées du Kurdistan, en Syrie.
La synthèse est époustouflante. Pierre Madelin, s’appuyant sur les analyses de nombreux penseurs, parvient à résumer de façon très nuancée les contradictions auxquelles nous sommes confrontés, à dessiner les lendemains possibles, à esquisser concrètement des propositions de changement de paradigme.
Dernière édition par Florage le Ven 29 Mai - 4:40, édité 1 fois
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
IV. DYNAMIQUE DE SORTIE
DU RAPPORT ENTRE LE CAPITAL ET LE VIVANT
intrinsèquement liée à la vie sur terre
1. contribution à la critique de l'idéalisme révolutionnaire
prolétarien ou humaniste, toujours anthropocentré
2. dynamique de l'inversion des rapports humanité-nature, effective contre le capital
3. aucune écologie politique ne peut remplacer ce processus révolutionnaire
1. contribution à la critique de l'idéalisme révolutionnaire,
prolétarien ou humaniste, toujours anthropocentré
l'existence d'une dynamique révolutionnaire est une question difficile à laquelle je m'étais confronté en 2014 dès l'instant où il m'apparut que le rapport capital-nature-vivant devait être pris en compte dans la théorisation communiste
en effet, si l'on considère comme dynamique l'action d'un sujet révolutionnaire humain, qu'est une classe sociale, le prolétariat comme pôle de sa contradiction avec le capital comme tout, il n'en est pas de même pour tout autre extérieur à ce rapport d'autant qu'il n'est pas un sujet pensant ni a priori agissant en un sens historique déterminé si ce n'est pas son évolution naturelle (Darwin...). Ces arguments sont ressortis récemment dans la discussion pour ou contre l'intégration à la théorie communiste, dans sa version strictement prolétarienne de la communisation, qui ne peut logiquement que rejeter une telle propositionNononyme a écrit:27 mai
On peut vouloir comme on peut intégrer le problème de cette « nature » que le capitalisme bousille, il n’en demeure pas moins qu’effectivement ce problème n’a pas de dynamique qui lui est propre…
j'ai dit partager certains des arguments opposés par RS avec une précision pouvant échapperRS a écrit:19 mai
De façon très générale, pour le moment, perso, je demeure sur une conception assez simpliste, j’en conviens : la “nature” n’a d’existence que par et dans un mode de production. En cela, elle ne peut être un terme en rapport avec le mode de production. Si le capital “dévaste la nature”, c’est une contradiction interne du MPC, pas un rapport (ou autre terme) avec la “nature”. La “nature” ne fait rien, n’y est pour rien, et à la limite “ne subit rien”, c’est une réalité inexistante en soi [...]
28 mai
Le problème et bien dans le fait de le poser comme “destruction de la nature” ce qui présuppose une existence de la nature que l’on dit ensuite subsumée mais aussi toujours existante en tant que telle, il me semble qu’il y a toujours deux fers au feu, du type : “le capital la produit comme son extériorité” (je cite de mémoire). Le genre de dialectique qui permet de ne jamais avoir tort en n’ayant jamais raison. Si c’est “subsumé”, “contradiction interne”, etc., il n’y a pas stricto sensu, “destruction de la nature”, quel que soit l’évidence réelle des faits ainsi décrits et leur “impact” (je n’aime pas trop le terme) dans la lutte des classes.
la nature comporte le vivant et le non-vivant
j'avais souligné qu'à strictement parlé, sur le plan logique et philosophique, RS avait raison contre ses contradicteurs, et pas seulement parce que prônant un sujet strictement prolétarien. J'ai récemment affirmé aussi qu'il n'y a pas possibilité pour le capital de "détruire la nature", mais seulement "le vivant", la première incluant celui-ci et comportant des éléments quasi inertes sur le plan social, si ce n'est comme participant des éco-systèmes y compris humains, ce qui peut être beaucoup : ex. vivre dans une grotte, protégé par de la roche du froid, des intempéries, des animaux sauvages, d'autres tribus humaines
la surdétermination du vivant
si le vivant n'a pas d'action réfléchie et orientée, il présente néanmoins une résistance physique à son exploitation : cela demande de la "force de travail", ce qui suppose une force de résistance, résultante comme on dit en physique. De même, sa destruction, par exemple par le feu, produit des contre-réactions se retournant contre qui a mis le feu, le pyromane pris dans l'incendie de la forêt qu'il a provoqué, le sanglier fuyant l'incendie fracassant sa voiture... et bien évidemment tout ce que le vivant produit en réaction à son exploitation qui se retourne contre l'humanité entière, exemple, le coronavirus
cela ne constitue pas une dynamique de sujet, mais surdétermine la dynamique des sujets humains que sont la classe capitaliste et ceux qui luttent contre elle, prolétaires ou non, dans une nouvelle dialectique des rapports humanité-capital-vivant
la fausse dynamique anthropocentriste de la révolution
examinons ces formules : « cette « nature » que le capitalisme bousille, ce problème pas de dynamique propre » (Nononyme), « La “nature” ne fait rien, n’y est pour rien, et à la limite “ne subit rien”, c’est une réalité inexistante en soi », « “destruction de la nature” présuppose une existence de la nature que l’on dit ensuite subsumée mais aussi toujours existante en tant que telle »
elles ne fonctionnent pour leurs auteurs que liées à cette ineptie historique et philosophique de RS : « la “nature” n’a d’existence que par et dans un mode de production », c'est-à-dire en refusant les phénomènes de la vie sur terre, tous en interactions, en rapports dynamiques qu'on le veuille ou non, par définition d'éco-systèmes imbriqués les uns dans les autres du micro au macro et réciproquement (exemples devenus lieux communs : les bêtes et les gens qui s'énervent par temps orageux, l'effet papillon, la pandémie de nature biologique et ses conséquences économiques et sociales, etc.)
cet anthropocentrisme redouble, en miroir, celui du capital car il considère toujours la "nature" comme extériorité, tout en affirmant qu'elle n'existe, subsumée ou non, « que par et dans un mode de production », une "extériorité interne", un oxymore parfait
la critique de ce courant absolutisant la mission révolutionnaire du prolétariat, nous l'avons souvent souligné, permet par surcroît (sic) celle de toute conception prolétarienne de la révolution, comme celle, à l'opposé, de l'humanisme-théorique de Temps Critiques avec sa Révolution à titre humain fondée sur une "tension de individu à la communauté humaine". Cette double critique a été faite depuis 2017 dans CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION
on peut dire paraphrasant Marx qu'en critiquant la théorie de la communisation comme l'opium des communisateurs, qui ne s'empare pas même de leur sujet le prolétariat, on tient la matrice de toute critique des idéologies révolutionnaires
la véritable dynamique est sous nos yeux
c'est bien évidemment l'ensemble des rapports complexes humanité-capital-nature qui sont dynamiques, ce qui ne signifie pas orientés historiquement et moins encore vers une révolution. Prendre en considération comme étant dynamique seulement ce qui s'orienterait vers une révolution, prolétarienne ou humaine, c'est isoler une problématique conceptuelle étroite de la réalité, dont elle tronque et tord la représentation en un sens déterministe. C'est d'emblée refuser la réalité écologique intrinsèque de ces rapports, au sens d'éco-systèmes en interactions, équilibres et déséquilibres compris, et, aux limites, la destruction du vivant, non celle de la nature, qui existait avant l'humanité et le capital, et qui existera après le capital, avec ou sans l'humanité, avec ou sans des êtres vivants au sens où l'on parle des conditions d'apparition de la vie, l'eau, etc.
cela me semble couler de source. Allez, pour tenir la route, une petite nature morte ?
Le Philosophe, André Martins de Barros, 2004
d'après Le Bibliothécaire d'Arcimboldo, 1570
2. dynamique de l'inversion des rapports humanité-nature, effective contre le capital
je renverse la formule "par surcroît" en effective, car cette lutte suppose une activité explicite et consciente, qui ne vient pas en plus comme par magie dans une opération du Saint-Esprit prolétarien, sur le modèle ancien où la révolution prolétarienne devait résoudre les inégalités hommes-femmes, le racisme, et toutes dominations dans le capitalisme, installant pour longtemps une hostilité du marxisme à la critique féministe, antiraciste, et écologiqueFD a écrit:Si les prolétaires qui ne veulent plus l’être « se sauvent », càd détruisent tous les rapports qui constituent le capital, ils sauveront l’humanité et la nature par surcroît.
c'est en effet l'inverse qui résulte du point 1. C'est la dynamique à l'inversion au sens de Jacques Camatte, et donc par tous moyens de luttes qui ne sont pas nécessairement frontales, mais auto-produisant une autre conscience de cette situation de possible auto-destruction de l'humanité dans le capitalisme, à tous niveaux des rapports sociaux et du psychisme, que Jacques Camatte appelle le risque d'extinction
ce problème suppose la connaissance de ses textes et des discussions afférentes, à partir d'ici :
- Lettre au sujet de la pandémie et du risque d'extinction, 23 mars 2020
- Instauration du risque d'extinction, 30 avril
- L'inversion n'est pas une stratégie, 23 mai
mon cheminement propre, en compagnie d'Adé et quelques autres, n'est pas collé à la pensée de Jacques Camatte. Nous y sommes arrivés par d'autres chemins, mais la rencontre de sa pensée a donné à la nôtre une décisive impulsion
3. aucune écologie politique ne peut remplacer ce processus révolutionnaire
ayant procédé à rebours, exposant le schéma d'inversion comme positivité du communisme en mouvement, il en ressort plus clairement la critique négative de l'écologie politique
en tant que politique, elle tombe sous la critique radicale de la démocratie politique et du démocratisme radical, c'est-à-dire une fine de l'État politique comme étant démocratisable, alors qu'il est l'essence de la démocratie sous le capital y compris dans sa forme opposée de la dictature
ici, nous retrouverons la réflexion d'Étienne Balibar partant de la critique de l'État par Marx, et distinguant dans sa fonction la politique et l'administration des choses. Voir 29 avril XXIX. LE POUVOIR POLITIQUE D'ÉTAT vs L'ADMINISTRATION DES CHOSES
en tant qu'écologique, écologisme, elle a toute chance de placer cette dimension en dominante de celle du capitalisme comme économie politique; c'est pourquoi, j'ai en introduction présenté la Critique de l'écologie politique comme complémentaire de la Critique de l'économie politique
(à suivre)
Dernière édition par Florage le Dim 31 Mai - 20:13, édité 1 fois
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
du 31 mai
V. INTRODUIRE LES SCIENCES DE LA COMPLEXITÉ
DANS LA RELATION HUMANITÉ-(CAPITAL)-NATURE
avec l'écopsychologie, étude de la relation Homme-Nature
DANS LA RELATION HUMANITÉ-(CAPITAL)-NATURE
avec l'écopsychologie, étude de la relation Homme-Nature
cet épisode fait appel à l'écopsychologie, qui ne prétend pas couvrir tous les aspects du problème que nous pointons : les rapports sociaux de l'humanité et de la "nature", qui sont inévitablement médiés par le Capital, c'est l'objet de la Critique de l'économie politique
31 mai
plus on creuse le sujet des RAPPORTS HUMANITÉ-(CAPITAL)-NATURE, plus on prend conscience qu'il est complexe, et plus l'on voit l'inanité des thèses prolétaristes assénant contre toute évidence que « l’extériorité de la nature est une construction sociale capitaliste », comme si l'humanité avait attendu des millénaires avant de s'en "séparer", donc de créer cette "extériorité" (cf Camatte et l'anthropologie)
il est bon de faire appel aux sciences de la complexité. J'ai donc jeté un œil dans La méthode, tome 1 : La Nature de la nature, Edgar Morin, 1977, sans trouver de choses que trop... compliquées, et pas suffisamment en rapport avec notre sujet, hormis en II ORGANISACTION, l'organisation active 5. Première boucle épistémologique : physique -> biologie -> anthropo-sociologie ---> physique, dont ce schéma est assez parlant, puisqu'il renvoie aux diverses sciences dures, de la terre, humaines et sociales dont nous avons souhaité l'interdisciplinarité
pour penser cette complexité, je conseille la lecture de La relation Homme-Nature, de Patrick Guérin et Marie Romanens, 2015, dans le webmagazine écopsychologie : « La matière subjective de l’écopsychologie n’est ni l’humain, ni le naturel, mais l’expérience vécue de l’interrelation entre les deux, que la “nature” en question soit humaine ou non-humaine*. » Par ces mots, Andy Fisher définit le sujet de l’écopsychologie : la relation homme-nature
* Andy Fisher, Radical ecopsychology, Psychology in the service of life, State University of New York Press, 2002
on y trouve des références à
- Phillipe Descola, Par-delà nature et culture, 2006
- Edgar Morin, La méthode II : La vie de la vie, 1980
- Nicole Huybens, La forêt boréale, l’éco-conseil et la pensée complexe. Comprendre les humains et leurs natures pour agir dans la complexité, 2011 etc.
ce texte, entre autres mérites, a celui de présenter les différentes "visions" de "la relation homme-nature : anthropocentrique, biocentrique, écocentrique, multicentrique". Il fait appel aux théories de la complexité, dont on sait que je fais un grand usage, en la mariant avec la dialectique, une idée qu'on trouvait chez Lucien Sève, auteur avec un collectif de scientifiques d'un livre auquel je me suis souvent référé : :
Emergence, complexité et dialectique - Sur les systèmes dynamiques non linéaires, 2005Fruit d'un travail collectif entre des scientifiques et un philosophe, ce livre a pour première originalité de se centrer sur ce qu'on y tient pour le cœur même de la complexité : la dynamique des systèmes non linéaires, où les rapports se font paradoxalement contradictoires entre tout et partie, cause et effet, déterminisme et imprédictibilité. Chaos, émergence, auto-organisation, complexité - à travers ces concepts aujourd'hui en plein débat paraît se révéler à nous plus qu'une série d'aspects inédits du réel une dimension fondamentale de ce réel tout entier.
La seconde originalité de cet ouvrage est de pousser la réflexion sur le sens philosophique de ces paradoxes scientifiques, en convoquant à nouveau ce grand absent de la culture logique contemporaine : la dialectique, ici exposée et mise en œuvre dans son ampleur sous des formes foncièrement repensées et mises à jour. La dialectique pour penser la non-linéarité, le complexe pensé dialectiquement : une nouvelle révolution paradigmatique ? Le débat est ouvert.
31 mai
il apparaît clairement que toute conception environnementale de l'écologie, toute écologie environnementale, tombe par définition sous le coup de cette critique (sauf quand le terme environnement n'est pas utilisé au sens de "ce qui environne"). Nous y revenons avec cette approche intégrant LES SCIENCES DE LA COMPLEXITÉ DANS LA RELATION HUMANITÉ-(CAPITAL)-NATURE en nous appuyant sur La relation Homme-Nature, de Patrick Guérin et Marie Romanens, 2015 :Deux représentations l’emportent bien souvent : la première inclut totalement l’humain dans la nature, la seconde les sépare. Pour Edgar Morin, ces deux visions relèvent d’un méta-paradigme, celui de la « simplification, qui, devant toute complexité conceptuelle, prescrit soit la réduction (ici de l’humain au naturel), soit la disjonction (ici entre l’humain et le naturel), ce qui empêche de concevoir l’unidualité (naturelle et culturelle, cérébrale et psychique) de la réalité humaine, et empêche également de concevoir la relation à la fois d’implication et de séparation entre l’homme et la nature(16). »
La méthode IV. Les idées : leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, 1991
on retrouve la "première boucle épistémologique : physique -> biologie -> anthropo-sociologie ---> physique" (Morin, 1977) : par la constitution physique, biologique de son corps, l'être humain comme animal, être vivant, répond aux mêmes lois dans sa nature interne que celles à l'œuvre dans la nature qui lui est extérieure, physiquement, biologiquement en interactions, ce ni l'Esprit de l'Homme ni le Capital qui en décident, et ce n'est pas moins vrai aujourd'hui qu'il y a 300.000 ans, à l'apparition d'Homo Sapiens et avant la séparation humanité-natureConnaître les processus qui animent les animaux, les végétaux, les écosystèmes demande de faire appel aux nombreuses disciplines qui en font l’étude : l’éthologie, la phytologie, la géologie, la systémique, l’écologie… Nous avons besoin de tous ces savoirs pour comprendre comment fonctionne la nature puisque celle-ci, n’étant pas dotée de parole, ne peut nous l’expliquer ! Par contre, en tant qu’être humain (et plus particulièrement en tant que psychologue), nous pouvons tenter de comprendre ce qu’il en est des processus qui animent l’homme en relation avec ce qui est « autre ».
[...]
Mais, auparavant, il nous paraît nécessaire de parler du phénomène de la perception. C’est en effet par l’intermédiaire des sens que nous entrons en contact avec l’environnement, que nous entrons en relation avec lui. Nous ne savons ce qu’il en est de lui en dehors de notre présence (ne serait-ce que de simple observateur). Il nous faut donc avoir à l’esprit que ce que nous percevons comme étant la nature n’est pas la nature elle-même (une nature objectivée), comme nous aurions tendance à le croire, mais le résultat de notre propre perception.
[...]
En fait, la nature n’existe pas de manière isolée, en tant qu’objet face à nous sujet. Elle est le terme d’un couple indissociable : nature-culture.
« La nature ne se laissant saisir d’abord qu’à travers notre perception, étant donc un ensemble de significations pour la conscience qui la vise, son existence en soi ne saurait avoir de sens déterminé. » Ronald Bonan, Apprendre à philosopher avec Merleau-Ponty, 2010
[...]
3. L’écocentrisme : quand le système est le centre à partir duquel s’évalue les décisions
S’il remet en cause l’anthropocentrisme, le biocentrisme reste cependant tributaire d’une approche individualiste qui n’attribue de réalité qu’aux organismes isolés en négligeant leur intégration dans leur milieu de vie. Or la protection de la biodiversité s’intéresse surtout à des entités supra-individuelles, les espèces et les écosystèmes.
L’écocentrisme propose une approche plus large afin d’inclure ces entités globales : les espèces, les communautés d’êtres vivants, les écosystèmes. Elles ont une valeur intrinsèque car elles sont une matrice pour les organismes. Il s’agit donc de les prendre en considération.
Dans une interview, Philippe Descola déclarait :
« Nous aurons accompli un grand pas le jour où nous donnerons des droits non plus seulement aux humains mais à des écosystèmes, c’est-à-dire à des collectifs incluant humains et non-humains, donc à des rapports et plus seulement à des êtres. »
La vision écocentrique s’appuie sur les découvertes systémiques de l’écologie scientifique : les éléments vivants (biotiques), et non vivants (a-biotiques) interagissent pour former un tout qui a sa cohérence propre. Elle se fonde sur l’existence même de la valeur systémique dans la nature.
En même temps, note Nicole Huybens, sa philosophie s’enracinerait dans un terreau traditionnel, notamment, le romantisme et le courant de la wilderness, qui considère l’être humain en lien étroit avec les éléments du monde plus-qu’humain et la nature comme un équilibre, plein d’harmonie et de beauté, à contempler et respecter.
L’éthique de l’écocentrisme repose sur l’analyse des conséquences des actes que nous accomplissons sur les écosystèmes.
4. Le multicentrisme : quand le centre est dans la coordination de l’un ET l’autre
Nicole Huybens relève que la vision écocentrique est entachée de plusieurs paradoxes :
– Les lois de la nature sont appréhendées et comprises en dehors de la présence de l’homme. Nous étudions les processus naturels en eux-mêmes, comme si l’homme n’y était pas mêlé. Mais qu’en est-il de la situation réelle, celle où il est inséré dans la nature ?
– Par ailleurs, les écosystèmes ne sont pas stables. Faut-il préserver à tout prix leur intégrité, au risque de contrevenir au processus naturel d’évolution ? Si l’on veut conserver les écosystèmes tels qu’ils sont, ne risque-t’on pas de contrevenir à la dynamique de changement, lente et puissante, de la nature ?
« Dans un monde complexe où la destruction de la nature s’accélère, agir efficacement pour la protection de la faune et de la flore n’est plus à la portée de n’importe quelle personne d’aussi bonne volonté soit-elle . »
– Enfin, la nature est autant « barbare » que « bienveillante » et les lois de la nature ne sont pas forcément toutes « bonnes » à suivre.
Si l’écocentrisme introduit à la complexité, il s’agit d’aller plus loin encore en proposant une vision multicentrique qui intègre « des antagonismes et des contradictions dans un cadre qui permet d’envisager leur complémentarité ».
L’écocentrisme « devrait permettre d’intervenir dans la complexité d’une problématique socio-environnementale, qui inclut et dépasse les trois premières visions et présente de manière articulée ce qui peut a priori apparaître comme des contradictions). » Jean-Claude Génot, Plaidoyer pour une nouvelle écologie de la nature, 2014
[...]
Dernière édition par Florage le Lun 15 Juin - 11:21, édité 1 fois
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
cette Critique de l'écologie politique ne va pas sans un travail sur la positivité des relations humaines à la nature, ceci dans tous les domaines de la vie. Exemple inattendu MUSIQUE, SONS de la NATURE, ET HUMANITÉ
3 nouveaux sujets :
- MUSIQUE, SONS de la NATURE et SOCIÉTÉ, présentation et développements
- musique, sons de la nature, et société (anthropologie et ethnologie de la musique, études, livres)
- INSTRUMENTS de MUSIQUE "NATURELS"
« Je ne peux plus respirer » :
la connexion entre racisme et crise climatique est évidente
la connexion entre racisme et crise climatique est évidente
si elle l'est pour certains, dont je suis, cela n'est pas évident, ni chez les écologistes, ce texte en témoigne, ni chez les puristes de la lutte des classes, le genre communisateur à la Carbure qui affirme en même temps : « Ce n’est pas en tant que Noir ou femme qu’on subit l’oppression » et « Le vert est la couleur du dollar »... Misère du nouveau négationnisme d'ultragauche !
ce genre d'enquête indique que les dominations et l'exploitation sont inséparables, et que le rapport à l'environnement, à la nature, en fait partie comme fondement d'une potentialité de lutte radicale contre le capitalisme
Aux États-Unis, la lutte contre le « racisme environnemental » est de plus en plus vive
Yona Helaoua, Reporterre, 13 juin
Washington (États-Unis), correspondance

Yona Helaoua, Reporterre, 13 juin
Washington (États-Unis), correspondance

Aux États-Unis, la mort de l’afro-américain George Floyd lors de son arrestation a provoqué une prise de conscience inédite du racisme institutionnel. Les minorités raciales, plus durement touchées par la pauvreté, les problèmes de santé ou encore les violences policières, sont aussi en première ligne de la crise climatique.
En une quinzaine de jours, les États-Unis ont vécu un bouleversement idéologique. Le meurtre de George Floyd, énième mort d’un Américain noir aux mains de la police, a provoqué une conversation inédite sur le racisme ancré dans les institutions du pays. Parmi ses composantes, le racisme environnemental est, depuis le début des années 1980, dénoncé par une partie du mouvement écolo. Il a toutefois tendance a être moins mis en avant dans les luttes.
Dans le domaine des sciences de l’environnement, le champ de la « justice environnementale » s’affaire à démontrer que les minorités raciales sont disproportionnellement exposées aux risques climatiques. En 1982, des protestations contre l’acheminement de déchets hautement toxiques vers une décharge située dans un comté à majorité noire de Caroline du Nord ont lancé le mouvement.
En 1987, une étude considérée comme fondatrice a expliqué comment les communautés avec un fort pourcentage de Noirs ou d’hispaniques avaient plus de risques d’avoir sur leur territoire un ou plusieurs sites de déchets toxiques. Les travaux sur le sujet se sont succédé depuis. Une étude de 2003 a ainsi montré que les Noirs avaient trois fois plus de risques que les Blancs de vivre dans un quartier où le trafic automobile, et donc la pollution, est dense.
Au total, plus d’un million d’habitants ont été évacués quand l’ouragan de catégorie 5 a frappé, le 29 août 2005.
Plus récemment, l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en 2005, qui a dévasté des quartiers noirs mal protégés par les digues, l’affaire de l’eau contaminée au plomb à Flint, une ville du Michigan à majorité noire [1] ou encore la lutte des Amérindiens de Standing Rock, opposés à l’arrivée d’un oléoduc sur leur réserve dans le Dakota du Nord, sont d’autres exemples de racisme environnemental.
Du racisme au sein du mouvement écologiste
Ces sujets bénéficient d’un traitement médiatique de plus en plus important. Mais les scientifiques et militants qui travaillent sur la question du racisme environnemental se plaignent de ne pas être encore assez entendus. Y compris par leurs pairs du monde écolo. « Il y a du racisme au sein du mouvement lui-même, où certains pensent qu’évoquer ces questions est une distraction », affirme Jacqueline Patterson, directrice du programme pour la justice climatique et environnementale pour l’organisation [NAACP|The National Association for the Advancement of Colored People], organisation américaine de défense des droits civiques, au site NBC News. « Personne n’enfile de cape blanche [en référence au Klu Klux Klan] mais le racisme et les biais implicites sont évidents. »
En 2016 de jeunes Sioux de la réserve sont venus manifester à New-York contre le projet d’oléoduc.
Elle explique ce problème par des raisons historiques : « Les racines du mouvement environnemental traditionnel viennent de la conservation de la flore, de la faune et des espaces sauvages. C’est faire un grand saut pour ces gens-là que de réfléchir aux droits humains et à la façon dont le racisme environnemental affecte les communautés. »
Robert Bullard, professeur d’urbanisme et de politique environnementale à la Texas Southern University de Houston, a fait l’expérience de cette résistance. En 1979, sa femme avocate a travaillé sur une plainte collective contre l’installation d’une décharge publique dans un quartier noir de Houston. Il avait alors étudié la question, mais avait reçu peu de soutien : « Il n’y avait pas de mouvement pour la justice environnementale en 1979. Il y avait des groupes environnementaux blancs qui ne comprenaient pas les problèmes et l’injustice, mais il y avait aussi des organisations noires qui se battaient pour les droits civiques et qui pensaient que ça [la justice environnementale] ne faisait pas partie de leur agenda », a-t-il expliqué à NBC News.
« Je ne peux plus respirer » : la connexion entre racisme et crise climatique est évidente
Robert Bullard est aujourd’hui l’une des voix les plus importantes aux États-Unis en matière de justice environnementale. En 1991, il a cosigné une lettre adressée à plusieurs ONG, comme l’Environmental Defense Fund, le Natural Resources Defense Council ou encore le Sierra Club, pour dénoncer le manque de diversité en leur sein. « C’était pour les mettre au défi d’être fidèles à leurs idéaux », explique-t-il à NBC News. « S’ils sont pour la protection de l’environnement, ils devraient parler de la protection de l’environnement pour tous, pas seulement pour les élites et les classes moyennes blanches. »
Un rassemblement du mouvement Black Lives Matter, soit « les vies noires comptent »
Pour le révérend Michael Malcom, directeur d’Alabama Interfaith Power and Light, une organisation religieuse engagée contre la crise climatique et le racisme environnemental, la connexion entre les deux combats est pourtant évidente et se résume une phrase : « Je ne peux pas respirer. » Les derniers mots soufflés par George Floyd, écrasé sous le genou du policier qui l’a tué, sont valables dans une multitude de situations : « Qu’il s’agisse de la pression ressentie à travers une politique, de la violence que nous subissons de la part de ceux qui sont supposés nous protéger ou de la brutalité à laquelle nous faisons face à cause de la pollution », la réponse a toujours été « je ne peux pas respirer », indique-t-il au site NBC News.
[1] En 2014, le réseau d’eau potable de cet ex-ville industrielle a été pollué au plomb. L’empoisonnement de milliers d’enfants pourrait avoir des conséquences terribles sur leur santé durant des décennies.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
en apparence une bonne nouvelle : « seuls 36% des personnes interrogées considèrent le système économique capitaliste compatible avec la lutte contre le changement climatique », mais à tempérer avec les solutions qui ont la préférence des sondé.e.s, puisqu'aucune ne conduit à sortir du capitalisme. Pas de quoi nous étonner...
[sondage]
Les Français·es largement favorables à un changement de modèle économique
à contre-courant des annonces gouvernementales
Greenpeace, 14 juin 2020
Les Français·es largement favorables à un changement de modèle économique
à contre-courant des annonces gouvernementales
Greenpeace, 14 juin 2020
Un sondage [1] réalisé par l’institut BVA pour Greenpeace France démontre qu’une large majorité de Français·es considèrent qu’il faut réformer en profondeur notre système économique pour lutter contre le changement climatique et sont favorables à un changement conséquent de modèle dans les domaines des transports, l’énergie, l’agriculture et l’alimentation.
Alors que le gouvernement tente d’émettre un nouveau chèque en blanc aux entreprises dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR) annoncé en conseil des ministres mercredi [2], les Français·es comptent au contraire sur l’État pour mettre en œuvre ces réformes, notamment en imposant plus de contraintes aux entreprises.
Pour Greenpeace, ce troisième PLFR doit fixer des objectifs contraignants de réduction d’émissions pour les grandes entreprises, assortis de sanctions dissuasives en cas de non-respect, comme l’interdiction de verser des dividendes [3] – une mesure soutenue par 86% des personnes interrogées.
Selon ce sondage, seuls 36% des personnes interrogées considèrent le système économique capitaliste compatible avec la lutte contre le changement climatique. Une majorité souhaite que les ménages les plus aisés contribuent davantage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (54%), et la transition écologique est jugée pour 77% des Français·es comme une vraie opportunité pour l’emploi.
Une transition radicale est plébiscitée dans tous les secteurs :
– Agriculture : 91% souhaitent développer rapidement une agriculture locale et écologique, et 87% interdire l’entrée sur le territoire français de produits ayant potentiellement contribué à la déforestation dans d’autres pays du monde.
– Alimentation : 91% des Français·es souhaitent rendre l’alimentation bio accessible à tous et 80% veulent que l’argent public dédié à l’agriculture soit alloué en priorité aux agriculteurs bio et/ou déjà engagés dans la transition écologique.
– Énergies : 81% approuvent la réalisation d’investissements conséquents par le gouvernement pour promouvoir les énergies renouvelables quand, à l’opposé, une minorité (36%) considère qu’il faudra construire de nouvelles centrales nucléaires (EPR) ; par ailleurs, 67% pensent que l’argent public ne devrait pas être dépensé pour subventionner des énergies fossiles.
– Mobilité : plus de la moitié des personnes interrogées sont en faveur de la suppression des lignes aériennes intérieures lorsqu’il existe des alternatives en train de moins de six heures (58%), et 65% soutiennent la proposition d’un malus plus important sur les véhicules les plus polluants comme les SUV.
– Commerce : 82% estiment que la France devrait s’opposer à tout accord de libre-échange avec des pays qui ne réduisent pas suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre.
Pour mettre en œuvre ces réformes, les Français·es estiment majoritairement que c’est d’abord à l’État de prendre ses responsabilités (57%), et 76% pensent qu’il doit être contraint par la justice à agir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris.
Enfin, 88% souhaitent que les responsables politiques obligent les entreprises à émettre moins de gaz à effet de serre, et 81% pensent que l’État ne devrait pas accorder d’aides aux entreprises polluantes sans contreparties écologiques contraignantes.
C’est pourtant la direction inverse qu’a pris le gouvernement depuis la crise du COVID-19. En effet, 23 milliards d’euros ont été débloqués en soutien aux secteurs automobile et aéronautique, sans remettre en cause leur modèle de développement. Aucune réduction sérieuse du trafic aérien, aucune limitation du nombre de voitures sur les routes, ni aucune mesure pour soutenir le secteur ferroviaire, une des alternatives indispensables à développer, n’ont été annoncées.
« Cette étude montre que les Français·es sont largement favorables à des changements structurels radicaux pour faire face à l’urgence climatique, bien loin des mesures timorées annoncées depuis le début de la crise. Cette période si singulière est une opportunité incroyable pour les responsables politiques. La puissance publique n’a jamais été autant réclamée par la population. Des appels à des mesures fortes et des changements substantiels se font entendre de partout. C’est le moment de réguler et repositionner l’économie, notamment en imposant des mesures contraignantes aux grandes entreprises », souligne Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.
Parmi les autres enseignements de ce sondage :
– 72% estiment que les compagnies pétrolières font partie des principaux responsables du changement climatique.
– 73% des Français·es vont maintenir ou accélérer leurs efforts en faveur d’un développement plus durable.
– 58% considèrent qu’il est légitime que les citoyens désobéissent ou enfreignent la loi pour lancer l’alerte sur les menaces pesant sur la planète.
– 61% sont favorables à l’introduction de deux repas végétariens dans les cantines scolaires.
Notes aux rédactions
[1] Le sondage a été effectué par Internet du 27 mai au 1er juin 2020 auprès d’un échantillon représentatif de la population française composé de 1003 répondant·es âgé·es de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession, région, catégorie d’agglomération et nombre de personnes dans le foyer.
L’ensemble des réponses sont disponibles ici
[2] https://www.greenpeace.fr/espace-presse/troisieme-budget-rectificatif-plfr-3-reaction-de-greenpeace-france/
[3] Dans un rapport publié début mai, Greenpeace France a calculé que les 10 entreprises les plus climaticides du CAC 40 sont responsables de l’émission de 3,1 milliards de tonnes d’équivalent CO2 , tout en ayant versé près de 20 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires.
BNP Paribas, qui a le plus lourd bilan carbone du CAC 40 (du fait notamment d’investissements dans les énergies fossiles), a versé 3,7 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, tandis que la major pétrolière Total, dont l’empreinte carbone est comparable à celle du territoire national, leur a versé 6,6 milliards d’euros de dividendes.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
fiche de lecture publiée par lundimatin à l'occasion de sa réédition, Apocalypse et Révolution fait partie des Convergences anciennes signalées par Jacques Camatte, Invariance ayant publié sa première traduction française à partir de 1975. lundimatin eût pu le signaler... la filiation étant davantage du côté de Camatte que de Anselm Jappe, et le lien à faire plus fécond qu'avec le situationnisme
en attendant, pas obligé de l'acheter, puisqu'il est en ligne chez Camatte (moi, lézeur des zéditeurs, je les emmerde)
Apocalypse et Révolution
1 – Saut périlleux
2 – La préhistoire comme présent
3 – Le "sacré" profané
4 – Chirurgie esthétique
5 – Art de vivre
6 – Contra "christianos"
7 – Les infortunes de la passion
8 – La dialectique réelle
« LA RÉVOLUTION PART DU CORPS »
Note sur Apocalypse et Révolution, de Giorgio Cesarano et Gianni Collu
lundimatin#247, 15 juin 2020
Note sur Apocalypse et Révolution, de Giorgio Cesarano et Gianni Collu
lundimatin#247, 15 juin 2020
Depuis jeudi dernier, on peut trouver en librairie Apocalypse et Révolution de Girogio Cesarano et Gianni Collu, réédité par les éditions La Tempête. Ce livre a été rédigé en 1972 pour répondre à la parution du rapport du Club de Rome, Halte à la croissance. Émanant du MIT et financé par la FIAT, le rapport préconisait une « croissance zéro » et une limitation du capitalisme. Dès sa parution, Cesarano et Collu réagissent par une analyse précoce et subtile de la façon dont le capitalisme mute dans ces années-là : ses nouvelles armes sont désormais le millénarisme religieux, la colonisation de l’individualité et le développement d’une économie de la dette. Ils proposent également un renouvellement des termes de l’antagonisme révolutionnaire qui ne serait pas seulement l’affrontement entre les classes mais le combat du corps de l’espèce humaine contre sa mise à mort par le processus de production capitaliste. À ce qui remet en cause la survie même de l’espèce, ce livre oppose une certitude : la révolution part du corps.
Giorgio Cesarano fut un auteur proche de la critique situationniste en son temps. À l’occasion de la réédition de son Manuel de Survie, nous avions publié un entretien fort instructif dans nos colonnes. Il participa également à la fondation du groupe Ludd, dont Anselm Jappe nous avait déjà parlé ici.
Les rares initiés aux écrits de Giorgio Cesarano forment une communauté secrète. C’est sûrement parce que cet auteur a produit une pensée totale et sans compromis, profonde et dialectique, écrite dans une prose enflammée qui ne se laisse pas facilement pénétrer, qu’elle continue, bien que souterrainement, à fasciner près de cinquante ans plus tard. Tous les écrits théoriques publiés du vivant de l’auteur furent, selon ses propres aveux, rédigés « sous l’effet de l’urgence ». Cesarano a perçu avec une grande acuité que, dans les années 1970, une brève fenêtre s’ouvrait, qui pouvait très rapidement et sournoisement se refermer et dans laquelle il fallait violemment lutter contre les mystifications de « la politique ». Son suicide en 1975, alors qu’il avait 47 ans, peut se comprendre comme un refus de voir cette chance historique s’éteindre dans une fictive libération.
D’une envergure et d’une densité impressionnantes, la pensée de Cesarano compte parmi celles qui transforment irrémédiablement notre façon de voir et de vivre. Et les transforme non parce qu’elle nous apporte un complément d’information sur une thématique – comme tant de livres périssables s’en contentent – mais parce qu’elle rend lisibles les justes conflits que nous pressentions en nous-mêmes, sans savoir les nommer adéquatement. Lecteur avide, inspiré tant par la psychanalyse que l’anthropologie, par le marxisme que par la biologie, Cesarano produit une vision du monde désabusée et exigeante, à la hauteur non seulement de son propre temps mais aussi de notre présent. La théorie de la valeur, des formes de narcissismes contemporains, l’écologie, la critique de la psychiatrie (et celle de l’anti-psychiatrie), de la théologie, mais aussi l’amour, le couple, la passion, le désir et la transgression sont autant de thèmes que Cesarano aborde et dynamise dans la perspective d’une rupture avec la misère de la survie.
Les titres de ses ouvrages ont pris, à mesure que l’urgence s’approfondissait et que les horizons se bouchaient, une signification particulière. Comment en effet, alors que le mot d’apocalypse est maintenant dans toutes les bouches, et que toute solution réformiste semble définitivement irréaliste, ne pas être interpellés par un livre de 1972 qui posait déjà le conflit dans les termes d’apocalypse ou de révolution ? Par un auteur qui, dès 1974, proposait dans un Manuel de survie de se débarrasser des illusions de la fiction mutilante du Moi pour poser enfin sérieusement celle de notre présence au monde ?
Lorsque Cesarano écrit ces livres, le Club de Rome, vaste réunion d’experts interdisciplinaires issus des tendances les plus avancées du capitalisme, vient de publier Les limites à la croissance. Ce texte, inaugural de l’essor de l’écologie de politiciens qui se développera plus tard et dans laquelle le pire de ’68 se vautrera confortablement, entendait offrir une solution durable à la crise tant sociale qu’économique que traversait le développement du capital dans ces années-là. Financé par la Fiat, l’appel à une limitation de la croissance, à la frugalité, et à une meilleure gestion des ressources, apparut immédiatement à Cesarano comme une farce qui méritait la plus grande attention. Cette publication arrive de surcroît peu de temps après l’émergence du puissant mouvement révolutionnaire italien, auquel Cesarano, renonçant à sa vie d’avant et alors qu’il avait déjà quarante ans, s’était donné à corps perdu. C’est ainsi de l’intérieur de ces luttes, et aussi des nôtres, que Cesarano (nous) parle, qu’il (nous) met en garde contre l’acceptation de l’horreur dans sa prétendue contestation, et (nous) indique les enjeux d’une guerre à outrance contre le monde de la production.
Ce que cette parution du Club de Rome rendait finalement visible, c’était que le capital devrait se confronter à une crise sans précédant et qu’il n’a jamais résolue : la limitation des ressources de la biosphère. La puissance mortifère de l’économie scie la branche sur laquelle elle est assise mais entraîne dans sa chute l’humanité tout entière. Ce ne sont pas seulement les conditions de vie qui sont devenues impossibles à partir de ces années-là, mais à long terme les conditions de survie même de l’espèce. L’antagonisme dans un tel contexte ne peut-être que total et absolu, et tout type d’intermédiaire apparaît comme un mensonge criminel. Cependant, alors même que la logique abstraite du capital est responsable d’une telle situation, celui-ci tentera, par tous les moyens, de se faire passer pour la dernière utopie possible. Les scientifiques endosseront désormais les habits de prophètes à qui les êtres humains devront léguer aveuglement toute confiance. Face au rouleau compresseur d’une domination impersonnelle et destructrice, l’alternative devient fatale : ou bien l’apocalypse, ou bien la révolution.
Cette utopie-capital se construit dans les années 1970 alors que les machines tendaient à prendre une part considérable dans le travail productif, et qu’il fallait ouvrir de nouveaux terrains à l’extraction de plus-value. Le développement du capital fictif – fictif en ceci qu’il ne se base pas sur de la valeur présente mais à venir – s’accompagne alors d’une colonisation inédite des intériorités. Surmonter une crise, pour le capital, cela ne signifie pas seulement réorienter l’économie, mais aussi produire un homme nouveau adéquat à celle-ci, un homme qui soit capable de la soutenir. La crise économique induit une crise métaphysique, une crise de sens, que le capital cherchera à tout prix à colmater. L’investissement dans la « personne sociale », c’est-à-dire l’individu qui, par le mouvement dans lequel il prétend se libérer, se trouve séparé de ses désirs réels mais rassasié par l’industrie culturelle, intégralement soumis aux exigences de la société et parfaitement dépendant d’elle, fut l’une des armes les plus sournoises et efficaces du capitalisme des années 1970. Il est difficile, en lisant les lignes que Cesarano consacre à la « personne sociale », de ne pas penser à ces « réseaux », dans lesquels chacun, persuadé de l’originalité de sa story, affiche la misérable homogénéité des formes de vie du capital. Ce que Cesarano analyse, en reprenant les catégories de la linguistique, comme une domination de la langue sur la parole, c’est-à-dire du sens mort et désincarnés sur le sens vivant, traduit cette intronisation sans précédant des exigences du capital dans la vie des hommes.
Le capital fictif également, ne se fondant plus sur un travail qui est présent, mais sur le crédit et la spéculation, se doit, pour assurer sa domination, de réintégrer les discours théologiques. Le crédit est donc un crédit de sens. Toute crise économique engendre une crise métaphysique, une crise sur le sens de la vie. Celle-ci peut-être mis à profit par le capital afin de soumettre les individus à ses exigences, à son sens. Pour écraser toute affirmation, il doit se faire lui-même affirmatif. C’est ainsi que le discours de l’apocalypse, habilement manié par les nouveaux prophètes du Club de Rome et de l’écologie d’État, témoigne d’un investissement du vocabulaire religieux adéquat aux réorganisations nécessaires à l’économie capitaliste. La théologie ne s’est jamais séparée du discours légitimant une réorganisation de l’économie : elle permet de faire écran, en offrant un sens fictif à une peur produite, aux termes d’un véritable antagonisme révolutionnaire.
Cette prise en charge de la vie de l’individu – une fois réduit au rôle de « personne sociale » – qui se développe parallèlement au développement de la cybernétique et se justifie à travers un discours apocalyptique, acquiert, dans les temps troublés que nous traversons, une inquiétante actualité. La « société thérapeutique » – terme préférable à celui, usé jusqu’à la corde, de « biopolitique » – produit l’homme à son image et l’identifie à sa survie. Comme le résume Jacques Camatte, « le développement du capital est délinquance et démence. Maintenant tout est permis ; il n’y a plus de tabou, d’interdit. Mais, en vivant les diverses ’’perversions’’ les hommes et les femmes peuvent se perdre, se détruire et ne plus être ’’opératoires’’ pour le capital ; d’où la nécessité d’une communauté qui les réinsère toujours dans celle du capital (plus exactement cette dernière prend la dimension d’une communauté thérapeutique). Un ensemble de spécialistes-thérapeutes serviront de médiateurs pour cette réinsertion. » La crise de sens se résout dans une gestion et une prise en charge des moindres gestes et par un développement inégalé de la propagande. Mais il s’agit d’une propagande de la « créativité individuelle », du « développement personnel » : une propagande de l’Ego-entrepreneur. Cependant, la pensée de Cesarano n’en reste pas à ce constat sinistre. Grâce à l’archéologie et à la biologie, Cesarano perçoit dans les conflits contemporains des questions non résolues de l’histoire la plus longue. L’émergence du sens, survenue par la rupture de l’homme d’avec l’animal, a permit le développement des pouvoirs religieux et des chefferies. C’est par différentes prothèses, tant linguistiques, symboliques et religieuses, que le corps s’est peu à peu séparé de lui-même pour faire consister le monde comme chose qui lui fait face. Si les questions métaphysiques ont une histoire, elles se résoudront donc historiquement.
La violente introduction des prothèses abstraites, dont la domination capitaliste du corps est l’aboutissement appelle, selon les termes de Cesarano, une révolution dans laquelle il s’agit, non de changer les dirigeants au pouvoir, mais « une révolution biologique définissant de façon irrévocable le sort de l’espèce. La libération vis-à-vis de la mort immanente, coïncide avec la libération du corps de l’espèce vis-à-vis de la ’’machine’’ aliénée, qui s’est emparée de ses modes d’évolution et les transforme en pièges mortels ».
Cesarano fut un homme habité par la certitude, intime et profonde, que le sens ne se laisserait pas recouvrir, que la vie s’insurgerait fatalement contre ce qui, chaque jour davantage, la mutile et la nie. Il supposait que dans les années 1970, cette domination de l’intériorité n’en était qu’à une phase de « domination formelle », ce qui laissait effectivement un écart, une chance. On peut se poser légitimement la question de savoir si les délires transhumanistes et la « révolution » numérique n’ont pas définitivement achevé cette colonisation, et si donc nous n’en sommes pas désormais au stade de la « domination réelle » du capital sur le corps. La capacité à séparer les êtres, tant d’eux-même qu’entre eux, et à les relier uniquement à travers le miroir de leurs « masques » est parvenu à un degré de sophistication effrayant. On peut constater également que la réponse capitaliste à l’antique question du sens commence à se fissurer de part en part. Les insurrection qui ne manquerons pas d’advenir poserons de façon toujours plus cruciale des questions de vie et de mort, et même de la vie biologique contre la mort organisée. En ce sens, Cesarano devient un interlocuteur privilégié, et peut nous transmettre, plutôt que des espoirs toujours déçus, la certitude qu’une autre vie est possible, qu’elle se construit déjà à présent et qu’elle n’abdiquera pas infiniment.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
d'hier, j'ajoute dessous une vidéo avec Andreas Malm, du 26 mai : Corona Capitalism: Struggles Over Nature
recherche Armel Campagne
Les chercheurs éco-marxistes ont en commun d'avoir exploré le lien entre capitalisme et dérèglement climatique. Cependant, ils divergent sur une question cruciale : la nature et le climat sont-ils extérieurs au capitalisme, nécessitant donc une révolution anti-capitaliste pour être sauvés, ou bien constituent-t-ils une contradiction interne à celui-ci, le menant structurellement à son effondrement ?
VI. QUOI DE NEUF ENTRE MARXISMES ET ÉCOLOGIE ?
Le choc des éco-marxismes face au dérèglement climatique
Armel Campagne, Terrestres, 1 juin 2020

Le choc des éco-marxismes face au dérèglement climatique
Armel Campagne, Terrestres, 1 juin 2020

recherche Armel Campagne
Les chercheurs éco-marxistes ont en commun d'avoir exploré le lien entre capitalisme et dérèglement climatique. Cependant, ils divergent sur une question cruciale : la nature et le climat sont-ils extérieurs au capitalisme, nécessitant donc une révolution anti-capitaliste pour être sauvés, ou bien constituent-t-ils une contradiction interne à celui-ci, le menant structurellement à son effondrement ?
Après une histoire remarquable de l’essor du capitalisme fossile dans Fossil Capital1, partiellement disponible en français dans L’anthropocène contre l’histoire3, l’historien et militant éco-socialiste Andreas Malm s’attaque dans The progress of this storm. Nature and society in a warming world (Verso, 2018), son dernier livre paru – en attendant La chauve-souris et le capital. Notes sur une pandémie dans un monde qui se réchauffe et Comment saboter un pipeline ?2 –, à l’ensemble des théories post-dualistes au sujet du dérèglement climatique, y compris celle de l’éco-marxiste Jason Moore, dont l’ouvrage principal sera bientôt disponible dans une traduction française sous le titre de Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital4. Un débat riche d’enjeux actuels à l’heure d’une pandémie qui illustre particulièrement bien les relations complexes du capitalisme aux milieux naturels5.
Les théories post-dualistes ont en effet en commun, au-delà de leurs nombreuses différences, de considérer l’opposition entre « nature » et « société » comme fallacieuse. En effet, selon elles, il n’y aurait que des « hybrides » de nature et de société, pour reprendre l’expression de Bruno Latour, figure centrale des théories post-dualistes : le dérèglement climatique n’est ainsi ni complètement « naturel » ni complètement « social », de toute évidence. Malm s’accorde volontiers avec leur critique du dualisme cartésien, qui suppose une séparation radicale entre « nature » et « société », un « grand partage » conceptuel rendu obsolète à l’aune du dérèglement climatique d’origine anthropique. Néanmoins, s’il y a bien une matérialité commune aux processus climatiques et aux sociétés humaines, rendant possible l’existence même du dérèglement climatique du fait des émissions d’origine humaine de gaz à effet de serre, il n’y a pas moins une autonomie des processus climatiques vis-à-vis des sociétés humaines (et vice-versa), d’où l’impossibilité d’un contrôle humain du climat. L’irréductibilité des uns aux autres explique d’ailleurs l’existence du dérèglement climatique, puisque s’il n’y avait pas d’autonomie du climat vis-à-vis des sociétés humaines, celles-ci n’auraient pu dérégler celui-ci de manière incontrôlée, provoquant « un hiatus irrémédiable dans l’équilibre complexe du métabolisme »6 entre climat et sociétés humaines. La non-reconnaissance de cette irréductibilité, a contrario, implique une possibilité de contrôle humain du climat au travers des techniques de géo-ingénierie. D’autre part, l’hybridisme latourien peut mener à une position climato-sceptique, puisque dans une approche post-structuraliste, il n’y a pas de “nature” indépendante des sociétés humaines, celle-ci étant une création discursive.
Malm s’attaque donc au dualisme cartésien et à l’hybridisme latourien en proposant un dépassement de leurs apories respectives. Il défend, d’une part, un « monisme de substance » reconnaissant qu’il n’existe qu’un monde matériel commun aux processus climatiques et aux sociétés humaines, face au dualisme cartésien et ses potentialités climato-sceptiques. D’autre part, Malm promeut un « dualisme de propriétés » reconnaissant une autonomie au climat et aux sociétés humaines, face à l’hybridisme latourien et ses potentialités climato-sceptiques ou démiurgiques.
Malm s’en prend particulièrement aux incohérences de Moore à ce sujet, puisque celui-ci est obligé de recourir à des distinctions conceptuelles entre nature et capitalisme, y compris pour développer sa thèse innovante au sujet des contradictions écologiques internes au capitalisme : c’est du fait même qu’il y a une irréductibilité des processus biogéochimiques et de l’accumulation capitaliste qu’il peut y avoir une érosion massive des sols entraînant des crises écologiques du capitalisme agraire. Ainsi, si Moore peut défendre à un niveau théorique un post-dualisme intégral, dès qu’il retourne à ses explications historiques, il est obligé de recourir à un dualisme de propriétés, même s’il a raison d’insister sur l’existence d’une matérialité commune au capitalisme et aux processus biogéochimiques.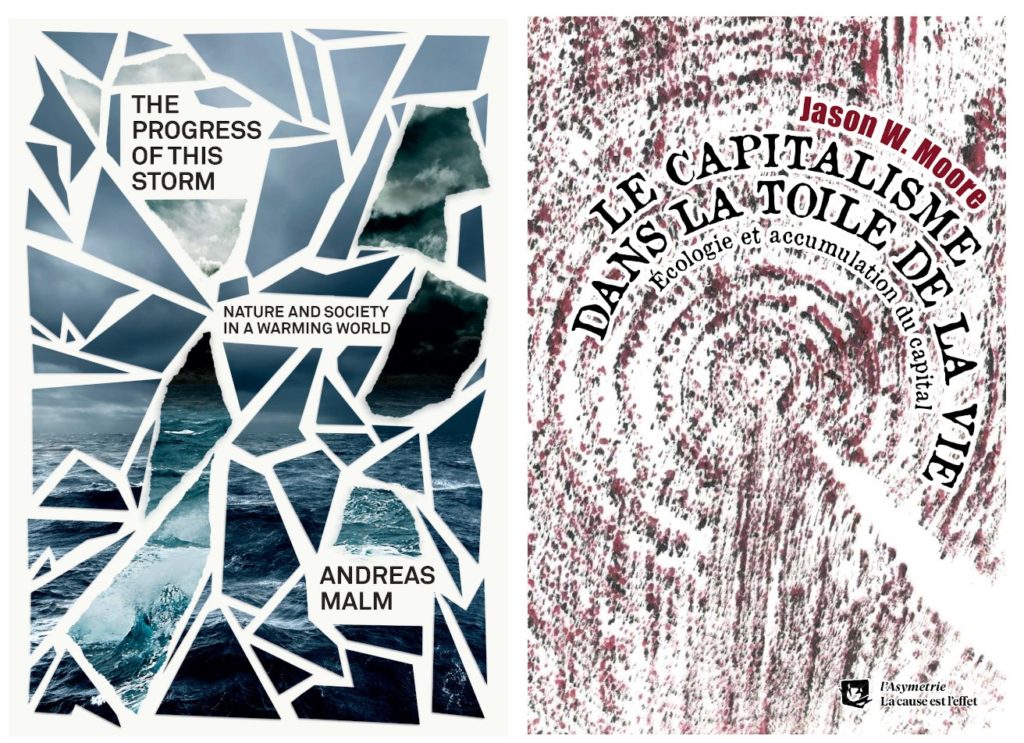
Néanmoins, face au dérèglement climatique, l’essentiel n’est pas d’y voir une contradiction interne au capitalisme, puisqu’elle favorise une position d’attente de l’effondrement d’origine climatique du capitalisme, alors qu’il s’agit d’en finir au plus vite avec celui-ci au nom de ses conséquences extra-capitalistes. D’autre part, l’hypothèse de Jason Moore d’une crise climatique du capitalisme à cause d’une hausse tendancielle des salaires du fait de l’augmentation des prix agricoles ne se vérifie pas. En réalité, le capitalisme et ses principaux représentants, les capitalistes, seront plutôt les dernières victimes du dérèglement climatique, grâce aux OGM, aux usines de désalinisation de l’eau, à l’accès aux réserves d’énergies fossiles arctiques, aux assurances-risques, aux marchés du carbone, au maintien de l’ordre militaro-policier et, en dernier ressort, aux techniques de géo-ingénierie. Selon Malm, leur inaction même résulte du sentiment qu’ils en sortiront indemnes. Les premières victimes sont bien plutôt les populations rurales des périphéries du capitalisme mondial, qui perdent parfois tout et se retrouvent obligées de migrer au sein des centres urbains et donc de grossir l’armée de réserve du capital, entraînant, contrairement aux prévisions de Moore, une baisse des salaires. Le capitalocentrisme de Moore, s’il peut être intéressant dans l’étude des contradictions internes au capitalisme agraire, aboutit néanmoins au sujet du dérèglement climatique à une paralysie politique plutôt qu’à une nécessaire radicalisation de l’antagonisme des principaux responsables et des principales victimes du dérèglement climatique.
Face au dérèglement climatique et à ce capitalocentrisme, Malm propose un parallèle entre l’autonomie des prolétaires vis-à-vis du capital, objet des théoriciens opéraïstes de l’Italie des années 1960-70, et l’autonomie des processus biogéochimiques vis-à-vis du capital, mise en avant dans un récent ouvrage de Carolyn Merchant7. Les processus biogéochimiques ont ainsi leur autonomie relative – quoique sous influence humaine –, puisqu’ils obéissent à leurs propres lois (autonomie provient de autos, soi, et nomos, loi), et non aux lois du capital, et cela quand bien même il s’agirait d’une autonomie dépourvue de capacité d’action consciente, contrairement à celle des prolétaires. Le capital n’est ainsi jamais parvenu à une subordination complète des processus biogéochimiques et des prolétaires, ou au contraire à s’en émanciper, en dépit du développement des forces de production technologiques. Le développement des énergies fossiles et des machines thermo-industrielles depuis deux siècles ont certes permis au capital de devenir partiellement autonome vis-à-vis des cycles naturels ou du labeur musculaire du prolétariat, mais cette tentative d’autonomisation du capital a précisément conduit au dérèglement climatique, réintroduisant l’autonomie des processus biogéochimiques vis-à-vis du capitalisme de manière brutale. Et de même qu’il a toujours introduit de nouvelles technologies pour faire face aux luttes ouvrières, sa solution face au dérèglement climatique sera probablement de nature technologique, au risque d’une affirmation d’une ampleur inédite de l’autonomie du climat vis-à-vis des techniques de géo-ingénierie.
Néanmoins, il ne s’agit pas de rejeter en bloc l’approche de Moore au profit de celle de Malm, mais plutôt de tenter une combinaison – esquissée dans Le Capitalocène – des forces respectives de ces deux éco-marxismes. Ainsi, il y a bien des contradictions écologiques internes au capitalisme (le Covid-19 en est un bon exemple) et des « externalités » écologiques d’origine capitaliste. Les critiques de Malm et de Moore du dualisme cartésien sont complémentaires, avec d’une part une insistance sur ses potentialités climato-sceptiques, et d’autre part sa conceptualisation comme condition idéologique du développement du capitalisme à travers une dissociation dévalorisante des non-humains vis-à-vis des humains – une vision qui était d’ailleurs celle de Merchant à l’origine. Au-delà du cas de Moore, on peut suggérer suite à Troy Vettese8 qu’il existe d’autres travaux sur des sujets connexes qui utilisent de manière pertinente une approche latourienne critique, notamment ceux de Timothy Mitchell dans The Rule of Experts9, à rebours du technocratisme de certains écrits de Latour, ou de Daniel Schneider dans Hybrid Nature10, une histoire des usines de traitement des eaux usées qui insiste sur une irréductible autonomie de processus biogéochimiques et des prolétaires vis-à-vis du capital.
Par ailleurs, le cadre politique de Malm est éminemment problématique. D’une part, il défend un « léninisme écologique » particulièrement autoritaire, notamment dans une interview à Révolution permanente : « Les idées anarchistes doivent être combattues ; elles ne nous mèneront nulle part. Je pense qu’il est temps de commencer à expérimenter quelque chose comme un léninisme écologique »11. Lorsque l’on connaît l’ampleur des massacres – notamment d’anarchistes – opérés sur ordre de Lénine et de Trotsky entre 1917 et 1921, ce genre de propos, même s’il n’appelle évidemment pas à tels moyens, n’en demeure pas moins très menaçant pour une écologie politique qu’on voudrait plurielle, horizontale et émancipatrice. D’autre part, l’horizon politique d’Andreas Malm demeure l’État, y compris l’État fort de Lénine et son pseudo-écologisme, loué – bien que de manière ambigüe et critique – au sein de son dernier chapitre de L’anthropocène contre l’histoire. Cet horizon pourrait être dépassé au profit d’une écologie politique anti-autoritaire, notamment celle de Murray Bookchin12. De plus, Malm accorde peut-être une confiance démesurée aux climatologues, qui sont certes de précieux alliés face au capitalisme fossile, mais qui pourraient également se tourner vers une « solution » technologique au dérèglement climatique, la géo-ingénierie.
Enfin, Malm hésite de manière caractéristique de l’éco-marxisme contemporain entre une critique du capitalisme fossile comme mode de production, qui appelle à son abolition comme société du travail salarié et du capital, et une critique redistributrice du capitalisme fossile, qui appelle à une expropriation des plus riches pour financer une transition énergétique effective, quand bien même cette solution semble moins prometteuse écologiquement et plus propice à une dérive autoritaire, fut-telle « socialiste »13.
Ainsi, si d’un point de vue analytique et historique, une combinaison des forces respectives de l’éco-marxisme de Malm et de Moore semble une idée féconde, il faut néanmoins regarder du côté des théories éco-marxiennes anti-autoritaires pour des perspectives claires en termes de dépassement émancipateur du capitalisme fossile, tout en restant ouverts en termes de tactique et de stratégie face au désastre actuel.
Notes (liens dans l'original)
1. ↟ Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming, London, Verso, 2016. On trouvera une présentation et une discussion de cet ouvrage dans Armel Campagne, Le Capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement climatique, Paris, Divergences, 2017, disponible gratuitement en ligne sur le site des éditions Divergences (https://www.editionsdivergences.com/le-capitalocene-darmel-campagne-pdf/). Je remercie Benjamin Gizard, Troy Vettese et Sophia Ayada pour leurs relectures respectives de cet article.
2. ↟ Parutions prévues aux éditions La Fabrique respectivement en juin et en septembre 2020.
3. ↟ Andreas Malm, L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
4. ↟ L’ouvrage, initialement paru aux éditions Verso en 2015 sous le titre Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, devrait paraître aux éditions L’Asymétrie en novembre 2020.
5. ↟ Là-dessus, on pourra lire entres autres les travaux du biologiste de l’évolution et phylogéographe Robert Wallace, partiellement disponibles en français sur les sites d’Agitations et d’ACTA ainsi que l’article publié dans le No 13 des Terrestres : Le Covid-19 et les circuits du capital.
6. ↟ Karl Marx, Le Capital, Livre III. Le procès d’ensemble de la production capitaliste, Paris, Editions sociales, 1976, p. 735.
7. ↟ Carolyn Merchant, Autonomous Nature: Problems of Prediction and Control from Ancient Times to the Scientific Revolution, New York, Routledge, 2016.
8. ↟ https://marxandphilosophy.org.uk/reviews/17484_the-progress-of-this-storm-by-andreas-malm-reviewed-by-troy-vettese/
9. ↟ Timothy Mitchell. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley. University of California Press. 2002.
10. ↟ Daniel Schneider. Hybrid Nature – Sewage Treatment and the Contradictions of the Industrial Ecosystem. Cambridge. MIT Press. 2011.
11. ↟ https://www.revolutionpermanente.fr/Il-est-temps-d-experimenter-un-leninisme-ecologique-Entretien-avec-Andreas-Malm
12. ↟ Cf. notamment Floréal Romero, Agir ici et maintenant. Penser l’écologie sociale de Murray Bookchin, Éditions du commun, 2019.
13. ↟ Cf., sur cette opposition entre deux types de critique du capitalisme, Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009.
SOMMAIRECritical Theory in Berlin
Corona-Capitalism: Struggles over Nature - A conversation with Andreas Malm & Rahel Jaeggi
Organized by the Center for Humanities and Social Change (HU Berlin) and the Department of Philosophy and Humanities (FU Berlin) (Rahel Jaeggi and Robin Celikates)
At first sight, the coronavirus pandemic is just another random natural disaster. On a closer look, however, the pandemic unfolds in confrontation with pre-existing social institutions. Andreas Malm’s analysis goes even further. In his recent book Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century (forthcoming with Verso books) he argues that the origin and proliferation of this plague are tightly intertwined with global capitalist production that destroys natural habitats, consumes land and wildlife, trades commodities around the globe, and moves people from one side of the planet to the other at a speed unprecedented in history. Malm’s analysis places capitalism at the heart of the natural disaster, thereby implying a remedy that not only treats symptoms, but eradicates the root causes of the evil.
Andreas Malm is Associate Senior Lecturer in Human Ecology at Lund University and currently Fellow at the Humanities and Social Change Center Berlin. His research focuses on the climate crisis and political strategies to deal with it. He worked especially on the politics of fossil fuels and on the relation of society and nature. Malm is the author of Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (Verso, 2016) and The Progress of This Storm: Nature and Society in a Warming World (Verso, 2018).
I. INTRODUCTION 27 mai
la critique de l'écologie politique comme complément à la critique de l'économie politique
II. ÉCRIT DU MONDE D'AVANT 27 mai
"Critique de l’écologie politique" in Le Sourire du spectre, nouvel esprit du communisme, Daniel Bensaïd, février 2000
III. DE PRÉCÉDENTES CRITIQUES 28 mai
"L’écologie est avant tout une science, pas un mouvement politique', une tribune dans Le Monde en novembre 2018
IV. DYNAMIQUE DE SORTIE DU RAPPORT ENTRE LE CAPITAL ET LE VIVANT 28 mai
elle est intrinsèquement liée à la vie sur terre
1. contribution à la critique de l'idéalisme révolutionnaire
prolétarien ou humaniste, toujours anthropocentré
2. dynamique de l'inversion des rapports humanité-nature, effective contre le capital
3. aucune écologie politique ne peut remplacer ce processus révolutionnaire
V. INTRODUIRE LES SCIENCES DE LA COMPLEXITÉ
DANS LA RELATION HUMANITÉ-(CAPITAL)-NATURE, 30 mai
avec l'écopsychologie, étude de la relation Homme-Nature
VI. QUOI DE NEUF ENTRE MARXISMES ET ÉCOLOGIE ? 18 juin
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
« C'est assez d'avoir vu l'effondrement d'une civilisation magnifique
pour ne pas consentir à rechercher sa joie dans les ruines. »
Julien Green, Journal, 1940
une telle enquête aurait davantage sa place dans un sujet traduisant l'idéologie de l'époque à travers les réactions sociétales et culturelles, à savoir la Structure of Feeling selon le théoricien marxiste Raymond Williams, mais il n'est pas incongru d'y voir un aspect de du pessimisme écologiste d'une époque dépressive (au sens lacanien) qui se traduit aussi, on l'a vu, par le scénario d'inspiration religieuse eschatologique d'une Révolution prolétarienne à venir
j'avoue être un peu scotché par les chiffres, mais s'ils sont bons, leur analyse me semble assez sérieuse
65% des Français croient à l’effondrement imminent de notre civilisation
Fabienne Marion, UP magazine, 17 juin

la vie en rose ?
Fabienne Marion, UP magazine, 17 juin

la vie en rose ?
La crise du Covid-19 est-elle le marqueur d’un effondrement imminent de notre civilisation ? La crise liée à la pandémie a fait souffler un vent de collapsologie qui aurait convaincu de nouveaux adeptes. Et si le récit de l’effondrement futur de nos civilisations était le nouvel avatar du pessimisme français ? « Certains pensent que la civilisation telle que nous la connaissons va s’effondrer dans les années à venir » : en s’appuyant sur cette thématique, une étude internationale Ifop menée en France, au Royaume-uni, en Allemagne, en Italie et aux Etats-Unis, par Jean-Laurent Cassely et Jérôme Fourquet, pour la Fondation Jean Jaurès, montre pourquoi et comment la collapsologie rencontre un écho important en France et dévoile le profil et les affinités politiques de ses adeptes.
La France est le deuxième pays qui croit le plus en une prophétie collapsologique, derrière l’Italie (71 %) mais devant le Royaume-Uni (56 %) et les États-Unis (52 %), selon les données d’une étude de la Fondation Jean Jaurès. Popularisée notamment par l’ouvrage de l’Américain Jared Diamond, Collapse : How Societies Choose to Fail or Succeed (2005) (“Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie”), cette théorie « repose sur l’hypothèse selon laquelle le changement climatique, la diminution des ressources et l’extinction des espèces conduisent le monde à sa destruction à un rythme alarmant ».
Œuvres publiées, films et séries sur le sujet font souvent jouer au changement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles un rôle central dans le collapsus. Et l’érosion de la biodiversité, la prolifération nucléaire, le réchauffement climatique de plus en plus prégnant font penser à une fuite en avant que dénonce notamment le chercheur Luc Semal dans son ouvrage « Face à l’effondrement – Militer à l’ombre des catastrophes ».
Quand on interroge les personnes jugeant probable une telle issue, le scénario climatique et écologique est de fait souvent invoqué mais avec une intensité variable selon les pays.
Le récit effondriste : nouvel avatar du pessimisme français
Selon cette étude internationale sortie en novembre 2019, si la prophétie collapsologique a gagné beaucoup de terrain dans les imaginaires occidentaux ces dernières années, c’est en France et en Italie qu’elle rencontre manifestement le plus d’écho. 71 % des Italiens et 65 % des Français sont d’accord avec l’assertion selon laquelle « la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir ». Cette vision apocalyptique n’est partagée « que » par 56 % des Britanniques et par 52 % des Américains. Enfin, en Allemagne, cette thèse fait beaucoup moins recette avec un score de 39 %.
Deux remarques peuvent être faites à ce stade. La première est que le libellé de la question est très général et ne focalise pas spécifiquement sur les causes climatiques ou écologiques d’un tel effondrement. Cette précision a son importance car l’acception environnementale de la collapsologie est, comme nous le verrons plus loin, plus présente dans des pays comme la Grande-Bretagne (où est apparu par exemple le mouvement Extinction Rebellion) ou l’Allemagne. Le fait que les causes de l’effondrement ne soient pas, à ce stade du déroulement du questionnaire, précisées permet donc de capter un ensemble de représentations et de perceptions déclinistes.
Par ailleurs, le terme de « collapsologie », encore méconnu d’une partie de l’opinion et potentiellement clivant, n’était pas employé dans le libellé de la question pour laquelle seule une thèmatique était introduite en indiquant que « certains pensent que la civilisation telle que nous la connaissons va s’effondrer dans les années à venir », demandant ensuite aux enquêtés leur degré d’accord ou de désaccord avec ce diagnostic.
La seconde remarque découle de ce constat. On peut faire l’hypothèse que le degré d’adhésion à la thèse d’un effondrement prévisible de la civilisation constitue un bon indicateur de la prégnance du déclinisme et du pessimisme dans une société donnée. À l’appui de cette hypothèse, on notera que c’est en Allemagne, pays jouissant d’une très solide assise économique et institutionnelle, que le pronostic de l’effondrement de la civilisation est le moins répandu, suivi par les deux pays anglo-saxons puis enfin par la France et l’Italie, nations aux performances économiques moins satisfaisantes et où les tensions sociales et politiques sont fortes.
L’adhésion à la théorie d’un effondrement de la civilisation
65 % des Français d’accord avec la théorie de l’effondrement
Autre spécificité française, alors que l’adhésion à une vision collapsologique est dans les différents pays plus répandue dans les jeunes générations, quand les seniors y semblent plus réfractaires, ce clivage générationnel ne fonctionne pas en France. Dans notre pays, toutes les générations, soixante-cinq ans et plus compris, partagent le même sombre diagnostic.
Si le sondage dégage une moyenne de 65 % de Français d’accord avec la théorie de l’effondrement, la proportion de ceux qui pensent que la civilisation va s’effondrer progresse à mesure que le niveau de vie diminue : 50 % des membres des catégories aisées adhèrent à la théorie, 61 % parmi les membres des classes moyennes supérieures, 64 % parmi ceux des classes moyennes inférieures, et le pourcentage culmine à 75 % parmi les catégories modestes, avant de légèrement redescendre chez les Français les plus pauvres de notre typologie en cinq tranches de revenus (64 % adhérent à cette thèse).
Sur le plan éducatif, c’est parmi les sans diplôme (73 %) que l’adhésion est la plus forte. Nous verrons plus loin comment ces chiffres varient fortement en fonction des appartenances politiques mais, pour l’heure, il est important de noter que le portrait statistique qui se dégage de ces résultats issus d’un échantillon représentatif ne coïncide guère avec les enquêtes réalisées jusqu’alors auprès des milieux « collapsonautes », terme employé à propos d’individus qui sont non seulement convaincus de la menace, mais ont entamé une réorientation de leurs modes de vie pour mieux s’y préparer (ils se distinguent des « collapsosophes », plus portés sur le changement intérieur et spirituel, et des « collapsologues » à proprement parler, qui sont les théoriciens et les inventeurs de la collapsologie).
Dans la revue Yggdrasil cofondée par Pablo Servigne, une étude menée par trois enseignants membres de l’Obveco, l’Observatoire des vécus du collapse, auprès de participants à des forums Facebook collapso, aboutit au portrait suivant : des hommes (60 %), urbains (65 %), « très diplômés par rapport à la population française et plutôt jeunes (entre trente-quatre et trente-huit ans de moyenne d’âge selon les études) », puisque « 85 % des collapsonautes ont suivi des études supérieures, voire très longues » et qu’« ils manipulent bien l’information scientifique et savent exercer leur esprit critique. » Ce collapso engagé est un « geek », écrivent encore les auteurs, « car ses connaissances sont très pointues pour un non-spécialiste ».
Il y a un décalage entre le portrait-robot d’un collapsonaute (sur-)diplômé, (hyper-)informé et volontariste d’une part, et le niveau socioculturel des adhérents à la thèse de l’effondrement dans ce sondage qui peut s’expliquer de la manière suivante. Les collapsonautes engagés, qui fréquentent les plateformes et les lieux de débat et ont même engagé une transition, représentent une minorité éclairée très exposée médiatiquement, scrutée par les journalistes et les chercheurs. L’enquête montre un mouvement plus souterrain et massif d’adhésion à la thèse de l’effondrement de la part d’une population qui vit ce risque sous l’angle d’une menace et qu’elle associe à une situation sociale et économique globalement « dominée », ou subie sans grande marge de manœuvre pour s’en extraire. Son adhésion signale l’impuissance plutôt que le volontarisme collapsonaute et ses accents scoutistes, qui sont le propre de cette minorité de décrocheurs ou décroissants volontaires. Il est par ailleurs peu probable que ce public économiquement fragilisé se définisse comme sympathisant de la « collapsologie », un terme qui n’a pas utilisé dans les questions du sondage.
Echéance de l’effondrement : demain !
Autre symptôme de ce rapport particulièrement inquiet à l’avenir en France, parmi les personnes adhérant à l’idée d’un effondrement, la proportion de ceux qui anticipent cette échéance d’ici dix ou vingt ans (c’est-à-dire demain si on se place à l’échelle temporelle d’une civilisation) est particulièrement élevée : 54 % contre 41 % en Italie et 32 % en Grande-Bretagne par exemple.
Ramenée à l’ensemble de la population de chacun des pays, la proportion de personnes partageant la thèse d’un effondrement à venir et le diagnostiquant au maximum à une échéance de vingt ans s’établit à pas moins de 35 % de la population en France contre 29 % en Italie, 22 % en Allemagne et moins de 20 % aux États-Unis (19 %) et en Grande-Bretagne (18 %).
Un tiers de nos concitoyens anticipe ou juge très probable l’effondrement de notre modèle de société d’ici à vingt ans.Un tiers de nos concitoyens, soit une proportion élevée, anticipe ou juge très probable l’effondrement de notre modèle de société d’ici à vingt ans. Au regard de ce chiffre, on comprend mieux pourquoi les ouvrages et traités de collapsologie rencontrent un tel succès de librairie, qu’il s’agisse par exemple de Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, du Plus grand défi de l’histoire de l’humanité. Face à la catastrophe écologique et sociale d’Aurélien Barrau ou de Devant l’effondrement. Essai de collapsologie d’Yves Cochet.
Une montée en puissance caractérisée
Comme l’a analysé le chercheur Olivier Gadeau, la thématique de l’effondrement s’impose au milieu des années 2010 dans le débat médiatique français, avec la popularisation croissante du terme « collapsologie » à partir de 2015 et surtout de 2018 dans les médias – il s’agit d’années marquées par de nombreux bouleversements géopolitiques : crise humaine des réfugiés, crise politique européenne, crise écologique.
D’abord présentée avec un recul critique mêlé d’amusement pour cette théorie aux airs de science-fiction, la collapsologie va néanmoins s’imposer comme un récit crédible dans cette décennie anxiogène, et la question posée lors de nombreux débats paraît ne plus être la plausibilité de la thèse, mais son degré d’imminence ainsi que les solutions concrètes pour y survivre et s’y adapter – dans la mesure où, pour reprendre le titre d’un ouvrage du trio Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle publié en 2018, Une autre fin du monde est possible.
C’est certainement au cours de ces années charnières que l’hypothèse d’un effondrement va quitter le registre hollywoodien du film catastrophe (2012, Le Jour d’après, Deep Impact…) pour devenir l’arrière-plan de fictions de plus en plus réalistes.
Conséquence de la visibilité des penseurs, des analystes et des influenceurs de l’effondrement, une pop culture collapso s’est développée, avec comme récente illustration la mini-série produite par Canal Plus, L’Effondrement. La série fait le choix scénaristique d’un effondrement soudain mais réaliste et présente en huit épisodes, dont certains diffusés sur YouTube par la chaîne, plusieurs tableaux qui donnent un avant-goût des conflits auxquels la société française serait confrontée lors du grand collapse économique, social et politique du pays. Le premier épisode se déroule dans un supermarché en rupture de stock. On assiste dans le deuxième au rationnement de l’essence dans une station-service, etc.
Quels scénarios collapsologiques ?
Les adeptes de la thèse de l’effondrement divergent en fait quant aux causes identifiées. Deux grands narratifs se concurrencent et fédèrent à peu près le même nombre de suffrages.
Ceux qui pensent que la cause la plus probable serait « les conséquences du réchauffement climatique et de la surconsommation (disparition des espèces, catastrophes climatiques, épuisement des ressources) » sont à peu près aussi nombreux (27 % en France par exemple) que ceux (32 % dans notre pays) qui pensent plutôt « qu’il n’y aura pas d’effondrement soudain mais plutôt une dégradation progressive des conditions de vie actuelles ».
À côté de ces deux visions effondristes mainstream existent deux autres scénarios plus minoritaires et renvoyant à un autre imaginaire nettement plus violent. Sans doute sous l’effet de la crise migratoire de 2015-2017 et des images extrêmement fortes qu’elle a charriées, l’hypothèse d’un effondrement sous « l’effet de vagues migratoires totalement incontrôlables » recueille un score conséquent en Europe continentale (12 % en Italie, 15 % en France et 17 % en Allemagne) et s’y classe en troisième position. Ce scénario fait moins recette en Grande-Bretagne et aux États-Unis (7 %).
L’hypothèse d’un effondrement causé par « une guerre civile ou des tensions de plus en plus fortes au sein de la société »* réunit également un nombre d’adeptes conséquent : 15 % aux États-Unis, 14 % en France et en Allemagne et 9 % en Italie et en Grande-Bretagne. Le questionnaire propose également d’autres options mais ayant trait à la survenue d’un fait accidentel ou d’un événement particulier.
* on reconnaît dans cette catégories le "théoricien" de la communisation Crabure : Lutte des classes / Guerre civile / Communisation
Ces scénarios, qu’il s’agisse d’un accident industriel ou nucléaire, d’une vague d’attentats ou d’une catastrophe naturelle ne convainquent guère les personnes adhérant à un diagnostic collapsologique. Tout se passe comme si pour bien fonctionner le narratif effondriste devait s’appuyer sur un raisonnement de type systémique. Manifestement, ces individus créditent notre société d’une certaine forme de résilience qui la mettrait à l’abri d’une réaction en chaîne provoquée par un seul événement. Ils pensent en revanche que l’effondrement commencera sous la pression de phénomènes beaucoup plus massifs, soit sur le plan environnemental et climatique (tels ce que décrivent des films comme Home de Yann Arthus-Bertrand où La 11eHeure de Nadia Conners), soit d’une thrombose et d’une dégénérescence de notre société, soit enfin sous les coups de boutoirs de crises migratoire ou sociale majeures.
Survivalistes et collapsonautes : deux récits effondristes pour deux imaginaires politiques
Si toute une partie de la société française communie dans la projection d’un avenir funeste, les imaginaires qui se développent et sont mobilisés font réapparaître des lignes de clivages générationnelle et politique. Comme le montre le graphique suivant, plus on progresse dans la pyramide des âges et plus la propension à adhérer au scénario d’une décadence et d’une dislocation progressive est prégnante.
C’est dans les jeunes générations que la thèse d’un collapsus environnemental et climatique est la plus présente.Et, à l’inverse, c’est dans les jeunes générations que la thèse d’un collapsus environnemental et climatique est la plus présente. Au regard de ces chiffres, il apparaît que dans les générations les plus âgées, qui ont grandi pendant les Trente Glorieuses, l’impact de nos modes de vie et de consommation ne soit pas spontanément vu comme pouvant à terme provoquer un effondrement de notre civilisation. Elles adhèrent bien davantage à l’idée, nostalgique, d’une progressive décadence, la vision collapsologue dans cette génération s’articulant sans doute en partie autour du thème classique du « Tout fout le camp et c’était mieux avant ».
La cause la plus probable de l’effondrement de la civilisation par tranche d’âge en France
Les générations les plus jeunes adhèrent beaucoup moins à cette vision d’un délitement progressif et d’un déclin au long cours mais se montrent en revanche beaucoup plus sensibles à l’impact du changement climatique et de la surconsommation des ressources sur le thème « Il n’y a pas de planète B ». Cette différence d’approche générationnelle majeure qui s’observe également en Allemagne renvoie à une reconnaissance très variable selon les tranches d’âge de l’impact du way of life occidental sur l’équilibre de la planète.
Le récit effondriste fait preuve d’une grande diversité et plasticité pour coller aux cultures des différentes familles politiques.Parallèlement à ce clivage générationnel marqué, le récit effondriste fait preuve d’une grande diversité et plasticité pour coller aux cultures des différentes familles politiques. Ainsi, assez logiquement, la vision d’un épuisement des ressources et du dérèglement climatique s’impose très largement parmi les sympathisants écologistes (56 % de citations) et dans une moindre mesure, bien qu’étant également en tête, au sein des sympathisants des Insoumis (37 %) et du Parti socialiste (31 %). Les sympathisants macroniens qui pensent que l’effondrement est possible partagent plutôt un imaginaire de droite dans la mesure où l’option qu’ils privilégient pour 45 % d’entre eux est celle d’un déclin progressif.
C’est sans doute pour conjurer cette perspective funeste d’un déclin français qu’ils ont fait leur l’ambition transformatrice et réformatrice d’Emmanuel Macron. On retrouve cet état d’esprit parmi les sympathisants Les Républicains (LR) qui citent à hauteur de 33 % ce scénario d’une décadence ou dégénérescence. Les soutiens du Rassemblement national (RN), quant à eux, sont les seuls à placer en tête parmi les causes d’un effondrement prévisible l’effet de vagues migratoires incontrôlables qu’ils sont 30 % à retenir (soit le double par rapport à la moyenne). Ils sont également nettement plus nombreux que la moyenne des Français collapsologistes à craindre « une guerre civile ou des tensions de plus en plus fortes au sein de la société » (21 % contre 14 % en moyenne).
Gageons que, pour cet électorat, ces tensions au sein de la société seraient en lien direct avec le phénomène migratoire et que l’imaginaire de guerre civile qu’ils partagent met aux prises différentes communautés ethno-culturelles.
La perspective effondriste est, dans les autres pays également, très fortement indexée sur les cultures politiques des interviewés. Elle fonctionne en quelque sorte comme une surface projective permettant de lire la vision du monde et de la société qui structure chaque électorat. Ainsi aux États-Unis, les sympathisants démocrates placent loin devant le scénario des conséquences du réchauffement climatique et de la surconsommation avec 49 % de citations, alors que ce score n’est que de 16 % dans l’électorat républicain, apparemment massivement en ligne avec le discours climato-sceptique de Donald Trump. Les sympathisants républicains mentionnent en revanche bien davantage que les démocrates la perspective d’une guerre civile (24 % contre 10 %), les vagues migratoires totalement incontrôlées (14 % contre 4 %) mais aussi la perspective d’une décadence et d’un effondrement progressif (27 % contre 19 % parmi les démocrates).
Leurs homologues conservateurs allemands se retrouvent aussi prioritairement sur ce thème (33 %), quand les sympathisants du SPD (36 %), et plus encore ceux des Grünen, évoquent l’effondrement climatique et la raréfaction des ressources naturelles. Et, à l’instar des électeurs lepénistes, les sympathisants de l’Alternative für Deutschland (AfD) se positionnent majoritairement sur l’hypothèse de la submersion migratoire (40 % de citations contre 17 % en moyenne) mais également sur les risques de guerre civile (23 % contre 14 %).
On notera que dans la plupart des pays étudiés, l’adhésion au scénario d’un effondrement de la civilisation est nettement plus prégnante parmi les électorats des formations radicales ou contestataires de droite comme de gauche. À l’inverse, les sympathisants des partis de gouvernement, plus à l’aise avec le fonctionnement de la société et généralement les mieux insérés socialement, sont tendanciellement moins enclins à communier dans une telle vision.
Ainsi, en Allemagne, 57 % des sympathisants de l’AfD et 47 % de ceux de Die Linke sont d’accord avec cette thèse d’un effondrement prévisible de la société contre seulement 23 % de leurs homologues du SPD et 31 % des proches de la CDU/CSU.
On va retrouver la même configuration partisane en Italie et en France à ceci près que, d’une part, dans toutes les composantes politiques, la prévalence d’une croyance effondriste est nettement plus élevée et que, d’autre part, les écarts entre partis de gouvernement et partis protestataires sont plus faibles.
En Italie, l’adhésion à la théorie d’un effondrement de la civilisation s’établit à 74 % parmi les sympathisants de la Ligue et 71 % pour ceux du Mouvement 5 étoiles, soit un étiage identique à celui observé dans les rangs de Forza Italia (73 %). Seuls les sympathisants de Parti Democratico sont un petit peu moins pessimistes (59 %).
En France, la configuration est assez similaire : 76 % des Insoumis, 74 % des sympathisants du RN mais également 71 % de ceux des Républicains font ce diagnostic qui est également partagé par 61 % des sympathisants socialistes. Dans ce climat décliniste, les sympathisants La République en marche (LREM) se démarquent en affichant un degré d’optimisme plus élevé : seuls 39 % d’entre eux diagnostiquent un effondrement de notre civilisation.
Nous avons ici une illustration supplémentaire de la polarisation du paysage électoral selon des dimensions émotionnelles ou plus précisément selon des « variables subjectives » mises en avant par les chercheurs Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault dans leur ouvrage Les Origines du populisme -Enquête sur un schisme politique et social. Dans le cadre de leur enquête sur la dernière élection présidentielle, les chercheurs dévoilent en particulier le rôle joué dans la proximité partisane par deux variables subjectives que sont le degré de bien-être (mesuré par des questions comme « êtes-vous heureux ces jours-ci ? », « êtes-vous satisfait de votre vie en général ? ») et le degré de confiance interpersonnelle (la confiance que l’on accorde a priori aux autres : proches, amis, voisins, concitoyens, personnes étrangères). Cette approche permet de distribuer les électeurs selon deux axes en fonction de leurs réponses à ces deux questions : Un axe du bien-être : sont-ils satisfaits ou insatisfaits de leur propre situation économique et sociale ? Et un axe du niveau de confiance : ont-ils l’impression de vivre dans une société dans laquelle chacun doit se méfier de son prochain, ou bien sont-ils à l’inverse plutôt confiants envers les autres ?
Voici une version simplifiée de la matrice qui résume ce positionnement :
Le croisement des deux axes aboutit à placer les électeurs sur quatre cadrans. Dans les deux cadrans placés à droite, les électeurs d’Emmanuel Macron, mais aussi de Benoît Hamon et de François Fillon ont tous un niveau de bien-être élevé : ils sont plutôt satisfaits de leur vie. Ce qui les différencie est le degré de confiance qu’ils projettent dans le corps social : macronistes et hamonistes sont confiants, tandis que les fillonistes sont défiants.
À l’inverse, les électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen convergent sur le point de leur insatisfaction : les deux électorats de la gauche radicale et de la droite populiste se recrutent parmi les perdants économiques déclarant un faible niveau de bien-être.
Le clivage gauche/droite réapparaît avec la prise en compte de l’axe de la confiance. Mais, et c’est le point crucial, loin de s’évanouir, le clivage gauche/droite réapparaît avec la prise en compte de l’axe de la confiance. Comme on le pressent, les électeurs de la gauche radicale font plutôt confiance en leurs prochains quand ceux de Marine Le Pen ont plutôt l’impression de vivre dans une société de défiance. Selon les chercheurs, alors que « la société postindustrielle promettait l’émancipation des hiérarchies anciennes, elle a surtout creusé la solitude sociale et le sentiment d’insécurité. Et, loin de préparer une société d’autonomie et de liberté, elle a renforcé le besoin de protection. »
Or, c’est parmi « le monde postindustriel des services », celui des ouvriers et employés des petites entreprises artisanales, peu syndiqués, précarisés et évoluant dans des configurations qui favorisent peu le collectif, « que s’expriment le plus fortement les sentiments de solitude et de mal-être social ». Cette défiance s’exprime évidemment à propos de l’immigration chez ces électeurs, mais elle est plus globale et elle concerne également, dans une moindre mesure, voisins, amis et même entourage familial.
La combinaison mal-être et défiance est donc le propre des électeurs des partis de droite populiste, qui sont, selon les auteurs des Origines du populisme, non seulement « les perdants de la nouvelle économie, mais encore les perdants de la ’société des individus’ ».
À l’inverse, la confiance interpersonnelle est la marque d’une culture politique très ancrée à gauche, notamment au sein de l’électorat de la fonction publique. La confiance est devenue, dans une société dans laquelle l’appartenance de classe recule, « le filtre qui permet aux individus de se donner un projet de société désirable », ce qui explique que « malgré une détestation partagée des élites, les deux versants de la protestation antisystème prennent appui sur des valeurs fondamentalement opposées. »
Dans le monde d’après l’effondrement de la civilisation, on ne pourra compter que sur soi-mêmeForts de ce détour théorique, nous pouvons revenir à notre fin du monde et constater que, lorsqu’est posée une question très similaire à celle des enquêtes sur la confiance interpersonnelle dans un cadre collapsologique, les préférences partisanes et politiques révèlent tout leur poids. À une formulation aussi frontale que « dans le monde d’après l’effondrement de la civilisation, on ne pourra compter que sur soi-même », l’adhésion augmente de façon linéaire en partant des électeurs de Benoît Hamon (40 % le pensent) à ceux de Marine Le Pen (72 % le croient) en passant par ceux de Jean-Luc Mélenchon (45 %), de François Fillon (48 %) et d’Emmanuel Macron (49 %), tous trois à des niveaux assez proches. La moyenne française (obtenue sur la base des seuls répondants qui adhèrent à la thèse de l’effondrement imminent ou lointain, qu’il soit brutal et monocausal ou progressif) s’établit sur cet item à 52 %.
Part des électeurs de ces candidats au premier tour qui adhèrent à la proposition : « Dans le monde d’après l’effondrement de la civilisation, on ne pourra compter que sur soi-même. » Base : 65 % des Français pour lesquels « la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir »
Entraide et solidarité contre ressentiment et menaces de l’autre
Ces résultats incitent à associer les deux grands récits de l’effondrement que sont la collapsologie et le survivalisme à des tendances politiques bien identifiées. Du côté des premiers et de leur chef de file Pablo Servigne, l’accent est mis sur l’entraide et la solidarité.
Les publications ou les groupes Facebook proches de la collapsologie sont grandement consacrés aux aspects socioculturels du monde d’après l’effondrement et, lorsqu’il s’agit de savoirs pratiques, ils sont orientés vers l’écologie, mettant en avant les techniques de la permaculture, de l’habitat autonome, participatif et alternatif en « éco-village », « éco-hameau » ou autre « éco-lieu », dont les promoteurs « recrutent » souvent de nouveaux habitants par le biais de ces forums.
Sans être absente des pages et forums fréquentés par les survivalistes, la dimension socioculturelle est parfois mise au second plan au profit d’approches plus techniques de la survie, qu’il s’agisse de la gestion d’une base autonome à défendre (la BAD) ou de la liste des équipements du sac de survie (Bug out Bag), liste qui fait l’objet de très nombreuses publications et de photographies d’équipements de la part de membres de ces réseaux. Les survivalistes sont également écolos à leur manière, se rapprochant d’une branche primitiviste : ils sont par exemple des adeptes du « bushcraft », ou « art de vivre dans les bois », une discipline qui s’inspire des façons de vivre, d’interagir avec la nature de civilisations traditionnelles.
Les survivalistes abordent leur préparation à l’effondrement à partir de trois piliers que sont « le jardin, l’autonomie et l’autodéfense », comme le formule le sociologue Bertrand Vidal, spécialiste de ces mouvements. Sur le plan des valeurs et de la vision politique, toujours selon le sociologue, le survivalisme est le signe pour ses adeptes d’une « sortie de la société de la confiance bâtie sur le mythe du progrès créé au XVIe siècle, qui disait que demain sera meilleur qu’aujourd’hui […] ».
Collapsonautes et survivalistes divergent non seulement par certaines approches de la survie, mais avant tout par leurs finalités : « À l’inverse de ces mouvements écologistes, explique encore Bertrand Vidal, les néosurvivalistes ne sont pas mus par le même imaginaire. Quand un écologiste quitte la ville pour cultiver son jardin, il le fait pour rendre le monde meilleur. Pour les survivalistes, ce n’est pas pour rendre le monde meilleur, c’est parce qu’il y a une catastrophe qui plane et c’est donc le seul moyen pour s’en sortir. »
Alors que les influenceurs de la galaxie collapso sont généralement issus des rangs de la mouvance écologiste, le panthéon survivaliste est plutôt composé de personnalités qui mettent en scène leurs capacités de résistance physique et leur aptitude à la survie, à l’image de l’Américain Vol West. Pour toutes ces raisons, il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’apparaisse une congruence entre imaginaires survivalistes et ressentiment nourri par la certitude que les autres sont des menaces plutôt que des ressources.
Les scénarios d’après l’effondrement testés, inspirés directement de ces sous-cultures effondristes – mais sans jamais utiliser les termes « collapsologie » ni « survivalisme » – montrent ici encore un partage assez clair des imaginaires. Une « société stressante et dangereuse dans laquelle l’essentiel de l’activité humaine sera consacrée à la survie » est le scénario le plus probable pour les électeurs des partis de droite et d’extrême droite, avec un score maximal chez les électeurs de Marine Le Pen, alors que le scénario d’une « société sobre basée sur un retour à l’agriculture traditionnelle, une consommation se limitant aux besoins essentiels » a la faveur des électeurs de Jean-Luc Mélenchon – cela ne signifiant pas nécessairement d’ailleurs qu’ils la souhaitent, simplement qu’ils la jugent plus probable.
La combinaison du niveau d’adhésion à la thèse de l’effondrement en fonction de la proximité partisane, étudiée plus haut, et des résultats de l’étude concernant les scénarios post-effondrement aboutit à cette représentation schématique du rapport à l’effondrement : d’une part, un tronc commun d’électeurs convaincus par la thèse de l’effondrement, et qui se subdivisent ensuite sur l’axe de la confiance et du modèle de société à reconstruire, ce qui correspond assez bien à l’opposition classique entre imaginaires collapsonautes et survivalistes ; d’autre part, une partie de la population moins directement concernée par la baisse de son niveau de vie, et donc de son niveau de bien-être, moins susceptible de croire à un effondrement prochain.
Ce partage schématique entre des imaginaires n’implique en rien que les survivalistes votent Marine Le Pen et les collapsonautes pour un candidat écologiste, mais signifie plus exactement que certains groupes d’adhérents à la thèse de l’effondrement et certains segments de l’électorat peuvent partager une vision du monde commune. Gardons enfin à l’esprit que cette opposition entre collapsonautes et survivalistes est à nuancer et que, dans les faits, des croisements existent entre les deux univers (1).
*********
Pablo Servigne expliquait dans une interview à France Inter en avril dernier, « En collapsologie, il y a deux écueils à éviter : le premier, c’est de dire que « tout est foutu ». Le deuxième, dire que « tout ira bien ». On a besoin d’optimistes et de pessimistes actifs, qui se préparent aux multiples chocs à venir, et pas d’optimistes et de pessimistes passifs, dans le déni.«
En effet, malgré un nombre croissant de citadins français qui cherchent aujourd’hui à s’installer à la campagne et de l’augmentation importante de demandes pour apprendre à devenir collapsologue, en s’équipant d’éolienne sur le toit, de récupérateur d’eau, de four solaire, … l’économiste Loïc Steffan, auteur de N’ayez pas peur du Collapse ! (2), déclarait à France Info que« Beaucoup de gens étaient dans le déni. Le déni est une première phase classique dans un processus que les collapsologues appellent « metanoia », ou « croire enfin en ce que l’on savait déjà ». Avec le Covid, la prise de conscience que nos sociétés sont brutalement fragiles se fait sentir. Un minuscule virus est capable de mettre le monde à genoux, l’hyper-connectivité du monde pose un problème… les stratégies de protection mentale commencent à s’effriter ».
« Le Covid-19 n’annonce pas l’effondrement total de l’État et de l’État de droit mais plutôt une « répétition générale, une sorte de test de stress qui nous a permis de voir ce qui a fonctionné ou non », a-t-il également déclaré. Pour lui, « Contrairement aux survivants, qui veulent courir vers les collines, les collapsologues croient en l’entraide pour améliorer la résilience des groupes. C’est le même point de départ mais pas la même réponse. Le collapsologue veut sauver la société. Le survivant est un individualiste ».
Le coronavirus, donc, est-il le début d’un effondrement imminent ? Tout le monde n’accepte pas cette idée. Pour Laurent Joffrin, rédacteur en chef de Libération, « La crise des coronavirus, aussi tragique soit-elle, a peut-être mis en lumière non pas la fragilité des sociétés modernes, mais leur capacité de résistance« . Selon lui, « Bien qu’ils soient fortement sollicités, les systèmes de santé et les économies n’ont pas implosé et la crise pourrait accélérer la nécessité de mettre en place une transition écologique plus rapide ».
(1) Certaines personnalités évoluent entre les deux pôles, à l’image de l’instructeur en stages de survie et auteur David Manise, interviewé dans la revue de Pablo Servigne et qui s’éloigne des clichés d’un survivalisme paramilitaire.
(2) N’ayez pas peur du Collapse ! de Loïc Steffan et Pierre-Eric Sutter – Edition Desclée de Brouwer, 3 juin 2020
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
une approche passionnante ouvrant la voie à une véritable philosophie de la nature. Ce qui m'a frappé, plus encore que l'influence de l'anthropologie, est celle de l'art, notamment avec les peintres Turner et Dubuffet, pour une perception directe de la nature qui shunte la raison, l'intelligible
on est là assez proche de ce que j'ai considéré comme une approche poétique au sens profond du terme, percepts et affects par les sens, avant une construction intellectuelle par les concepts (on retrouve les distinctions de Deleuze et Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie ?). C'est aussi ce que j'ai tenté de faire ressortir dans MUSIQUE, SONS de la NATURE, ET HUMANITÉ et jusque dans la moindre façon d'acquérir une technique musicale pour l'improvisation. Tout cela est chez moi indissociable et sans nier leurs apports remet à leur juste place aussi bien sciences que concepts philosophiques
compte-rendu à lire en ayant en tête les avertissements d'Isabelle Stengers dans « La science est balbutiante face aux enchevêtrements du vivant »
très belles illustrations dans l'original
Exercices en infra-physique, pour une nouvelle philosophie de la nature
Susanna Lindberg, Terrestres, 1 juin 2020

Rejetant tout système, 'Le toucher du monde, Techniques du naturer', écrit par David gé Bartoli et Sophie Gosselin, propose une pensée sensible qui accueille l’événement Gaïa sans l’ériger en force transcendante. En rendant compte des inventions techniques du naturer, cette oeuvre d'éco-philosophie est une réponse au besoin existentiel de vivre et de s’inscrire dans les plis d’une Terre animée.
Dans l’impressionnant livre de Sophie Gosselin et David Gé Bartoli Le toucher du monde. Techniques du naturer (éditions Dehors, 2019), l’enjeu déclaré n’est rien moins que de réinventer le rapport au monde. Le monde ? Partout, il y a la nature, or la nature n’est pas la totalité substantielle et rationnelle mais ouverture et mouvement illimité du naturer (p. 16). Pour penser le mouvement du naturer – sa poussée, sa sécrétion, son se tramer – il convient de saisir en quoi il n’est rien d’autre que la technique. Mais on ne comprendra cela qu’en déplaçant aussi la question de la technique. « Le déplacement qu’il s’agissait pour nous d’opérer consistait à repenser la technique non plus depuis le postulat de la supériorité de la dimension intelligible, mais depuis la prise en compte de la dimension sensible. Ce déplacement oblige à reconsidérer ce que nous entendons par sensible en le pensant par-delà toute opposition dialectique avec l’intelligible. Le sensible est d’abord puissance de toucher et d’être touché : puissance-matière qui ne peut être pensée à partir des catégories ontiques (relatives à ce qui est donné) mais seulement selon les termes de l’approche pathique (attentive à ce qui arrive, à ce qui se passe, à l’événement » (p. 378). Pour porter cette technique touchante en paroles, Gosselin et Bartoli ont démantelé une longue tradition de la philosophie de la technique et formulé nombre de nouveaux concepts, à la fois lumineux et pourtant souvent arythmiques (parce que contre-linguistiques, comme le se tramer). Qu’est-ce qui motive ce travail tectonique ?
Jean-Luc Nancy a écrit dans Corpus que « toute la philosophie de la nature est à refaire, si la “nature” doit être pensée comme l’exposition des corps » 1. Si Nancy a créé une pensée extraordinairement féconde de l’être singulier pluriel des corps articulés depuis leur “ex-peau-sition”, il n’a pas pour autant développé la philosophie de la nature dont il énonce ici la nécessité. Par le mot « éco-technie » 2, il fait certes signe vers la possibilité de penser la nature à travers la technique, mais comme cet « éco » désigne probablement davantage l’éco-nomie que l’éco-logie, l’éco-technie ne débouche finalement pas sur la techno-nature elle-même – sur la nécessité de penser la nature comme technique et la technique comme nature.
Sur fond de cette attente mise en mots par Nancy, il est réjouissant de découvrir la philosophie de la nature enfin refaite par Sophie Gosselin et David Gé Bartoli dans leur livre extraordinaire Le toucher du monde. Techniques du naturer. Ce livre ne s’adresse pas spécialement à Nancy mais développe une réflexion et une création libre se mouvant dans un paysage intellectuel beaucoup plus vaste, peuplé de grands noms de la pensée française du 20ème siècle (Blanchot, Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, Jullien, Bailly, Deligny), ainsi que de l’anthropologie et de l’art. D’un côté, pour exposer l’être-des-corps, Le toucher du monde s’inspire de la phénoménologie, notamment de l’idée, formulée par Merleau-Ponty, du chiasme du touchant-touché qui fait la chair (p. 248-253). De l’autre côté, pour déjouer les tentations naturalistes de la phénoménologie, Gosselin et Bartoli se réfèrent à Derrida et surtout à sa pensée du pharmakon de l’écriture (p. 71-78, 158-159), de la khôra (p. 316-317) et de la spectralité (386), termes qui suggèrent que ce qui apparaît n’est pas tant la chose même que son signe, qui tire son sens non pas directement du réel mais depuis une activité inconsciente de mémoire et d’imagination. Enfin, pour dépasser la négativité de la déconstruction, Gosselin et Bartoli suivent la leçon de Deleuze, Guattari et aussi de Nancy en développant tout un réseau de nouveaux concepts – naturer, tramer, approcher, tracer, intensible, infraphysique… – qui permettent de tracer, puis d’inscrire, ce qui se propose comme une nouvelle expérience de la nature.
UN NOUVEL AGENCEMENT DE CONCEPTS
Le résultat est un agencement de concepts qui laisse voir l’être d’une nouvelle façon. Le toucher du monde reflète la même pulsion métaphysique qui a généré, depuis le début du 21ème siècle, de nombreux traités de métaphysique (y compris dans la philosophie analytique) et de nouveaux systèmes métaphysiques (notamment ceux qu’on regroupe sous le titre de réalisme spéculatif ou d’Ontologie Orienté Objet, dont par exemple Forme et objet de Tristan García 3). Certains de ces systèmes témoignent d’un souci écologique (Levi S. Bryant 4) et tous sont conscients du statut spéculatif des systèmes métaphysiques d’aujourd’hui, ce qui fait que souvent ils côtoient la littérature et l’art. Si on lit Le toucher du monde sur ce fond comme un traité d’ontologie contemporaine, il se distingue clairement de ces systèmes en ce que, se nourrissant d’un terrain post-phénoménologique et post-structuraliste, il refuse de s’établir en une ontologie mais se veut plutôt, comme le dit Jullien, une « opération de désontologie » (p. 317) ; et il refuse d’ériger un système métaphysique qui lui paraîtrait instrumentaliste et totalitaire, mais se comprend plutôt comme une « infra-physique capable d’accueillir l’événement d’une advenue et l’espacement sous-jacent depuis lesquels ils se déploient » (p. 91). Rejetant tout système, il n’est pas non plus une machine conceptuelle, mais vraiment un paysage où des traces et « chevêtres » de pensée se croisent sans fin pour rendre possible quelque chose qui est peut-être une éco-philosophie. Car tout autant qu’une infraphysique, ce livre est une réponse au besoin existentiel de se rapporter au monde naturel.
Jusqu’à très récemment, il a fallu un certain courage pour écrire une philosophie de la nature motivée par un souci écologique. Surtout en France, l’écologie a longtemps été rejetée de la philosophie par des humanistes qui y voyaient une continuation du totalitarisme nazi (parce que les premiers grands traités de l’écologie philosophique étaient allemands ?) ou par des esthètes urbains qui y voyaient juste des rêveries new age californiennes, en sorte que seuls quelques solitaires comme Michel Serres y prêtaient attention. Mais on pourrait aussi dire que ce rejet fut la grande erreur de la pensée française du 20ème siècle autrement si fructueuse. Aujourd’hui, nulle personne qui suit un tant soit peu les sciences de la vie et de la terre ne peut ignorer les très grandes menaces environnementales auxquelles il faut réagir : le réchauffement climatique, la sixième extinction, mais aussi d’autres catastrophes comme par exemple le plastique qui étouffe les systèmes aquatiques, et l’agriculture intensive qui appauvrit les sols.
Aujourd’hui, heureusement, les réactions ne manquent plus, surtout celles, scientifiques, politiques, artistiques ou citoyennes – ou celles des jeunes des mouvements comme Fridays for Future ou Extinction Rebellion. Mais il est également impératif de faire face à la situation philosophiquement, de trouver des outils, des techniques de penser, et finalement aussi des assises dés/ontologiques. Voilà ce que font Bartoli et Gosselin, offrant une « infra-physique » à la mesure du monde où la nature bouge sous les pieds. Ils sont motivés par des soucis éthiques, dont ils signalent surtout la bio-technologie (p. 380-384), le transhumanisme (p. 384-387) et la crise écologique (p. 387-390), et dont la dangerosité tient en partie aux limitations de la conception de la technique sur laquelle ils évoluent. C’est donc autant pour des raisons politiques que pour des raisons philosophiques qu’il est important de révéler ce qui dans la conception traditionnelle de la technique soutient l’époque calamiteuse – et comment penser la technique autrement.
Plutôt que de chercher la structure idéale du monde, Bartoli et Gosselin exposent sa structure technique. Ils pensent la technique, contrairement à ses interprétations traditionnelles, instrumentalistes ou systémiques, comme le mouvement du naturer. La nature se fait lorsque les corps se rapportent les uns aux autres « techniquement ». Envisagé comme le mouvement même de la nature, la technique se pense comme la techné la plus originaire où la technique et l’art sont encore unies. La techné originaire s’exprime bien sûr aussi dans la rationalité instrumentale et dans l’idéalité scientifico-politique, mais Le toucher du monde privilégie surtout à ses autres expressions, notamment dans l’art et dans les pratiques des peuples indigènes. Cette pluralité des sources est importante, car elle permet à Gosselin et Bartoli de contourner la tentation de s’appuyer trop lourdement sur un mythe (par exemple de Gaïa) en attirant plutôt l’attention sur l’infinité des traces et des inscriptions diverses.
NATURE ET NATURER
Le livre Le toucher du monde se divise en trois grandes parties intitulées par des verbes transitifs : se tramer, approcher, tracer. On peut lire ces termes comme les réponses que donnent Gosselin et Bartoli aux trois grandes questions classiques de l’être, de la connaissance et de l’œuvre.
La philosophie de la nature de Gosselin et Bartoli expose l’être comme nature, et la nature, non pas comme unité substantielle ou rationnelle, mais comme un mouvement infini du naturer. Le naturer se déploie en se tramant : « Le se tramer est tout entier pris dans le mouvement du naturer, qu’il faut comprendre non comme un ordre immuable de propriétés et de lois, mais l’infinité des variations sensibles du corps » (p. 28). Se tramer est la poussée terrestre liée aux rencontres, accidents et aléas de la terre (ibid.). Tout comme la nature n’est pas un être mais l’infinité de corps, le naturer n’est pas une force souterraine mais l’infinité des écarts entre les existants : « Il n’y a de monde que depuis l’épreuve du naturer, en tant que le naturer ouvre la possibilité d’une multiplicité des mondes. Un monde consiste (prend consistance) à travers la co-advenue des existants depuis une puissance sous-jacente constituée d’une infinité de traces, c’est-à-dire d’amorces de différenciation et de formation de la matière » (p. 59). « C’est dans les écarts de la nature […] que quelque chose se trame » (p. 34).
Gosselin et Bartoli ne pensent pas la technique selon le paradigme moderne (instrumentaliste ou systémique) mais comme l’articulation qui accompagne le mouvement du naturer : « La technique n’est donc plus ici pensée relativement au faire d’un agent mais comme articulation d’une trame d’espaces et de temps se déployant à travers les corps depuis la persistance d’une poussée impersonnelle. Cette trame d’espaces et de temps articule une inscription à même les écarts du naturer. » (p. 127). La nature est donc conçue « comme mouvement persistant du naturer, comme infinité d’écarts, d’événements et de variations sensibles qui s’ouvrent depuis la possibilité d’un se tramer, d’une poussée arachnéenne. » (Ibid.) La technique n’est donc pas un moyen du corps mais un mouvement de se tramer qui, avant toute intention et conscience, naît dans la nuit intime des corps, les traverse et peut éventuellement prendre la consistance d’une trame qui s’enchevêtre à d’autres trames (p. 56-57). Lorsque le monde se trame, la technique s’inscrit ainsi dans son mouvement. L’existence est technique, et la technique consiste en ce que les existants s’ouvrent les uns aux autres, co-adviennent, habitent les uns près des autres à l’écart des autres : font monde (p. 127).
« L’enjeu consiste à libérer le mouvement du naturer de toute tentative de capture » (p. 58) en sorte que « la singularité d’un existant ne se confond donc pas avec l’individualité pensée comme unité indivisible ». Il faut plutôt penser l’existant selon une constellation qui « articule un double mouvement d’individuation et de dividuation, double mouvement qui articule une inscription » (p. 87). Pour que ce double mouvement puisse avoir lieu, il faut résister à la localisation et la clôture des corps, et les ouvrir aux traces latentes précédant l’invididuation, aux autres absents (“spectraux”), bref, les ouvrir au dehors. Voilà ce que fait l’infraphysique. Elle est une pensée qui s’expose au dehors, à l’écart, à la forme ou à l’image en train de se prendre – à la dimension préindividuelle du monde (91-93, 130).
La deuxième partie, Approcher : de la connaissance ontique à la co-naissance pathique démonte le concept traditionnel de connaissance tout en tissant à sa place une pensée de co-naissance qui, bien que déjà nommé par Claudel (p. 144), acquiert ici un statut philosophique complet. Suivant la définition de Heidegger, selon qui la technique n’est pas un instrument mais une forme de savoir, Bartoli et Gosselin interprètent la question de la connaissance comme question de la technique et ils présentent celle-ci à travers son histoire. Ce point de vue ouvre une autre histoire de la technique, où la question de la technique ne revient pas à réaliser des objectifs humains mais à voir le monde en train de se tramer ; regard redoublé par différentes façons de faire voir ce tramage à travers diverses techniques d’exposition et de présentation. Il n’est donc pas étonnant que la démonstration ne cesse de montrer les limites de l’interprétation scientifique de la technique en se référant plutôt aux techniques de la peinture, depuis Lascaux via Léonard jusqu’à Turner et Dubuffet.
Gosselin et Bartoli commencent leur histoire de la technique par les techniques de chasse que Bataille découvre dans les peintures pariétales de Lascaux. Dans ces dessins, disent-ils, dessiner l’animal n’est pas le capturer une deuxième fois dans son image mais « bien plutôt accueillir l’écart irréductible entre le chasseur et sa proie, écart qui se déploie dans les contours toujours mouvants de la nature » (p. 133). Comme le dit Bailly, dans ces images « le visible recèle le caché » qui est « pour ainsi dire l’intimité du visible » (134). Gosselin et Bartoli poursuivent : « La nuit est l’écart insaisissable en lequel la vie peut sans cesse se renouveler. Depuis la nuit de sa cachette, l’animal tisse les relations avec les êtres qui l’entourent. Au creux de l’écart, il peut se réinventer, redéployer un nouveau mouvement, un nouveau geste. […] [Car] à travers l’événement que marque l’irruption de l’animal, c’est l’événement même du naturer qui se donne à sentir, l’événement de son advenue incommensurable. Et la beauté […] » (p. 135).
TECHNIQUES
Dans le monde préhistorique imaginé ici, les techniques de la chasse et du dessin visent la proie dans sa proximité, dans sa fuite et sa disparition victorieuse. Le fil conducteur de l’histoire de la technique-connaissance racontée par Gosselin et Bartoli est cet écart entre le chasseur de la connaissance et sa proie où, presque paradoxalement, plus l’écart diminue, moins le chasseur connaît sa proie et plus l’écart se creuse, plus le chasseur connaît la proie telle qu’elle se montre – le chasseur connaît alors la difficulté d’approcher les trames de sa vie. Dans un premier temps, ce paradoxe s’illustre dans la lecture que font les auteurs du monde grec, d’abord de l’époque homérique où, « de rite initiatique qu’elle était, la chasse se transformera en acte de guerre, d’une guerre livrée contre le non humain, dans une dialectique qui n’aura de cesse d’opposer l’homme à l’animal, le civilisé à la nature sauvage » (p. 136) et ensuite de l’époque classique qui réduit la technique définitivement à un moyen. « La réduction de la technique en un ensemble de moyens déterminés par une fin est indissociable d’un processus de neutralisation de la dimension pathique du geste technique, dimension qui seule permettait d’accueillir à la fois la dimension imperceptible du naturer et son caractère événementiel. » (p. 140). Cette neutralisation s’affine dans le travail de Platon, comme le montrent Gosselin et Bartoli par une lecture, fort à propos, de la métaphore de la technique de la pêche à la ligne présentée dans le Sophiste, où Platon fait une distinction entre la technique sophistique permettant une chasse matérielle et le savoir philosophique permettant une chasse immatérielle des idées.
La différence entre ceux qui réduisent l’écart et ceux qui le perçoivent se rejoue à l’époque moderne, notamment entre les scientifiques et les peintres. La méthode de la connaissance scientifique depuis la Renaissance jusqu’à nous est la méthode expérimentale : « N’y a-t-il pas paradoxe à dire que la science moderne découvre la rationalité immanente à la matière en la transformant ? C’est en effet ce paradoxe que réalise la méthode expérimentale moderne. Celle-ci consiste à construire des expériences afin de vérifier des démonstrations, des lois, c’est-à-dire des rapports universels et nécessaires échappant aux variations indéfinies de la matière. » (p. 174-175). Les conséquences sont énormes : l’espace et le temps deviennent une dimension quadrillée hors-sol (p. 197), les corps sont virtualisés (p. 198), et finalement la science elle-même, de connaissance de la nature, devient techno-science qui s’accepte comme une technique de simulation des processus naturels et comme une production des corps (comme le montrent bien Hottois et Stengers, p. 243-246).
La peinture moderne, au contraire, s’est souvent confrontée à l’écart dans le visible en tant que celui-ci est imprégné d’invisible. C’est ce qui caractérise déjà la technique du sfumato qui rend les contours imprécis, inventée par Léonard de Vinci : « Si Léonard reprend à son compte l’approche mathématique et mécanique de la nature défendue par Alberti, approche qui prépare l’avènement de la science moderne avec Galilée, il ouvre aussi, à travers l’invention du sfumato, le frayage d’une autre voie, d’une voie qui échappe à la mathématisation et mécanisation de la physis. » (p. 161). Le sfumato n’est pas une image indistincte mais le « déploiement de la physis en tant que spectralité » (p. 164). Parmi les peintres qui auront étudié la présence spectrale de la nature, Gosselin et Bartoli nomment surtout Turner et Dubuffet : « Turner tente de se situer, à l’instar de Dubuffet, au plus près du moment d’éclosion, c’est-à-dire de laisser advenir, à la surface de la toile, le “moment technique” du naturer » (p. 237). Ce n’est pas une technique apte à représenter la nature mais la découverte de la technique qu’est la nature, ce qui se produit à même l’infinité des traces lors du « passage des traces aux tracés dans et depuis l’espacement de l’articulatoire » (p. 240). Ce que les peintres touchent ici, les philosophes le connaissent aussi : Agamben l’appelle puissance et Merleau-Ponty l’appelle l’élément de la chair.
Cette apparition de la « nature » qui se donne en se dérobant, mais qui laisse quand même retracer ses traces, signale le passage de la connaissance à ce que Gosselin et Bartoli appellent co-naissance : « ce que nous tentons de penser comme co-naissance vise […] à ouvrir un monde capable d’accueillir et d’articuler la puissance instable du naturer » (p. 260). « La co-naissance consiste d’abord dans l’art de laisser vivre l’écart, l’espacement articulatoire, en lequel persiste la puissance comme puissance de transformation ou puissance métamorphique. À ce titre, la co-naissance se démarque de l’approche interactionniste promue par la techno-science » (p. 262).
Dans la philosophie moderne, pensée depuis le sujet, les questions de l’être et de la connaissance débouchent sur l’œuvre (qui articule et présente la connaissance de l’être). Le Toucher du monde ne connaît pas de sujet car il pense à même la pluralité de toutes sortes de corps, humains et non humains. Plutôt que d’ériger une œuvre totale, la dernière partie du livre Tracer : de la métaphysique à l’infraphysique, demande comment habiter le monde. Au lieu de survoler le réel, les auteurs demandent au plus près du mouvement du naturer comment accompagner ce mouvement et s’y inscrire. Après avoir montré comment le naturer se déploie comme technique, le livre conclut ainsi en montrant comment « la technique est ce qui rend possible un habiter » (p. 266). C’est en y habitant que l’existant s’inscrit au monde.
HABITER LA TERRE
Gosselin et Bartoli suivent l’impulsion de la grande interprétation heideggérienne de l’époque de la technique en ce qu’ils pensent comme lui que l’onto-techno-logie moderne a fini par écraser tout savoir-habiter-le-monde. Comme Heidegger, ils cherchent donc une nouvelle possibilité d’habiter le monde mais contrairement à lui, ils ne la cherchent nullement dans la refondation de la communauté historiale sur le fondement de la Terre (rendue somme toute silencieuse par Heidegger), mais dans une plongée dans la Terre elle-même en suivant les lignes de son foisonnement minéral, végétal, animal et humain dans toutes ses formes.
L’onto-technologie des temps modernes désire marquer la terre en y apposant un quadrillage mathématique qui permette de substituer le sol par un espace-temps abstrait hors-sol. Sa meilleure illustration est la cité moderne : « Les constructions urbaines et industrielles de la modernité, du chemin de fer au réseau numérique en passant par le réseau (auto)routier ne sont que des prolongements d’une conception de la nature reconstruite selon les seuls principes mathématiques. Le réseau numérique n’est que la version ultime d’un déploiement réticulaire qui a conquis l’ensemble de la planète Terre » (p. 270). Gosselin et Bartoli désirent rompre avec ce quadrillage (comme on peut désirer marcher pieds nus sur la terre). Pour cela, il faut désapprendre à marquer la terre et apprendre à « découvrir la possibilité d’une inscription dans les écarts du naturer » (p. 266). Voilà ce que ferait la technique au sens recherché ici : « La technique est ce qui rend possible un habiter, l’articulation d’un espace sensible comme condition de l’être-avec » (ibid.). Habiter est donc une possibilité technique qui continue la croissance même du naturer lorsque les existants s’inscrivent dans des processus déjà en cours en ajoutant leur propre force aux forces qui sont déjà en jeu. « L’intervention humaine s’inscrit dans un champ de forces dont elle est indissociable. Dans l’inscription l’espacement entre les forces s’articule, se déploie en formes. Cet espacement est toujours mouvant, sans début ni fin assignables dans l’espace et dans le temps, puisqu’il les précède et les rend possible. En ce sens, l’inscription déplie une trame singulière d’espaces et de temps, elle ouvre et elle conditionne l’expérience du paysage (topos) » (p. 269).
L’habitation recherchée dans ce livre se réalise en paysages. Penser la place comme un paysage ne signifie pas penser depuis un point de vue de survol englobant mais depuis les passages à travers, voire dans le paysage. Le paysage consiste en rencontres plus ou moins fortuites, et il est ce qui rend possible une co-habitation. « Le paysage (topos) prend forme dans l’enchevêtrement de ces tracés » (p. 291). « Le paysage (topos) prend forme dans les écarts entre les lignes, à travers les zones de rencontre, les divergences de parcours ou les points d’arrêt du mouvement. Ces lignes expriment les mouvements d’une multiplicité des corps qui dans leur commerce inscrivent une manière d’être au monde à la fois singulière et commune » (p. 293).
L’infra-physique se définit maintenant comme un savoir-faire conforme à un tel paysage. « On parlera alors d’infraphysique, considérant cette approche qui va non pas du particulier à l’universel et de la partie au tout, mais du commun au singulier, qui pense le naturer comme divers apparaissant sans postuler de principe unificateur et totalisant. L’infraphysique ne vient pas après la nature, mais tisse et articule la physis de part en part » (p. 298). L’infraphysique suit le mouvement du naturer comme un geste technique qui s’entend comme un aller-avec (ibid). Elle n’est pas seulement pathique car elle révèle « l’épaisseur sensible du paysage (topos) [qui] est prise dans une profondeur du champ spectrale composée de toutes les traces latentes de l’espace d’inscription » (p. 297). Elle saisit la présence « spectrale » des corps comme mémoire, et les accompagne jusqu’à « l’image-naissante » où ils deviennent visibles.
Pour mieux cerner l’approche infraphysique, Gosselin et Bartoli signalent en quoi la techno-science contemporaine fait voir le monde à travers une « phénoménotechnique » où les phénomènes sont scénographiés techniquement (p. 306-307) – et où même les corps sont des produits. L’inscription cherchée dans Le toucher du monde est à l’opposé de cette opération techno-scientifique (p. 308). Elle s’illustre le mieux par l’art – les auteurs citent encore Warburg, Duchamp, Dubois, Guzmán… – et surtout par l’anthropologie, dont la présence est massive dans la partie sur l’habiter. Gosselin et Bartoli multiplient les exemples sur d’autres façons d’habiter le monde, notamment les mondes orientaux (Jullien, Fukuoka) et indigènes (Viveiros de Castro, Danowski, Descola, Glowszewski, Brunois, Martin) et le monde des enfants autistes décrit par l’éducateur spécialisé Fernand Deligny. Toutes ces expériences d’habiter, non conformes au standard occidental et par ailleurs très variées, redoublent les expériences ordinaires de chacun par des possibilités d’autres expériences, qui se font sentir de manière sylversatile : « À l’inverse de l’universalité postulée depuis l’ontologie unifiante de la cité européenne, l’expérience de la duplicité ontologique ouvre l’existence humaine à la sylversatilité qu’elle n’a cessé de refouler. Contraction de “sylvestre” (sauvage, forêt) et de “versatile” (capable de retournement, duplicité ou ambivalence ontologique), nous appelons sylversatilité ce qui, dans l’épreuve d’un monde, nous expose à des entités non conventionnelles, non sociales, non humaines, marginales ou liminaires, c’est-à-dire aux diverses manifestations des puissances métamorphiques du naturer à partir desquelles un monde peut advenir » (p. 362-363).
Si j’avais un désaccord avec Le toucher du monde, il porterait sur une question technique de philosophie, sur l’interprétation du terme philosophique de khôra : ne risque-t-on pas ici de le rabattre à la simple hylé ? Mais peu importe, car sylversatilité a une autre portée. Car il est vrai que la khôra se donne comme une dimension transcendantale, alors qu’ici on cherche tout autre chose : les rencontres des êtres réels qui font un paysage concret, concrescent. Là où la khôra reste éternellement dans l’ombre, la sylversatilité de ces rencontres donne couleur, chair, joie et sérieux au paysage déployé dans Le toucher du monde.
Notes
1. Jean-Luc Nancy, Corpus, Paris, Métailié, 2006, p. 34, cité dans Sophie Gosselin et David Gé Bartoli : Le toucher du monde. Techniques du naturer. Paris, Éditions Dehors, 2019, p. 394
2. Nancy nomme déjà l’éco-technie dans Corpus, op cit., mais il développe aussi ce motif notamment dans Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 1996, p. 158-166, et dans Le sens du monde, Paris, Galilée, 1993, p. 159-162, voir aussi 211-212.
3. Tristan Garcia, Forme et objet : Un traité des choses. PUF 2010.
4. Levi R. Bryant, Onto-Cartography. An Ontology of Machines and Media. Edinburgh University Press 2014.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Désétatiser nos imaginaires politiques et nos savoirs scientifiques
Igor Babou, Joëlle Le Marec, Terrestres, 11 septembre 2019

Face à l’effondrement environnemental qui s’annonce, l’État est-il un recours ou l’un des problèmes existentiels de l’espèce humaine ? Revisitant l'actualité de la pensée libertaire de l'écologie de Murray Bookchin, cet essai interroge l’hégémonie d'un modèle de scientificité promu par l’État. Il est temps de désétatiser notre imaginaire écologique.
Les appels à un renforcement de l’action de l’État se multiplient depuis quelques années : appel d’Aurélien Barreau avec des artistes et des intellectuels, appel de la jeunesse à l’initiative de la jeune suédoise Greta Thunberg, appel des enseignants pour la planète, actions de 350.org, etc. La plupart de ces appels désignent l’État ou les États (l’Europe) comme cibles et interlocuteurs des actions de revendication.
Cet étatisme contemporain d’une partie du mouvement écologiste ne peut qu’interroger celles et ceux qui se rappellent d’un manifeste rédigé en 1969 par l’un des fondateurs de l’écologie politique, Murray Bookchin, dont l’actualité de la pensée apparaît clairement dans cette citation :Nous espérons que les groupes écologistes écarteront tout appel au « chef de l’Etat » ou aux institutions bureaucratiques nationales et internationales, c’est-à-dire à des criminels qui contribuent matériellement à la crise écologique actuelle. Nous pensons que c’est aux gens eux-mêmes qu’il faut faire appel, à leur capacité d’agir directement et de prendre en main leur propre vie. C’est seulement ainsi que s’édifiera une société sans hiérarchie et sans domination, une société où chacun sera le maître de son propre destin. 1Murray Bookchin, Roots, New-York, 1969
traduit dans Bookchin, M., Pouvoir de détruire, pouvoir de créer, L’Echappée, Paris, 2019
Face à l’effondrement environnemental qui s’annonce, l’État peut-il contrer la destruction des écosystèmes planétaires, ou, inversement, doit-on le considérer comme l’un des problèmes existentiels que l’espèce humaine a dorénavant à affronter ? Cette question est stratégique et essentielle à traiter sérieusement dans un contexte où toute une série d’acteurs sociaux – ONG, militants écologistes, scientifiques, etc. – sont en train de se mobiliser et organisent leurs stratégies avec l’espoir, publiquement exprimé, que l’État s’implique davantage pour la protection de la nature, pour la lutte contre l’effondrement de la biodiversité, contre l’aggravation du réchauffement climatique et de la pollution des terres et des océans. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on désigne ainsi l’État ?
Avant tout, répondre à ce type de question impose de préciser, même brièvement, « d’où l’on parle ». Ces enjeux relèvent en effet plus souvent de la circulation de discours d’opinion que d’analyses étayées par des observations. Si nous nous exprimons à ce sujet, c’est parce que nos travaux de recherche, qui prennent la forme d’enquêtes de terrain, portent directement sur les politiques de protection de la nature, sur les mobilisations environnementales, sur les attentes, représentations et actions des publics à l’égard des sciences et de l’environnement, bref, parce que nous observons depuis des décennies ce sur quoi nous nous exprimons ici. Cela n’élimine en rien la dimension nécessairement idéologique de tout raisonnement sur l’action publique et la nature, mais au moins cela permet d’éviter un certain nombre des pièges du sens commun ou du prêt à penser médiatique. Ensuite, si nous nous exprimons au titre d’une connaissance « scientifique » de ces questions – c’est-à-dire argumentée du point de vue des sciences humaines et sociales -, nous n’en sommes pas moins inquiets et concernés en tant qu’habitants de ce monde en cours d’effondrement. C’est pourquoi cette discussion reposera en dernière analyse sur des choix politiques et éthiques. Enfin, nous avons lu les auteurs de l’écologie politique et de la socio-anthropologie de la nature, mais nous ne ferons pas ici le détour par l’histoire des idées ou la problématisation des débats contemporains dans ce domaine. Ce texte n’a pas vocation à être publié en tant que production de recherche, et nous préférons argumenter en nous appuyant sur notre expérience directe des questions, problèmes, institutions et pratiques de l’écologie politique.Le premier postulat qu’il nous paraît important de poser, c’est que la situation d’effondrement décrite par le GIEC2 ou l’IPBES3 a pour origine non pas l’espèce humaine dans son ensemble, mais les modes d’organisation économiques, politiques et sociaux imposés par le développement du capitalisme industriel et par le type de rationalité produit et enseigné par les techno-sciences. Il est très important de ne pas essentialiser l’espèce humaine dans son rapport à la nature, aux savoirs et au développement si l’on ne veut pas se tromper de diagnostic : toutes les populations humaines ont eu un impact sur l’environnement et sur les paysages, mais l’anthropologie permet de comprendre que cet impact et que la responsabilité des humains sont très différents selon les modes de développement et d’organisation et selon les types de connaissances qui ont été privilégiés par les sociétés. Seul le développement industriel contemporain, qui doit son efficacité aux mécanismes d’administration de la preuve et de prévision des techno-sciences, a causé des destructions telles que l’on en arrive aujourd’hui à craindre la fin de l’espèce humaine et de pans entiers du vivant.
La coupure qui s’est instaurée entre nature et culture à partir du XVIIème siècle avec l’avènement des sciences empiriques et des idéologies du progrès technique et de l’utilitarisme (« maître et possesseur de la nature » disait Descartes) n’est pas du tout une constante dans l’histoire des sociétés humaines. De même, la conception du monde selon laquelle la « nature » serait un ensemble d’éléments extérieurs à l’humanité et que l’on pourrait donc « gérer » ou « préserver » de l’humain, n’a rien d’universel4. C’est pourquoi nous récusons, avec d’autres, le terme d’Anthropocène, et s’il faut vraiment instaurer de grandes périodisations, nous préférons utiliser celui de Capitalocène. Le paradoxe qu’il faut cependant affronter c’est celui d’une scientificité qui fournit aujourd’hui les outils du diagnostic de l’effondrement – et donc de la dénonciation du modèle économique et politique qui le sous-tend – mais dont nous avons pourtant toutes les raisons de croire qu’elle en est l’un des facteurs importants.
L’ÉTAT ET LES POLITIQUES DE LA NATURE
Venons-en maintenant à la question de l’État et des politiques de la nature. Commençons par poser quatre points préalables à cette réflexion.
Le premier point à avoir en tête est que les questions d’environnement sont planétaires. On ne peut donc pas raisonner uniquement au niveau d’un seul État. Il faut tenir compte de la grande diversité des manières dont les États mettent en œuvre des politiques de protection de la nature. Il se trouve que l’un d’entre nous analyse depuis dix ans les politiques de protection de la nature et leurs effets concrets dans des parcs naturels5 situés dans plusieurs pays (Argentine, France, Espagne). On dispose par ailleurs de toute une littérature scientifique sur ce sujet. Au plan quantitatif, environ 15% des terres de la planète et 10% des eaux territoriales correspondent à des aires naturelles protégées et font l’objet d’une gestion administrative et scientifique. Les aires naturelles protégées fournissent donc un bon observatoire des politiques publiques en matière d’environnement.
Le deuxième point important est qu’il existe deux grands types de cadres réglementaires pour la protection de l’environnement. Soit des lois nationales, soit des conventions internationales signées sous l’égide de l’Unesco (patrimoine mondial, réserves de biosphère, etc.). Mais comme l’Unesco n’a aucun pouvoir de contrainte sur les États signataires des conventions internationales, ce sont les États qui mettent en œuvre ces conventions sur la base de leurs législations nationales.
Le troisième point clé est que l’action de l’État ne passe pas seulement par l’application de lois, car elle doit aussi s’appuyer sur l’implication des populations locales et leur participation aux prises de décision : dans l’article 8 de la convention sur la diversité biologique, signé par la France en 1992, l’Unesco reconnaît « les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle ».
Enfin, le quatrième point est qu’une politique nationale de protection de l’environnement qui repose sur des lois n’a d’effet que si elle est appliquée concrètement sur les espaces protégés. Ce ne sont donc pas seulement les lois qu’il faut analyser, mais l’ensemble des conditions économiques, politiques, culturelles, sociales, et organisationnelles de leur application.
Une fois ces quelques préalables posés, on ne peut pas dire que l’action de l’État serait une solution en soit. Dans certains cas, l’appareil législatif n’est tout simplement pas appliqué en raison de la faiblesse de l’État ou de sa corruption. On peut avoir des lois rigoureuses en matière de protection de la nature, mais si l’État ne finance pas de postes pour des éco-gardes ou ne leur donne pas les moyens de travailler efficacement, ces lois seront sans effet. En France, l’État est très centralisé et notre pays a une culture régalienne forte, mais il faut tenir compte d’une tendance contemporaine à la dérégulation. Depuis la loi de 20066, les parcs nationaux ont vu leur gestion se transformer et ils sont maintenant plus dépendants qu’avant des collectivités territoriales et des « parties prenantes » (acteurs économiques, etc.), c’est à dire des formes contemporaines de la gouvernementalité libérale. Ils sont aussi plus proches dans leur fonctionnement des parcs régionaux et une partie de leurs actions relève du développement économique et non de la conservation. Enfin, depuis 2011, la tendance est à la réduction de leurs budgets de fonctionnement et de leurs effectifs. Un rapport du Commissariat général au développement durable de 2018 décrit ces baisses, et indique que plusieurs parcs ont dû renoncer à certains de leurs objectifs par manque de personnel. Or, ces objectifs font partie de la politique de l’État français. Enfin, le même rapport se conclut en demandant aux parcs de trouver des moyens de fonctionnement complémentaires via le secteur privé et le « naming »7, ou via le mécénat d’entreprise, ou même en mettant en place des taxes sur l’extraction de ressources naturelles en leur sein, ou encore par l’émission d’obligations vertes pour attirer des fonds de pension, voire de recourir au bénévolat… bienvenue dans un monde de précarité et dans une nature financiarisée, marquetée et toujours aussi exploitée !
On voit donc bien que l’action d’un État aussi régalien que la France n’est pas la garantie en soi d’une politique efficace de protection de la nature tant que les dogmes du libéralisme s’appliqueront. À cela s’ajoute la faiblesse de l’action et de la réflexion de l’État en matière de participation des populations à la prise de décision dans les parcs, quand ces derniers sont habités. Enfin, pour quitter le domaine des aires naturelles protégées, quand l’État français agit, c’est assez souvent contre-productif : on connaît tous les luttes qui ont dû être menées par des activistes pour contrer les « Grands Projets Inutiles », la politique d’enfouissement des déchets nucléaires, les constructions en zones fragiles (notamment la destruction des littoraux français par une urbanisation débridée), le projet minier de la Montagne d’Or en Guyane, etc., mais on constate aussi actuellement une politique explicite de dérégulation : avec la privatisation des barrages, ou celle d’Aéroports de Paris, l’État se prive de possibilités importantes d’action en matière d’énergie ou de transports. Symétriquement, quand il y a renforcement des prérogatives régaliennes de l’État français, cela va dans le sens d’un affaiblissement des dispositifs d’expertise indépendante susceptibles de réguler le développement industriel pour des raisons écologiques : ce fut le cas en 2018 avec la suppression progressive des enquêtes publiques qui étaient menées en amont des projets d’aménagement, et en 2019 avec le projet d’affaiblissement de l’Autorité environnementale.
Cette dérégulation ne bénéficie cependant pas à l’initiative et à l’expérimentation citoyenne, environnementale et politique. Sur le terrain, on constate la faiblesse des dispositifs de repérage et d’accompagnement des initiatives vertueuses. Le travail d’enquêtes sur les lieux et collectifs qui s’engagent dans des actions en faveur de l’environnement relève de l’initiative militante ou de travaux de chercheurs impliqués.
Mais pire encore, ces initiatives font l’objet d’entraves et de répressions continuelles. Par exemple, rappelons que c’est pour empêcher la destruction d’un espace naturel fragile et pour s’opposer au développement du transport aérien dans une zone déjà bien dotée en aéroports, que la contestation du projet d’aéroport de Notre Dame des Landes est née et s’est concrétisée avec une occupation. La ZAD a fait l’objet d’un démantèlement très violent alors que précisément elle était une expérimentation socio-environnementale à grande échelle. Il s’agissait non seulement d’une lutte pour empêcher la construction d’un aéroport (de ce seul point de vue les zadistes mériteraient la reconnaissance collective car ils ont permis d’éviter qu’une erreur majeure ne soit commise) mais aussi, bien sûr, de développer une autre manière de vivre et de s’organiser sur un territoire autonome. La ZAD a vu s’organiser depuis 2009 la cohabitation entre de nombreux habitants, anciens ou plus jeunes, agriculteurs ou pas, avec des visions et des convictions très différentes, mais tous impliqués dans une manière d’habiter qui montrait que politiquement et socialement, nous avons moins besoin que nous le pensons d’être gouvernés et gérés. On retrouve dans la ZAD ce qui caractérise d’autres lieux d’expérimentations : l’importance de l’éducation populaire, les expérimentations de fonctionnements politiques, et l’auto-critique des multiples rapports de domination enchâssés dans les organisations (sexisme, racisme, etc.). Si le déluge de grenades lacrymogènes, l’envoi de blindés, la destruction des habitations à partir du 9 avril 2018 puis le 24 mai 2018 ont été si massifs à la ZAD, c’est aussi pour empêcher le développement de ces alternatives, pour les rendre impensables, inimaginables, inexistantes. En milieu urbain, il existe également des initiatives relevant de l’écologie sociale, comme le Laboratoire Ecologique Zéro Déchet (à Noisy-Le-Sec, puis à Pantin), qui se voient constamment empêchées de se développer en dépit de l’adhésion qu’elles rencontrent dans la population environnante.
Les initiatives sont donc pour la plupart niées ou entravées par les pouvoirs publics avec une telle constance qu’il est impossible de faire crédit à l’État d’un réel intérêt pour ce type d’expérimentations pourtant si précieuses en contexte d’urgence environnementale. Nous devrions donc, quand nous en appelons à l’État, nous demander pourquoi il n’y a aucune action de repérage et d’accompagnement de l’initiative vertueuse, mais tout au contraire la répression systématique des expérimentations dignes de ce nom (nous ne parlons pas ici des occupations extrêmement temporaires des friches urbaines).
APPELS À L’AUTORITÉ ET PUBLICS INFANTILISÉS
Un des problèmes vient du refus de considérer ensemble la question environnementale et la vie politique et sociale. Or les questions politiques, sociales et environnementales sont étroitement liées. Mais on ne veut pas voir ces liens précisément parce que les rapports de domination s’accompagnent d’une mainmise sur les représentations du réel social, environnemental et politique. On constate ainsi un refus de laisser s’exprimer des voix différentes, et une volonté de contrôler les discours collectifs, ce qui aboutit à ce que la linguiste Marie-Anne Paveau a appelé l’énonciation ventriloque8 : de nombreuses personnes ou collectifs sont parlés et décrits par autrui. Ils se voient privés de la possibilité de prendre en charge eux-mêmes leur propre représentation et l’expression de leurs propres expériences, et sont représentés d’une manière qui les disqualifie ou les rabaisse. Les « gens » sont ainsi constamment représentés comme infantiles ou défaillants, par exemple dans les interventions publiques d’Aurélien Barreau. Celui-ci en appelle en effet à des mesures autoritaires en comparant les individus à des enfants qui auraient cassé leur jouet, et que l’État devait donc protéger des effets de leur immaturité, avec des mesures qui seraient courageusement impopulaires.
Nous faisons donc ici un lien direct entre l’entrave à l’initiative, l’appel à l’autoritarisme, et une insensibilité au public, à la population. Remarquons au passage que le « peuple » refait son apparition dans les discours médiatiques et politiques à travers la référence péjorative à la montée des « populismes », là où le mot « démagogie » serait plus adapté pour qualifier les discours politiques : signe évident d’un mépris pour la population.
Or, la crise environnementale majeure coïncide avec l’exigence de prêter attention à quantité d’êtres et de phénomènes qui ont été et continuent d’être invisibilisés, niés ou masqués sous des représentations qui les trahissent. Si les dégradations environnementales ont été si anormalement graves et massives, c’est bien que nous nous sommes arrangés pour ne rien voir ou ne rien sentir. Cette fabrique de l’aveuglement volontaire doit être remise en question : elle concerne non seulement les autres êtres vivants, mais aussi des groupes et des personnes humaines. L’aveuglement et l’insensibilité aux entités vivantes (animaux, plantes, milieux écologiques) qui a rendu possible leur destruction, est le même aveuglement et la même insensibilité qui affectent des populations humaines et des personnes sans pouvoir, et que l’on ne veut ni entendre ni voir. Certaines d’entre elles sont en outre déjà représentées par des discours et des figures les concernant, qui les masquent et les desservent : ainsi, les femmes ont été parlées par des hommes pendant des siècles. Face à cela, il est sans doute intolérable pour l’État de voir se développer des initiatives citoyennes : cela signifierait que les savoirs et discours qui circulent à propos de la population sont faux. Ce sont donc des rapports de domination qui interviennent, à tous niveaux, dans la minoration obstinée des voix différentes ou ordinaires.
MINORER LES PRÉOCCUPATIONS DES PUBLICS : UN BIAIS PERSISTANT
Les enquêtes auprès du public des musées de sciences9 ont été l’occasion de constater l’incompréhension tenace, voire le refus de prendre au sérieux ce qui s’exprime de la part du public lorsque celui-ci n’est pas parlé ou sondé par d’autres : scientifiques, politiques, acteurs du marketing et des médias.
1986 a été l’année où ont coïncidé l’ouverture de la cité des Sciences et la catastrophe de Tchernobyl. Un des colloques organisés cette année-là à la Cité des Sciences a vu se succéder à la tribune des chercheurs internationaux dénonçant rituellement le problème des « peurs irrationnelles » chez les publics. L’un des membres de la direction de l’établissement était alors intervenu en signalant que la catastrophe de Tchernobyl, étrangement oubliée par les orateurs, prouvait que les populations avaient parfaitement raison d’avoir peur et d’être préoccupées du fonctionnement des sciences. Pourtant le thème des peurs irrationnelles et de leur gestion politique et culturelle continue aujourd’hui d’être constamment invoqué.
En 1988, la cité des Sciences a choisi d’ajouter aux expositions permanentes un espace consacré à l’environnement. L’équipe projet souhaitait éviter tout discours alarmiste, jugé contraire à l’esprit scientifique et à l’exercice de la raison. Le choix s’est donc porté sur le refus de toute approche émotionnelle ou sensible, et sur l’explicitation de concepts : espèce, population, écosystème, etc. Une enquête préalable auprès des visiteurs de la Cité des sciences avait mis en évidence une préoccupation très forte pour la dégradation des relations Homme/nature et elle avait également fait apparaître l’interprétation politique de l’initiative de la Cité des sciences de traiter la question. Ainsi, les visiteurs étaient heureux qu’une institution liée à la science, réputée honnête et indépendante, fasse entendre sa voix contre celle des médias « qui disent n’importe quoi » : qu’elle rende publics des diagnostics, situe les responsabilités, évoque le rôle des scientifiques (que les visiteurs imaginaient tantôt soumis à la puissance des acteurs industriels, tantôt rivés à l’exigence de vérité et du bien public), et propose une place au public. Le rapport tiré de cette enquête a rencontré l’incrédulité dans l’équipe muséale, y compris de la part de chercheurs en sciences sociales : la préoccupation environnementale semblait trop vertueuse pour être vraie, ou bien inspirée par un attachement réactionnaire à la nature. Les visiteurs si soucieux d’environnement avaient-ils par ailleurs des comportements de consommation vertueux10 ? Or, la préoccupation des publics à l’égard de la dégradation des relations Homme/nature s’est confirmée dans la plupart des enquêtes par entretiens les années suivantes. L’expression inaudible de cette préoccupation a d’ailleurs eu une grande importance puisqu’elle a déterminé le choix d’une carrière de recherche pour l’une d’entre nous, les attentes institutionnelles à l’égard des études et évaluations paraissant en décrochage chronique avec ce qui s’exprimait spontanément dans le public. Plusieurs années plus tard, en 1994, à l’occasion du lancement d’un programmes d’expositions et de manifestations intitulé « La planète », Jean-Paul Natali, membre de la délégation aux affaires scientifiques à la Cité des sciences, avait à son tour organisé des ateliers délibératifs non plus avec des visiteurs mais avec des personnes recrutées par voie de presse. À nouveau la force des préoccupations environnementales, les attentes à l’égard de l’institution, ont pris de court les équipes muséographiques qui commençaient déjà à se positionner en termes d’offre culturelle dans le champ du loisir culturel.
Ce que nous souhaitons mettre en avant, avec cet exemple d’études de public maintenant anciennes, c’est la capacité précoce des publics de se saisir des enjeux écologiques et à imaginer des actions institutionnelles qui leur donnent un rôle et une place intéressants, du moins lorsqu’ils sont respectés et écoutés dans des situations qui ont un sens, et non pas simplement sondés n’importe comment et n’importe où.
Mais revenons brièvement au thème constamment invoqué des peurs irrationnelles du public et donc à l’impossibilité supposée de lui faire confiance. Cette posture viriliste de dénonciation des peurs et affects n’est pas nécessairement plus raisonnée que l’expression de préoccupations. En 1978, Joanna Macy, une militante éco-féministe, considérait le désespoir environnemental comme un état à partir duquel les femmes pouvaient partager et élaborer des actions communes. Dans ce type d’approche éco-féministe, les émotions et la peur des catastrophes à venir ne sont plus mises à distance comme étant irrationnelles, mais intégrées à une approche collective, sensible mais raisonnée, de la situation analysée. On évoque désormais plus volontiers qu’on ne le faisait il y a quelques années les émotions qui animent les chercheurs dans le domaine de l’environnement et du climat, et qui ont conduit il y a plus de soixante ans un chercheur aussi incontesté que Jean Malaurie à transformer ses projets et pratiques de recherche pour se porter témoin des Inuits.
LA VOIX DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Cela nous amène un autre problème : la minoration ou l’occultation de la pertinence des sensibilités et des expériences est à mettre en lien avec l’affaiblissement continu des sciences humaines et sociales, affaiblissement en partie organisé par l’État et ses réformes, alors même que dans ce domaine disciplinaire se développent des travaux qui permettent de situer le politique dans le soin quotidien destiné à ceux avec qui l’on vit et au milieu dans lequel on vit (ce que l’on appelle le « care » dans les théories anglo-saxonnes) et non plus dans l’ailleurs lointain et abstrait des politiques publiques de la mondialisation ou des réseaux de communication. Les scientifiques des sciences de la nature et les décideurs privilégient ainsi une pensée gestionnaire parsemée d’idées fausses sur la société et la culture. Il ne viendrait à l’idée d’aucun sociologue de proposer une expertise et des préconisations concernant des questions relevant de la physique ou de la biologie, mais la modestie et le scrupule qui devraient animer tout scientifique qui ne connaît rien d’un domaine s’évaporent lorsqu’il est question de dire quelque chose des pratiques culturelles, de la pensée sociale, des formes organisations, ou des manières de vivre et d’agir.
L’URGENCE : DÉCONSTRUIRE DE FAUSSES ÉVIDENCES
Pour nous il y a une triple urgence : dés-essentialiser les notions, désétatiser l’imaginaire de l’action, et transformer les rapports aux savoirs.
– Des-essentialiser : l’« humain », ça ne veut rien dire. Tant qu’on utilisera cette catégorie fourre-tout, on se trompera gravement dans les diagnostics et dans l’attribution des responsabilités. Il faut au contraire tenir compte des leçons des sciences sociales, notamment de l’anthropologie, pour comprendre que ce sont les sociétés capitalistes qui sont à l’origine de ce qui n’est pas une « crise » environnementale, mais un effet structurel du mode de développement d’une partie seulement des sociétés humaines. De même « l’État » est une catégorie trop large puisque selon les États, les politiques de la nature divergent. Il y a un travail de connaissance à approfondir pour comprendre concrètement qui agit, selon quelles modalités, et avec quels effets.
– Désétatiser : c’est avant tout nos imaginaires politiques qu’il faut désétatiser. Car tant que l’on attendra tout d’une abstraction comme l’État, et tant qu’on la posera comme au-dessus des habitants, on restera dans le contexte d’une société de la domination et dans le cadre de fonctionnements centralisés et gestionnaires. Or, on a besoin aujourd’hui de diversité : pas seulement de diversité biologique, mais aussi d’une diversité culturelle et politique. Diversité politique, parce qu’aucun système politique ne peut s’imposer mondialement sans s’appuyer sur une forme de totalitarisme. De ce point de vue, nous vivons un moment politique dangereux. Quand on se disputait au nom d’idéologies, entre marxistes et libéraux par exemple, les choix politiques pouvaient apparaître comme liés à des intérêts individuels ou collectifs en conflit. Mais avec la crise environnementale et la place que prend l’expertise, on est en train de définir un horizon normatif qui transcende la conflictualité, et c’est pourquoi on en arrive – avec les appels d’Aurélien Barreau et d’autres – à des revendications potentiellement ou explicitement autoritaires, visant à contraindre les populations au nom de cet horizon normatif non dialectique. Surtout si ces revendications reposent sur des notions essentialisées comme « l’humain » et « l’État ». Diversité culturelle, parce que les dégâts du capitalisme sont aussi les dégâts de l’uniformisation et de la mondialisation d’un système économique. On a besoin de prendre au sérieux les modes de relation au monde d’autres cultures. Pas pour penser tous comme des autochtones d’Amazonie, car nous avons un parcours historique différent de ces populations, mais comme source d’inspiration et comme ouverture à d’autres possibles. Et dans cette diversité culturelle, il faut ranger la diversité des modes de connaissance : la science empirique contemporaine est un indicateur utile pour comprendre ce qui nous arrive – heureusement que le GIEC et l’IPBES existent ! -, mais elle constitue aussi un élément du problème à cause de son obsession de la maîtrise de la nature et de son utilitarisme.
– Transformer les rapports aux savoirs : on a besoin aujourd’hui d’une science qui ne reposerait pas uniquement sur la domination de la nature et qui reconnaisse ses erreurs et ses impasses. Il y a eu tout un mouvement allant dans ce sens au sein des milieux scientifiques dans les années 1970 à 1980, avec les mouvements d’auto-critique des sciences. Ce mouvement s’appuyait sur un intérêt pour l’interdisciplinarité entre sciences humaines et sociales et sciences de la nature. Ce mouvement a d’ailleurs été en partie à l’origine, en France tout au moins, des premières expressions publiques d’une écologie politique radicale : nous faisons ici référence à des universitaires comme Alexandre Grothendieck, Jean Marc Levy-Leblond ou Pierre Clément, et à des publications comme Survivre et vivre, Labo contestation et Impascience. Or, ce mouvement était ouvert à la parole et aux savoirs de communautés non scientifiques et non académiques.
DÉSÉTATISER LES IMAGINAIRES ET LES SAVOIRS
Si nous voulons combattre la situation d’effondrement environnemental en donnant des outils conceptuels et pratiques aux générations qui auront à affronter ce défi, alors nous devons repenser intégralement l’enseignement de l’école primaire au supérieur. Mais cela ne consisterait surtout pas à insérer dans chaque cycle d’enseignement des cours d’écologie ou de biologie comme certains le demandent. Ce serait là un aveu d’échec intellectuel et politique majeur. Ce dont nous avons besoin, c’est plutôt d’un enseignement interdisciplinaire, articulant sciences humaines et sociales et sciences de la nature et qui serait ouvert à la critique de science de manière à poser les bases d’une rationalité expurgée de ses effets de domination et de hiérarchisation. Il faudrait même certainement dépasser cette interdisciplinarité critique, qui resterait très abstraite sans une éducation écologique articulée à des modes d’habiter donnant une consistance et un sens partagé à ce qui est enseigné et appris. Une enquête récente menée en France sur les ZAD, leurs habitants et leur manière de penser et de vivre leur habitat a ainsi montré comment les représentations du monde de ces habitants se transformaient par le fait-même d’habiter et de construire d’une manière spécifique11 : non seulement par le contact sensible avec la nature, mais aussi par les pratiques d’habitat autonome, les esthétiques privilégiées pour l’aménagement, etc. Les expériences très concrètes menées par Murray Bookchin et ses étudiants au début des années 1970 dans le cadre de l’Institut d’Ecologie Sociale (Vermont, USA) seraient également une source d’inspiration, l’enseignement interdisciplinaire y ayant été développé de concert avec une réflexion systématique sur l’habitat.
Aujourd’hui, le contexte des politiques publiques est cependant celui d’une domination des sciences de la nature dans les formes d’organisation et de gouvernance des institutions de recherche et d’enseignement. Cet état des légitimités disciplinaires, et les styles autoritaires de gestion de l’enseignement supérieur et de la recherche qui se sont installés dans les institutions éducatives et de recherche depuis plusieurs décennies, ne permettront pas de construire une véritable interdisciplinarité pour avancer vers des solutions à la fois démocratiques et écologiques, ni pour promouvoir et mettre en place des enseignements qui seraient cohérents avec la lutte contre l’effondrement en cours.
Il serait donc urgent de développer, en particulier au sein des institutions de recherche et d’enseignement, une pensée non autoritaire, non hiérarchisée et non centralisée, capable de réflexivité et d’auto-critique et qui désigne clairement ses ennemis : le capitalisme, le productivisme, et le libéralisme qui promeuvent la concurrence plutôt que la coopération, et le gaspillage plutôt que la sobriété. Ce qu’il faut arriver à penser ensemble, sans les dissocier, ce sont les dimensions écologiques, politiques et sociales de nos manières d’habiter le monde. Il ne s’agit cependant pas de créer un nouvel académisme reproduisant une nouvelle science à la pointe des modes contemporaines. Les étiquettes du type « humanités environnementales », de même que les anglicismes chics de la « political ecology », ou le thème de la « survie dans les ruines du capitalisme »12 nous paraissent ainsi suspects de ce modernisme académique de pointe dont les universitaires ont le secret quand il s’agit de tout changer pour que jamais rien ne change. L’enjeu réel est de créer un corpus de savoirs et de pratiques permettant de reconstruire une nouvelle société qui ne sera écologique que si elle devient égalitaire, et qui ne deviendra égalitaire que lorsque nous aurons désétatisé nos imaginaires.
En concluant notre propos sur cet appel à une refondation libertaire de nos imaginaires, nous sommes conscients de marcher dans les traces des penseurs précurseurs qu’étaient Murray Bookchin et André Gorz : il est urgent de les lire ou de les relire. Cependant, cette relecture ne peut pas se faire sans critiquer leur absence d’interrogation des effets de domination inscrits dans les savoirs scientifiques. Tout occupés qu’ils étaient à élaborer des utopies permettant de sortir nos sociétés de la barbarie capitaliste, ces auteurs ont en effet négligé de déconstruire les bases politiques des sciences qui leur apparaissaient comme des outils d’émancipation13. Aujourd’hui, nous devons apprendre à nous émanciper des techno-sciences quand elles n’interrogent plus le monde – du vivant aux sociétés – et quand elle se prêtent à la tentation d’une gestion surplombante. Ce travail ne peut être que long et imprévisible dans les formes qu’il peut prendre pour chacun. Mais pour terminer sur une maxime bookchinienne, nous restons persuadés que l’humain n’est pas le problème, mais la solution. Du moins, si la catégorie de « l’humain » est dés-essentialisée et reposée dans ses relations écologiques à l’ensemble des êtres et des formes politiques et cognitives.
Notes
1. ↟ Murray Bookchin, Roots, New-York, 1969 (traduit dans Bookchin, M., Pouvoir de détruire, pouvoir de créer, L’Echappée, Paris, 2019
2. ↟ Groupe International d’Experts sur le Climat : https://www.ipcc.ch/
3. ↟ Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques : https://www.ipbes.net/
4. ↟ On ne peut que déplorer la parution en librairie d’un essai, « le bug du cerveau » de Sébastien Bohler (Robert Laffont, 2019), qui situe dans le cerveau humain la propension de l’Humanité à détruire la planète. Il est désolant de trouver de nos jours ce type de propos universalisant sans aucune prise en compte de la diversité des populations humaines dont les cerveaux semblent fonctionner autrement que celui de ce prétendu Homme universel.
5. ↟ Voir par exemple Babou, I. Disposer de la nature. Enjeux environnementaux en Patagonie argentine, Paris, L’Harmattan, 2008.
6. ↟ Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux
7. ↟ Pratique de sponsoring : les parcs concèdent leur nom en tant que « marque » lors de labellisations, notamment pour des entreprises situées sur leur territoire.
8. ↟ https://penseedudiscours.hypotheses.org/4734
9. ↟ Le Marec, J. Publics et musées. La confiance éprouvée, Paris, L’Harmattan, 2007.
10. ↟ Cette remarque, fréquente, ne tient pas : nous sommes tous le public, et nous éprouvons tous le décalage entre nos modes de vie et la conscience de ses effets négatifs. Cela ne signifie nullement que nous ne serions pas prêts à vivre autrement
11. ↟ Voir par exemple les travaux de Clara Breteau, et en particulier cet article tiré de sa thèse : POÈME : la POïesis à l’Ère de la Métamorphose, Ecozon@, Vol 10, n°1, 2019.
12. ↟ Nous faisons ici référence à l’ouvrage d’Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, La Découverte, 2017.
13. ↟ On peut mettre à part le texte de Bookchin « Les ambiguïtés de la science », publié pour la première fois en 1982, même si ce texte interroge les ambiguïtés de la science d’un point de vue très général, sans entrer dans le détail des fonctionnements institutionnels et économiques des sciences contemporaines. Voir Bookchin, M., Les ambiguïtés de la science, Pouvoir de détruire, pouvoir de créer, Paris, L’Echappée, 2019.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
livre déjà signalé. Un récente lecture critique
TOUS (et toutes) DOMESTIQUÉ(e)S ?
Comment en sommes-nous arrivés là ?
À propos de Homo domesticus de James C. Scott
La découverte, 2019, 302 pages.
Charles Stepanoff, Terrestres, 26 juin 2020

À propos de Homo domesticus de James C. Scott
La découverte, 2019, 302 pages.
Charles Stepanoff, Terrestres, 26 juin 2020

D'où vient notre rapport particulier à la nature ? Quel est le rôle de la domestication des plantes et des animaux dans l'avènement de l'État ? Avec les ressources de l'ethnographie, de l'archéologie et de l'anthropologie, et en s'attaquant au livre plébiscité de James C. Scott, Homo domesticus, Charles Stépanoff vient déconstruire et complexifier l'histoire simplificatrice de la domestication comme réalité homogène et inchangée depuis la Préhistoire.
La crise écologique globale a ramené au cœur du débat les grandes questions des origines que le structuralisme avait rendues désuètes : d’où vient notre rapport particulier à la nature ? Comment ont émergé nos économies et nos modes de vie ? L’humanité est-elle vouée depuis son apparition à détruire son milieu vital ? La notion d’Anthropocène vient insérer les dévastations écologiques actuelles dans une perspective de long terme qui renvoie les contemporains aux vastes échelles temporelles de la géologie et de la préhistoire. Les enjeux graves et immédiatement politiques de ces questions leur ont donné un tour souvent imprécatoire. De nouveaux récits se constituent dans lesquels on montre du doigt les ancêtres responsables des désastres actuels. La ressemblance avec les grands mythes et les récits religieux de la chute originelle est frappante. Cette quête des commencements amène à regarder les sociétés anciennes qui nous ont précédés, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, les premiers fermiers néolithiques, non pas dans la logique spécifique de leur monde mais en tant qu’annonciateurs et précurseurs de notre monde à nous. Nous collectons dans la préhistoire et l’histoire les signes avant-coureurs de notre destinée.
L’ouvrage de James C. Scott se situe sans ambiguïté dans cette nouvelle perspective généalogique dont il illustre bon nombre d’écueils. « Il est difficile de ne pas se demander ‘ce que nous avons fait de mal pour en arriver là.’» dit-il, souhaitant contribuer à « retracer les origines à long terme de nos maux actuels » (p.21, note a). D’après la présentation de son éditeur, son ouvrage « démonte implacablement le grand récit de la naissance de l’État antique comme étape cruciale de la ‘civilisation’ humaine » et « révolutionne nos connaissances sur l’évolution de l’humanité et sur ce que Rousseau appelait ‘l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes’. »
Dans un ouvrage précédent, Zomia ou l’Art de ne pas être gouverné (2009, trad. fr. 2013), Scott proposait déjà un « contre-récit » de l’avènement de l’Etat, sur la base d’une étude des peuples montagnards d’Asie du sud-est. Il montrait que les tribus des montagnes de la « Zomia », classiquement vues comme des groupes n’ayant pas atteint un développement suffisant pour constituer des Etats, s’étaient en réalité formées en grande partie d’individus ayant fui les plaies des sociétés étatiques des plaines : les impôts, l’esclavage et les épidémies. Leur mode de vie centré sur la cueillette et les cultures itinérantes serait à lire comme une forme délibérée de résistance à l’emprise étatique.
Dans Homo domesticus, Scott entreprend d’étendre ce modèle à l’histoire des premiers États pour en faire un trait constitutif du phénomène étatique. Pour Scott, les conditions de vie des habitants des États archaïques (qu’il entend en un sens élastique allant d’Ur à l’empire romain) sont marquées par des épidémies, un travail pénible alimenté par l’esclavage et une crise de la biodiversité. La Zomia n’a pas existé qu’en Asie du sud-est : Scott fait la démonstration convaincante que les anciens Etats ont été régulièrement entourés des zones incontrôlées peuplées par des fuyards et des rebelles échappant à la civilisation. La vie dans ces sociétés « barbares » (Scott désigne ainsi ironiquement les sociétés sans État), caractérisée par la mobilité nomade et par une subsistance diversifiée, permettrait d’échapper à la fois aux épidémies et « à toute forme de sujétion et de domestication par l’ordre social hiérarchique de l’agriculture sédentaire et de l’État » (p. 267).
Or le projet d’Homo domesticus va plus loin qu’une simple extension d’analyses antérieures, il explore les liens entre l’émergence de l’Etat et un phénomène beaucoup plus ancien et général, la domestication par l’homme des plantes et des animaux. C’est cette réflexion qui va nous intéresser, car c’est elle qui constitue l’argument central du livre et, probablement, la cause de son échec. Dans la critique de la domination étatique, Scott marche dans les pas de brillants prédécesseurs : La Boétie, Rousseau, Engels, Kropotkine et de nombreux autres auteurs qui ont décrit d’un point de vue critique l’histoire des sociétés humaines. La particularité de l’argumentation de Scott réside dans sa réinterprétation de la domestication. Selon lui, « une compréhension globale de la domestication en tant que contrôle sur la reproduction est susceptible d’être appliquée non seulement aux plantes et aux animaux, mais aussi aux esclaves, aux sujets de l’État et aux femmes. » (p.12). Les États domestiquent les Barbares, en particulier les femmes, en les réduisant en esclavage de la même manière que les premiers fermiers ont domestiqué les mouflons sauvages pour en faire des moutons. La domestication sert ainsi de fil conducteur à une série d’oppositions dualistes teintées d’appréciations morales qui charpentent le livre : sauvage et domestique, mauvaises herbes et céréales, sociétés nomades et sociétés sédentaires, « Barbares » et « État », liberté et servitude. La domestication est, dans tous ces cas, le processus faisant passer du premier au second terme de l’opposition. Ainsi les pathogènes épidémiques qui se propagent dans les villes surpeuplées existaient depuis plusieurs millénaires dans la domus néolithique, cet espace confiné partagé entre humains, plantes et animaux domestiques.
Une grande part de la séduction troublante de ce livre tient sans doute à son art de réaliser le mariage improbable entre des données scientifiques récentes et des postulats théoriques remontant au XIXe siècle qui n’ont pas cessé de structurer notre perception commune de l’histoire humaine. Au début de son livre, Scott semble prendre en compte les changements de paradigme qui se sont opérés ces dernières décennies dans l’étude de la domestication et des origines de l’agriculture, disqualifiant l’image mythique d’une humanité passant soudainement de l’état sauvage à la civilisation au cours de la « Révolution néolithique ». Il prend note du fait que la sédentarité a existé avant le Néolithique et l’apparition de l’agriculture (p.61) (par exemple la culture natoufienne au Levant), ce qui ne l’empêche pas de réaffirmer plus loin le vieux schéma selon lequel la sédentarité serait une « grande réalisation civilisationnelle » du Néolithique (p.110).
Ces étonnantes contradictions se répètent. Scott constate à juste titre combien nous sommes piégés par la syntaxe en employant le verbe « domestiquer » qui réserve à l’humain la qualité de sujet et place les espèces non humaines en position d’objet (p.35). Ce schéma anthropocentré donne l’illusion d’un processus unilatéral orchestré par l’homme, démiurge domesticateur tout puissant, fort éloigné des modèles scientifiques récents décrivant la domestication comme un processus coévolutif millénaire impossible à planifier1. Or le vieux récit anthropocentré a tôt fait de resurgir plus vigoureux que jamais : « à force de soins et d’attention, nous créons une plante totalement domestiquée (…) elle est notre création ; elle ne peut plus prospérer sans notre intervention. En termes d’évolution, une plante complètement domestiquée est une anomalie florale hyperspécialisée et son avenir dépend entièrement du nôtre. » (p.90). Et dans la suite du livre, Scott ne cesse de recourir au paradigme syntaxique qu’il dénonçait pour décrire la façon dont les États « domestiquent » les Barbares, les femmes, les paysages, etc.
A peine a-t-il reconnu à juste titre qu’« il n’a pas existé de moment magique où Homo sapiens aurait franchi la ligne fatale qui sépare la chasse et la cueillette de l’agriculture, la préhistoire de l’histoire et l’état sauvage de la civilisation » (p.83), voilà qu’il proclame : « Une fois qu’Homo sapiens a franchi le Rubicon de l’agriculture, notre espèce s’est retrouvée prisonnière d’une austère discipline monacale » (p.105). Difficile de renoncer à la croyance au « moment magique » et à l’ethnocentrisme irrépressible qui réduit l’histoire de l’espèce Homo sapiens à celle de nos sociétés agricoles.
Les anciens empires des steppes xiongnu, ouighour et gengiskhanides et même les empires modernes moghol et ottoman sont classés parmi les « Barbares », c’est-à-dire des sociétés mobiles sans États (p.236), mais en même temps ce sont des « proto-États » et des « États itinérants » (p.262).
LE BOIS DE BOULOGNE, BERCEAU DE LA DOMESTICATION
La notion de « domestication », qui sert de colonne vertébrale à la théorie de Scott, n’a rien d’intuitif ni d’universel. Le verbe domesticare, porteur du schéma syntaxique où l’humain est sujet et le non-humain objet, est une invention du latin médiéval, quant au substantif dérivé « domestication », il n’apparaît en français qu’au début du XIXe siècle. Ce qui signifie que, pendant des millénaires, des sociétés humaines ont partagé leur vie avec des plantes et des animaux sans penser qu’elles les « domestiquaient ». Elles considéraient qu’elles les avaient « reçus » d’Isis en Égypte, de Déméter à Rome ou du dieu Soleil chez les Incas. Les différentes variétés de céréales et les races de bétail ont évolué en fonction de processus complexes associant des adaptations spontanées des espèces à l’environnement anthropisé et aux conditions bioclimatiques régionales et des pratiques de sélection humaines motivées par des préférences non seulement économiques mais aussi esthétiques, rituelles et sociales. L’objectif des méthodes de sélection était généralement de maintenir une biodiversité perçue comme spontanée ou reçue d’entités divines. Comme l’a montré l’anthropologue préhistorienne Helen M. Leach, l’idée démiurgique d’améliorer les espèces par sélection dirigée et de créer des races et des cultivars artificiels n’existe pas dans les méthodes agricoles traditionnelles, mais se développe en Europe à partir du XVIIe siècle2. C’est cette attitude nouvelle d’amélioration de la nature qui va servir de modèle aux théorisations du XIXe siècle. La première définition scientifique de la domestication est celle du naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et c’est celle que retient Scott (sans le citer) : « La prise de possession de la race par l’homme, par conséquent, la soumission permanente de l’animal, c’est la domestication. (…) La domestication implique nécessairement la reproduction sous la main de l’homme »3. On fait généralement de ce critère du contrôle sur la reproduction une vérité biologique éternelle en ignorant son contexte historique et social. Dans ces pages, Geoffroy Saint-Hilaire se contente en fait de citer le règlement des concours de la Société impériale d’acclimatation. Cette société savante offrait des médailles à qui serait capable d’obtenir la reproduction en captivité sur deux générations de divers animaux exotiques, comme le kangourou ou l’autruche. Les participants à ces concours étaient des personnages fortunés de toute l’Europe, aristocrates et grands bourgeois capables d’entretenir un zoo sur leur domaine et de faire venir des animaux rares des colonies. On exhibait au Jardin d’acclimatation de Paris, créé par la Société impériale d’acclimatation, les résultats de ces conquêtes, auxquelles s’ajoutèrent bientôt les zoos humains. Tel est le décor historique auquel nous devons notre définition classique de la domestication : la conquête de la nature et des races colonisées par l’homme blanc capitaliste. Le berceau de la domestication, ce n’est pas le Proche-Orient néolithique, c’est le Jardin d’acclimatation du bois de Boulogne de Napoléon III.
Le jardin d’Acclimatation du bois de Boulogne
DES ESPÈCES HANDICAPÉES ?
Scott s’inscrit dans le prolongement direct de cette vision de la domestication quand il décrit les espèces domestiques comme des « créations » « handicapées » de l’homme, entièrement dépendantes de lui pour leur survie (p.36). Chez les animaux domestiques, il diagnostique une perte de conscience de l’environnement et une « diminution générale de leur réactivité émotionnelle » (p.96). Ce déclin cognitif résultant d’une vie confinée dans des enclos pleins d’excréments aurait pour mécanisme une réduction du système limbique. Scott se réfère à ce sujet à des études4 répertoriant les réductions de taille du cerveau chez différentes espèces et elles sont en effet impressionnantes : -24% chez le mouton par rapport au mouflon, -33% chez le porc comparé au sanglier. Pour expliquer ce phénomène, Scott évoque l’expérience fameuse de Dmitri Belyaev, systématiquement citée dans ce genre de raisonnements. Des chercheurs russes ont sélectionné des renards argentés sur le critère de la docilité et, en seulement vingt générations, ils ont obtenu un tiers de renards non seulement doux et affectueux comme des chiens, mais présentant en outre différents traits du syndrome de domestication chez le chien : museau réduit, oreilles pendantes, pelage varié, queue dressée. Belyaev aurait ainsi reproduit en laboratoire ce que les hommes de la Préhistoire ont fait subir au loup pour le transformer en chien.
Mais qui étaient ces chercheurs russes et ces renards argentés, héros d’un véritable mythe savant dans les théories de la domestication ? Dmitri Belyaev est un généticien soviétique qui applique à Novossibirsk une méthode de sélection dirigée sur des renards d’élevage importés du Canada et élevés en captivité pour la production de fourrure. Sélectionnés en réalité depuis la fin du XIXe siècle, ils se sont adaptés à un univers totalement artificiel où ils n’ont plus à chasser pour se nourrir, ni à se battre pour accéder à la reproduction et où ils ne peuvent pas s’accoupler avec des individus sauvages5. Cet univers est fabriqué par la zootechnie d’État dans un contexte de colonisation et d’exploitation brutale des ressources naturelles et des ethnies de Sibérie. Alors que les renards de Belyaev sont sélectionnés pour leur soumission et leur adaptation à la vie en cage, les chasseurs-cueilleurs actuels utilisent le chien comme auxiliaire de chasse et comptent sur son autonomie et son agressivité. Il n’y a donc aucune chance que le monde de Belyaev ait quelque rapport avec celui des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur qui ont vécu la domestication du chien.
Concernant la réduction du volume cérébral, quels animaux les zoologues ont-ils choisis pour servir de référence dans la comparaison entre populations sauvages et domestiques ? Ce sont généralement des races occidentales modernes6. Le déclin aurait-il été aussi frappant si l’on avait choisi les porcs d’élevage extensif de Nouvelle-Guinée, croisés à chaque génération avec des sangliers ? Comme l’a montré récemment une équipe de jeunes généticiens, le point aveugle de ces modèles biologiques, c’est qu’ils confondent espèces domestiques et races produites par la zootechnie occidentale et érigent ces dernières en norme du vivant domestiqué7.
La réduction du coefficient d’encéphalisation est incontestablement un des effets de la domestication, mais elle ne prend pas partout les proportions connues dans nos races modernes et surtout ses conséquences sur le plan cognitif sont difficiles à évaluer. Les animaux domestiques féraux, c’est-à-dire revenus à une vie sauvage sans contrôle humain, gardent un cerveau de taille réduite, ce qui ne les empêche pas d’assurer depuis des siècles toutes les fonctions vitales dans un environnement sensoriel et moteur riche8. Selon Kruska auteur des principales recherches sur la comparaison des volumes cérébraux, cette réduction ne peut être interprétée comme une baisse d’intelligence : « il est plus correct de considérer les changements entre cerveau sauvage et domestique comme une adaptation particulière à la niche écologique de la domestication. (…) Les animaux domestiques montrent que l’intelligence n’est pas nécessairement corrélée ou dépendante d’un cerveau plus gros9 ».
En effet, l’éthologie cognitive a totalement bouleversé ces dernières années notre regard sur l’intelligence des animaux domestiques. Alors que le chimpanzé, animal que l’on tenait pour le plus proche de l’homme par son intelligence, échoue à apprendre des signaux de cognition sociale tels que le suivi du regard ou du pointage du doigt, on s’est aperçu que les animaux qui nous entourent en sont capables : le chien, la chèvre, le cheval et même le cochon. Ces facultés extraordinaires dans le monde du vivant ont été acquises au cours de la domestication.
L’image d’animaux domestiques « handicapés » et élevés en confinement dans une dépendance complète envers l’homme correspond à un mode de traitement de l’animal caractéristique des sociétés occidentales modernes, avec l’élevage industriel et le statut d’animal de compagnie. Ailleurs, les chevaux et les bovins savent se défendre contre les loups ; les races rustiques de brebis, qui portent des cornes, peuvent repousser les renards et les buses ; les chats et les chiens chassent, se battent et maîtrisent leur sexualité. Si on ne les confine pas en batterie, les poules pondeuses sont de redoutables prédatrices capables de chasser insectes, vers et même musaraignes.
Selon Scott, « le test décisif de la domestication d’une plante ou d’un animal est le fait qu’elle ou il ne puisse pas se propager sans notre assistance » (p.59). L’absurdité de cette affirmation peut se mesurer au nombre d’espèces domestiques vivant actuellement à l’état féral à travers le monde : mustangs, chats harets, chiens, chèvres, moutons, bovins, chameaux, poules, porcs ou abeilles ayant échappé au contrôle humain10. Les plantes ne sont pas en reste : blé, colza, seigle, riz, sorgho, tournesol, coton, betterave à sucre peuvent se dédomestiquer et se reproduire sans être cultivés11. Le maïs féral s’implante actuellement en Autriche. Des dattiers continuent de prospérer sur d’anciennes oasis des siècles après leur abandon. Les généticiens ont récemment démontré que le cheval de Przewalski qu’on croyait sauvage est un ancien cheval domestique, revenu à la vie sauvage depuis plusieurs millénaires. Aujourd’hui les seuls chevaux qui subsistent sur terre sont les chevaux domestiques, alors qu’il n’y a plus de chevaux sauvages. Si le cheval ne s’était pas domestiqué en s’adaptant aux milieux anthropisés, il aurait sans doute disparu comme d’autres espèces des temps glaciaires, tels l’ours des cavernes ou le mégacéros. Les espèces domestiques ne sont pas handicapées, elles se sont au contraire adaptées à des écosystèmes anthropisés et à des modes de vie pluri-espèces et cette adaptation s’est faite plus souvent de façon spontanée que par sélection humaine dirigée.
L’HOMME DOMESTIQUE
À la domestication biologique des animaux correspond selon Scott une domestication culturelle de l’espèce humaine manifestée par son enfermement dans la domus, le déclin de ses savoirs écologiques et une prise de contrôle de sa reproduction par l’État. Ces affirmations sont largement fondées sur des préjugés non vérifiés.
Pour Scott, la révolution néolithique constitue un « cas de déqualification massive (…) un appauvrissement de la sensibilité et du savoir pratique de notre espèce face au monde naturel, un appauvrissement de son régime alimentaire, une contraction de son espace vital et aussi, sans doute, de la richesse de son existence rituelle. » (p. 106). La domestication des plantes et des animaux « reposait sur une base génétique extrêmement étroite et fragile : une poignée d’espèces cultivées, un petit nombre de races de bétail et un paysage radicalement simplifié qui devait être constamment défendu contre le retour des éléments naturels qui en avaient été exclus. » (p. 126).
Le philosophe américain Paul Shepard a popularisé ce mythe paranoïde de l’homme néolithique à couteaux tirés avec une nature sauvage menaçant son pré carré12. L’archéologie nous fait découvrir un monde bien plus intéressant. Pendant des millénaires, les plantes cultivées n’ont pas présenté de différence avec les plantes sauvages parce qu’elles étaient collectées ensemble et mélangées au moment des semailles. L’étude génétique du blé engrain montre qu’il n’a pas subi de réduction de sa diversité génétique au cours de sa domestication13. La paléobotanique des espèces végétales présentes sur des sites néolithiques emblématiques comme Çatalhöyük (fin 8e- milieu 6e millénaire avant J.C.) nous apprend que les cultivateurs utilisaient systématiquement non seulement les plantes cultivées mais aussi différentes adventices, c’est-à-dire des plantes sauvages opportunistes s’introduisant dans leurs cultures. Le pain quotidien mêlait des céréales cultivées et des graines de moutarde sauvage, une plante invasive des champs appréciée pour ses qualités gustatives. Différentes graines de crucifères et de lamiacées sauvages faisaient l’objet d’un stockage spécialisé. Loin du Proche-Orient, les villages néolithiques rubanés en Europe centrale stockent aussi ce que nous appelons des « mauvaises herbes », par exemple le chénopode (Chenopodium album), une sorte d’épinard sauvage appréciant les sols perturbés et fertiles14. L’agriculture néolithique est un jardinage qui fait cohabiter et s’hybrider plantes sauvages et domestiques sans rupture ontologique. On connaît dans le monde de multiples exemples actuels de méthodes de cultures associant de façon comparable des espèces sauvages et des espèces domestiques, qu’il s’agisse des jardins sur brûlis d’Amazonie et de Mélanésie ou de l’agriculture itinérante du Sahel.
Au Proche-Orient, les choses changent au sortir du Néolithique. Avec l’émergence de grands centres urbains en Mésopotamie à la fin du 4e millénaire avant notre ère, se développe une culture extensive sur terres labourées par traction animale pour répondre aux besoins de consommation et de taxes des villes. Dans cette nouvelle écologie, les plantes opportunistes trouvent difficilement leur place15. Ce ne sont donc pas les « céréales qui font l’État », ce sont les villes qui font naître un nouveau type de culture céréalière.
Pour illustrer la déqualification néolithique qu’il imagine, Scott met en contraste la richesse des savoirs écologiques des chasseurs-cueilleurs et leur pauvreté chez les agriculteurs. Cette vision dualiste est évidemment démentie par des dizaines de volumes d’ethnoécologie des peuples cultivateurs. Scott ne les ignore pourtant pas totalement puisque pour illustrer « l’étendue des connaissances des chasseurs-cueilleurs sur leur environnement naturel », il renvoie à l’ouvrage du fondateur de l’ethnoécologie, Harold C. Conklin, Hanunoo agriculture16 (note 19 de la page 104). Or les Hanunoo ne sont pas des chasseurs-cueilleurs mais bien des cultivateurs de riz comme l’indique le titre de l’ouvrage de Conklin !
Les civilisations agraires sont toutes porteuses de savoirs diversifiés concernant des ressources végétales sauvages utilisées dans l’alimentation quotidienne et la médecine populaire. Aujourd’hui encore, l’ethnobotanique des sociétés rurales d’Europe en donne la preuve, en dépit d’une modernisation et d’une standardisation brutale des modes de vie : en Albanie, une enquête relève 70 taxons sauvages utilisés et 160 préparations médicinales17, en Sardaigne, 99 taxons connaissant 191 usages alimentaires, médicinaux et magiques18. Au cœur même de ce Proche-Orient dépeint par Scott comme un désert ethnobotanique depuis la fin du Néolithique, une étude récente menée chez des guérisseurs kurdes d’Irak a répertorié 66 espèces végétales utilisées et 49 recettes médicinales inconnues jusque-là dans la littérature19. Ces savoirs populaires longtemps méprisés sont encore trop peu étudiés, mais cela n’autorise pas les chercheurs à présumer sans vérification qu’ils n’existent pas. Quant à la pauvreté rituelle que Scott prête aux céréaliers, elle est démentie par la multitude des rites agraires, célébrations de la première gerbe et autres cultes de l’esprit du blé et de l’âme du riz connus à travers le monde.
UN ÉTAT NON CÉRÉALIER EST-IL POSSIBLE ?
Les grandes théories de l’origine de l’État se réduisent le plus souvent à des théories de la civilisation, c’est-à-dire de l’urbanisme, car en se focalisant sur les États urbains qui nous sont familiers, elles ignorent la diversité des formations étatiques à travers le monde20. Homo domesticus n’échappe pas à cette règle. Parmi les caractéristiques de l’État, Scott en retient trois : les murailles entourant les villes, la fiscalité payée en céréales ou en argent et l’existence d’un corps de fonctionnaires (p.134). Parmi ces critères qui limitent nécessairement la portée de la comparaison, la muraille est à coup sûr le plus curieux. L’arasement des fortifications autour de Paris signifie-t-il que la France est devenue dans les années 1920 une société sans État ? Dans la taïga sibérienne, au Néolithique, on connaît déjà des villages entourés de fortifications. Ces défenses ne sont pas l’indice d’un État forestier, mais au contraire de guerres entre villages voisins et donc de l’absence d’unification politique.
Limitant arbitrairement son investigation aux États céréaliers, Scott y découvre sans surprise que les céréales y sont d’une importance économique cruciale (p.145), et il en tire un soupçon sur les céréales dont la culture présenterait des affinités électives avec l’État. La culture céréalière serait une condition, non suffisante sans doute, mais bien « nécessaire » à l’émergence des États. La liste serait innombrable des sociétés de cultivateurs de céréales à travers le monde qui ne possèdent pas de structures étatiques propres. On sait depuis quelques années que des communautés proche-orientales, à Ohalo, stockaient du blé et de l’orge probablement cultivés et en faisaient du pain il y a 23000 ans, soit plus de 10000 ans avant le Néolithique21. Sur ces 23000 ans de relation intensifiée hommes-céréales, l’existence étatique en représente moins d’un quart : si l’État était en germe dans les céréales, pourquoi sa germination fut-elle si lente ?
Sur la foi de son étude de la Zomia, Scott généralise son affirmation d’un lien indissoluble entre État et céréales et l’incompatibilité entre État et tubercules (une culture d’« évitement de l’État »). Or cette généralisation est démentie par les États archaïques de Polynésie qui émergent dans une économie de culture de tubercules (taro et patate douce22). Ou encore par l’Europe du XVIIIe siècle dont les États imposent la culture des pommes de terre, provoquant en Russie les « révoltes de la pomme de terre », de violentes insurrections de paysans défendant leurs champs de céréales face à une répression brutale. Une société à État ne se définit pas par le fait que les gens cultivent du blé plutôt que des patates douces, ou élèvent des dindons plutôt que des canards, mais par l’existence d’un pouvoir capable d’imposer aux paysans ce qu’ils doivent produire et comment ils doivent le faire.
Sa vision binaire de l’État et des Barbares amène Scott à attribuer des traits qu’il juge positifs de sociétés à État à des sociétés sans État. Il convoque ainsi la théorie l’économie paysanne familiale de l’économiste russe Chayanov pour illustrer l’absence de recherche d’excédent dans la paysannerie avant l’émergence de structures étatiques (p.169). Or Chayanov ne décrit pas du tout une paysannerie pré-étatique : ses travaux sont fondés sur les statistiques agricoles russes de 1893, dans un État qui est l’autocratie impériale russe23.
Non suffisante à l’émergence des formations étatiques, la culture céréalière ne lui est pas non plus nécessaire. Les empires des steppes sont les plus grands État que la Terre ait portés, pourtant comme ils ne sont pas fondés sur la culture céréalière et ne bâtissent pas de murailles, Scott les classe dans le monde « barbare » des sociétés sans État. Sa dichotomie entre les Barbares et l’État reproduit les divers stéréotypes romantiques que David Sneath a patiemment démontés dans son ouvrage The headless state24. Le contraste entre la rigidité de l’État sédentaire agricole et la souplesse informelle de l’empire des steppes que l’on voit peint dans Mille plateaux (1980) par Deleuze et Guattari ignore l’importance de l’organisation administrative et territoriale, de la corvée et des impôts dans les aristocraties pastorales. « Tout en ciblant l’État civilisé et en romantisant l’Autre ‘non étatique’ dans la meilleure tradition rousseauiste, cette approche n’est pas sans faire écho au discours orientalisant du colonialisme25. » Cette remarque vaut aussi bien pour Scott.
En Mongolie, l’empire des Xiongnu il y a 2500 ans lève déjà un impôt et bâtit des cités entourées de murailles ; les Turcs anciens (T’ukue) ont une écriture et enregistrent les taxes sur des tablettes. Les Kyrgyz du Ienisseï soumettent les chasseurs-cueilleurs de Sibérie à une taxe en fourrures de zibeline et d’écureuil. Depuis les Xiongnu, les empires steppiques ont pour colonne vertébrale un système militaro-administratif décimal rangeant les combattants en dizaines, centaines et milliers selon une structure hiérarchique pyramidale. Reprise dans les empires turcs anciens puis mongols, cette administration originale ne paraît pas être la copie d’un système chinois préexistant.
Prenons l’exemple de l’empire mongol de Gengis khan et de ses descendants. La loi suprême est le iasak, code civil et administratif par lequel le grand khan impose à la société et à l’armée une discipline venue du ciel. Meurtre, mensonge, adultère et sodomie sont punis de mort26. En résulte une discipline mongole dont la description par le franciscain Plan Carpin au XIIIe siècle est fort éloignée de l’image du Barbare libre et insoumis peinte par Scott : « Les Tartares sont les plus obéissants du monde à leurs seigneurs, plus même que quelque religieux que ce soit à ses supérieurs. Ils les révèrent infiniment, et ne leur disent jamais une menterie27. » Dans l’empire mongol médiéval, les seigneurs (noian) sont entourés de fonctionnaires chargés des questions militaires, administratives, judiciaires et du recouvrement des impôts. Les pasteurs nomades sont en positions de serfs par rapport à leur seigneur : leurs déplacements et l’accès aux pâturages sont décidés par le seigneur, ils sont astreints à des redevances en bétail et produits d’élevage, à la corvée et au service des relais de poste28. Le système des relais de postes qui permettait à l’administration une communication et un contrôle performants à travers de vastes territoires était fondé sur les contributions de centaines de familles de pasteurs contraints de les entretenir29.
Les souverains gengiskhanides soumettent les populations des chasseurs-cueilleurs de Sibérie au paiement du tribut. Au XVIe siècle, dans le Khanat tatar de Sibir’ des collecteurs lèvent un impôt en fourrure et en poissons séchés sur les chasseurs-pêcheurs ougriens de la forêt qui doivent également leur soutien militaire au Khan. Ce régime d’imposition est ensuite repris et étendu par l’État russe et c’est du terme mongol iasak qu’il désigne le lourd impôt en fourrure auquel il soumet les populations indigènes.
L’opposition entre « Barbares » et « civilisation » est par définition ethnocentrique et ne peut servir de base à une typologie des formations politiques. Les Grecs ne voyaient pas les Barbares comme des sociétés sans État, mais au contraire comme des peuples soumis à des régimes despotiques ; ce n’est qu’au XIXe siècle que l’on voit le romantisme imaginer la barbarie comme un havre de liberté. « Le tableau des nations barbares offre je ne sais quoi de romantique, qui nous séduit » reconnaissait Chateaubriand qui se définissait comme un « barbare de l’Armorique »30. Pour cet auteur, les Scythes, barbares des steppes, représentent un idéal de vie simple et libre : « Un roi ou plutôt un père guidait la peuplade errante. Ses enfants le suivaient plutôt par amour que par devoir. » (ibid. p180). On n’est pas loin des barbares de Scott parmi lesquels « il fait bon vivre ». Kropotkine dans L’État, son rôle historique (1906) vante « l’esprit ‘barbare’ — scandinave, saxon, celte, germain, slave » qu’il décrit comme une « négation absolue de l’esprit unitaire et centralisateur romain, par lequel on cherche à expliquer l’histoire dans notre enseignement universitaire. » Plus d’un siècle avant Scott, l’anarchiste russe affirme que la mort de l’État n’est pas un désastre, mais un « renouveau » : « Les États mis en pièces, et une nouvelle vie recommençant dans mille et mille centres, sur le principe de l’initiative vivace de l’individu et des groupes, sur la libre entente. » (ibid.)
L’ESCLAVAGE EST-IL UNE DOMESTICATION ?
Pour établir le parallèle entre domestication et esclavage, Scott propose de prendre au sérieux les réflexions d’Aristote comparant les esclaves au bétail et affirmant que les Barbares sont esclaves par nature. D’après Scott, le philosophe aurait à l’esprit des « Sauvages », bandes de chasseurs cueilleurs, plutôt que des « Barbares » définis comme des populations pastorales (p.235).
Cette interprétation d’Aristote est surprenante : comment le philosophe grec du IVe siècle avant notre ère aurait-il pu avoir connaissance de l’existence de peuples de chasseurs-cueilleurs ? En réalité, pour Aristote, si les Barbares sont par nature voués à être esclaves, c’est du fait de leur soumission au despotisme. Les Barbares par excellence sont les sujets des empires orientaux, les Perses de Cyrus, qui se distinguent des Grecs par leur ignorance de la démocratie (Politiques, III, VII). Ce qui les caractérise, ce n’est pas l’absence d’État, mais l’excès d’État.
D’où viennent donc ces catégories de « sauvages » et de « barbares » que Scott prête à tort aux Grecs anciens ? On y reconnaît sans peine les stades de l’évolution humaine définis par Morgan (1877) et repris par Engels (1884) : la Sauvagerie caractérisée par la chasse-cueillette, la Barbarie par l’élevage et la Civilisation par l’agriculture. Les Anciens n’ayant pas de notion de « domestication », l’idée que l’esclavage imite la domestication des animaux ne peut venir d’eux. Par contre, elle est explicite chez Engels et Childe. Dans l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), Engels place l’apparition des esclaves, ce « bétail humain », à la suite de l’invention de l’agriculture. Ce scénario d’Engels est repris, dans une citation que Scott fait sienne en la mettant en exergue (p.183), par l’archéologue marxiste Gordon Childe, auteur de la notion de « Révolution néolithique » : après avoir inventé l’agriculture et la guerre, les gens s’aperçurent que les ennemis pouvaient être domestiqués comme des animaux si on les asservissait au lieu de les tuer31. Avec sa domus, Scott reproduit presque mot pour mot, mais sans le citer, les thèses d’Engels sur la familia agraire, berceau de la propriété privée, de l’esclavage, de l’État et de la fameuse « défaite historique de la femme », mais en y ajoutant l’argument du contrôle sur la reproduction. Constatant que les esclaves des États antiques sont majoritairement des femmes chargées de fournir des enfants, Scott y voit une domestication des femmes calquée sur la gestion d’un troupeau de moutons qui réunit principalement des brebis pour quelques béliers.
Ces idées du XIXe siècle correspondent aux connaissances de l’époque sur la domestication et sur l’esclavage, mais elles ne peuvent plus être répétées aujourd’hui sans recul critique. On sait maintenant que l’esclavage a existé dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs indépendamment de toute influence des sociétés agricoles ou pastorales et de tout trafic d’esclaves avec elles, par exemple sur la côte Nord-Ouest de l’Alaska et du Canada ou en Sibérie. Les femmes y sont comme ailleurs surreprésentées parmi les esclaves, malgré l’absence de troupeaux de moutons à imiter. La raison en est simple et n’a rien à voir avec l’élevage : les esclaves sont le plus souvent capturés lors de combats avec des ennemis. Alors que les sociétés sans esclaves, comme les Aborigènes d’Australie, massacrent tous leurs ennemis, les sociétés à esclaves sont celles qui épargnent les femmes et les enfants. Si les hommes sont rarement laissés en vie, c’est parce qu’ils sont combattants.
Par ailleurs, comme l’ont montré les comparaisons mondiales de Testart, la condition des esclaves est souvent meilleure dans les États despotiques que dans les sociétés non étatiques où, privés de toute protection juridique et sans possibilité d’affranchissement, ils sont mis à mort à volonté par leurs maîtres et doivent souvent l’accompagner dans la tombe32. Il n’est pas sûr que les esclaves des « Barbares » aient trouvé leurs conditions de vie si « enviables » que Scott le suggère.
CONCLUSION
Les malentendus et les raccourcis de ce livre tiennent au fond à une tendance fort répandue qui consiste à concevoir la domestication comme une réalité homogène et inchangée depuis la Préhistoire, dont nous pourrions connaître l’essence simplement en observant le statut que les animaux et les plantes domestiques ont acquis dans nos sociétés depuis l’époque moderne. Est-il possible d’élargir nos conceptions de la domestication et de la penser en dehors du paradigme de la domination que le mot lui-même charrie ? Pourquoi pas ? C’est en français et dans les langues romanes que « domestique » désigne aussi bien le bétail que les serviteurs. L’adjectif russe équivalent, domashnyi, basé sur la même racine indo-européenne, ne véhicule pas les notions latines de domination qui en constituent un développement tardif singulier, mais évoque avant tout la famille et l’intimité. À l’exemple du vocable russe, nous pouvons séparer la notion de domestication du schéma verbal « domestiquer » qui distingue sujet et objet, pour revenir à sa source et décrire à travers elle le processus par lequel une espèce non humaine s’attache sur plusieurs générations à la maison humaine, un devenir-familier des non-humains et un devenir-hybride de la maison.
L’ouvrage de Scott en dit long sur les difficultés des modernes à comprendre les modes de vie unissant humains, plantes et animaux dans des communautés hybrides. L’hybridité des habitats et des paysages partagés déclenche des hantises de contamination et de pollution, à l’image de la domus insalubre de Scott. Derrière ces craintes, se profile le désir d’un monde sain et ordonné, où demeurent séparés les existences naturelles et les existences culturelles. Car le propre de la domestication et ce qui la rend menaçante pour les modernes, c’est qu’elle transgresse toute séparation nette entre le naturel et l’artificiel, l’animal et l’humanisé, le biologique et le social, ces frontières si nécessaires à la pensée naturaliste.
L’ouvrage de Scott place à l’origine d’une évolution sociale unilinéaire une écologie imposant de l’extérieur ses contraintes aveugles à la socialité humaine. Or ce déterminisme obnubilé par les céréales empêche de développer une réflexion sur la dynamique du processus étatique dans sa diversité, incluant les empires nomades, les royautés sacrées africaines ou les premiers États polynésiens. L’État n’est pas une économie ni une écologie particulière, c’est un certain type de violence légale capable d’imposer n’importe quel mode de subsistance. En URSS, à l’inverse des schémas de Scott, l’État a transformé de force des sédentaires en nomades et des éleveurs en chasseurs-cueilleurs pour leur faire collecter des fourrures précieuses nécessaires à l’obtention de devises. Tout en affirmant renverser les grands récits menant à la civilisation, Scott reproduit une vision téléologique et ethnocentrique de la domestication et de l’agriculture, qui réduit l’histoire d’« Homo sapiens » aux événements survenus au Proche-Orient. Pourtant une multitude d’autres foyers de domestication ont existé en Afrique, en Sibérie, en Asie du sud, en Océanie et dans les deux Amériques, donnant naissance à une incroyable diversité d’imbrications vitales entre des humains, des animaux et des plantes tant domestiques que sauvages. Dans ces divers foyers, on s’interroge, non moins qu’en Occident, sur l’entrée des espèces végétales et animales dans les sociétés humaines. Des récits d’origine sont portés par ces peuples pasteurs, agriculteurs, horticulteurs, qui nous font découvrir des modèles tout différents du paradigme viricentré de l’homme-domestiquant-et-dominant-la-nature. En Sibérie, l’origine des rennes domestiques est souvent attribuée à une curiosité réciproque et une amitié entre une femme et un renne sauvage. Un pacte est noué assurant aux humains et aux animaux un intérêt et une responsabilité dans cette nouvelle vie partagée. De nombreuses mythologies attribuent aux femmes l’origine du pacte noué avec les plantes et les animaux, car dans la vie quotidienne ce sont elles qui l’entretiennent, tandis que le monde des hommes est celui de la confrontation avec les espèces sauvages dans la chasse. Il serait temps d’élargir notre champ d’imagination aux récits de ceux qui entrelacent leur vie au quotidien avec les plantes et les animaux si nous voulons comprendre le pacte qui les unit et dans lequel nous ne nous sentons plus liés.
L’auteur remercie Laurent Berger et Pierre Déléage pour leurs remarques sur ce texte.
Notes
1. ↟ Dorian Q. Fuller, « An emerging paradigm shift in the origins of agriculture », General Anthropology 17, no 2 (2010): 1–12.
2. ↟ Helen M. Leach, « Selection and the unforeseen consequences of domestication », in M.Mullin & R. Cassidy éd. Where the Wild Things are now: Domestication reconsidered, New York, Berg : 71-99.
3. ↟ Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Acclimatation et domestication des animaux utiles (Paris: Librairie agricole de la maison rustique, 1861), 156‑57.
4. ↟ Melinda A. Zeder, « Pathways to Animal Domestication », Biodiversity in Agriculture: Domestication, Evolution, and Sustainability, 2012, 227.
5. ↟ Pat Shipman, The animal connection: a new perspective on what makes us human (New York: Norton, 2011), 202; Kathryn A. Lord et al., « The History of Farm Foxes Undermines the Animal Domestication Syndrome », Trends in Ecology & Evolution 2020, 35, no 2: 125‑36.
6. ↟ Peter Ebinger, « A Cytoarchitectonic Volumetric Comparison of Brains in Wild and Domestic Sheep », Zeitschrift Für Anatomie Und Entwicklungsgeschichte 144, no 3: 267‑302.
7. ↟ Kathryn A. Lord et al., ibid.
8. ↟ Dieter Kruska, « On the evolutionary significance of encephalization in some eutherian mammals: effects of adaptive radiation, domestication, and feralization », Brain, behavior and evolution 65, no 2 (2005): 73–108.
9. ↟ Kruska, 103.
10. ↟ Par exemple Tom Lee McKnight, Friendly Vermin: A Survey of Feral Livestock in Australia (University of California Press, 1976).
11. ↟ M. V. Bagavathiannan et R. C. Van Acker, « Crop Ferality: Implications for Novel Trait Confinement », Agriculture, Ecosystems & Environment 127, no 1 (2008): 1‑6.
12. ↟ Paul Shepard, The Only World We’ve Got: A Paul Shepard Reader (Sierra Club Books, 1996).
13. ↟ B. Kilian et al., « Molecular Diversity at 18 Loci in 321 Wild and 92 Domesticate Lines Reveal No Reduction of Nucleotide Diversity during Triticum Monococcum (Einkorn) Domestication: Implications for the Origin of Agriculture », Molecular Biology and Evolution 24, no 12 (2007): 2657‑68.
14. ↟ Amy Bogaard, Mohammed Ater, & John G. Hodgson, « Arable weeds as a case study in plant-human relationships beyond domestication », in Hybrid Communities: Biosocial Approaches to Domestication and Other Trans-species Relationships, éd. par Charles Stépanoff et Jean-Denis Vigne (Londres ; New-York: Routledge, 2018).
15. ↟ Bogaard, Ater, et Hodgson ibid.
16. ↟ Hanunóo agriculture: a report on an integral system of shifting cultivation in the Philippines (Rome, Italie: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1957).
17. ↟ Manuel Pardo-de-Santayana, Andrea Pieroni, et Rajindra K. Puri, Ethnobotany in the New Europe: People, Health and Wild Plant Resources (Berghahn Books, 2010), 29.
18. ↟ Maria Adele Signorini, Maddalena Piredda, et Piero Bruschi, « Plants and traditional knowledge: An ethnobotanical investigation on Monte Ortobene (Nuoro, Sardinia) », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 5, no 1 (10 février 2009): 6.
19. ↟ Hiwa M. Ahmed, « Ethnopharmacobotanical study on the medicinal plants used by herbalists in Sulaymaniyah Province, Kurdistan, Iraq », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12, no 1 (28 janvier 2016): 8.
20. ↟ Cette remarque est développée par Alain Testart, La servitude volontaire. 2, L’origine de l’État (Paris, France: Éditions Errance, 2004).
21. ↟ Snir, A., Nadel, D., Groman-Yaroslavski, I., Melamed, Y., Sternberg, M., Bar-Yosef, O., & Weiss, E.
22. ↟ Patrick Vinton Kirch. How Chiefs Became Kings: Divine Kingship and the Rise of Archaic States in Ancient Hawai’i (Berkeley: University of California Press, 2010).
23. ↟ Aleksandr Chayanov, On the theory of peasant economy, éd. par Daniel Thorner et al. (Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1966), 54.
24. ↟ The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, & Misrepresentations of Nomadic Inner Asia (New York: Columbia University Press, 2007).
25. ↟ Sneath, 202.
26. ↟ René Grousset, L’empire des steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan : avec 30 cartes et 20 figures dans le texte (Paris: Payot, 1939), 278‑79.
27. ↟ Voyages de Benjamin de Tudelle… de Jean du Plan Carpin en Tartarie… (Paris, 1830) 166.
28. ↟ B. Vladimirtsoff, Le régime social des Mongols. Le féodalisme nomade. (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1948), 148, 181, 211.
29. ↟ Charles Bawden, The modern history of Mongolia (Londres; New-York: Kegan Paul Int., 1968), 103, 109.
30. ↟ Arlette Michel, « Images des Barbares dans l’œuvre de Chateaubriand : Esthétique et religion », Bulletin de l’Association Guillaume Budé 1, no 2 (1998): 175.
31. ↟ Vere Gordon Childe, Man makes himself (Londres: The Rationalist Press Association, 1936), 109.
32. ↟ Alain Testart, L’institution de l’esclavage: une approche mondiale, éd. par Valérie Lécrivain (Paris, France: Gallimard, 2018).
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
sujet remonté comme essentiel parmi les essentiels, avec I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
MIEUX VAUT TERRE QUE JAMAIS
qu'un théoricien de la communisation, Gilles Dauvé, après 40 d'existence de cette théorie et de son quasi silence sur "la question écologique", en vienne à engager une réflexion sérieuse sur icelle (de la terre), vaut son pesant de patates pour combler le trou noir de ce milieu avant-gardiste qui gratte le ciel de sa foi révolutionnaire
ce premier épisode, Pommes de terre contre gratte-ciel. À propos d’écologie. 1) Question ancienne et nouvelle, DDT21, se lit sans déplaisir, avec l'intérêt de références rares dans le rapport de la pensée révolutionnaire à cette question dite aujourd'hui écologique, de Fourier à Bordiga en passant par Marx, Pannekoek et des savants russes de l'époque socialiste
le plaisir se double pour moi du constat que, dans l'esprit sinon dans la lettre et dans l'intention, puisque la chute est programmée par 'Une seule solution, la communisation par les prolétaires !', la démarche rejoint la mienne de considérer la critique de l'écologie politique comme nécessaire et complémentaire de celle de l'économie politiqueG.D. a écrit:Pour nous, il ne s’agira donc pas d’ajouter l’écologie à l’économie, ni de corriger la seconde par la première, mais de mener la critique de l’une comme de l’autre.
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
RS, GD et les autres :
ENCORE UN EFFORT POUR Y COMPRENDRE QUELQUE CHOSE
au-delà d'une critique pertinente, l'idéologie de la communisation, non sa prétendue "théorie"
dans cette dernière livraison de son feuilleton sur l'écologie, posant la question Écologie : capitalisme ou communisme ?, Gilles Dauvé développe l'argument que tenait Roland Simon (RS) pour repousser la proposition de François Danel d'introduire la dimension écologique dans le corpus de Théorie Communiste (CONJONCTURE ÉPIDÉMIQUE crise écologique, crise économique et communisation : « La “nature” ne fait rien »*
* voir l'historique antérieur de ces débats dans L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?G.D. a écrit:4 / DEUX CONTRADICTIONS ?
ou LA NATURE EST-ELLE UNE FORCE HISTORIQUE ?
Mais que fait la nature ? La Terre se borne à s’adapter à ce qu’elle subit (de façon imagée, on pourrait la dire « résiliente »). Une force historique, quelle qu’elle soit, prend des décisions, pratique des choix, variés et opposés, elle est capable aussi de se tromper, elle fait plus que répondre à des stimuli et aux contraintes qui la poussent dans un seul sens. Ce n’est pas le cas d’une forêt, d’un glacier ou d’un champ pétrolifère. Parmi les forces productives, seul le prolétariat a une existence sociale, donc peut agir en sujet historique.
la conclusion était attendue dès le départ de cette série, comme c'est le cas de tous les textes communisateurs (on l'a encore vu avec Hic Salta et Le ménage à trois), puisque c'est le présupposé de la théorie de la communisation, le syllogisme prolétarien (Charrier), le noyau dur au cœur de cette idéologie, qui n'a jamais besoin d'être démontré : la base s'effondrant, ce qui s'en suit est spécieux. Ici :G.D. a écrit:L’affirmation est certes abrupte, elle est pourtant nécessaire : la seule solution à la « crise écologique » contemporaine, c’est une révolution communiste. [...] Parmi les forces productives, seul le prolétariat a une existence sociale, donc peut agir en sujet historique.
tous ces textes relèvent d'une manipulation intellectuelle, d'une supercherie, car ils font comme si une critique pertinente du capitalisme débouchait logiquement sur une certitude de la révolution prolétarienne, mais il n'y a pas de théorie "de la communisation", il y a une critique théorique du capital par ses théoriciens, intéressante, et au-delà une idéologie de la communisation, tout juste bonne à alimenter l'activisme*
* la véritable "implication réciproque"
dernier en date, AgitationsToto : « Notre marxisme est issu des théories développées par le courant communisateur... nous pensons que la théorie a une fonction organisationnelle et pratique qui doit s'extraire des carcans académiques. », affirmation en rupture avec ladite théorie comme l'a montré RS à l'époque de Sic (la théorie n'est pas un guide pour l'action). Mais qu'importe, puisque la théorie sert à ça, et ne peut aboutir qu'à ça, ou à la contemplation des puristes et à la récitation des adeptes. Le "milieu radical" est constitué inséparablement de la théorie et de ses activistes, hors de relations concrètes réelles avec leur sujet révolutionnaire, le prolétariat. Ils ne sont pas d'accord mais ont besoin réciproquement les uns des autres pour exister. En 20 ans on n'est pas sorti de l'arnaque consubstantielle à la revue Meeting, un mode de survie, ou comme on dit de "résilience"
j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire plus haut, hormis cette conclusion, ces textes de Dauvé ne me posent pas de problème, ils recoupent essentiellement mes propres considérations depuis des années*, mais je veux revenir sur l'argument "la nature de fait rien". Évidemment qu'elle n'est pas un sujet, qu'elle ne « peut agir en sujet historique », mais la question n'est pas là et je ne l'ai jamais posée comme ça. C'est couramment le cas de l'écologie politique, encore qu'au niveau théorique il faudrait regarder de plus près certains courants ou auteurs
* plus récemment exposées dans ce sujet au titre explicite : II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
le mouvement de ma pensée est celui-ci : l'humanité, et/ou le capital, fait quelque chose à la nature, qui réagit en s'y adaptant ("résilience", écrit Dauvé), mais cela fait en retour quelque chose à l'humanité, au capital qui y répond par le "capitalisme vert", qui bien évidemment ne peut résoudre la crise écologique, sur ce point Dauvé a raison... Toutefois, cela ne fait pas qu'au prolétariat mais à l'ensemble des êtres humains parmi les êtres vivants ou non, et ceux-là (les humains) réagissent quelle que soit leur appartenance de classe. Logique puisque le capitalisme met en péril tout le vivant et l'humanité en particulier. Ce que feront les uns et les autres le jour où les aspects écologiques de la crise mettront plus immédiatement et plus massivement leur existence en danger, nous n'en savons rien, et n'avons pas de raison de prétendre que ce ne serait pas radicalement contre le capital, et dans ce cas pas uniquement l'action du prolétariat. On en a déjà une idée avec bien des luttes, paysannes ou pas, qui ont un caractère antagonique de classe évident
autrement dit, Gilles Dauvé détourne la question et répond à côté, en refilant LA solution de la révolution prolétarienne, mais sans montrer en quoi le prolétariat serait le moment venu le seul et le mieux armé de solutions écologistes et communistes à la hauteur de l'enjeu : sauver la nature et par conséquent l'humanité
ces gens-là n'ont pas fini de nous prendre pour des imbéciles, mais "douche froide" pour douche froide, les voilà arroseurs arrosés
Invité- Invité
 Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
Re: II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
les points sur lazy
de la "radicalité" de Sandrine Rousseau
relativement à l'économie politique du Capital
Patlotch a écrit:ma lectorate studieuse n'a point besoin que je lui fasse un dessin, car il faut tout de même souligner que les propositions de Sandrine Rousseau, contrairement à ce qu'elle soutient, ne font pas rupture avec le capitalisme ni avec l'étatisme, loin de là. C'est une reprise dans l'air du temps de l'idéologie démocrate radicale (radicale en tant que démocratie, me précisait naguère RS/TC). Elle n'a pas de critique radicale du capitalisme, mais seulement de ses excès
la candidate à l'élection présidentielle a beau affirmer « Jadot croit au marché, il croit qu’on peut s’entendre avec les multinationales. Moi, je ne crois pas au capitalisme vert », elle est loin d'en sortir par ses propositions d'« encadrer le capitalisme » par des mesures essentiellement étatiques (législatives) appuyées par le nouveau peuple-tigre dont les femmes seraient « le moteur »*. Sa vision intersectionnelle, dite "woke" par ses détracteurs de droite (voir par exemple Pascal Perrineau : "Sandrine Rousseau est révélatrice de l'importation du wokisme en France"), est même assez faible en contenu social (syndicalisme issu de la CFDT...), d'obédience quasi social-démocrate. Elle ne peut apparaître "radicale" qu'en comparaison d'un Jadot, girouette politicienne qui n'a en tête que donner à l'écologisme ses lettres de noblesses politiques et gouvernementales
* l'anti-étatisme de Jadot est de ce point de vue fort limité, quand il affirme rocardien : « Mon moteur, ce sont les choses extraordinaires que font les hommes et les femmes en marge des politiques publiques », LCI hier. Autrement dit se qui se fait en marge des décisions d'État, dans la bouche d'un aspirant Président de la République... Mis à part les tirades gauchisantes de sa concurrente, on a du mal à saisir ce qui les oppose vraiment, dans cette contradiction inhérente au pouvoir politique qui prétend s'auto-"déconstruire", qu'on retrouve chez Mélenchon
je ne développe pas, lire ses interventions ou l'entendre dans les débats contradictoires pour mesurer l'écart, relativement aux critères d'une rupture radicale digne de ce nom avec le capitalisme et son économie politique
en contrepoints :
- Nouvelle vie pour le mot « radicalité », Guillaume Erner, France Culture, 21 septembre. Il est vrai que la fonction mainstream du terme de radicalité est de faire peur : jusque-là étaient "radicalisés" ceux qui deviennent terroristes islamistes, ultragauchistes ou ultradroitistes violents
- « Le “vivant” n’est pas un slogan, c’est une carte pour s’orienter », Baptiste Morisot, Le Monde, 22 septembre, tout spécialement pour RS, pour qui "on ne sait pas ce qu'est le vivant" (c'est là-dedans : L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?)
- L'ÉTANT CHANGE, un pseudo-poème où je compare Sandrine Rousseau à Arlette Laguiller pour le rôle politico-médiatique qu'elle est appelée à jouer dans un contexte où l'idéologie d'opposition politique radicale (en tant que politique) a perdu son rouge et gagné son vert, ou plutôt sa verte... et pas mûre ? Notons au passage le changement de classe sociale de ce leadership de parole d'extrême-gauche, traduisant le long passage du programmatisme ouvrier au démocratisme radical, deux utopies anticapitalistes dans le capital
Troguble- Messages : 101
Date d'inscription : 31/07/2021
 Sujets similaires
Sujets similaires» CRITIQUE DU CONCEPT DE RÉVOLUTION
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» ÉDITORIAUX et PLAN du Journal critique de la crise
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» IMPROVISATION ET LIBERTÉ, poétique et philosophie politique
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» ÉDITORIAUX et PLAN du Journal critique de la crise
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» IMPROVISATION ET LIBERTÉ, poétique et philosophie politique
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum








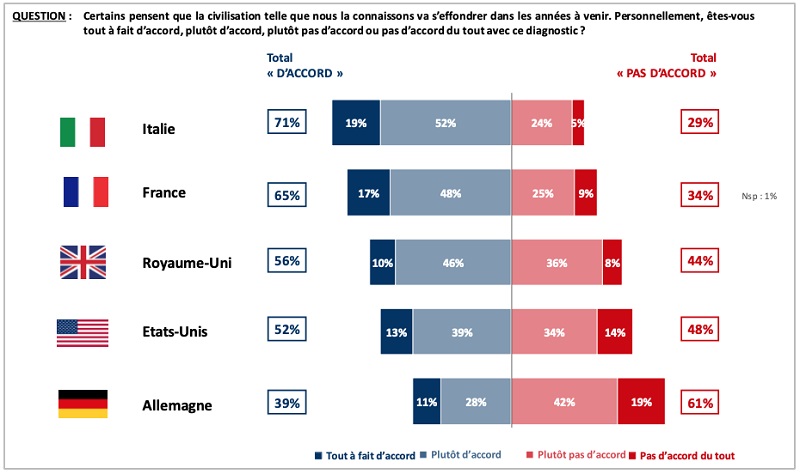
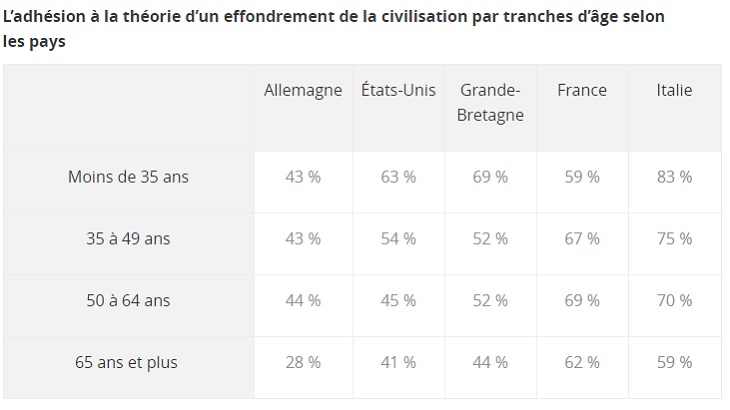
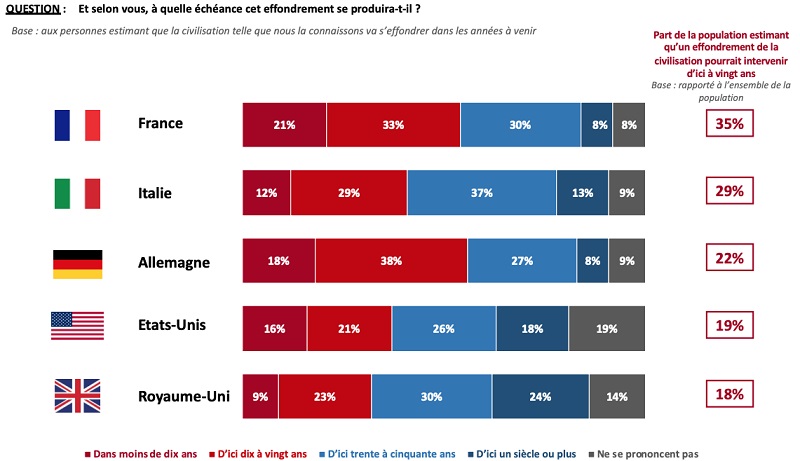
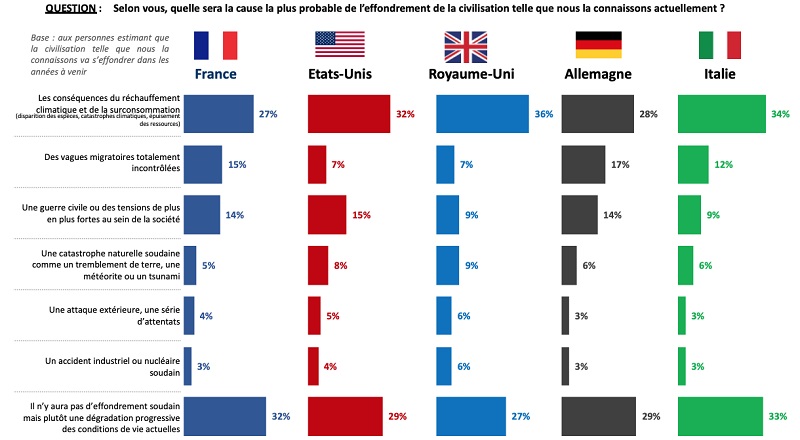
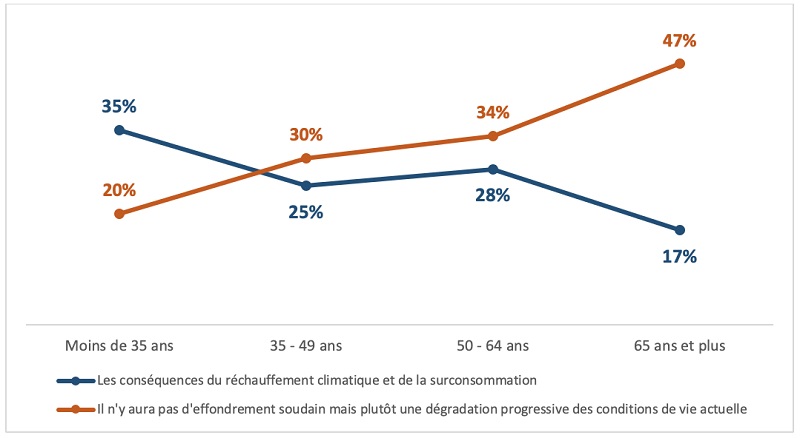
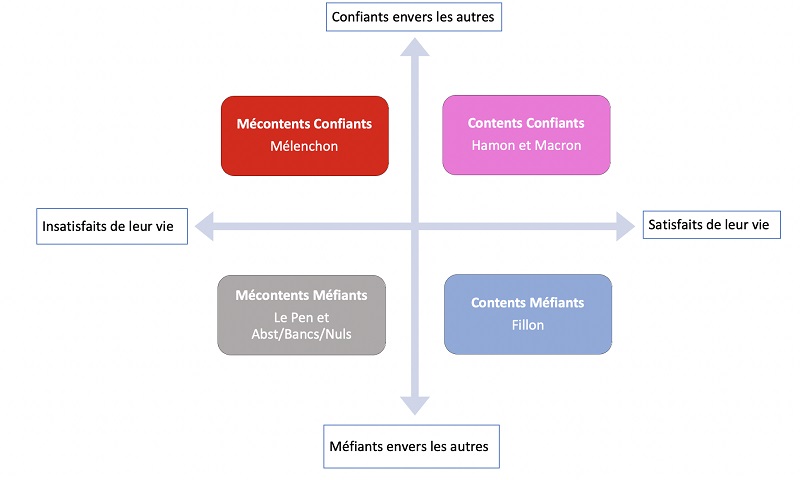
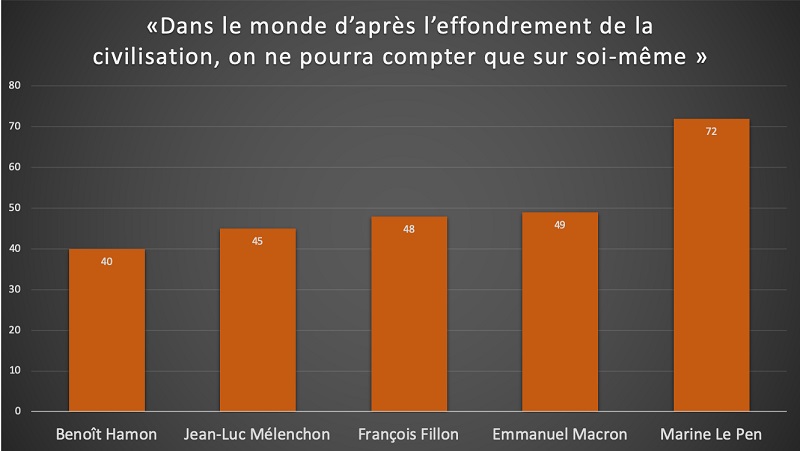
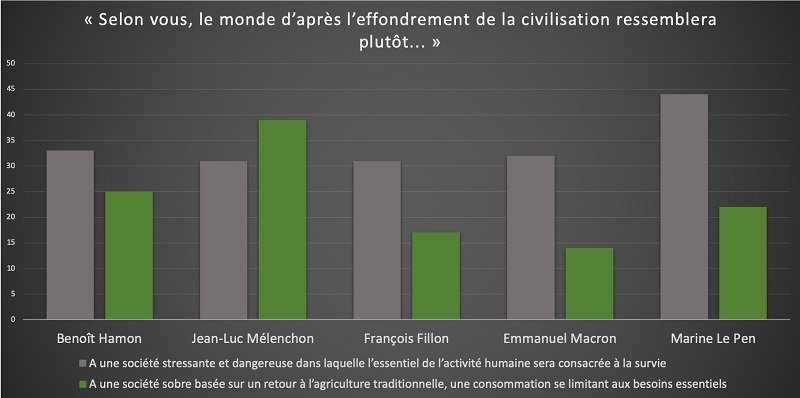
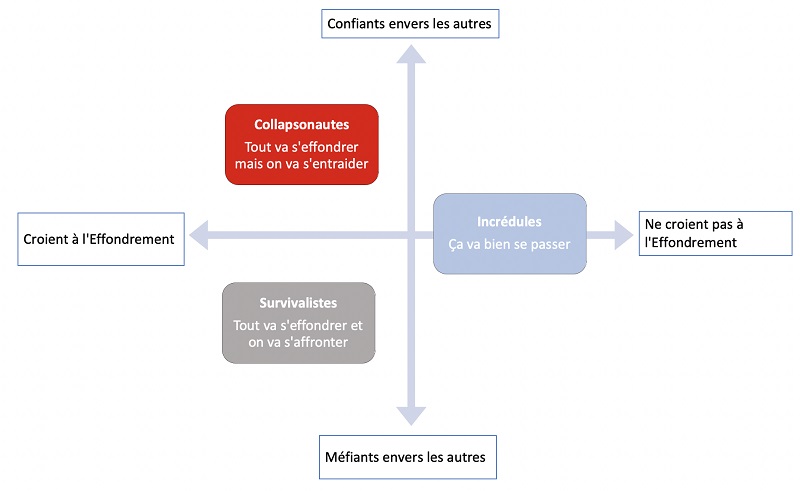



» BIEN CREUSÉ, VIEUX TOP ! Histoires d'une mare
» IRONÈMES, poésie minimaliste, depuis 2018
» MATIÈRES À PENSER
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» I 2. TECHNIQUES et MUSIQUES pour guitares 6, 7 et 8 cordes, IMPRO etc.
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» PETITES HISTWEETOIRES IMPRÉVISÉES
» HOMONÈMES, du même au pas pareil
» LA PAROLE EST À LA DÉFONCE
» KARL MARX : BONNES FEUILLES... BONNES LECTURES ?
» IV. COMBINATOIRE et PERMUTATIONS (tous instruments)
» CLOWNS et CLONES des ARRIÈRE- et AVANT-GARDES
» VI. À LA RECHERCHE DU SON PERDU, ingrédients
» CAMATTE ET MOI
» III. LA BASSE et LES BASSES À LA GUITARE 8 CORDES
» L'ACHRONIQUE À CÔTÉ
» LA CRISE QUI VIENT
» MUSIQUE et RAPPORTS SOCIAUX
» PETITE PHILOSOPHIE PAR LA GUITARE à l'usage de toutes générations, classes, races, sexes...