LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
2 participants
Page 1 sur 1
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
dans le précédent forum, j'ai analysé le moment historique présent comme [i]double crise du capital et de l'Occident[/i], avec la remontée de leur formation structurelle commune. C'est dans ce contexte que je situais [i]les luttes et la pensée décoloniales[/i] comme paradigmatiques, ce que leurs penseurs nomment [i]"le tournant décolonial"[/i] d'une façon réductrice, en l'occurrence sous-estimant le facteur capitaliste, les rapports de production et reproduction
le tome 1 du nouveau livre d'Alain Bihr permet d'approfondir les fondements historiques de cette analyse. Il est probablement le meilleur que cet auteur ait écrit depuis les deux tomes de [url=https://www.google.fr/search?q=la+reproduction+du+capital+Bihr&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&oq=la+reproduction+du+capital+Bihr&aqs=chrome..69i57j0j69i64.9479j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8][i][u]La Reproduction du capital, prolégomènes à une théorie générale du capitalisme[/u][/i][/url], 2001. C'est sans doute dû au fait qu'il n'y [i]« s'agit pas de livrer des enseignements politiques valables hic et nunc »[/i]
[center][img(389px,583px)]https://www.syllepse.net/syllepse_images/produits/expansion_europenne_une_800.jpg[/img]
[url=https://www.revue-ballast.fr/aux-sources-du-capitalisme-avec-alain-bihr/][u][b]Aux sources du capitalisme[/b] — avec Alain Bihr[/u][/url]
Entretien inédit pour le site de Ballast, 18 octobre 2018[/center]
[i]C’est là une somme de près de 700 pages consacrée — ainsi que l’indique son titre — au premier âge du capitalisme : ce tome 1, paru au mois de septembre 2018 aux éditions Syllepse, se penche sur l’expansion impérialiste européenne et sur ce qu’Alain Bihr, son auteur, sociologue et membre de l’organisation Alternative libertaire, nomme le « devenir-monde du capitalisme ». Interroger l’Histoire, c’est aussi contester le statut, supposément « indépassable », du mode de production qui administre aujourd’hui une part toujours plus vaste du monde. Nous en discutons avec lui.[/i]
[quote][size=15][b]Soyons mauvaise langue : tout n’a-t-il pas déjà été dit 100 fois sur le capitalisme ?[/b]
Ce n’est pas être mauvaise langue que de poser pareille question : elle est parfaitement justifiée. Tout auteur se doit d’expliquer en quoi il prétend apporter du neuf par rapport à ce qui a pu être dit sur le même sujet avant lui. Et elle est d’autant plus justifiée dans le cas présent que, en effet, la littérature sur la question est proprement inépuisable ! Si j’ai cependant remis le travail sur le métier, c’est essentiellement pour deux raisons — d’ailleurs liées. En premier lieu, si cette littérature est immense, elle est aussi pour l’essentiel très spécialisée, en ne traitant généralement au mieux qu’un aspect particulier de la question, voire des détails, qu’il est certes intéressant et même indispensable de connaître, mais dont la simple accumulation ne nous fournit aucune vue d’ensemble. Autrement dit, les innombrables arbres, arbustes et arbrisseaux dont la science historienne nous a légué des analyses fouillées ne nous permettent pas d’embrasser la forêt, selon la métaphore bien connue. Et ce défaut n’a fait que s’accentuer au cours des dernières décennies qui ont vu les historiens se réfugier dans la microhistoire en tournant le dos à la synthèse historique, rendue suspecte de ne pas pouvoir se passer d’une philosophie de l’Histoire ou de présupposés scientifiquement invérifiables.
En second lieu, les quelques auteurs qui se sont essayés à embrasser la période historique dont je traite dans son ensemble, soit n’en saisissent tout simplement pas l’enjeu (le parachèvement de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe occidentale), soit ne le rapportent pas à ce qui constitue à mes yeux le premier moteur (l’expansion commerciale et coloniale européenne), soit encore ne parviennent qu’en partie à articuler les deux. Dans sa somme [i]Civilisation matérielle, économie et capitalisme[/i], Fernand Braudel fournit un exemple du premier cas, faute d’avoir assimilé la leçon de Marx — en l’occurrence le concept de rapports capitalistes de production. Les marxistes qui se sont penchés sur la transition du féodalisme au capitalisme ont pour la plupart privilégié les transformations des rapports de production dans les campagnes — certes un moment essentiel du processus sur lequel Marx lui-même met l’accent dans la fameuse section qu’il consacre à l’« accumulation primitive » dans le Livre I du [i]Capital[/i] — mais omettent complètement de l’articuler avec l’expansion européenne1. Les deux tomes consacrés par Immanuel Wallerstein à ce même sujet relèvent de la troisième catégorie : s’ils se proposent pour leur part d’articuler transition du féodalisme au capitalisme et expansion européenne, il me semble qu’ils échouent à le faire. C’est le constat de ces différentes lacunes qui m’a décidé à reprendre toutes ces questions.
[b]Votre ouvrage débute en 1415. Existe-t-il toutefois des prémices capitalistes, voire des systèmes capitalistes, antérieurs à cette date ?[/b]
Cette question témoigne d’une confusion entre capital et capitalisme, due à une maîtrise insuffisante de ces deux concepts — défauts que l’on rencontre couramment, y compris chez les meilleurs auteurs, ou réputés tels. Si l’on suit Marx, le capital est ce rapport social de production caractérisé tout à la fois par l’expropriation des producteurs, la transformation de la force de travail en marchandise, la valorisation de la valeur avancée sous forme de moyens de production et de force de travail par la formation de la plus-value résultant de l’exploitation de la force de travail, enfin par la transformation d’une part plus ou moins importante de cette plus-value en capital additionnel, venant alimenter l’accumulation du capital. Ce rapport de production a pu se former tôt dans l’histoire des sociétés humaines mais est resté longtemps très marginal, dans les pores d’autres rapports de production alors prédominants. Sa formation est notamment subordonnée à celle, préalable, d’une forme imparfaite du capital, ce que Marx nomme le capital marchand, sous sa double forme de capital commercial (procédant du profit réalisé dans le négoce en gros au sein du commerce lointain) et de capital usuraire (forme archaïque du capital financier). Contrairement aux rapports capitalistes de production, le capital marchand a pu connaître des développements somptueux sur la base de rapports précapitalistes de production, fondés sur l’esclavage ou le servage, par exemple.
[b]À quoi songez-vous ?[/b]
Pensons à la Carthage antique ou à la Venise médiévale. Mais sa base restait toujours précaire, tant qu’il ne pouvait se valoriser que par la circulation de marchandises dont il ne maîtrisait pas les conditions de production. C’est pourquoi il a tôt tenté de s’en rendre maître, pour partie au moins, sous la forme, par exemple, du travail en commandite (le marchand fournissant la matière de travail transformée par des paysans et des artisans encore indépendants, et écoulant le produit sur des marchés lointains). Le capitalisme, c’est tout autre chose. C’est le mode de production, autrement dit la forme originale de totalité sociale, de société globale, qui tend à se structurer sur la base des rapports capitalistes de production.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/Albert_Gleizes_1911_Paysage_Landscape_oil_on_canvas_71_x_91.5_cm._Reproduced_frontispiece_catalogue_Galeries_Dalmau_Barcelona_1912.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
Pour que l’on puisse commencer à parler de capitalisme, il faut donc, non seulement que le capital soit devenu le rapport de production dominant, désintégrant les anciens rapports précapitalistes de production ou les intégrant en les transformant, souvent profondément, selon ses exigences propres, mais encore que la reproduction des rapports capitalistes de production ainsi définis se mette à se subordonner tendanciellement à l’ensemble des rapports sociaux, des pratiques sociales, des modes de vie en société, bien au-delà de la seule sphère économique, pour constituer ce que vous appelez vous-même un système : une unité complexe capable de maintenir sa structure constitutive par la réorganisation permanente des éléments qui la composent. Dans ces conditions, s’il y a incontestablement eu des embryons de rapports capitalistes de production dans l’Europe médiévale, fruits du développement du capital marchand prospérant sur la base du commerce lointain (par exemple des échanges entre Europe occidentale et Proche et Moyen-Orient) comme du commerce proche (les échanges entre villes et campagnes en Europe même), c’est un anachronisme total que de parler de capitalisme, de « système capitaliste », à ce sujet. Pour que ce système puisse commencer à prendre forme, il a fallu au préalable que les rapports capitalistes de production n’en restent pas à leur forme embryonnaire médiévale, qu’ils se développent et se parachèvent en commençant à imprimer leur empreinte spécifique sur l’ensemble des autres sphères de la vie sociale. Et c’est ce qui n’a pu se produire qu’à la faveur de cette expansion commerciale et coloniale en direction des autres continents de la planète, dans laquelle l’Europe occidentale se lance à la fin du Moyen Âge. C’est en ce sens que 1415 — date de la prise par les Portugais de Ceuta, prélude à leur lente descente le long des côtes africaines qui les fera déboucher à la fin du siècle dans l’océan Indien — m’a paru pouvoir marquer le début de cette expansion et, avec elle, celui de ce premier âge du capitalisme qui constitue l’objet de mon étude.
[b]Quelles ont été les résistances les plus manifestes de la société féodale à sa conversion en une société capitaliste ?[/b]
En un sens, tout oppose la société féodale à la société capitaliste. La première repose sur le servage de la paysannerie, ce rapport de production qui lie chaque famille paysanne à un domaine foncier en lui garantissant l’exploitation d’une parcelle et l’accès aux terres communales, ainsi qu’au seigneur maître de ce domaine auquel elle doit des redevances de divers types, par un lien de dépendance personnel que renforcent, autant qu’ils l’équilibrent, les liens de dépendance communautaires entre familles paysannes. Alors que la société capitaliste repose sur l’expropriation des producteurs, leur réduction au statut de « travailleurs libres » privés de tout accès direct aux moyens de production, mais aussi de tout lien de dépendance, personnel ou communautaire. Dans sa forme originelle, telle qu’elle voit le jour en Europe occidentale entre le IXe et le XIe siècle de notre ère, la société féodale marginalise complètement et les échanges marchands et la vie urbaine — tandis que la société capitaliste procède d’une marchandisation généralisée de tous les éléments de la vie sociale et d’une urbanisation non moins généralisée de cette dernière. La société féodale est une société d’ordre, dans laquelle le statut social d’un individu est largement déterminé par sa naissance, tandis que son existence restera tributaire des liens de dépendance personnels ou communautaires que lui fixe son ordre. La société capitaliste est, elle, une société de classe, les individus pouvant changer plusieurs fois de classe sociale au cours de leur existence — même si leur mobilité sociale est toujours en partie déterminée par leur appartenance de classe originelle.
La société féodale repose sur un émiettement du pouvoir politique au sein de la hiérarchie féodale (la hiérarchie des seigneurs liés entre eux par des liens personnels d’hommage et d’allégeance) qui conduit à une quasi-disparition de l’État (si l’on veut bien mettre l’Église catholique entre parenthèses). Au contraire, la marche vers le capitalisme va s’accompagner d’une recentralisation du pouvoir et d’une réémergence de l’État. Enfin, la société féodale est une société profondément religieuse, la religion — en l’occurrence chrétienne — en constituant l’idéologie non seulement dominante mais quasi-exclusive, tous les mouvements populaires de contestation de l’ordre féodal s’exprimant dans son langage sous la forme d’hérésies multiples. Alors que la société capitaliste crée, de multiples manières, les conditions du relativisme, de l’indifférence en matière religieuse, du scepticisme, voire de l’incroyance, même si, contradictoirement, elle développe différents fétichismes — de la valeur, du droit, de l’État, de la nation, etc. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre comment, malgré tout, une dynamique a pu s’enclencher au sein même du féodalisme — qui aura finalement abouti à faire naître ces embryons de rapports capitalistes de production, dont le développement, à la faveur de l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe, va donner naissance au capitalisme.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/41837545082_a8e123d2aa_b.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
[b]Votre livre traite d’une première mondialisation comme point de départ du capitalisme. En quoi la mondialisation — ou du moins ce que l’on nomme aujourd’hui comme tel — en serait-elle la source et non la conséquence ?[/b]
En fait, elle est l’un et l’autre à la fois. Ma thèse est que la mondialisation — que je préfère dénommer le devenir-monde du capitalisme — est à la fois le point de départ de ce dernier, sa condition préalable de possibilité et, simultanément, son résultat, qu’il ne cesse de parachever, d’étendre et d’approfondir. Elle est en ce sens son point d’arrivée. Et en est le point de départ en ce que, sans cette première mondialisation, sans cette première période du devenir-monde du capitalisme qu’a constitué l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe qui a eu lieu du XVe au milieu du XVIIIe siècle, les rapports capitalistes de production, qui n’avaient connu qu’un développement embryonnaire dans l’Europe féodale, ne seraient jamais parvenus à se parachever, à réaliser la totalité de leurs conditions, et à commencer à marquer de leur empreinte la réalité sociale tout entière, en donnant ainsi naissance à un premier âge du capitalisme. C’est ce que s’efforce de démontrer le deuxième tome de l’ouvrage à paraître au printemps prochain. Mais il est bien évident que le capitalisme n’en est pas resté là, et que l’ensemble de ce processus s’est poursuivi depuis lors, en combinant : la transformation des rapports capitalistes de production, dans le sens d’une domination réelle croissante du travail sur le capital (depuis la « révolution industrielle » jusqu’à nos jours) ; l’extension progressive de ces mêmes rapports de production à l’ensemble de la planète et de l’humanité par intégration/désintégration de l’ensemble des rapports de production précapitalistes ; la hiérarchisation des différentes formations sociales ainsi incluses dans le cycle de leur reproduction ; leur emprise progressive sur la totalité des sphères de la vie sociale. En ce sens, le devenir-monde du capitalisme est une œuvre toujours en cours, dont ce qu’on nomme depuis quelques lustres la « mondialisation » ou « globalisation » n’est que la dernière phase en date.
[b]Le fait que la mondialisation ait permis ce passage du féodalisme au capitalisme n’a-t-il pas conduit, plus tard, des courants anticapitalistes à privilégier l’échelle nationale ?[/b]
Cela sort du cadre de mon ouvrage car il a trait à la période postérieure du devenir-monde du capitalisme. Celle qui est précisément marquée par l’avènement d’un monde capitaliste fragmenté en une multiplicité d’États-nations concurrents et rivaux, dont les principaux (les États centraux) sont impérialistes en ce sens qu’ils luttent en permanence pour le partage et le repartage de la planète entière en empires coloniaux. Ce deuxième âge du capitalisme débute avec la Révolution industrielle et s’achève avec la crise structurelle ouverte dans les années 1970, après que la décolonisation aura multiplié les États-nations — en en consacrant en quelque sorte le modèle. L’étude de ce deuxième âge devrait faire l’objet d’un autre ouvrage, que je propose d’écrire, pour autant que le temps m’en soit donné… Au cours de ce deuxième âge, on a en effet vu des mouvements anticapitalistes tourner le dos à l’internationalisme pour lui préférer le nationalisme ou, du moins, le cadre de l’État-nation, plus ou moins fétichisé. Cela n’a pas été le fait seulement de courants de droite et d’extrême droite (nationalismes et populismes de droite, fascismes) mais aussi, et peut-être surtout, des courants dominants au sein du mouvement ouvrier même.
[b]Comme ?[/b]
Pensons à ce qu’il est advenu des organisations politiques affiliées à la IIe Internationale social-démocrate et à la manière dont elles se sont toutes engagées dans les politiques de l’Union sacrée en août 1914. Pensons plus largement à la manière dont, à partir de l’entre-deux-guerres, au centre du monde capitaliste (Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon), le mouvement ouvrier s’est glissé dans le cadre des États-nations, en réduisant l’internationalisme prolétarien à une pure figure rhétorique. Mais tout cela a plus à voir avec les caractéristiques de ce deuxième âge du capitalisme, notamment avec la configuration du développement des États-nations comme forme spécifique du devenir-monde du capitalisme au cours de cet âge, qu’avec l’héritage de la transition du féodalisme au capitalisme au cours du premier âge de celui-ci. Même si certains des mouvements anticapitalistes de droite ou d’extrême droite ont été hantés par la nostalgie d’un Moyen Âge fantasmé, ou même d’un héritage ethnique pré-médiéval. Je pense évidemment ici en particulier au nazisme.
[b]En quoi les expansions commerciales et coloniales permises par cette première mondialisation ont-elles donné ce rôle central à l’Europe ?[/b]
L’expansion commerciale et coloniale qu’a constituée cette première période du devenir-monde du capitalisme a considérablement élargi la sphère ouverte à l’accumulation du capital marchand en Europe, en même temps qu’elle en a accéléré le rythme. Pensons seulement à ce qu’a représenté le volume de métal précieux (or et surtout argent) extrait des mines d’Amérique, qui aura permis de sextupler le stock monétaire européen en trois siècles, en dynamisant ainsi les échanges marchands en Europe même, ainsi que ceux entre l’Europe, ses colonies (essentiellement américaines) et l’Asie, en favorisant la concentration du capital sous forme de compagnies commerciales à privilèges, mais en favorisant aussi la formation et l’accumulation de capital industriel sous forme de mines, de manufactures et de fabriques, mais aussi, déjà, d’exploitations agricoles, etc.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/JkEkUbw.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
Tout cela retentissant sur la division et la hiérarchisation des sociétés européennes, de plus en plus traversées et par conséquent bouleversées par des divisions de classes ; tout cela contribuant au renforcement de la bourgeoisie (notamment marchande) en tant que classe sociale, ce dont témoignent les premières révolutions bourgeoises (dans les anciens Pays-Bas, en Angleterre) ; tout cela favorisant la transformation des royautés en monarchies absolues, avec un considérable développement des appareils d’État (militaires, judiciaires, administratifs, fiscaux), donnant lieu à une multiplicité de « révolutions culturelles » (la Renaissance, la Réforme, les Lumières, etc.). Évidemment, ce processus n’a répondu à aucun déterminisme — et encore moins à une quelconque téléologie. Il n’a d’ailleurs été ni linéaire ni contenu : il a emprunté des chemins de traverse (en passant par des États ibériques qui ont ouvert le chemin pour rapidement laisser la place à d’autres) et a connu des stagnations, voire des régressions (le court XVIIe siècle, qui va de 1620 à 1690, peut être qualifié comme tel). Il s’est accompagné de profondes inégalités de développement en Europe même, dont le continent reste marqué de nos jours encore.
[b]Mais cela aurait-il pu se produire autrement ?[/b]
Je ne le crois pas. Sans la sérieuse impulsion qu’elle a reçue de l’expansion européenne, l’accumulation de capital marchand et son début d’emprise sur les procès de production (dans l’agriculture, l’artisanat, la proto-industrie), au cours du Moyen Âge, auraient peut-être connu le même destin que ce qui s’était déjà produit plusieurs fois dans l’Histoire auparavant : ils se seraient essoufflés, voire auraient été étouffés par les forces réactionnaires (féodales) qu’ils menaçaient. Au mieux, le processus aurait été beaucoup plus lent — comme cela a été le cas par exemple en Chine sous les Song, les Ming et les premiers Qing, ou encore au Japon dans la période d’Edo.
[b]La colonisation européenne n’est pas parvenue à s’implanter avec les mêmes « succès », sinistres s’il en est, sur l’ensemble des continents. Sait-on pourquoi ?[/b]
Répondre à cette question revient à s’interroger sur l’état des différentes formations sociales extra-européennes au moment où elles vont être confrontées à l’expansion européenne. Car cet état détermine et l’intérêt qu’elles peuvent présenter pour les Européens, et la résistance qu’elles peuvent opposer aux entreprises européennes de colonisation. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que, dans les conditions de l’époque, une colonisation soit possible. Il faut tout d’abord que les territoires visés par les projets coloniaux soient accessibles par voies de mer ou de terre. Il faut aussi qu’ils présentent des ressources (minières ou agricoles) exploitables et valorisables sur le marché européen. Il faut encore que les populations indigènes soient exploitables, c’est-à-dire rompues à la discipline d’un travail impliquant la production d’un surproduit. Enfin, il faut que ces populations ne soient pas en état de se défendre soit par elles-mêmes soit par la « protection » des pouvoirs politiques, qui ont intérêt à ce qu’elles ne soient pas soustraites à leur propre exploitation. Or, sous ces rapports, les différentes formations extra-européennes ne se valent pas.
[b]Que voulez-vous dire par là ?[/b]
La partie la plus développée du continent américain est alors celle qui est comprise dans les deux Empires aztèques (centrés sur l’actuel Mexique) et inca (centré sur l’actuel Pérou). L’un et l’autre ont ouvert un réseau de voies de communication terrestres qui en facilitent la pénétration. L’un et l’autre recèlent de fabuleux trésors d’or et d’argent et, en deçà, les ressources minières correspondantes, sans compter une agriculture florissante. Leurs populations sont de surcroît de longue date habituées à la discipline collective d’un travail exploité, dont les Espagnols reprendront pour l’essentiel les modalités. Enfin, leur capacité de résistance est limitée, pour différentes raisons : inexistence des armes à feu, passivité des populations, de surcroît désarmées, intégration encore bien trop lâche de l’Empire aztèque et crise dynastique au sein de l’Empire inca. Tout cela explique que quelques centaines d’Espagnols aient pu s’en rendre maîtres — à chaque fois en quelques années seulement ! Ailleurs sur le continent américain, dans les Antilles ou sur les côtes de ce qui va devenir le Brésil, les conditions de la colonisation ont été beaucoup moins favorables. Aucune richesse minière (le Minas Gerais ne sera mis en exploitation qu’à la toute fin du XVIIe siècle) ; la possibilité, certes, de développer des cultures tropicales valorisables, à commencer par celle de la canne à sucre, mais trop peu de populations indigènes pour les lancer, ou des populations capables de se soustraire à la domination par la fuite, si bien que le développement de ces cultures demandera l’importation massive d’une population servile depuis les côtes africaines.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/1957_002_view2_o2.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
[b]Et l’Afrique subsaharienne, justement ?[/b]
Elle sera paradoxalement préservée de la colonisation par sa pauvreté relative. Sur ses côtes occidentale et orientale, elle n’a pas grand-chose à offrir que les Européens ne puissent acquérir par les moyens alternatifs d’un commerce souvent forcé et toujours inéquitable : quelques épices, de l’or (issu de la vallée du Niger ou du plateau zimbabwéen) et, surtout, des esclaves que les pouvoirs tribaux indigènes leur fournissent en échange de produits industriels : de la pacotille, des tissus, des barres de fer et de plomb, des armes à feu aussi, de l’alcool, etc. Soit qu’ils aient été esclavagistes avant même l’arrivée des Européens, soit qu’ils se soient lancés dans la traite négrière pour éviter d’être eux-mêmes transformés en esclaves. Quant à l’intérieur du continent, il reste impénétrable par les Européens — sauf le long de quelques fleuves (le Sénégal, le Congo et le Zambèze notamment). L’Asie continentale, par contre, offre de multiples richesses à la convoitise des Européens, à commencer par les fameuses épices. C’est d’ailleurs pour s’en emparer que Portugais et Espagnols se sont lancés dans l’aventure de l’expansion maritime. Mais les pouvoirs asiatiques (les empires et royaumes indiens, l’empire chinois Ming tout d’abord et Qing ensuite, les royaumes indochinois, mêmes les petits sultanats indonésiens, le shogunat Tokugawa dès lors qu’il aura pacifié le Japon féodal) sont bien trop puissants pour que, venus d’aussi loin, les Européens puissent songer à s’en emparer. Au moins dans un premier temps. Ceylan (Sri Lanka) et une partie de Java seront en partie colonisés à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle par les Néerlandais. Aussi, pour l’essentiel, les Européens devront-ils se contenter de s’emparer, par des moyens de force, des circuits marchands de l’Asie maritime qui s’étend alors de l’Afrique orientale jusqu’au Japon, en en chassant tout d’abord les marchands arabes, indiens, malais et chinois qui en étaient maîtres à leur arrivée, puis en se faisant la guerre entre eux pour se repartager le gâteau.
[b]L’économiste franco-égyptien Samir Amin, figure de l’altermondialisme, est récemment décédé. A-t-il nourri vos propres travaux ?[/b]
Je tiens pour majeure sa contribution à l’analyse du système capitaliste mondial, notamment en ce qui concerne les mécanismes générateurs du développement inégal et de l’échange inégal entre formations centrales et formations périphériques au sein du monde capitaliste. Cela m’a servi à analyser les rapports entre ces différentes formations dans le contexte, pourtant différent, du premier monde capitaliste, celui correspondant à la période antérieure du devenir-monde du capitalisme, sur laquelle lui-même ne s’est cependant pas directement penché.
[b]Peut-on retirer de ce premier tome un quelconque appui présent, à l’heure où, en France, rien ne semble pouvoir s’élever, massivement, contre l’hégémonie capitaliste ?[/b]
La finalité immédiate de mon ouvrage n’est pas de livrer des enseignements politiques valables[i] hic et nunc,[/i] mais de rendre compréhensible le processus historique à travers lequel le capitalisme a pris naissance. Cependant, la compréhension de ce processus fournit aussi l’occasion de s’approprier des concepts qui restent tout à fait pertinents pour la compréhension des formes actuelles de la « mondialisation ». Elle permet de relativiser la nouveauté apparente de la situation actuelle, en montrant qu’elle réédite des formes d’exploitation et de domination déjà anciennes — évitant ainsi de prendre des vessies ancestrales pour d’inédites lanternes et d’être victimes des mirages de l’ère néolibérale… La conscience de l’historicité du mode capitaliste de production permet de se convaincre que le monde capitaliste qui est le nôtre n’échappe pas plus aujourd’hui qu’hier aux contradictions fondamentales des rapports capitalistes de production qui lui servent de base. En ce sens, le néolibéralisme s’illusionne complètement en croyant en avoir fini avec les limites que le capital dresse lui-même périodiquement sur la voie de sa propre reproduction — l’épisode de la crise des subprimes, il y a 10 ans, l’a montré. Et cela n’est rien à côté des limites que sa propre ubris productiviste, son accumulation sans fin ni mesure, est en train de rendre manifestes ! Et de plus en plus effectives sous la forme de la catastrophe écologique dans laquelle il nous engage chaque jour un peu plus.
Illustrations : extraits de peintures d’Albert Gleizes (1881-1953)
1. ↑ C’est le cas par exemple des contributions réunies par Maurice Dobb et Paul Sweezy, écrites au long des années 1950-1960, comme de celles ayant pris part au fameux Brenner Debate qui a agité la revue britannique Past and Present dans la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980.[/size][/quote]
on pourra lire également [url=https://alencontre.org/societe/livres/alain-bihr-la-mondialisation-a-permis-de-donner-naissance-au-capitalisme.html][u][b]Alain Bihr: [i]« La mondialisation a permis de donner naissance au capitalisme »[/i][/b][/u][/url], [i]Alencontre[/i], 21 septembre 2018 et [url=https://www.google.fr/search?q=alain+bihr+capitalisme&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiR9dOBt5LeAhUHrxoKHasFCA4Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938][u]autres comptes-rendus[/u][/url]
le tome 1 du nouveau livre d'Alain Bihr permet d'approfondir les fondements historiques de cette analyse. Il est probablement le meilleur que cet auteur ait écrit depuis les deux tomes de [url=https://www.google.fr/search?q=la+reproduction+du+capital+Bihr&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&oq=la+reproduction+du+capital+Bihr&aqs=chrome..69i57j0j69i64.9479j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8][i][u]La Reproduction du capital, prolégomènes à une théorie générale du capitalisme[/u][/i][/url], 2001. C'est sans doute dû au fait qu'il n'y [i]« s'agit pas de livrer des enseignements politiques valables hic et nunc »[/i]
[center][img(389px,583px)]https://www.syllepse.net/syllepse_images/produits/expansion_europenne_une_800.jpg[/img]
[url=https://www.revue-ballast.fr/aux-sources-du-capitalisme-avec-alain-bihr/][u][b]Aux sources du capitalisme[/b] — avec Alain Bihr[/u][/url]
Entretien inédit pour le site de Ballast, 18 octobre 2018[/center]
[i]C’est là une somme de près de 700 pages consacrée — ainsi que l’indique son titre — au premier âge du capitalisme : ce tome 1, paru au mois de septembre 2018 aux éditions Syllepse, se penche sur l’expansion impérialiste européenne et sur ce qu’Alain Bihr, son auteur, sociologue et membre de l’organisation Alternative libertaire, nomme le « devenir-monde du capitalisme ». Interroger l’Histoire, c’est aussi contester le statut, supposément « indépassable », du mode de production qui administre aujourd’hui une part toujours plus vaste du monde. Nous en discutons avec lui.[/i]
[quote][size=15][b]Soyons mauvaise langue : tout n’a-t-il pas déjà été dit 100 fois sur le capitalisme ?[/b]
Ce n’est pas être mauvaise langue que de poser pareille question : elle est parfaitement justifiée. Tout auteur se doit d’expliquer en quoi il prétend apporter du neuf par rapport à ce qui a pu être dit sur le même sujet avant lui. Et elle est d’autant plus justifiée dans le cas présent que, en effet, la littérature sur la question est proprement inépuisable ! Si j’ai cependant remis le travail sur le métier, c’est essentiellement pour deux raisons — d’ailleurs liées. En premier lieu, si cette littérature est immense, elle est aussi pour l’essentiel très spécialisée, en ne traitant généralement au mieux qu’un aspect particulier de la question, voire des détails, qu’il est certes intéressant et même indispensable de connaître, mais dont la simple accumulation ne nous fournit aucune vue d’ensemble. Autrement dit, les innombrables arbres, arbustes et arbrisseaux dont la science historienne nous a légué des analyses fouillées ne nous permettent pas d’embrasser la forêt, selon la métaphore bien connue. Et ce défaut n’a fait que s’accentuer au cours des dernières décennies qui ont vu les historiens se réfugier dans la microhistoire en tournant le dos à la synthèse historique, rendue suspecte de ne pas pouvoir se passer d’une philosophie de l’Histoire ou de présupposés scientifiquement invérifiables.
En second lieu, les quelques auteurs qui se sont essayés à embrasser la période historique dont je traite dans son ensemble, soit n’en saisissent tout simplement pas l’enjeu (le parachèvement de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe occidentale), soit ne le rapportent pas à ce qui constitue à mes yeux le premier moteur (l’expansion commerciale et coloniale européenne), soit encore ne parviennent qu’en partie à articuler les deux. Dans sa somme [i]Civilisation matérielle, économie et capitalisme[/i], Fernand Braudel fournit un exemple du premier cas, faute d’avoir assimilé la leçon de Marx — en l’occurrence le concept de rapports capitalistes de production. Les marxistes qui se sont penchés sur la transition du féodalisme au capitalisme ont pour la plupart privilégié les transformations des rapports de production dans les campagnes — certes un moment essentiel du processus sur lequel Marx lui-même met l’accent dans la fameuse section qu’il consacre à l’« accumulation primitive » dans le Livre I du [i]Capital[/i] — mais omettent complètement de l’articuler avec l’expansion européenne1. Les deux tomes consacrés par Immanuel Wallerstein à ce même sujet relèvent de la troisième catégorie : s’ils se proposent pour leur part d’articuler transition du féodalisme au capitalisme et expansion européenne, il me semble qu’ils échouent à le faire. C’est le constat de ces différentes lacunes qui m’a décidé à reprendre toutes ces questions.
[b]Votre ouvrage débute en 1415. Existe-t-il toutefois des prémices capitalistes, voire des systèmes capitalistes, antérieurs à cette date ?[/b]
Cette question témoigne d’une confusion entre capital et capitalisme, due à une maîtrise insuffisante de ces deux concepts — défauts que l’on rencontre couramment, y compris chez les meilleurs auteurs, ou réputés tels. Si l’on suit Marx, le capital est ce rapport social de production caractérisé tout à la fois par l’expropriation des producteurs, la transformation de la force de travail en marchandise, la valorisation de la valeur avancée sous forme de moyens de production et de force de travail par la formation de la plus-value résultant de l’exploitation de la force de travail, enfin par la transformation d’une part plus ou moins importante de cette plus-value en capital additionnel, venant alimenter l’accumulation du capital. Ce rapport de production a pu se former tôt dans l’histoire des sociétés humaines mais est resté longtemps très marginal, dans les pores d’autres rapports de production alors prédominants. Sa formation est notamment subordonnée à celle, préalable, d’une forme imparfaite du capital, ce que Marx nomme le capital marchand, sous sa double forme de capital commercial (procédant du profit réalisé dans le négoce en gros au sein du commerce lointain) et de capital usuraire (forme archaïque du capital financier). Contrairement aux rapports capitalistes de production, le capital marchand a pu connaître des développements somptueux sur la base de rapports précapitalistes de production, fondés sur l’esclavage ou le servage, par exemple.
[b]À quoi songez-vous ?[/b]
Pensons à la Carthage antique ou à la Venise médiévale. Mais sa base restait toujours précaire, tant qu’il ne pouvait se valoriser que par la circulation de marchandises dont il ne maîtrisait pas les conditions de production. C’est pourquoi il a tôt tenté de s’en rendre maître, pour partie au moins, sous la forme, par exemple, du travail en commandite (le marchand fournissant la matière de travail transformée par des paysans et des artisans encore indépendants, et écoulant le produit sur des marchés lointains). Le capitalisme, c’est tout autre chose. C’est le mode de production, autrement dit la forme originale de totalité sociale, de société globale, qui tend à se structurer sur la base des rapports capitalistes de production.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/Albert_Gleizes_1911_Paysage_Landscape_oil_on_canvas_71_x_91.5_cm._Reproduced_frontispiece_catalogue_Galeries_Dalmau_Barcelona_1912.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
Pour que l’on puisse commencer à parler de capitalisme, il faut donc, non seulement que le capital soit devenu le rapport de production dominant, désintégrant les anciens rapports précapitalistes de production ou les intégrant en les transformant, souvent profondément, selon ses exigences propres, mais encore que la reproduction des rapports capitalistes de production ainsi définis se mette à se subordonner tendanciellement à l’ensemble des rapports sociaux, des pratiques sociales, des modes de vie en société, bien au-delà de la seule sphère économique, pour constituer ce que vous appelez vous-même un système : une unité complexe capable de maintenir sa structure constitutive par la réorganisation permanente des éléments qui la composent. Dans ces conditions, s’il y a incontestablement eu des embryons de rapports capitalistes de production dans l’Europe médiévale, fruits du développement du capital marchand prospérant sur la base du commerce lointain (par exemple des échanges entre Europe occidentale et Proche et Moyen-Orient) comme du commerce proche (les échanges entre villes et campagnes en Europe même), c’est un anachronisme total que de parler de capitalisme, de « système capitaliste », à ce sujet. Pour que ce système puisse commencer à prendre forme, il a fallu au préalable que les rapports capitalistes de production n’en restent pas à leur forme embryonnaire médiévale, qu’ils se développent et se parachèvent en commençant à imprimer leur empreinte spécifique sur l’ensemble des autres sphères de la vie sociale. Et c’est ce qui n’a pu se produire qu’à la faveur de cette expansion commerciale et coloniale en direction des autres continents de la planète, dans laquelle l’Europe occidentale se lance à la fin du Moyen Âge. C’est en ce sens que 1415 — date de la prise par les Portugais de Ceuta, prélude à leur lente descente le long des côtes africaines qui les fera déboucher à la fin du siècle dans l’océan Indien — m’a paru pouvoir marquer le début de cette expansion et, avec elle, celui de ce premier âge du capitalisme qui constitue l’objet de mon étude.
[b]Quelles ont été les résistances les plus manifestes de la société féodale à sa conversion en une société capitaliste ?[/b]
En un sens, tout oppose la société féodale à la société capitaliste. La première repose sur le servage de la paysannerie, ce rapport de production qui lie chaque famille paysanne à un domaine foncier en lui garantissant l’exploitation d’une parcelle et l’accès aux terres communales, ainsi qu’au seigneur maître de ce domaine auquel elle doit des redevances de divers types, par un lien de dépendance personnel que renforcent, autant qu’ils l’équilibrent, les liens de dépendance communautaires entre familles paysannes. Alors que la société capitaliste repose sur l’expropriation des producteurs, leur réduction au statut de « travailleurs libres » privés de tout accès direct aux moyens de production, mais aussi de tout lien de dépendance, personnel ou communautaire. Dans sa forme originelle, telle qu’elle voit le jour en Europe occidentale entre le IXe et le XIe siècle de notre ère, la société féodale marginalise complètement et les échanges marchands et la vie urbaine — tandis que la société capitaliste procède d’une marchandisation généralisée de tous les éléments de la vie sociale et d’une urbanisation non moins généralisée de cette dernière. La société féodale est une société d’ordre, dans laquelle le statut social d’un individu est largement déterminé par sa naissance, tandis que son existence restera tributaire des liens de dépendance personnels ou communautaires que lui fixe son ordre. La société capitaliste est, elle, une société de classe, les individus pouvant changer plusieurs fois de classe sociale au cours de leur existence — même si leur mobilité sociale est toujours en partie déterminée par leur appartenance de classe originelle.
La société féodale repose sur un émiettement du pouvoir politique au sein de la hiérarchie féodale (la hiérarchie des seigneurs liés entre eux par des liens personnels d’hommage et d’allégeance) qui conduit à une quasi-disparition de l’État (si l’on veut bien mettre l’Église catholique entre parenthèses). Au contraire, la marche vers le capitalisme va s’accompagner d’une recentralisation du pouvoir et d’une réémergence de l’État. Enfin, la société féodale est une société profondément religieuse, la religion — en l’occurrence chrétienne — en constituant l’idéologie non seulement dominante mais quasi-exclusive, tous les mouvements populaires de contestation de l’ordre féodal s’exprimant dans son langage sous la forme d’hérésies multiples. Alors que la société capitaliste crée, de multiples manières, les conditions du relativisme, de l’indifférence en matière religieuse, du scepticisme, voire de l’incroyance, même si, contradictoirement, elle développe différents fétichismes — de la valeur, du droit, de l’État, de la nation, etc. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre comment, malgré tout, une dynamique a pu s’enclencher au sein même du féodalisme — qui aura finalement abouti à faire naître ces embryons de rapports capitalistes de production, dont le développement, à la faveur de l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe, va donner naissance au capitalisme.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/41837545082_a8e123d2aa_b.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
[b]Votre livre traite d’une première mondialisation comme point de départ du capitalisme. En quoi la mondialisation — ou du moins ce que l’on nomme aujourd’hui comme tel — en serait-elle la source et non la conséquence ?[/b]
En fait, elle est l’un et l’autre à la fois. Ma thèse est que la mondialisation — que je préfère dénommer le devenir-monde du capitalisme — est à la fois le point de départ de ce dernier, sa condition préalable de possibilité et, simultanément, son résultat, qu’il ne cesse de parachever, d’étendre et d’approfondir. Elle est en ce sens son point d’arrivée. Et en est le point de départ en ce que, sans cette première mondialisation, sans cette première période du devenir-monde du capitalisme qu’a constitué l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe qui a eu lieu du XVe au milieu du XVIIIe siècle, les rapports capitalistes de production, qui n’avaient connu qu’un développement embryonnaire dans l’Europe féodale, ne seraient jamais parvenus à se parachever, à réaliser la totalité de leurs conditions, et à commencer à marquer de leur empreinte la réalité sociale tout entière, en donnant ainsi naissance à un premier âge du capitalisme. C’est ce que s’efforce de démontrer le deuxième tome de l’ouvrage à paraître au printemps prochain. Mais il est bien évident que le capitalisme n’en est pas resté là, et que l’ensemble de ce processus s’est poursuivi depuis lors, en combinant : la transformation des rapports capitalistes de production, dans le sens d’une domination réelle croissante du travail sur le capital (depuis la « révolution industrielle » jusqu’à nos jours) ; l’extension progressive de ces mêmes rapports de production à l’ensemble de la planète et de l’humanité par intégration/désintégration de l’ensemble des rapports de production précapitalistes ; la hiérarchisation des différentes formations sociales ainsi incluses dans le cycle de leur reproduction ; leur emprise progressive sur la totalité des sphères de la vie sociale. En ce sens, le devenir-monde du capitalisme est une œuvre toujours en cours, dont ce qu’on nomme depuis quelques lustres la « mondialisation » ou « globalisation » n’est que la dernière phase en date.
[b]Le fait que la mondialisation ait permis ce passage du féodalisme au capitalisme n’a-t-il pas conduit, plus tard, des courants anticapitalistes à privilégier l’échelle nationale ?[/b]
Cela sort du cadre de mon ouvrage car il a trait à la période postérieure du devenir-monde du capitalisme. Celle qui est précisément marquée par l’avènement d’un monde capitaliste fragmenté en une multiplicité d’États-nations concurrents et rivaux, dont les principaux (les États centraux) sont impérialistes en ce sens qu’ils luttent en permanence pour le partage et le repartage de la planète entière en empires coloniaux. Ce deuxième âge du capitalisme débute avec la Révolution industrielle et s’achève avec la crise structurelle ouverte dans les années 1970, après que la décolonisation aura multiplié les États-nations — en en consacrant en quelque sorte le modèle. L’étude de ce deuxième âge devrait faire l’objet d’un autre ouvrage, que je propose d’écrire, pour autant que le temps m’en soit donné… Au cours de ce deuxième âge, on a en effet vu des mouvements anticapitalistes tourner le dos à l’internationalisme pour lui préférer le nationalisme ou, du moins, le cadre de l’État-nation, plus ou moins fétichisé. Cela n’a pas été le fait seulement de courants de droite et d’extrême droite (nationalismes et populismes de droite, fascismes) mais aussi, et peut-être surtout, des courants dominants au sein du mouvement ouvrier même.
[b]Comme ?[/b]
Pensons à ce qu’il est advenu des organisations politiques affiliées à la IIe Internationale social-démocrate et à la manière dont elles se sont toutes engagées dans les politiques de l’Union sacrée en août 1914. Pensons plus largement à la manière dont, à partir de l’entre-deux-guerres, au centre du monde capitaliste (Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon), le mouvement ouvrier s’est glissé dans le cadre des États-nations, en réduisant l’internationalisme prolétarien à une pure figure rhétorique. Mais tout cela a plus à voir avec les caractéristiques de ce deuxième âge du capitalisme, notamment avec la configuration du développement des États-nations comme forme spécifique du devenir-monde du capitalisme au cours de cet âge, qu’avec l’héritage de la transition du féodalisme au capitalisme au cours du premier âge de celui-ci. Même si certains des mouvements anticapitalistes de droite ou d’extrême droite ont été hantés par la nostalgie d’un Moyen Âge fantasmé, ou même d’un héritage ethnique pré-médiéval. Je pense évidemment ici en particulier au nazisme.
[b]En quoi les expansions commerciales et coloniales permises par cette première mondialisation ont-elles donné ce rôle central à l’Europe ?[/b]
L’expansion commerciale et coloniale qu’a constituée cette première période du devenir-monde du capitalisme a considérablement élargi la sphère ouverte à l’accumulation du capital marchand en Europe, en même temps qu’elle en a accéléré le rythme. Pensons seulement à ce qu’a représenté le volume de métal précieux (or et surtout argent) extrait des mines d’Amérique, qui aura permis de sextupler le stock monétaire européen en trois siècles, en dynamisant ainsi les échanges marchands en Europe même, ainsi que ceux entre l’Europe, ses colonies (essentiellement américaines) et l’Asie, en favorisant la concentration du capital sous forme de compagnies commerciales à privilèges, mais en favorisant aussi la formation et l’accumulation de capital industriel sous forme de mines, de manufactures et de fabriques, mais aussi, déjà, d’exploitations agricoles, etc.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/JkEkUbw.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
Tout cela retentissant sur la division et la hiérarchisation des sociétés européennes, de plus en plus traversées et par conséquent bouleversées par des divisions de classes ; tout cela contribuant au renforcement de la bourgeoisie (notamment marchande) en tant que classe sociale, ce dont témoignent les premières révolutions bourgeoises (dans les anciens Pays-Bas, en Angleterre) ; tout cela favorisant la transformation des royautés en monarchies absolues, avec un considérable développement des appareils d’État (militaires, judiciaires, administratifs, fiscaux), donnant lieu à une multiplicité de « révolutions culturelles » (la Renaissance, la Réforme, les Lumières, etc.). Évidemment, ce processus n’a répondu à aucun déterminisme — et encore moins à une quelconque téléologie. Il n’a d’ailleurs été ni linéaire ni contenu : il a emprunté des chemins de traverse (en passant par des États ibériques qui ont ouvert le chemin pour rapidement laisser la place à d’autres) et a connu des stagnations, voire des régressions (le court XVIIe siècle, qui va de 1620 à 1690, peut être qualifié comme tel). Il s’est accompagné de profondes inégalités de développement en Europe même, dont le continent reste marqué de nos jours encore.
[b]Mais cela aurait-il pu se produire autrement ?[/b]
Je ne le crois pas. Sans la sérieuse impulsion qu’elle a reçue de l’expansion européenne, l’accumulation de capital marchand et son début d’emprise sur les procès de production (dans l’agriculture, l’artisanat, la proto-industrie), au cours du Moyen Âge, auraient peut-être connu le même destin que ce qui s’était déjà produit plusieurs fois dans l’Histoire auparavant : ils se seraient essoufflés, voire auraient été étouffés par les forces réactionnaires (féodales) qu’ils menaçaient. Au mieux, le processus aurait été beaucoup plus lent — comme cela a été le cas par exemple en Chine sous les Song, les Ming et les premiers Qing, ou encore au Japon dans la période d’Edo.
[b]La colonisation européenne n’est pas parvenue à s’implanter avec les mêmes « succès », sinistres s’il en est, sur l’ensemble des continents. Sait-on pourquoi ?[/b]
Répondre à cette question revient à s’interroger sur l’état des différentes formations sociales extra-européennes au moment où elles vont être confrontées à l’expansion européenne. Car cet état détermine et l’intérêt qu’elles peuvent présenter pour les Européens, et la résistance qu’elles peuvent opposer aux entreprises européennes de colonisation. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que, dans les conditions de l’époque, une colonisation soit possible. Il faut tout d’abord que les territoires visés par les projets coloniaux soient accessibles par voies de mer ou de terre. Il faut aussi qu’ils présentent des ressources (minières ou agricoles) exploitables et valorisables sur le marché européen. Il faut encore que les populations indigènes soient exploitables, c’est-à-dire rompues à la discipline d’un travail impliquant la production d’un surproduit. Enfin, il faut que ces populations ne soient pas en état de se défendre soit par elles-mêmes soit par la « protection » des pouvoirs politiques, qui ont intérêt à ce qu’elles ne soient pas soustraites à leur propre exploitation. Or, sous ces rapports, les différentes formations extra-européennes ne se valent pas.
[b]Que voulez-vous dire par là ?[/b]
La partie la plus développée du continent américain est alors celle qui est comprise dans les deux Empires aztèques (centrés sur l’actuel Mexique) et inca (centré sur l’actuel Pérou). L’un et l’autre ont ouvert un réseau de voies de communication terrestres qui en facilitent la pénétration. L’un et l’autre recèlent de fabuleux trésors d’or et d’argent et, en deçà, les ressources minières correspondantes, sans compter une agriculture florissante. Leurs populations sont de surcroît de longue date habituées à la discipline collective d’un travail exploité, dont les Espagnols reprendront pour l’essentiel les modalités. Enfin, leur capacité de résistance est limitée, pour différentes raisons : inexistence des armes à feu, passivité des populations, de surcroît désarmées, intégration encore bien trop lâche de l’Empire aztèque et crise dynastique au sein de l’Empire inca. Tout cela explique que quelques centaines d’Espagnols aient pu s’en rendre maîtres — à chaque fois en quelques années seulement ! Ailleurs sur le continent américain, dans les Antilles ou sur les côtes de ce qui va devenir le Brésil, les conditions de la colonisation ont été beaucoup moins favorables. Aucune richesse minière (le Minas Gerais ne sera mis en exploitation qu’à la toute fin du XVIIe siècle) ; la possibilité, certes, de développer des cultures tropicales valorisables, à commencer par celle de la canne à sucre, mais trop peu de populations indigènes pour les lancer, ou des populations capables de se soustraire à la domination par la fuite, si bien que le développement de ces cultures demandera l’importation massive d’une population servile depuis les côtes africaines.
[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/1957_002_view2_o2.jpg[/img]
Extrait d’une toile d’Albert Gleizes
[b]Et l’Afrique subsaharienne, justement ?[/b]
Elle sera paradoxalement préservée de la colonisation par sa pauvreté relative. Sur ses côtes occidentale et orientale, elle n’a pas grand-chose à offrir que les Européens ne puissent acquérir par les moyens alternatifs d’un commerce souvent forcé et toujours inéquitable : quelques épices, de l’or (issu de la vallée du Niger ou du plateau zimbabwéen) et, surtout, des esclaves que les pouvoirs tribaux indigènes leur fournissent en échange de produits industriels : de la pacotille, des tissus, des barres de fer et de plomb, des armes à feu aussi, de l’alcool, etc. Soit qu’ils aient été esclavagistes avant même l’arrivée des Européens, soit qu’ils se soient lancés dans la traite négrière pour éviter d’être eux-mêmes transformés en esclaves. Quant à l’intérieur du continent, il reste impénétrable par les Européens — sauf le long de quelques fleuves (le Sénégal, le Congo et le Zambèze notamment). L’Asie continentale, par contre, offre de multiples richesses à la convoitise des Européens, à commencer par les fameuses épices. C’est d’ailleurs pour s’en emparer que Portugais et Espagnols se sont lancés dans l’aventure de l’expansion maritime. Mais les pouvoirs asiatiques (les empires et royaumes indiens, l’empire chinois Ming tout d’abord et Qing ensuite, les royaumes indochinois, mêmes les petits sultanats indonésiens, le shogunat Tokugawa dès lors qu’il aura pacifié le Japon féodal) sont bien trop puissants pour que, venus d’aussi loin, les Européens puissent songer à s’en emparer. Au moins dans un premier temps. Ceylan (Sri Lanka) et une partie de Java seront en partie colonisés à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle par les Néerlandais. Aussi, pour l’essentiel, les Européens devront-ils se contenter de s’emparer, par des moyens de force, des circuits marchands de l’Asie maritime qui s’étend alors de l’Afrique orientale jusqu’au Japon, en en chassant tout d’abord les marchands arabes, indiens, malais et chinois qui en étaient maîtres à leur arrivée, puis en se faisant la guerre entre eux pour se repartager le gâteau.
[b]L’économiste franco-égyptien Samir Amin, figure de l’altermondialisme, est récemment décédé. A-t-il nourri vos propres travaux ?[/b]
Je tiens pour majeure sa contribution à l’analyse du système capitaliste mondial, notamment en ce qui concerne les mécanismes générateurs du développement inégal et de l’échange inégal entre formations centrales et formations périphériques au sein du monde capitaliste. Cela m’a servi à analyser les rapports entre ces différentes formations dans le contexte, pourtant différent, du premier monde capitaliste, celui correspondant à la période antérieure du devenir-monde du capitalisme, sur laquelle lui-même ne s’est cependant pas directement penché.
[b]Peut-on retirer de ce premier tome un quelconque appui présent, à l’heure où, en France, rien ne semble pouvoir s’élever, massivement, contre l’hégémonie capitaliste ?[/b]
La finalité immédiate de mon ouvrage n’est pas de livrer des enseignements politiques valables[i] hic et nunc,[/i] mais de rendre compréhensible le processus historique à travers lequel le capitalisme a pris naissance. Cependant, la compréhension de ce processus fournit aussi l’occasion de s’approprier des concepts qui restent tout à fait pertinents pour la compréhension des formes actuelles de la « mondialisation ». Elle permet de relativiser la nouveauté apparente de la situation actuelle, en montrant qu’elle réédite des formes d’exploitation et de domination déjà anciennes — évitant ainsi de prendre des vessies ancestrales pour d’inédites lanternes et d’être victimes des mirages de l’ère néolibérale… La conscience de l’historicité du mode capitaliste de production permet de se convaincre que le monde capitaliste qui est le nôtre n’échappe pas plus aujourd’hui qu’hier aux contradictions fondamentales des rapports capitalistes de production qui lui servent de base. En ce sens, le néolibéralisme s’illusionne complètement en croyant en avoir fini avec les limites que le capital dresse lui-même périodiquement sur la voie de sa propre reproduction — l’épisode de la crise des subprimes, il y a 10 ans, l’a montré. Et cela n’est rien à côté des limites que sa propre ubris productiviste, son accumulation sans fin ni mesure, est en train de rendre manifestes ! Et de plus en plus effectives sous la forme de la catastrophe écologique dans laquelle il nous engage chaque jour un peu plus.
Illustrations : extraits de peintures d’Albert Gleizes (1881-1953)
1. ↑ C’est le cas par exemple des contributions réunies par Maurice Dobb et Paul Sweezy, écrites au long des années 1950-1960, comme de celles ayant pris part au fameux Brenner Debate qui a agité la revue britannique Past and Present dans la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980.[/size][/quote]
on pourra lire également [url=https://alencontre.org/societe/livres/alain-bihr-la-mondialisation-a-permis-de-donner-naissance-au-capitalisme.html][u][b]Alain Bihr: [i]« La mondialisation a permis de donner naissance au capitalisme »[/i][/b][/u][/url], [i]Alencontre[/i], 21 septembre 2018 et [url=https://www.google.fr/search?q=alain+bihr+capitalisme&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiR9dOBt5LeAhUHrxoKHasFCA4Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938][u]autres comptes-rendus[/u][/url]
Dernière édition par Patlotch le Mar 19 Jan - 12:26, édité 1 fois
 OCCIDENT et CAPITAL, COLONISATION, CIVILISATION(S)... et maintenant : DÉCOLONIAL ?
OCCIDENT et CAPITAL, COLONISATION, CIVILISATION(S)... et maintenant : DÉCOLONIAL ?
que l'Occident soit en déclin ou non n'est pas le problème
j'ai affirmé dans L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT que « le plus gros "choc" en cours n'est pas entre civilisations mais entre la civilisation capitaliste et le vivant, dernier stade de l'expansion humaine sur la terre »
c'était une allusion au livre de 1996 (français 1997)

dans mon analyse antérieure de la double crise du Capital et de l'Occident, j'ai réfuté l'idée de déclin de l'Occident (de Spengler 1918 à Houellebecq prix Spengler 2018)...) pour insister sur la crise de l'Occident en tant qu'y est né le capitalisme et qu'ils ont ensemble étendu leur suprématie sur le mondeMenacé par la puissance grandissante de l'islam et de la Chine, l'Occident parviendra-t-il à conjurer son déclin ? Saurons-nous apprendre rapidement à coexister ou bien nos différences nous pousseront-elles vers un nouveau type de conflit, plus violent que ceux que nous avons connus depuis un siècle ? Pour Samuel P. Huntington, les peuples se regroupent désormais en fonction de leurs affinités culturelles. Les frontières politiques comptent moins que les barrières religieuses, ethniques, intellectuelles. Au conflit entre les blocs idéologiques de naguère succède le choc des civilisations... Le livre qu'il faut lire pour comprendre le monde contemporain et les vraies menaces qui s'annoncent. "Le livre le plus important depuis la fin de la guerre froide." Henry Kissinger. "Un tour de force intellectuel : une oeuvre fondatrice qui va révolutionner notre vision des affaires internationales." Zbigniew Brzezinski. Samuel P. Huntington est professeur à l'Université Harvard où il dirige le John M. Olin Institute for Strategic Studies. Il a été expert auprès du Conseil national américain de sécurité, sous l'administration Carter. Il est le fondateur et l'un des directeurs de la revue Foreign Policy.
ces derniers temps, ce thème est repris, par Michel Onfray (La civilisation occidentale va mourir), Éric Zemmour (la France actuelle est "colonisée" par des "civilisations étrangères"), Philippe de Villiers (« Nous vivons peut-être la fin d'une civilisation, la nôtre »), et donc Houellebecq : « L'Occident est dans un état de déclin très avancé. »
pour ma part je considère qu'il n'y a plus de civilisation occidentale. L'extension mondiale du capitalisme en a mondialisé tous les aspects, et c'est pourquoi il est plus judicieux de parler de civilisation capitaliste. Que la résistance, réactionnaire ou "progressiste", se manifeste hors d'Occident, comme décoloniale, est un autre aspect de la question, et que l'Islam en soit rendu responsable encore un autre, celui que les auteurs cités mettent en exergue. On appréciera aussi la sortie d'Olivier Faure, chef du PS : « Il y a des endroits (...) qui donnent le sentiment que l'on est dans une forme de “colonisation à l'envers” », variante adoucie du grand remplacement
au-delà de leur caractère raciste et réactionnaire-conservateur, ces visions ont l'inconvénient d'être à courte vue. S'il y a crise, et crise mortelle pour la civilisation, pour l'humanité, c'est parce qu'elle englobe tous ses Rapports à la nature extérieure et rapports à la nature intérieure, pour le dire dans les termes de Jacques Wajnsztejn (Rapport à la nature, sexe, genre et capitalisme, 2014, p. 19-22), en quoi l'essence humaine ne saurait être seulement l'ensemble de ses rapports sociaux (Marx, Thèses sur Feuerbach)
la question posée, et nous y reviendrons avec Jacques Camatte (CAMATTE et NOUS), est donc de savoir si le capitalisme contemporain (domination réelle etc.) a englobé ou non tous ces rapports, puisqu'y répondre négativement implique que sortir de l'impasse mortelle ne porte pas seulement sur ce que le mode de production capitaliste a introduit de nouveau dans ces rapports
à cet égard parler de capitalocène est sans doute discutable, puisque la destruction de la nature par les humains n'a pas attendu le capital (exemples donnés dans L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT)
j'ai conscience de n'avoir pas été jusque-là en mesure de donner une exposition satisfaisante de cette problématique, mais une chose est certaine, que la civilisation occidentale comme telle décline ou non, je m'en fous, parce que je ne suis en rien attaché à ce qui la caractérise
Dernière édition par Patlotch le Jeu 28 Fév - 4:58, édité 1 fois
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
je n'ai pas repris, dans ce forum, la rubrique sur la colonisation et ses suites, du pré-capitalisme aux entreprises coloniales du 19e siècle, de la traite, de l'esclavage et du commerce triangulaire aux abolitions, de l'anticolonialisme aux néo-colonialisme et post-colonialisme (au sens de la FrançAfrique...), ni la grosse documentation et les débats sur le décolonial, dans le monde et en France : pourquoi ?
ce n'était pas une priorité au moment où j'ai détruit l'ancien forum, et nombres d'autres rubriques ont été englouties, dont il reste ou non ici la trace, en attente de reprise ou pas
le concept de "décolonial" n'a rien perdu pour moi de sa pertinence théorique, mais naturellement dans l'inventaire critique que j'en faisais, excessivement marginal dans les débats en France du moins, à fronts renversés contre l'essentialisme du PIR, la guerre menée à ce concept tant pas le pouvoir ("un camp décolonial réservé aux Blancs"...) et les anti-racialisateurs ou anti-racialistes dans le déni du racisme au nom de "les races n'existent pas"
l'actualité future me donnera très certainement l'occasion d'y revenir, par exemple avec
Françoise Vergès, « féminisme décolonial » et révolution permanente, Jeune Afrique, 28 janvier
mais il est un autre rapport historique à reprendre, celui du CAPITAL et de l'OCCIDENT. Voici un article signalé par l'Argentine Ana Cecilia Dinerstein, qui est la seule théoricienne, avec moi, à avoir avancé l'idée d'un MARXISME DÉCOLONIAL, raison pour laquelle nous avions entretenu quelques échanges, et Adé traduit ses textes de l'espagnol au français. Mon intérêt portait surtout sur son approche de l'UTOPIE CONCRÈTE, qu'elle reprenait à Ernst Bloch, en rapport avec mes considérations sur la SUBJECTIVATION RÉVOLUTIONNAIRE [...]Elle est l’une des figures des Ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar du 21 au 26 janvier, et s’apprête à publier un ouvrage sur le « féminisme décolonial. »
European colonisation of the Americas killed 10% of world population
and caused global cooling
La colonisation européenne des Amériques a tué 10% de la population mondiale
et provoqué un refroidissement global
The Conversation, 31 janvier 2019
Auteursand caused global cooling
La colonisation européenne des Amériques a tué 10% de la population mondiale
et provoqué un refroidissement global
The Conversation, 31 janvier 2019
Alexander Koch, PhD candidate in Physical Geography, UCL
Chris Brierley, Associate Professor of Geography, UCL
Mark Maslin, Professor of Earth System Science, UCL
Simon Lewis, Professor of Global Change Science at University of Leeds and, UCL

An artist’s impression of Columbus arriving in America by Wilhem Berrouet
Salon de la Mappemonde/Flickr, CC BY-ND
While Europe was in the early days of the Renaissance, there were empires in the Americas sustaining more than 60m people. But the first European contact in 1492 brought diseases to the Americas which devastated the native population and the resultant collapse of farming in the Americas was so significant that it may have even cooled the global climate.
The number of people living in North, Central and South America when Columbus arrived is a question that researchers have been trying to answer for decades. Unlike in Europe and China, no records on the size of indigenous societies in the Americas before 1492 are preserved. To reconstruct population numbers, researchers rely on the first accounts from European eyewitnesses and, in records from after colonial rule was established, tribute payments known as “encomiendas”. This taxation system was only established after European epidemics had ravaged the Americas, so it tells us nothing about the size of pre-colonial populations.
The coast in Cuba where Columbus arrived in 1492. Authentic Travel/Shutterstock
Early accounts by European colonists are likely to have overestimated settlement sizes and population to advertise the riches of their newly discovered lands to their feudal sponsors in Europe. But by rejecting these claims and focusing on colonial records instead, extremely low population estimates were published in the early 20th century which counted the population after disease had ravaged it.
On the other hand, liberal assumptions on, for example, the proportion of the indigenous population that was required to pay tributes or the rates at which people had died led to extraordinarily high estimates.
Our new study clarifies the size of pre-Columbian populations and their impact on their environment. By combining all published estimates from populations throughout the Americas, we find a probable indigenous population of 60m in 1492. For comparison, Europe’s population at the time was 70-88m spread over less than half the area.
The Great Dying
The large pre-Columbian population sustained itself through farming – there is extensive archaeological evidence for slash-and-burn agriculture, terraced fields, large earthen mounds and home gardens.
By knowing how much agricultural land is required to sustain one person, population numbers can be translated from the area known to be under human land use. We found that 62m hectares of land, or about 10% of the landmass of the Americas, had been farmed or under another human use when Columbus arrived. For comparison, in Europe 23% and in China 20% of land had been used by humans at the time.
This changed in the decades after Europeans first set foot on the island of Hispaniola in 1497 – now Haiti and the Dominican Republic – and the mainland in 1517. Europeans brought measles, smallpox, influenza and the bubonic plague across the Atlantic, with devastating consequences for the indigenous populations.
Incan agricultural terraces in Peru. Alessandro Vecchi/Shutterstock
Our new data-driven best estimate is a death toll of 56m by the beginning of the 1600s – 90% of the pre-Columbian indigenous population and around 10% of the global population at the time. This makes the “Great Dying” the largest human mortality event in proportion to the global population, putting it second in absolute terms only to World War II, in which 80m people died – 3% of the world’s population at the time.
A figure of 90% mortality in post-contact America is extraordinary and exceeds similar epidemics, including the Black Death in Europe – which resulted in a 30% population loss in Europe. One explanation is that multiple waves of epidemics hit indigenous immune systems that had evolved in isolation from Eurasian and African populations for 13,000 years.
Native Americas at that time had never been in contact with the pathogens the colonists brought, creating so-called “virgin soil” epidemics. People who didn’t die from smallpox, died from the following wave of influenza. Those who survived that succumbed to measles. Warfare, famine and colonial atrocities did the rest in the Great Dying.
Global consequences
This human tragedy meant that there was simply not enough workers left to manage the fields and forests. Without human intervention, previously managed landscapes returned to their natural states, thereby absorbing carbon from the atmosphere. The extent of this regrowth of the natural habitat was so vast that it removed enough CO₂ to cool the planet.
The lower temperatures prompted feedbacks in the carbon cycle which eliminated even more CO₂ from the atmosphere – such as less CO₂ being released from the soil. This explains the drop in CO₂ at 1610 seen in Antarctic ice cores, solving an enigma of why the whole planet cooled briefly in the 1600s. During this period, severe winters and cold summers caused famines and rebellions from Europe to Japan.
Global temperatures dipped at the same time as the Great Dying in the Americas.
Robert A. Rohde/Wikipedia, CC BY-SA
The modern world began with a catastrophe of near-unimaginable proportions. Yet it is the first time the Americas were linked to the rest of the world, marking the beginning of a new era.
We now know more about the scale of pre-European American populations and the Great Dying that erased so many of them. Human actions at that time caused a drop in atmospheric CO₂ that cooled the planet long before human civilisation was concerned with the idea of climate change.
Such a dramatic event would not contribute much to easing the rate of modern global warming, however. The unprecedented reforestation event in the Americas led to a reduction of 5 parts per million CO₂ from the atmosphere – only about three years’ worth of fossil fuel emissions today.
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
sans commentaire pour l'heure
L’écologie aussi connaît un tournant décolonial. Les travaux – inédits en français – de l’anthropologue Arturo Escobar montrent comment les luttes des indigènes et les mouvements de libération en Amérique latine apprennent à lutter de façon réaliste contre le néolibéralisme, et à favoriser un usage responsable des ressources.
Pour une écologie décoloniale
À propos de :

Claire Gallien, La vie des idées / Collège de France, le 11 février
À propos de :

Claire Gallien, La vie des idées / Collège de France, le 11 février
L’écologie aussi connaît un tournant décolonial. Les travaux – inédits en français – de l’anthropologue Arturo Escobar montrent comment les luttes des indigènes et les mouvements de libération en Amérique latine apprennent à lutter de façon réaliste contre le néolibéralisme, et à favoriser un usage responsable des ressources.
La publication de Sentir-penser avec la terre. L’écologie au-delà de l’Occident rend disponible en français une partie du travail de l’anthropologue sud-américain Arturo Escobar. Elle marque un moment important dans l’acclimatation en France de la pensée décoloniale, encore largement inconnue et caricaturée. À partir du concept de « Sentir-penser » (néologisme formé à partir des termes sentirpensar ou sentipensar), l’auteur bouscule le cadre épistémologique occidental fondé sur une séparation entre sentir et penser, corps et esprit, objet perçu et sujet pensant. Par contraste avec cette « ontologie binaire » qui fonde les régimes de modernité et de colonialité (souvenons-nous de la Controverse de Valladolid et autres débats à sens unique sur la prétendue absence d’âme des Indiens ou des Noirs), Escobar théorise, notamment à partir des luttes indigènes en Colombie – dont il est originaire – une « ontologie relationnelle » où la pensée n’existe que de façon incorporée et genrée, c’est-à-dire située dans des corps, pensant à partir d’eux et agissant sur eux. Le sujet humain ne surplombe pas un monde d’objets non-humains ou de sujets considérés comme des objets non-humains exploitables. La pensée relationnelle récuse la distinction ontologique entre le moi et les autres, le sujet et son « environnement ». Elle invite à repenser le sujet à partir de ses interactions, et le monde à partir du « plurivers », c’est-à-dire un agencement (ou « design », pour reprendre un autre concept clé d’Escobar) de mondes, chacun engagé dans un processus distinct, relationnel et situé de « faire monde ».
L’autre terre de la pensée décoloniale
Au moins deux raisons d’ordre structurel expliquent sans doute que le travail de ce penseur majeur du tournant décolonial demeure largement inconnu du public français. D’une part, Escobar enseigne à l’université de North Carolina. Le champ académique états-unien a en effet permis, en parallèle avec les études postcoloniales, largement portées par des chercheurs en lien avec l’Asie du Sud et les Caraïbes, et avec les études ethniques (Native American, Black, Chicano and Chicana studies), l’émergence d’un champ décolonial, plus largement représenté par des chercheur.e.s d’origine sud-américaine. Ainsi, les publications d’Escobar font partie d’une constellation décoloniale nord-américaine portée entre autres par Nelson Maldonado-Torres (Rutgers), Walter Mignolo (Duke), et Ramón Grosfoguel (Berkeley).
Arturo Escobar. Sentir-penser avec la Terre. L’écologie au-delà de l’Occident, Paris, Le Seuil, « Anthropocène », 2018, 13, 99 €
D’autre part, en France, le mouvement décolonial est largement identifié aux collectifs de militant.e.s dont les familles sont issu.e.s de l’immigration, et souvent restreint au Parti des Indigènes de la République (PIR), mouvement né en 2005 dans le contexte des émeutes des banlieues, afin de porter un message anti-impérialiste et de lutte contre les discriminations raciales et religieuses en France et de s’attaquer aux survivances du régime de colonialité. Le PIR est régulièrement accusé d’islamo-gauchisme, d’antisémitisme, de racisme (inversé), ou encore d’homophobie et d’anti-féminisme par les tenant.e.s du féminisme laïc français. Ces luttes politiques se situent largement hors du champ académique. Même si les travaux de certain.e.s chercheur.e.s en sociologie s’en réclament ou entrent en résonance avec le programme décolonial du mouvement, comme Nacira Guénif, Éric Macé, Elsa Dorlin, Éric Fassin, Sonya Dayan-Herzbrun, ils ne sont soutenus dans leurs luttes par aucun laboratoire ou programme de recherche. Le Master Euro-Philosophie porté par les universités de Toulouse 2 Jean Jaurès et Louvain en Belgique, financé par le programme ERASMUS + de l’Union Européenne, et à l’origine d’un séminaire d’études décoloniales et d’une université d’été, ou encore le Réseau d’Études Décoloniales, qui se fait l’écho à partir du Nord global des pensées du Sud global se situent par exemple en périphérie de l’institution, ou du moins en marge de la reconnaissance institutionnelle nationale. Dans ce contexte pour le moins tendu, on comprend pourquoi la recherche française n’a pas encore réellement fait son tournant décolonial.
La traduction, lien commun
Sentir-penser est traduit par Anne-Laure Bonvalot, Roberto Andrade Pérez, Ella Bordai, Claude Bourguignon, et Philippe Colin, membres de l’Atelier La Minga, pôle traduction du Réseau d’Études Décoloniales. Il se présente comme un collectif et insiste sur ce mode de travail, car traduire en commun est une intervention concrète visant le dépassement des logiques individualistes inculquées par l’idéologie néolibérale : « Le terme espagnol minga qui vient du quechua minka, désigne un travail collectif d’utilité sociale en vue du bien commun et prend donc à rebours la ‘modernité occidentale’ basée sur l’individualisme, la compétition, et la domination » (21). Ainsi traduire en commun et en tension) permet de revenir et de développer la théorie – en l’occurrence les études décoloniales. On pourrait dire que la méthode employée par le collectif s’inspire d’Escobar, pour qui la théorie ne peut émerger que de la praxis et du terrain, et pour qui la recherche ne peut être qu’engagement des corps et des esprits à la fois.
Il s’agit de traduire Escobar pour repenser les luttes au Nord en général, et en France en particulier, c’est-à-dire non pas juste traduire et comprendre des pensées venues d’ailleurs, comme le voudrait une approche anthropologique classique, mais montrer en quoi la séparation entre un ici et un ailleurs est une construction de la modernité coloniale prise dans des logiques extractivistes et de domination. Au contraire, le texte d’Escobar est remanié par endroits avec le soutien de l’auteur afin de créer du lien, de l’interrelation, avec des luttes locales situées au Nord. On trouve, par exemple, des références aux ZAD et à Notre-Dame-des-Landes en particulier, aux luttes contre la construction d’aéroports ou l’ouverture de site de déchets nucléaires, et une critique de ce que l’on nomme en France les « grands projets utiles ». À ces références s’ajoute un paratexte (notes, préface, postface) permettant de resituer Escobar dans le contexte intellectuel et militant français. Anna Bednik, journaliste, activiste et auteur d’Extractivisme (2016) relit en postface les mobilisations à Notre-Dame-des-Landes à partir d’Escobar.
Les traducteurs ne sont pas sans reconnaître la contradiction d’une approche cibliste : « Exercice de refabulation, en tant qu’elle propose de faire passer ailleurs en les reformulant les formes d’un savoir situé, la traduction court nécessairement le risque de devoir reconduire tacitement une hégémonie et un ethnocentrisme auxquels la lettre du texte prétend précisément s’attaquer » (19). Mais elles et ils y répondent de manière très convaincante, c’est-à-dire en déstabilisant leur propre pratique. L’exercice de traduction collective imposée permet de remettre en cause ou sous tension la notion d’autorité, implique des aménagements, des adaptations, des reformulations, donc permet de faire l’expérience d’une traduction non-autoritaire et qui ne prend pas l’autorisation comme postulat de départ. Le travail collaboratif rend aussi visible le bagage social et culturel de chacun des traducteurs et traductrices dans sa manière d’aborder, de lire et de traduire un texte, et donc permet en quelque sorte de combattre l’invisibilisation des rapports de domination inscrits dans la langue pour celles et ceux qui la pratiquent.
Déconstruire l’idéologie du développement
Une préface très informée resitue le travail d’Escobar dans le tournant ontologique qui a marqué l’anthropologie du début du XXIe siècle avec, nous le rappellent les auteur.e.s, Tim Ingold, Eduardo Viveiros de Castro, Barbara Glowczewski, Mario Blaser, Marisol de la Cadena et, en France, Philippe Descola. Le tournant anthropologique vise une remise en cause profonde du dualisme nature/culture proposée à partir des pensées indigènes. Escobar s’engage quant à lui dans une critique féroce de l’ontologie dualiste moderne occidentale et du régime de domination et d’exploitation du monde qu’il implique (colonisation, extractivisme, monoculture). Comme le rappellent les auteur.e.s de la préface, Escobar est d’abord connu comme analyste du « développement ». Loin d’être neutre ou bénéfique, cette notion, tout comme celle de « progrès », impose aux pays « sous-développés » ou « émergents » une entrée forcée dans le marché néolibéral, creuse les écarts de richesse, déstabilise des tissus sociaux et écologiques.
En tant qu’anthropologue et porteur d’une critique radicale du projet développementiste, son travail entre en résonance avec d’autres penseurs décoloniaux qui pointent du doigt le régime de colonialité opérant depuis 1492 et la conquête « ininterrompue » en Amérique du Sud (Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Bolivar Echevarria), et proposent une sortie de l’hégémonie épistémologique occidentale à partir des « épistémologies du Sud » (Buoventura de Sousa Santos). Ces chercheurs ne travaillent pas sur des mondes mais avec ou à partir de ces mondes, l’idée étant non seulement d’exposer et faire connaître des modalités alternatives d’habiter (non pas des modernités alternatives mais des alternatives à la modernité, comme le rappellent les auteur.e.s de la préface) et de se saisir de ces luttes au Nord, dans l’idée d’une possible convergence internationale. En parallèle à cette critique, Escobar élabore une étude des « ontologies relationnelles » forgée à partir de ses observations de terrain et s’engage, notamment en mettant au jour les luttes des communautés noires du Pacifique sud-colombien (le PCN), dans une « théorie/praxis » décoloniale, point de départ pour une reconnaissance du pluriversel, pour la dénaturalisation de la conception « unimondiste » du monde, et pour la mise en place de rapports symétriques entre mondes.
Ainsi, l’ouvrage nous permet de saisir le cheminement de la pensée escobarienne de la critique du « développement » à l’ouverture décoloniale. L’introduction, tout d’abord, lui permet de définir ses concepts, à commencer par celui d’« ontologie politique » qui « cherche à mettre en lumière à la fois la dimension politique de l’ontologie et la dimension ontologique de la politique ». Elle permet d’appréhender le fait que « tout ensemble de pratiques instaure nécessairement un monde » et consiste à se demander quel type de monde s’instaure, à partir de quelles pratiques, et comment sortir d’un monde pour entrer dans un autre, ou ce qu’Escobar appelle faire « transition » afin de sortir de situations de crises écologiques et sociales. En introduction, il précise également que le concept de « sentipensée » a d’abord été élaboré par Orlando Fals Borda en 1986 à propos des communautés de la côte atlantique colombienne. On retrouve ce concept dans l’expérience zapatiste de « raisonner avec le cœur ». Sentir-penser correspond à un mode d’être avec les territoires qui impliquent simultanément le corps et l’esprit.
L’ouvrage offre une lecture historique des phases de « développement » et « post-développement » telles qu’elles ont pu être subies par les sociétés sud-américaines, et en particulier colombienne qu’Escobar a étudiée dans La invención del tercer mundo. Consctrucción y deconstrucción del desarollo (1988, traduit en anglais en 1995 sous le titre de Encountering Development ? The Making and Unmaking of the Third World). Il élabore une généalogie du discours développementiste et note sa persistance malgré le constat de son échec. Escobar rapporte en dernier lieu les approches critiques au développementisme en Amérique du Sud depuis les années 1950-60 : CEPAL, théorie de la dépendance, théologie de la libération, recherche-action participative, éducation populaire (Paulo Freire, Fals Borda), et alternatives épistémiques proposées par Alberto Acosta (Buen Vivir), Eduardo Gudynas (alternatives au développement) et Maristella Svampa (combat socio-environnementaux).
Escobar propose également cinq pistes de sortie du « développement » et de la « modernité occidentale » imposés par la globalisation néolibérale :
(1) le programme de décolonisation épistémique (autour de Modernité/Colonialité/Décolonialité et d’auteurs comme Quijano, Mignolo, Dussel, Catherine Walsh, Edgardo Lander) ;
(2) les alternatives au « développement » (Gudynas, Acosta, aussi Mario Blaser dans Storytelling Globalization) ;
(3) les transitions postextractivistes ;
(4) les modèles subalternistes, visant à démystifier la modernité sans pour autant remythifier les traditions (Ashis Nandy, Bonfil Batalla, le Colectivo Situaciones et Raúl Zibechi) ;
(5) les différents modèles de « commun ». Escobar s’inspire notamment des expériences communales étudiées par Félix Patsi en Bolivie, de la notion de « maillage » communal (Raquel Gutiérrez), des travaux de Pablo Mamani, au sujet notamment du caractère désinstituant des luttes, de Gustavo Esteva et ses recherches sur les mouvements autonomes au Chiapas et à Oaxaca.
La question du commun permet également d’aborder les questions de « féminisme communautaire », « dépatriarcalisation », et « relationalité », fondée sur l’idée fondamentale selon laquelle il n’existe pas d’entité préexistante à la relation, l’entité se constituant dans la relation et donc demeurant en situation d’ouverture. Ces ontologies relationnelles, qu’on les retrouve en milieu rural ou urbain, ont une forte dimension territoriale.
En s’intéressant en particulier aux luttes menées par les communautés des territoires ancestraux de Yurumangui, Curvaradó, et La Toma, Escobar met au jour d’une part l’accaparement sauvage des terres par les multinationales spécialisées dans les monocultures destinées à l’exportation ou l’extraction minière, les déplacements et massacres de populations prises dans l’étau des groupes paramilitaires et militaires, et démontre comment un nouveau rapport à la terre, une nouvelle géo-graphie, permet à des communautés humaines de ré-exister avec les territoires et non sur les terres. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le mot d’ordre des afro-descendants : « Nous ne voulons pas une terre, nous voulons un territoire » (100). Par le biais de l’ancestralité, elles créent des mécanismes pour que soit reconnue la propriété collective et pour que soit défini un usage responsable et durable des terres et des ressources. Il s’agit d’investir dans une forme d’« utopie réaliste », c’est-à-dire un mode d’être radicalement différent du modèle néolibéral et en même temps hautement réaliste puisque les démarches écologistes et de mise en commun sont les seules à permettre survie et développement du territoire et des communautés qui l’habitent. Escobar convoque ici le Processus des communautés noires (PCN), le mouvement zapatiste, et aussi les travaux de géographes comme Chico Mendes ou Carlos Porto-Gonçalves inspirés de ces luttes.
Escobar s’inspire des travaux de Mario Blaser pour une redéfinition politique de l’ontologie qui serait l’étude de la manière dont des entités entrent dans des processus intersubjectifs de négociations par rapport au pouvoir afin de se construire en tant qu’identités et monde. De fait, l’ontologie politique relationnelle ouvre sur le pluriversel, la reconnaissance des « droits au territoire » et répond efficacement aux crises environnementales. Escobar revient sur le soulèvement zapatiste mais aussi sur certaines expériences de peuples du Pacifique Sud pour exposer les pratiques permettant de créer des mondes relationnels où la distinction nature/culture est désignée comme politique et non comme allant de soi, et où pratiques et cosmovisions permettent de la dépasser. Escobar se sert des travaux de Tim Ingold dans The Perceptions of the Environment (2000) pour distinguer l’ontologie « dualiste », relevant de la modernité séculaire, capitaliste, et libérale, de l’ontologie « relationnelle ». Le piège serait de croire en la domination parfaite de la modernité, alors même que des autres mondes résistent et se déploient à travers des pratiques (Escobar convoque ici la théorie de l’énaction ou « embodied mind » de Francisco Varela), et qu’il incombe au chercheur de radiographier ces mondes ne serait-ce que pour les faire connaître au-delà. Il s’agit de déconstruire le mythe de l’universel moderne et de prendre acte de l’existence du pluriversel. Les études pluriverselles entendent rendre visibles les autres manières de connaitre et de ré-exister au sens où les communautés ne font pas que lutter contre les spoliations mais élaborent d’autres modèles de vie. C’est ce que vise plus globalement la décolonisation épistémique.
Enfin, Escobar s’attache à définir le nouveau domaine de recherche des « transitions » (qui prend de multiples directions : postextractivisme, alternatives au développement, comme le Buen Vivir, droit de la nature) et à préciser la notion de « design », lequel consiste à concevoir les manières de préserver le pluriversel et la symétrie des rapports entre mondes sans pour autant envisager ces mondes comme des isolats et à réinventer la globalisation comme « stratégie de préservation et de promotion du plurivers » (155). Dire et vivre le plurivers ne revient pas à cultiver l’entre-soi, mais au contraire à créer du commun et des liens de solidarité globale. Ainsi, les études de la transition permettent de créer des passerelles entre luttes d’ici et d’ailleurs qui ne s’élaborent pas forcément dans les mêmes termes, car dépendants d’un milieu, mais visent les mêmes objectifs : entrer dans l’ère de la post-croissance au Nord global et du post-développement dans le Sud global.
Comment agencer les mondes ?
Si la pensée d’Escobar permet de faire de la convergence des luttes pour le plurivers antilibéral et écologique une évidence, il semble plus difficile de s’accorder sur la question des points d’agencement de ce plurivers. En effet, à moins d’une sortie immédiate du régime moderne-colonial-libéral, on voit mal comment les mondes cohabiteraient en symétrie. À moins que la symétrie et le plurivers demeurent chez Escobar des horizons plus que des points de départ. Si les cosmovisions pluriverselles sont déjà à l’œuvre chez les communautés étudiées par Escobar, il semble que l’auteur passe sous silence la question de l’agencement entre mondes. Le design escobarien fait le pari de la cohabitation des mondes, mais réfléchit trop peu à la question des points de friction. Il y a une raison théorique à ceci – Escobar n’envisage jamais l’entité comme un pré-construit et les mondes comme des isolats. Au contraire, il indique que les mondes, comme les territoires, ont des frontières non-fixes, poreuses, qui sont en constante redéfinition et mutation en fonction de la manière dont les communautés les habitent et se les approprient. C’est dans la relation que s’esquissent les contours mouvants des communautés. Malgré cela, le maintien du régime de colonialité/modernité, de même que la tension entre le local et le global, la composition in situ des mondes et leur tendance, capacité, besoin d’expansion, demeurent à ce stade des questions laissées en suspens.
Vu d’ici
Puisque la démarche éditoriale est celle d’un ré-ancrage d’Escobar en terrain français, j’aimerais indiquer en conclusion à quel point il permet de repenser, à partir du Sud global, le rôle de l’éducation et de la recherche aujourd’hui en France. Escobar refuse toute position de surplomb et revendique une participation pleine au processus de sortie d’une pensée unique et consensuelle. La recherche n’est pas abstraite. Elle est située – c’est-à-dire portée par des marqueurs sociaux, raciaux, genrés… – et il est fondamental de reconnaître ces situations d’énonciation afin de mesurer les enjeux de pouvoir, de domination, et d’invisibilisation. L’éducation et la recherche ne fonctionnent pas en vase clos et l’Université n’est pas emmurée. Elle est recherche-action, participative et indisciplinée, ou bien faudra-t-il accepter de la réduire à une fonction de reproduction et renforcement des inégalités et discriminations. Escobar rappelle avec force : « la production de savoir passe par l’’engagement intense’ en situation et vis-à-vis de la communauté » (86). Par « engagement intense », il n’entend pas fournir aux communautés des outils de pensée, mais indique que la pensée émerge de la lutte et que le travail académique se nourrit de ces cosmovisions. Par exemple, ce sont les cosmovisions des afro-descendants colombiens qui permettent à la recherche d’opérer une redéfinition de la notion de territoire et de sortir d’une définition unique héritée de la modernité. Ici, le « territoire » ne renvoie pas à la propriété mais à l’appropriation effective par le biais de pratiques culturelles, agricoles, écologiques.
Escobar écrit : « la globalisation néolibérale est une guerre menée contre les mondes relationnels – attaque toujours recommencée contre tout ce qui est collectif et une tentative de plus en plus musclée de consolider l’univers reposant sur le maillage ontologique individu-marché » (83). En dehors du champ universitaire strict, et en contexte de privatisation violente des espaces communs et services publics, il semble urgent non seulement de lire ces propos, mais de se les approprier pour les convertir en moteur de résistance.
Pour citer cet article :
Claire Gallien, « Pour une écologie décoloniale », La Vie des idées , 11 février 2019. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-ecologie-decoloniale.html
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
LES AÏNOUS, C'EST NOUS
Japan to recognize indigenous Ainu people for first time
Toshifumi Kitamura JapanToday 04:07 pm JST
The Japanese government introduced a bill Friday to recognize the country's ethnic Ainu minority as an "indigenous" people for the first time, after decades of discrimination against the group.

The Ainu people -- many of whom live in northern Hokkaido -- have long suffered the effects of a policy of forced assimilation, and while discrimination has receded gradually, income and education gaps with the rest of Japan persist.
"It is important to protect the honor and dignity of the Ainu people and to hand those down to the next generation to realize a vibrant society with diverse values," top government spokesman Yoshihide Suga told reporters. "Today we made a cabinet decision on a bill to proceed with policies to preserve the Ainu people's pride."
The bill is the first to recognize the Ainu as "indigenous people" and calls for the government to make "forward-looking policies", including measures to support communities and boost local economies and tourism.
The Ainu have long suffered oppression and exploitation, and the modern Japanese government in the late 19th century banned them from practising their customs and using their language.
The Ainu traditionally observed an animist faith, with men wearing full beards and women adorning themselves with facial tattoos before marriage. But like many indigenous people around the world, most of Japan's Ainu have lost touch with their traditional lifestyle after decades of forced assimilation policies.
The Ainu population is estimated to be at least 12,300, according to a 2017 survey, but the real figure is unknown as many have integrated into mainstream society and some have hidden their cultural roots.
"It is the first step for ensuring equality under the law," Mikiko Maruko, who represents a group of Ainu people in eastern Japan near Tokyo, told AFP.
"There are lots of things to be done, for example, creating a scholarship for families who struggle to send their children to high schools," she added, a system currently only available to Ainu in Hokkaido.
Under the new plan, the government will also allow the Ainu to cut down trees in nationally-owned forests for use in traditional rituals.
"It is a major step forward on policies toward the Ainu people," said Masashi Nagaura, chief of the Ainu policy bureau of the Hokkaido prefectural government that has spearheaded policies for the ethnic minority.2019 AFP
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
la dernière mouture du précédent forum s'intitulait CHANGEMENT DE CIVILISATION, signifiant une continuation de l'histoire longue qui en a vu la succession, leurs apogées et leurs effondrements et remplacements par d'autres, et plus ou moins unifiée par le mode de production capitaliste dans sa dernière phase (en date), la subsomption réelle ou domination de tous les rapports sociaux et sociétaux
plusieurs devenir civilisationnels sont possibles, et certainement pas un seul, entre chaos et révolution prolétarienne universelle comme le soutiennent les dogmes fossilisés du "marxisme" comme celui de la "théorie" de la communisation
ce texte est à cent lieues de mes convictions, mais comme c'est dans l'air...
Sommes-nous à l'ère de la «dé-civilisation» ?
Etienne Campion Le Figaro 22/02/2019
Etienne Campion Le Figaro 22/02/2019
L'historien Hamit Bozarslan publie "Crise, violence et dé-civilisation. Essai sur les angles morts de la cité" (CNRS, 2019). Il analyse l'histoire du monde et interroge son avenir à l'aune de la violence et des crises, angle mort de la recherche scientifique.
Hamit Bozarslan est historien et maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Spécialiste de la Turquie et de la question kurde, il est l'auteur, notamment, de Crise, Révolution et état de violence. Moyen-Orient 2011-2015 (CNRS, 2015), Histoire de la Turquie. De l'Empire à nos jours (Tallandier, 2013), Une histoire de la violence au Moyen-Orient. De la fin de l'Empire ottoman à al-Qaida (La Découverte, 2008). Il publie en ce début d'année Crise, violence et dé-civilisation. Essai sur les angles morts de la cité (CNRS, 2019).

Le Cours de l'Empire : destruction, par Thomas Cole, 1836
FIGAROVOX.- Vous évoquez dans vos travaux un processus de «dé-civilisation», mais, d'abord, que dire à propos du terme «civilisation» au XXIe siècle ?
Hamit BOZARSLAN.- De Thucydide à Norbert Elias et Sigmund Freud, en passant par Ibn Khaldûn (penseur maghrébin du 14ème siècle) et les Lumières, la définition de la civilisation n'a pas changé: la civilisation est la confiance dans le temps et dans l'espace, dans le fait qu'on puisse porter un regard réflexif sur le passé, maîtriser le présent et se projeter dans l'avenir, se mouvoir dans l'espace sans le craindre et sans le brutaliser. La civilisation est la capacité d'exister en tant que particulier, individuel ou collectif, mais aussi se penser comme universel. Elle est aisance, mais cette aisance se paye: il faut accepter la dépendance d'autrui, la pacification et l'«adoucissement des mœurs» qui exigent la soumission à un ordre et aux conduites et normes qu'il impose, la restriction de ses propres libertés, le renoncement au pouvoir de ses muscles. Il faut sans doute partir de la dé-civilisation pour comprendre (et mieux apprécier) ce que signifie la civilisation: en Syrie de 2012-2013 quelque 1200 milices fragmentaient le temps et l'espace collectifs et pouvaient agir en toute liberté pour accéder à des ressources militaires et partant économiques et humaines. Mais le prix payé pour cette liberté était la destruction de la vie, d'autrui, mais aussi la sienne, et le règne de la mort. Il en va de même de l'anti-démocratie. Il est extrêmement difficile de définir ce qu'est la démocratie, mais un court détour par la Chine, l'Iran, la Turquie ou la Russie des années 2000-2010 permet aisément de comprendre ce que signifie son absence.
Les tragédies qui ont ponctué l'histoire des deux derniers siècles ne s'expliquent pas par les Lumières, mais bien par l'abandon de leur potentiel critique, par le passage à un régime de « certitude ».
On s'interroge souvent sur le rôle des Lumières quant au processus historique de radicalisation et de rationalisation. Quelles sont leurs influences réelles ?
Bien sûr, les Lumières ont donné lieu à des multiples interprétations et je reconnais bien volontiers leurs limites et leur potentiel de déclencher des processus de radicalisation par leur simple diffusion dans des contextes qui leur sont postérieurs ou extérieurs. Mais on ne peut jamais établir un lien de causalité entre les Lumières et les tragédies des XIXe et XXe siècles, pas plus qu'on ne peut expliquer le régime des Khmers rouges par Le Capital de Marx, qui fut avant tout un humaniste. Les Lumières étaient pour Kant la capacité de sortir de sa condition de mineur pour accéder à la «majorité». Ce nouveau statut garantit la liberté, mais la conjugue aussitôt à la responsabilité. Les Lumières, c'est la capacité de critiquer le monde tel qu'il est donné, mais aussi de se maintenir dans une posture critique, s'exposer soi-même à la critique, se penser dans la pluralité et dans la complexité. Les tragédies qui ont ponctué l'histoire des deux derniers siècles ne s'expliquent pas par les Lumières, mais bien par l'abandon de leur potentiel critique, par le passage à un régime de «certitude», de classe, de race, ou de Raison créatrice, par la quête chiliastique qui voulait détruire ce que le Chronos avait institué par la simple volonté de Kairos. Limitions-nous à un seul exemple: le jeune démographe nazi Peter-Heinz Seraphim estimait que la guerre lui offrait la possibilité et le droit de corriger les «erreurs» démographiques du dernier millénaire en Europe en éliminant des millions d'Européens.
L'individualisme libéral est-il le produit de ce processus de dé-civilisation, ou bien son origine?
Je suis étonné, voire choqué, d'observer qu'on associe facilement le terme de «libéralisme» au «néolibéralisme» des Chicago Boys ou de Thatcher («la société n'existe pas»), ou au capitalisme sanguinaire de Pinochet. Je ne me définirai pas comme «individualiste» ou «libéral», mais je ferai une nette distinction entre le libéralisme et la dé-civilisation. Comme Ernest Bloch, Ernest Cassirer, Norbert Elias, ou Hannah Arendt l'ont remarquablement bien saisi, la dé-civilisation des années 1930-1940 consistait à détruire l'individu pour la fondre dans la «masse». Sans mémoire, sans réseau, sans tissu social, sans faculté cognitive, ce qui restait de l'individu était obligé de se «massifier», hurler avec les loups pour ne pas être dévoré par eux. Le nazisme, le stalinisme, le khomeynisme, le djihadisme actuel, est la conversion de ce processus de massification en ressource ultime du pouvoir.
La théorie du complot est relativement facile à analyser du point de vue des sciences sociales : il faut répondre à la perte des repères, mettre le « monde en sens » et trouver l'intrigue aux origines occultes, aux voies sinueuses...
Vous interrogez longuement la rationalité des individus: les êtres humains sont-ils rationnels ?
Je dirai que nous sommes gouvernés par nos intérêts, ce qui devrait en principe nous qualifier pour être rationnels, et par nos passions, qui ont toujours une dimension pulsionnelle. Mais on se constitue en cité, à savoir en communauté plurielle et complexe de citoyens, précisément pour défendre nos intérêts contradictoires tout en laissant une place à l'épanouissement de nos passions. L'histoire nous montre cependant que cet équilibre est fragile et peut s'effondrer, la société devenir morne dans sa rationalité routinière, sans imagination et sans horizon, ou se saborder par ses passions destructrices comme lors de la Guerre de Péloponnèse ou la Première Guerre mondiale. D'où la nécessité de refuser le fatalisme pour permettre aux générations successives d'inventer leurs mondes, mais aussi d'introduire la notion de la responsabilité, individuelle et collective, comme correctrice de nos passions.
La théorie du complot peut-elle être comprise à l'aune de ces processus que vous décrivez ?
La théorie du complot est relativement facile à analyser du point de vue des sciences sociales: il faut répondre à la perte des repères, mettre le «monde en sens» et trouver l'intrigue aux origines occultes, aux voies sinueuses, aux desseins maléfiques qui nous explique ce qui se passe. La machination en cours est suffisamment bien rodée pour se faire énigme, mais pas assez puisqu'elle laisse quelques traces qui conduisent à elle et permettent de la mettre à nu à… «minuit moins cinq». C'est parce que nous sommes tous intrigués par cette fabrique à intrigues que nous nous jetons sur les Dan Brown et les Daniel Easterman.
Mais la cité démocratique ne peut s'arrêter sur ce constat qui est, comme je l'ai dit, facile à établir. Du génocide des Arméniens à celui des Tutsis en passant par la Shoah, de la terreur stalinienne aux purges et procès hallucinants de la Turquie d'Erdogan en passant par le maccarthysme, il n'y a pas une seule phase funeste de l'histoire humaine qui n'ait pas puisé dans la théorie du complot. Comme l'avait saisi l'épistémologue Karl Popper, les pouvoirs qui s'épuisent à défaire des complots qui les viseraient, finissent eux-mêmes par devenir de vastes machinations de complot.
Un dernier exemple, de 2019, montre que la théorie du complot est une menace pour la démocratie, mais aussi pour la construction européenne: les courants anti-européens allemand et français, qui s'entendent par ailleurs parfaitement, peuvent accuser Macron d'avoir «vendu Alsace-Lorraine» à l'Allemagne ou, inversement, calomnier Merkel d'avoir imposé la domination française sur le Ruhr comme… en 1923.
Les pouvoirs publics, mais aussi l'action citoyenne doivent intervenir pour contrer ces théories, qui trouvent leur force avant dans leur capacité à détruire la rationalité elle-même.
À regarder la production cinématographique, on a l'impression que le rêve a pénétré l'industrie autant que l'industrie a pénétré le rêve, il s'est fait résistance, par l'industrie, mais souvent aussi contre elle.
Vous rappelez à quel point Sainte-Beuve déplorait que «l'industrie pénètre le rêve» et citez la pensée d'Adorno et d'Horkeimer sur l'«industrie culturelle». Est-ce une bonne grille d'analyse de la crise actuelle ?
Sainte-Beuve et le couple Adorno-Horkheimer s'expriment avec un siècle d'écart et dans des conditions qui sont radicalement différentes. Il est cependant frappant de voir la peur d'un monde sans culture et par conséquent vide de sens qui les habite. Je les cite, certes avec admiration et empathie, mais aussi pour m'en démarquer, pour suggérer que l'histoire n'est pas close, que la civilisation ne se réduit pas à sa technicité, et que la culture n'est pas morte. Sainte-Beuve concluait sa phrase par un constat mélancolique: «la librairie se meurt!» Or, deux siècles après, dans le tout petit périmètre où j'habite il y a trois libraires absolument magnifiques avec des libraires très raffinés. À regarder la production cinématographique dans la pluralité de ses langues et ses langages artistiques, on a l'impression que le rêve a pénétré l'industrie autant que l'industrie a pénétré le rêve, il s'est fait résistance, par l'industrie, mais souvent aussi contre elle. Il est peut-être temps qu'on mise sur la vie plutôt que sur l'épuisement de nos ressorts.
Comment analysez-vous le phénomène des Gilets jaunes ?
Comme beaucoup d'observateurs, je suis également effaré par ce qui s'exprime aux marges du mouvement des Gilets jaunes. Hélas, les vérités profondes d'une société se manifestent plus souvent dans ses marges que dans son cœur ouvert. Les Gilets jaunes sont un catalyseur de la tension entre la passion d'égalité et la passion de liberté, que Tocqueville saisissait en son temps: la démocratie ne peut être prospère qu'à condition que ces deux passions se maintiennent en tant que passions, mais trouvent aussi des réponses concrètes. Malgré leurs nombreuses insuffisances, les démocraties contemporaines protègent largement les libertés (du moins de ceux qui disposent d'un statut légal), mais en est-il de même de l'égalité?
Comme le craignait Tocqueville, le refus, légitime, des inégalités, peut se faire liberticide, déboucher sur la recherche des boucs émissaires, les «nantis», les «intellos», les mariés du même sexe, les femmes qui «dévirilisent» les hommes, les «immigrés», et bien sûr, le «juif», toujours «argenté», mais coupable avant tout de son crime de naissance. Il faut répondre à ces stigmatisations avant tout en défendant l'individu, les libertés et la vie, mais aussi par le social. Je ne suis pas certain que prises individuellement les sociétés démocratiques européennes disposent assez de ressources pour mettre en œuvre cette double réponse.
Les Gilets jaunes sont un catalyseur de la tension entre la passion d'égalité et la passion de liberté, que Tocqueville saisissait en son temps.
On ne peut plus penser une démocratie à la fois de liberté et d'égalité sans passer par l'Europe, sans transformer l'Europe, sans qu'il y ait une politique européenne égalitaire dans les domaines de taxation, de redistribution, d'aménagement des territoires, des solidarités interclasses, inter-genres et inter-générations. Passer à l'échelle européenne exige à son tour qu'on habilite l'Europe comme projet mais aussi comme action citoyenne en deçà et au-delà des États, qu'on refuse le choix, parfaitement stérile, entre d'un côté le fatalisme, de l'autre côté le refus de représentation démocratique, de toute représentation démocratique, y compris la sienne.
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
PANIQUE ANTI-DÉCOLONIALE
un excellent texte, et recommandé. Depuis la suppression de mon ancien forum, ou dizaines de sujets était consacrés à aux luttes et à la pensée décoloniales, croisées avec ma critique communiste rejetant la seule domination de classe, j'avoue avoir relâché la pression,
du fait d'un désintérêt d'une part des "décoloniaux" eux-mêmes (une méfiance imméritée je pense), mais surtout d'une hostilité ouverte des '"marxistes", particulièrement de post-ultragauche, anarchistes "anti-racialisateurs" et théoriciens de la "communisation" promouvant le prolétariat universel incolore qui seul "fera la révolution", comme en atteste encore l'an dernier, de Théorie Communiste, TC n°26 consacrant 40 pages à la critique du "grand récit décolonial", dans un collage de textes évitant soigneusement les problèmes posés (par moi les concernant), et déformant à l'envi cette pensée, abstraitisée et vidée des luttes qui l'ont fondée hier et, en tant que telle, aujourd'hui
comment expliquer cela ? Je pense que ma critique est jugée trop "décoloniale" par les "marxistes" et trop centrée contre le capital pour les "décoloniaux". Les premiers "oublient" que du capital je fais centralement la critique comme économie politique et qu'il n'est pas que ça, et les seconds que pour moi, la sortie du capitalisme n'est pas réduite à la victoire d'une classe révolutionnaire, encore moins réduite au prolétariat, prenant en compte les dominations en sus de l'exploitation. Soit par incompréhension, soit pas volonté de dénigrement, je suis soit négligé soit rejeté par les deux. Et s'il s'agit de désaccords, pourquoi refusent-ils d'en discuter : Patlotch combien de divisions ? C'est vrai, pas bon pour la propagande...
depuis 2015, dans L'idéologie française, j'avais montré que ce "milieu théorique radical" constituait de fait une cinquième colonne de l'idéologie anti-décoloniale portée par le pouvoir politique contre les "décoloniaux" français (Camp décolonial interdit aux Blancs", Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra), etc.
leurs procédés me semblent relever parfaitement de ce qui est décrit dans l'article ci-dessous, une grande bouffée d'oxygène, merci !
La panique décoloniale
Marie-Anne Pavot, 08 mars 2019
La pensée du discours, la théorie du discours ouverte à de nouvelles épistémologies
Marie-Anne Pavot, 08 mars 2019
La pensée du discours, la théorie du discours ouverte à de nouvelles épistémologies
En février dernier, quasiment le même jour, sont parus deux ouvrages qui font déjà date dans l’histoire de la pensée politique : La dignité ou la mort. "Éthique et politique de la race" de Norman Ajari (La découverte) et "Un féminisme décolonial "de Françoise Vergès (La fabrique). Ils paraissent dans un contexte intellectuel français hostile à la pensée décoloniale et pris d’une certaine panique devant ses développements.

Pamphlet et paniqueEn 1982, Marc Angenot publiait La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, qui reste une référence indépassable pour identifier et caractériser la « littérature de combat », constituée de textes majoritairement réactionnaires, les pamphlets (Angenot 1982).
Les traits dominants du pamphlet selon Marc Angenot sont l’image d’un énonciateur solitaire et courageux, la défense de la vérité dangereusement destituée par l’adversaire, la dénonciation du galvaudage des mots et la vision crépusculaire du monde permettant l’invocation d’un âge d’or. À partir de là, l’auteur analyse les différents procédés sémantiques, rhétoriques et discursifs qui soutiennent ce type de discours.
Le travail de Marc Angenot porte sur la période 1868-1968, mais ces traits se retrouvent à la lettre dans l’ensemble des pamphlets déclinistes et/ou catastrophistes sur l’éducation, la laïcité, la culture, internet, et bien d’autres thèmes, publiés postérieurement jusqu’à nos jours. Je l’avais par exemple montré sur les essais de rentrée sur l’éducation des années 1990 (Paveau 1999), et on retrouve ce canevas dans tous les discours qui pointent un phénomène, quelle que soit sa nature, considéré comme une menace sur le monde tel qu’il existe.
Au genre pamphlétaire peut s’articuler ce que plusieurs auteur.e.s ont appelé une « panique ». Eve Kosofsky Sedgwick proposait en 1990 la notion de « panique homosexuelle », centrale dans son Épistémologie du placard (Kosofsky Sedgwick 2008 [1990]), et définie comme une double contrainte pesant sur la culture virile, associant obligation d’homosocialité masculine et interdiction de relations homosexuelles. Noémie Marignier a proposé récemment d’enrichir cette notion de celle de « panique énonciative » qu’elle définit comme une situation d’énonciation « peu lisible et décryptable » (un « trouble énonciatif »), semant le doute quant aux définitions des catégories sexuelles, et brouillant la frontière entre homosocialité et homosexualité (Marignier 2017). Ruwen Ogien a quant à lui consacré un ouvrage entier à la « panique morale » , notion issue des travaux de Stanley Cohen dans années 1970, à partir de questions comme le clonage, l’adoption pour les couples de même sexe, la prostitution ou la pornographie (Ogien 2004). Il la définit, dans le cadre de son éthique minimale, comme « un ensemble de cas dans lesquels nous sommes pris de vertige devant cette exigence de réserve à l’égard des conceptions du bien personnel sur laquelle l’éthique minimale insiste tout particulièrement » (Ogien 2004, avant-propos). Le « principe de neutralité à l’égard des conceptions du bien personnel » constitue, avec le « principe d’égale considération » et le « principe d’intervention limitée aux cas de torts flagrants causés à autrui » (Ogien 2004, chap. 1, section « Raisons morales »), le dispositif théorique de l’éthique minimale. En 2017, paraît un collectif qui propose quant à lui la notion de « panique identitaire » , définie comme une variante de la panique morale (De Cock, Meyran dir. 2017).
Le décolonialisme, trouble dans l’universel
Plusieurs textes parus dans la presse française ces derniers temps relèvent à la fois du pamphlet et de la panique, face au développement des études décoloniales dans quelques lieux de l’université et de la recherche, et du militantisme décolonial dans les mouvements antiracistes : c’est ce que j’appelle la panique décoloniale, que je définis comme le sentiment d’être troublé.e ou menacé.e dans des convictions universalistes eurocentrées, présentées comme partagées, légitimes et objectives, par des propositions intellectuelles et/ou militantes alternatives et décentrées, impossibles à accepter selon le principe d’égale considération ou celui du respect du bien personnel. Trouble dans l’universel, donc, pour paraphraser un autre célèbre trouble. Pour aller vite, les convictions légitimes et objectivisées, à valeur de lois, sont l’universalisme des Lumières et l’évidence de leurs valeurs, la laïcité républicaine, l’égalité effaçant les différences, en particulier de couleur ; les propositions alternatives sont le pluriversalisme, le recours aux savoirs et aux pensées non occidentales, l’égalité dans la différence, notamment de race, le constat d’un colonialisme encore actif, via le racisme institutionnel par exemple, et ses manifestations oppressives multiples. Pour une vue d’ensemble de la pensée décoloniale, voir, entre autres, les deux ouvrages de Norman Ajari et de Françoise Vergès mentionnés plus haut, qui appartiennent à un corpus scientifique et militant important produit depuis les années 1960, que le web rend largement accessible à tou.t.e lecteur.trice en quête d’informations.
Je voudrais pointer, à partir de deux textes publiées dans la presse française, quelques marqueurs discursifs de cette panique décoloniale, dessinant une sorte de genre de discours qui s’est progressivement installé dans les médias et les débats contemporains. Le premier est « Le « décolonialisme », une stratégie hégémonique : l’appel de 80 intellectuels », publié dans Le Point le 28.11.2019. Le second est « Pour un 8 mars féministe universaliste ! », publié dans Libération le 03.03.2019. Je les ai choisis surtout pour leur visibilité et le nombre et le prestige des signatures, ce qui les rend emblématiques, si ce n’est prototypiques, de ce discours réactif et rétif au décolonialisme, que j’appelle panique décoloniale.
Sans surprise, on retrouve de nombreux traits mentionnés par Marc Angenot dans La parole pamphlétaire, et des procédés polémiques bien connus (les couplages notionnels, les suites d’assertions, les définitions, etc.). J’en sélectionne trois, l’usage des guillemets, la pluralisation et le vocabulaire de l’imposture.
Les guillemets de rejet
Ce sont des guillemets qui signalent que le.a locuteur.trice n’assume ou n’accepte pas le mot qu’ille emploie, car c’est le mot de l’autre, ce qui équivaut à mettre en doute l’existence ou la validité de son référent. Ils sont systématiques sur toute la famille lexicale de décolonial dans « L’appel des 80 » (décolonialisme dans le titre et dans le texte, décolonial et décoloniaux dans le texte). Dans le même texte, ils apparaissent sur colonial dans « sous couvert de dénoncer les discriminations d’origine « coloniale » », ce qui met en doute une des thèses les plus forte de la pensée décoloniale, la persistance des structures et des effets de la colonisation jusqu’à nos jours ; on les trouve aussi sur Blancs, racisés, racisme d’état (le terme étant également mis en italique d’insistance), anti-Lumières et race. Blancs est rejeté comme un terme raciste à partir de l’universalisme qui subsume toutes les différences dans l’unicité de l’humanité ; racisés, qui est doublement marqué puisqu’il est introduit par une tournure métalangagière (c’est-à-dire qui parle du langage et non du monde), « ce qu’ils appellent », est mis à distance en vertu de son lien morphologique avec race, mot impossible voire interdit dans le contexte français actuel où l’affirmation de l’inexistence de la race implique celle du mot ; les guillemets sur racisme d’état correspondent à une contestation de la nature systémique du racisme, et donc à un rejet des thèses de l’antiracisme politique ; enfin anti-Lumières est rejeté dans le cadre d’une doxa culturelle où le mouvement philosophique du XVIIIe siècle français fait figure d’origine inquestionnée des valeurs les plus sacrées de la démocratie et de la République. Dans la tribune des féministes universalistes, la stratégie des guillemets n’est pas dominante et on les trouve uniquement sur racialistes et nouveaux féminismes, avec la même fonction de mise en doute et délégitimation. Les guillemets apparaissent dans ces textes comme une stratégie de délégitimation à la fois du signifiant et du référent du mot marqué comme étant celui de l’adversaire.
Dans les deux textes que je regarde ici, ces mots sont donc rejetés pour ce qu’ils désignent et impliquent scientifiquement et politiquement. Les guillemets ont une valeur énonciative, rejetant des éléments lexicaux porteurs d’un sens condamné ; ils constituent un des outils majeurs de la panique décoloniale, la pensée décoloniale jetant un trouble certain dans la pensée hégémonique et incontestée de l’universalisme occidental. L’appel aux « autorités publiques […] mais aussi la magistrature » qui clôt la tribune de 80, manifeste bien qu’il y a, selon les signataires, péril en la demeure, et panique décoloniale, donc, dont les guillemets sont d’efficaces indicateurs.
La pluralisation
J’entends pluralisation au sens large de procédés qui produisent des effets de nombre et d’importance : pluriels, fréquences, intensifications, énumérations, etc. Dans « L’appel des 80 », tout est au pluriel ou presque : les initiatives, les groupes, les mouvances, les militants, leurs relais, les tentatives, les cabales… L’usage du pluriel se double de celui de l’énumération : les « références racialistes » dans le paragraphe 1, les « tentatives d’ostracisation » dans le 4, les institutions dans le 6… Le lexique est volontiers intensif, augmentatif ou fréquentatif : plusieurs… par mois, fréquent, se multiplient, regorge de, harcèlement, acharnement, encombrent, ne cessent de…
Dans la tribune des féministes universalistes, on retrouve les mêmes procédés : l’anaphore en « comment accepter ? », le pluriel de développements, nouveaux féminismes et de nombreuses énumérations : « assignations identitaires, culturelles et religieuses », et plus loin « identitaires, communautaires et religieuses », « courants de pensée relativistes, postcoloniaux et racialistes », « impostures décoloniales, indigénistes, racialistes, postmodernes… »
En face de ces pluriels, dans les deux textes l’affirmation du singulier de la laïcité, de l’universalisme, de la modernité politique, de la République, de la démocratie.
Cette pluralisation produit un effet de nombre, voire de horde envahissant les espaces de recherche d’enseignement et de militantisme, qui participe de la construction de la figure de l’adversaire.
Vérité et imposture
Un trait majeur du pamphlet est la dénonciation inlassable de l’imposture et de la falsification de la vérité ; les positions alternatives de la pensée décoloniale induisent un trouble dans la vérité, considérée par définition comme une et indivisible, laissant percer d’autres standards qui menacent l’équilibre universaliste.
Dans L’appel des 80, on trouve le vocabulaire classique de la falsification, associé à celui du détournement : « La stratégie des militants combattants « décoloniaux » et de leurs relais complaisants consiste à faire passer leur idéologie pour vérité scientifique » ; « des attaques qui, sous couvert de dénoncer les discriminations d’origine « coloniale », cherchent à miner les principes de liberté d’expression et d’universalité hérités des Lumières » ; « le détournement indigne des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent notre démocratie ». Dans la tribune des féministes universalistes, on trouve très classiquement le verbe prétendre (« les courants de pensée relativistes, postcoloniaux et racialistes qui prétendent porter le féminisme ») et le mot imposture (« Face aux impostures décoloniales, indigénistes, racialistes, postmodernes… »), ainsi que la tournure de rejet déjà rencontrée plus haut (des médias accordent une place grandissante à ce qu’ils appellent les «nouveaux féminismes»).
Les deux textes font référence aux Lumières (« les principes de liberté d’expression et d’universalité hérités des Lumières » dans L’appel des 80, « l’héritage des Lumières » dans la tribune féministe), présentées comme l’horizon de vérité indépassable de toute définition de la liberté. En cela ils les sacralisent en les rendant immuables, ce qui leur donne une forme de dimension métaphysique. Ruwen Ogien avait identifié cette tendance à la métaphysique dans son travail sur la panique moraleLa panique décoloniale est tout à la fois une panique intellectuelle, politique, lexicale mais aussi existentielle : ce que disent ces deux textes, c’est que la pensée décoloniale menace l’ordre installé, unique et devenu anhistorique des valeurs françaises, qu’elles soient intellectuelles ou militantes, valeurs qui croisent les choix axiologiques des individus dans leur vie de citoyen.ne.s. L’intéressante expression clivages imaginaires dans la tribune féministe informe sur l’imaginaire des signataires elleux-mêmes, reposant sur un idéal d’unicité sans rapport avec les réalités empiriques. La pensée décoloniale, qui attaque de front ces évidences sans histoire, représente, pour les signataires de ces textes, le monde de l’anti-valeur, selon l’expression de Marc Angenot, désignant ce qui a toujours été les pires adversaires des paniqueur.e.s du monde entier : l’histoire, l’hétérogénéité et l’altérité.Ogien 2004 a écrit:En fait, ceux que je vise lorsque je parle de « panique morale », ce ne sont pas les conservateurs « traditionalistes », dont j’essaie par ailleurs de souligner les incohérences. Ce sont les «libéraux», les « progressistes » ou les conservateurs « modernistes » (ceux qui ont accepté l’éthique minimale pour des raisons pragmatiques). Ils ne devraient jamais, en principe, chercher à justifier leurs positions morales et politiques par des arguments qui relèvent du « bien » ou de raisons religieuses ou métaphysiques (« nature humaine », « essence de l’homme », caractère « sacré » de la personne ou de la création, etc.), mais ils semblent incapables d’y arriver (Ogien 2004, emp. 548-553).
Bibliographie
Angenot Marc, 1982, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Paris, Payot.
De Cock Laurence, Meyran Régis, 2017, Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales, Bellecombe-en-Bauges, Le Croquant.
Kosovsky Sedgwick Eve, 2008 [1990], Épistémologie du placard, trad. Maxime Cervulle, Paris, Éditions Amsterdam.
Marignier Noémie, 2017, « « Gay ou pas gay ? » Panique énonciative sur le forum jeuxvideo.com », in Gauthier, M. & Mercier, E. (dir.), « Intimités numériques » Genre, sexualité & société 17 [En ligne], http://gss.revues.org/3964
Ogien Ruwen, 2004, La panique morale, Paris, Grasset.
Paveau Marie-Anne, 1999, « Formes et fonctions de la doxa dans les discours sur l’école, Mots 61, p. 9-27.
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
« Et pour le reste, que le poème tourne bien ou mal sur l’huile de ses gonds,
fous t’en Depestre, fous t’en et laisse dire Aragon ! »
Une journée consacrée à Aimé Césaire : contre Aragon, la poésie
Clément Solym ActuaLitté 21.03.2019
Ce 18 avril, onze ans après la disparition d’Aimé Césaire, France Ô va diffuser une programmation spécifique, entièrement consacrée à l’écrivain. Avec entre autres découvertes, le documentaire inédit, Césaire contre Aragon — qui retrace l’origine de la dispute entre les deux hommes. Et le point de rupture, sans retour possible, que leur polémique a pu atteindre.

avec l'étude de Anne Douaire-Banny, « Sans rimes, toute une saison, loin des mares » Enjeux d'un débat sur la poésie nationale, on comprend qu'il ne s'agit nullement d'une querelle directe entre Césaire et Aragon, mais d'une controverse pour ainsi dire interne entre intellectuels-poètes antillais se réclamant par ailleurs du marxismeNous sommes en 1955, à Paris : le Martiniquais Aimé Césaire écrit une lettre-poème à l’haïtien René Depestre, une attaque frontale contre Louis Aragon. Les trois hommes de lettres se retrouvent au cœur d’une des controverses — et à travers eux la France, les Antilles et l’Afrique — poétiques les plus fécondes de l’après-guerre, dont les enjeux auront vite fait de déborder les seuls cercles littéraires.Paris, 1955. Le poète martiniquais, Aimé Césaire, écrit une lettre-poème au poète Haïtien, René Depestre. Cette dernière qui s’avère en réalité être une attaque frontale contre le poète français Louis Aragon entrera dans l’Histoire. C’est par cette lettre-poème que Césaire, Depestre, Aragon — et à travers eux la France, les Antilles et l’Afrique— vont se retrouver au cœur d’une des plus fécondes controverses poétiques de l’après-guerre. Elle débordera les cercles littéraires pour inaugurer l’un de ces renversements politiques qui bouleverseront le XX siècle français…
« Et pour le reste, que le poème tourne bien ou mal sur l’huile de ses gonds, fous t’en Depestre, fous t’en et laisse dire Aragon ! », écrivit Aimé Césaire.
Comment Louis Aragon et Aimé Césaire, deux des plus grands poètes du XXe siècle, en sont-ils venus à s’opposer ? L’un adhère au Parti communiste en 1930, l’autre en 1935. Césaire démissionne du PCF en 1956, à cause notamment des révélations du rapport Khrouchtchev, mais Aragon garde le silence et restera au parti jusqu’à sa mort.
Cependant, l’opposition des deux hommes n’est pas seulement un différend politique sur fond de déstalinisation. La rupture entre eux est plus ancienne, plus profonde, et s’ancre dans un contexte historique de décolonisation qui a pris la forme d’une tentative de colonisation culturelle de l’un par l’autre.
De plus, Césaire trouve cocasse de recevoir une leçon de prolétariat de la part d’un bourgeois français, lui qui passe la majeure partie de son temps à régler des problèmes de santé publique ou d’assainissement de l’eau, aussi bien comme député de la Martinique que comme maire de Fort-de-France.
Mais, plus profondément, Césaire n’accepte pas cette mise sous tutelle de l’imaginaire antillais sous le joug culturel français, fût-il communiste.
Les archives d'Aimé Césaire
Ce documentaire, écrit par Patrick Chamoiseau, et réalisé par Guy Deslauriers, sera diffusé le 18 avril à 21 h 55.
Toute une journée de reportage et d’hommages sera, en cette journée, consacrée à Aimé Cesaire, à commencer par un documentaire reprenant le discours devant l’Assemblée nationale.
on peut considérer que les propos de Césaire, voire de Senghor, dans la vidéo à partir 11:00, sur leur formation marxiste ou socialiste de base et l'engagement pour leur communauté colonisée préfigure les débats actuels entre marxisme et décolonialisme, mais il faut bien noter l'universalisme humaniste, auquel tendra de plus en plus leur pensée de la Négritude, est d'une certaine façon tension au dépassement racialiste davantage que certaines positions dites décoloniales aujourd'hui
Dernière édition par Florage le Mer 17 Juin - 15:08, édité 1 fois
Invité- Invité
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
"DÉCOLONISER" LE DÉCOLONIALISME
en promouvant ses luttes, pas ses universitaires
"Comment le milieu universitaire utilise la pauvreté,
l’oppression et la douleur pour la masturbation intellectuelle."
Clelia O. Rodriguez

Patlotch a écrit:Anna Cecilia Dinerstein, ma "compagne" argentine théoricienne en "marxisme décolonial" signale ce texte salutaire de 2017. Si j'ai mis la pédale douce sur la "pensée décoloniale" et ses mérites à mes yeux, ce n'est pas que j'aurais changé d'avis, mais qu'il s'avère impossible de promouvoir un débat qui ne soit pas bouffé d'un côté par les leaders sud-américains, leurs adeptes français notamment le Parti des Indigènes et les universitaires dans la mouvance, et d'un autre par le rejet du pouvoir de ce qui ne serait qu'un communautarisme identitaire raciste à rebours, assistés des joueurs de flûtes ultra-gauchistes, dont communisateurs, sur le même thème (2018 de Théorie Communiste dans TC26, Le grand récit décolonial, avec la malhonnêteté intellectuelle coutumière de RS dans une construction sur mesure pour les dénigrer tout en passant à côté de l'essentiel)
pour moi, ce qui importe d'abord, ce sont les luttes qui relèvent de ce courant qu'elles portent ou non le label "décolonial", et de préférence celles qui ne sont pas strictement militantes, mais massives, et qui brassent souvent des questions de classe, de race, de genre et d'écologie, des luttes de prolétaires paysans en différents lieux du monde
How academia uses poverty, oppression, and pain for intellectual masturbation
Clelia O. Rodriguez, RaceBaitr, April 6, 2017
Clelia O. Rodriguez, RaceBaitr, April 6, 2017
The politics of decolonization are not the same as the act of decolonizing. How rapidly phrases like “decolonize the mind/heart” or simply “decolonize” are being consumed in academic spaces is worrisome. My grandfather was a decolonizer. He is dead now, and if he was alive he would probably scratch his head if these academics explained the concept to him.
I am concerned about how the term is beginning to evoke a practice of getting rid of colonial practices by those operating fully under those practices. Decolonization sounds and means different things to me, a woman of color, than to a white person. And why does this matter? Why does my skin itch when I hear the term in academic white spaces where POC remain tokens? Why does my throat become a prison of words that cannot be digested into complete sentences? Is it because in these “decolonizing” practices we are being colonized once again?
I am not granted the same humanity as a white scholar or as someone who acts like one. The performance of those granted this humanity who claim to be creating space for people of color needs to be challenged. They promote Affirmative action, for instance, in laughable ways. During hiring practices, we’re demanded to specify if we’re “aliens” or not. Does a white person experience the nasty bitterness that comes when POC sees that word? Or the other derogatory terminology I am forced to endure while continuing in the race to become America’s Next Top Academic? And these same white colleagues who do not know these experiences graciously line up to present at conferences about decolonizing methodology to show their allyship with POC.
The effects of networking are another one of the ways decolonizing in this field of Humanities shows itself to be a farce. As far as I understand history, Christopher Columbus was really great at networking. He tangled people like me in chains, making us believe that it was all in the name of knitting a web to connect us all under the spell of kumbaya.
Academic spaces are not precisely adorned by safety, nor are they where freedom of speech is truly welcome. Not all of us have the luxury to speak freely without getting penalized by being called radicals, too emotional, angry or even not scholarly enough. In true decolonization work, one burns down bridges at the risk of not getting hired. Stating that we are in the field of decolonizing studies is not enough. It is no surprise that even those engaged in decolonizing methods replicate and polish the master’s tools, because we are implicated in colonialism in this corporatized environment.
I want to know what it is you little kids are doing here—that is to say, Why have you traveled to our Mapuche land? What have you come for? To ask us questions? To make us into an object of study? I want to you go home and I want you to address these concerns that I have carried in my heart for a long time.
Such was the response of Mapuche leader Ñana Raquel to a group of Human Rights students from the United States visiting the Curarrehue, Araucanía Region, Chile in April 2015. Her anger motivated me to reflect upon how to re-think, question, undo, and re-read perspectives of how I am experiencing the Humanities and how I am politicizing my ongoing shifts in my rhyzomatic system. Do we do that when we engage in research? Ñana Raquel’s questions, righteous anger, and reaction forced me to reconsider multiple perspectives on what really defines a territory, something my grandfather carefully taught me when I learned how to read ants and bees.
As politicized thinkers, we must reflect on these experiences if we are to engage in bigger discussions about solidarity, resistance and territories in the Humanities. How do we engage in work as scholars in the service of northern canons, and, in so doing, can we really admit what took us there? Many of us, operating in homogeneous academic spaces (with some hints of liberal tendencies), conform when that question is bluntly asked.
As someone who was herself observed and studied under the microscopes by ‘gringos’ in the 1980s, when pedagogues came to ask us what life was like in a war zone in El Salvador, Raquel’s questions especially resonate with me. Both of us have been dispossessed and situated in North American canons that serve particular research agendas. In this sense, we share similar experiences of being ‘read’ according to certain historical criteria.
Raquel’s voice was impassioned. On that day, we had congregated in the Ruka of Riholi. Facing center and in a circle, we were paying attention to the silence of the elders. Raquel taught us a priceless lesson. After questioning the processes used to realize research projects in Nepal and Jordan, Raquel’s passionate demand introduced a final punch. She showed us that while we may have the outward face of political consciousness, we continued to use an academic discipline to study ‘exotic’ behaviors and, in so doing, were in fact undermining, denigrating and denying lessons of what constitutes cultural exchange from their perspective.
From these interactions in the field emerge questions that go to the heart of the matter: How do we deal with issues of social compromise in the Humanities? In unlearning? In many cases, academic circles resemble circuses rather than centres of higher learning, wherein a culture of competition based on external pressures to do well motivates the relationship between teacher and student.
One of the tragic consequences of a traditional system of higher education is working with colleagues who claim to have expertise on the topic of social activism, but who have never experienced any form of intervention. I am referring here to those academics who have made careers out of the pain of others by consuming knowledge obtained in marginalized communities. This same practice of “speaking about which you know little (or nothing)” is transmitted, whether acknowledged or not, to the students who we, as teachers and mentors, are preparing to undertake research studies about decolonizing.
Linda Smith speaks about the disdain she has for the word “research,” seeing it as one of the dirtiest words in the English language. I couldn’t agree more with her. When we sit down each semester to write a guide to “unlearning’,” or rather a syllabus, we must reflect upon how we can include content that will help to transmit a pre-defined discipline in the Humanities with current social realities. How can we create a space where a student can freely speak his/her mind without fear of receiving a bad grade?
Today, anything and everything is allowed if a postcolonial/decolonizing seal of approval accompanies it, even if it is devoid of any political urgency. These tendencies appear to be ornamental at best, and we must challenge the basis of those attempts. We can’t keep criticizing the neoliberal system while continuing to retain superficial visions of solidarity without striving for a more in-depth understanding. These are acts for which we pat ourselves on the back, but in the end just open up space for future consumers of prestige.
The corridors of the hallways in the institution where I currently work embodies this faux-solidarity in posters about conferences, colloquiums, and trips in the Global South or about the Global South that cost an arm and a leg. As long as you have money to pay for your airfare, hotel, meals and transportation, you too could add two lines in the CV and speak about the new social movement and their radical strategies to dismantle the system. You too can participate in academic dialogues about poverty and labor rights as you pass by an undocumented cleaner who will make your bed while you go to the main conference room to talk about her struggles.
We must do a better job at unpacking the intellectual masturbation we get out of poverty, horror, oppression, and pain–the essentials that stimulate us to have the orgasm. The “release” comes in the forms of discussions, proposing questions, writing grant proposals, etc. Then we move onto other forms of entertainment. Neoliberalism has turned everything into a product or experience. We must scrutinize the logic of power that is behind our syllabi, and our research work. We must listen to the silences, that which is not written, and pay attention to the internal dynamics of communities and how we label their experiences if we are truly committed to the work of decolonizing.
Clelia O. Rodríguez is an educator, born and raised in El Salvador, Central America. She graduated from York University with a Specialized Honours BA, specializing in Spanish Literature. She earned her MA and PhD from The University of Toronto. Professor Rodríguez has taught undergraduate and graduate courses in Spanish language, literature and culture at the University of Toronto, Washington College, the University of Ghana and the University of Michigan, most recently. She was also a Human Rights Traveling Professor in the United States, Nepal, Jordan, and Chile as part of the International Honors Program (IHP) for the School of International Training (SIT). She taught Comparative Issues in Human Rights and Fieldwork Ethics and Comparative Research Methods. She is interested in decolonozing approaches to teaching and engaging in critical pedagogy methodologies in the classroom.
Dernière édition par Florage le Mer 17 Juin - 15:08, édité 1 fois
Invité- Invité
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
L'OCCIDENT N'EST PLUS AU CENTRE
et la balle n'est pas dans son camp
l'Occident s'était toujours cru le centre du monde, depuis la Grèce ancienne quand la terre était plate, avant qu'il ne "découvre" l'Afrique, l'Asie, puis l'Amérique, qui naturellement existaient sans lui. Centre de l'humanisme, centre des valeurs universelles, centre du capitalisme pour le colonialisme, centre du communisme dont les prolétaires doivent libérer tous les autres chez Marx, centre de l'anthropocentrisme. C'est fini

comme suite à des sujets anciens, dont LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISEdepuis, toutes mes analyses se comprenaient dans le contexte de la perte de suprématie de l'Occident, inventeur du mode de production capitaliste, dominant sa mondialisation avec le colonialisme à la fin du 19e siècle puis la globalisation capitaliste un siècle plus tarddans le précédent forum, j'ai analysé le moment historique présent comme double crise du capital et de l'Occident, avec la remontée de leur formation structurelle commune. C'est dans ce contexte que je situais les luttes et la pensée décoloniales comme paradigmatiques, ce que leurs penseurs nomment "le tournant décolonial" d'une façon réductrice, en l'occurrence sous-estimant le facteur capitaliste, les rapports de production et reproduction
quelques titres dans la crise pandémique du coronavirus
- Crise du Covid : « L’Occident ne peut plus prétendre être un modèle pour le monde, Carol Isoux, Libération, 23 maiSpécialiste des relations entre l’Occident et l’Asie, le professeur Kishore Mahbubani, ancien diplomate et auteur singapourien, estime que la montée en puissance de l’Asie dans les domaines économique, technologique et culturel, est l’événement majeur de notre époque. Pour lui, la crise du coronavirus sera retenue dans les manuels d’histoire comme la date officielle d’un processus entamé depuis plusieurs décennies : l’ouverture du « siècle asiatique ». La pandémie du coronavirus a révélé que les systèmes socio-économiques et politiques en Asie avaient permis une meilleure maîtrise de la crise.
- Covid 19 : un Occident fracturé face au nouvel impérialisme chinois, Atlantico, 23 mai
L'ambition globale de la Chine menace la primauté internationale américaine. Les Etats-Unis étant les héritiers géopolitiques des grandes puissances européennes d’antan, c’est la longue hégémonie occidentale qui est en fait menacée.
- « Tant qu'elles ne touchent pas l'Occident, on regarde de loin les épidémies sévissant au Sud », Dialo Diop, L'Humanité, 19 mai
Entretien. Médecin biologiste à la retraite, Dialo Diop a longtemps été enseignant-chercheur au laboratoire de bactériologie et virologie de la faculté de médecine de Dakar. D’autres maladies, en Afrique, tuent incomparablement plus que le coronavirus, insiste-t-il.
- L’Occident mort de peur. Que n’a-t-on pas sacrifié à notre affolement devant le Covid-19 ? Jérôme Blanchet-Gravel, Causeur, 13 maiDéni de la mort : après le déclin, la fin de l’Occident ? / Mesures quasi-maladives
Crise spirituelle, crise civilisationnelle / Toujours des droits, jamais des devoirs
- La chute de l’Occident, Nicolas Baverez, Le Figaro, 3 mai
L’Occident a perdu sa crédibilité et montré sa vulnérabilité en échouant à gérer les risques systémiques et les chocs qui caractérisent le XXIe siècle.L’Occident a dominé le monde de la fin du XVe siècle au début du XXe siècle, exportant ses modes de production, ses institutions et ses idées sur tous les continents à travers trois grands mouvements de mondialisation: le XVIe siècle avec les grandes découvertes ; le XIXe siècle avec la convergence de la colonisation, de la révolution industrielle et du libre-échange ; la fin du XXe siècle avec l’effondrement de l’empire soviétique, l’universalisation et la dérégulation du capitalisme, le basculement dans l’ère numérique. Le succès de l’Occident a reposé sur quatre principes: l’invention du capitalisme ; le progrès de la science pour connaître et valoriser l’univers ; la construction de la liberté politique qui permet aux individus et aux nations de décider de leur destin ; enfin, la conscience de l’unité et de la solidarité des nations libres face aux sociétés d’Ancien Régime puis aux totalitarismes.
La troisième mondialisation a semblé marquer le triomphe de l’Occident, en faisant entrer...
[suite aux abonnés]
- Le coronavirus et la mort, chant du cygne de la suprématie occidentale ? Sputnik France, 30 avrilTrès attaché à la question démographique, Gérard Chaliand rappelle qu’il y a un siècle, les Occidentaux, « en mettant les Russes dedans », représentaient 33% de la population mondiale. Aujourd’hui, cet ensemble se limite à 15%. Il évoque ainsi un « sentiment d’amenuisement et de fragilité démographique », face à une poussée considérable en Chine, en Inde ou encore en Afrique, ce qui fait « partie de ce sentiment de précarité qui fait qu’on veut conserver au maximum la chance de mourir le plus tard possible ». Donc oui, pour le géopoliticien, le Covid-19 acte la fin de la suprématie occidentale, « parce que nous autres Européens, nous n’avons pas bâti les moyens pour défendre nos valeurs ».
- Géopolitique.L’influence de l’Occident mise à mal par l'épidémie, Courrier International, 29 avril (John Keiger, The Spectator, 12 avril)
Il sera plus dur pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la France de donner le ton à l’international, prédit ce professeur de Cambridge, alors que la pandémie a exposé les failles de leurs systèmes politiques et sanitaires.
Dernière édition par Florage le Mer 17 Juin - 15:08, édité 1 fois
Invité- Invité
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
Entre Orient et Occident :
le Covid-19, brève anatomie d’une crise sanitaire majeure
Paul-Antoine Miquel et Pierre Montebello, ForumEco, 18 mai
« Avec le Covid-19, nous sommes entrés dans un âge d’une autre dimension : la précarité.
La crise sanitaire mondiale réclame un changement radical de paradigme.
Les humains ne sont pas au-dessus de la nature, encore moins son centre. »
Paul-Antoine Miquel et Pierre Montebello, professeurs de philosophie à l’université de Toulouse 2
Paul-Antoine Miquel est membre de la Commission Philosophie NXU Think Tank, dédié à l’impact des NBIC (Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives) sur notre société. nxu-thinktank.com
Le Covid-19 est un puissant révélateur de nous-mêmes. Il fournit à chacun l’occasion de dire sa vérité, il suscite mille récits qui puisent aux obsessions et convictions de chacun.
Pêle-mêle, on apprend dans un mélange de fantasmes, de fausses évidences et d’authentiques contre-vérités, que prendre soin de soi et des autres est un modèle politique qui a de l’avenir, que nous sommes vulnérables, que la mort est dans la vie, que le virus prospère sur les failles du capitalocène, que le collapse est proche, que les pandémies sont naturelles et que la globalisation n’y est pour rien, que la science vaut moins que la politique (ou l’inverse). On entend même dire que ce virus est une sorte de nouveau Messie, venant punir l’homme de sa culpabilité…
UN CHANGEMENT RADICAL DANS L’IMAGINAIRE OCCIDENTAL
Mais, cette pandémie témoigne surtout du fait que nous avons changé d’imaginaire et de mythologie. Deux modèles de vulnérabilité se sont partagé l’imaginaire occidental, montrait Jean-Louis Chrétien : la faiblesse face au destin dans l’Antiquité et la fragilité face à Dieu dans le christianisme. En un éclair, le destin pouvait renverser à chaque instant les conditions, les hiérarchies, les positions, il mettait en évidence la faiblesse humaine. [1] La fragilité marquait, elle, la puissance de Dieu devant toute chose créée, elle signifiait l’insuffisance et l’imperfection de toute créature. Avec le Covid-19, nous sommes entrés dans un âge d’une autre dimension : la précarité. La précarité ne désigne pas un processus économique ou social seulement, elle manifeste ce sentiment nouveau que toutes les choses, y compris l’homme dans sa vie vitale, environnementale, et dans sa vie sociale et économique, sont vulnérables parce qu’elles sont des tissus de relations qui peuvent s’exténuer. Rien n’a d’autosuffisance et de consistance en soi. La précarité n’est certes pas un état permanent mais un fond possible : tous possiblement précaires, ayant épuisé nos relations fondamentales, voués alors soit à une mort sociale, soit à une mort économique, soit à une mort biologique, parfois les subissant successivement toutes. C’est ce sentiment qu’avive de manière si virulente la pandémie mondiale, comme s’il devenait clair en retour que nous avons absolument à faire consister les relations qui sont primordiales pour nous, climatiques, environnementales, sociales, économiques, pour ne pas être livrés à la moindre occasion, au tumulte de l’inconsistance radicale.
Face à la crise sanitaire elle-même, et avant même de réfléchir à ce problème écologique mondial, dû à notre mainmise sur la nature entière, les réactions ont différé du tout au tout. Dans les pays occidentaux (mais pas seulement), le confinement s’est imposé à peu près par- tout. Briser les chaînes de propagation avec le virus, sans préserver toutes les autres relations, a été vu comme la solution. Au niveau national, on s’est protégé aussi des autres nations. Ce double réflexe de coupure et de repli en dit long sur notre manière de prendre en charge le problème : l’autarcie serait-elle le seul remède, l’enfermement serait- il le seul outil dont nous disposons ? Pouvons-nous vraiment faire abstraction de toutes les relations qui nous constituent ? Ces mauvais choix n’étaient pas inévitables, pourquoi se sont-ils imposés ? Parce qu’ils témoignent, eux aussi, de pensées toutes faites sur ce que vivre protégé et être libre signifient et de l’absence totale de prise en compte des pratiques des autres.
L’OCCIDENT FACE À L’ORIENT
Le 17 février débute à Mulhouse un rassemblement évangélique de 2 500 personnes, dont on dit qu’il a été le vecteur central du Covid-19 en France. Ironie du sort, un autre rassemblement évangélique, patronné par la fameuse secte Shincheonji en Corée du Sud a lieu presque aux mêmes dates. 833 contaminations sont détectées le 24 février, dont 292 cas ont un lien avec la secte. La manière dont cette épidémie a été affrontée en Corée, et le courage qu’il a fallu au président Moon pour le faire, semblent peu intéresser la presse française [2]. Qui en France sait qui est le président Moon, comment il est parvenu au pouvoir, quelle guerre de tranchée permanente il a eu à mener contre l’extrême droite coréenne et les nostalgiques du dictateur Park encore bien implantés dans les médias et le système judiciaire sud-coréen ? Lee Man-Hee, le fondateur de la secte Shincheonji, et figure influente dans ce milieu, refuse de donner le fichier des noms de fidèles ; et dans la ville ultra-conservatrice de Daegu, l’épidémie commence à gagner en intensité. Le Président Moon fait pression. Il prend des risques. Lee Man-Hee est menacé de procès. La liste (non complète, plusieurs milliers de noms manquent) est finalement obtenue. Résultat ? En un peu plus d’un mois le système de santé Coréen jugule et canalise le virus. Quelle est la recette miracle ? En Corée tout le monde porte un masque, on fait immédiatement des tests de grande ampleur, et on pratique le tracking. Aucun risque de prendre le train et d’être assis à côté d’un malade sans le savoir. Aucun risque d’aller voir sa vieille grand-mère et de lui donner la mort sans le vouloir. À l’aune de nos valeurs et de la protection des individus le tracking est-il souhaitable ? N’est- il pas l’œuvre d’un gouvernement autoritaire de plus en Asie ? Rappelons que le père du président Moon fut un réfugié politique du Nord, et qu’il a été lui-même deux fois enfermé dans les geôles du dictateur Park, ayant milité toute sa vie, en tant qu’avocat, pour ces fameux droits de l’homme si contestés chez nous aujourd’hui, dans certains courants politiques. Autoritaire, le président Moon ? Dans une compréhension globale et complexe des relations dans lesquelles nous sommes pris, certains pays ont fait le choix de ne pas en sacraliser une seule, comme si la vie avait moins de prix que ce qu’on nomme vaguement liberté personnelle, sans aucun débat possible sur ce sujet, comme si la liberté n’enveloppait pas la condition primordiale de la liberté : vivre.
Comparons un moment avec la France ! À la fin du mois de janvier, notre ministre de la santé annonce qu’il ne faut pas s’inquiéter et que l’épidémie est contrôlée en Chine : tant mieux, parce que, dans notre système de santé qui est le meilleur du monde, il n’y a pas de masques ! On s’est assez moqué de Roselyne Bachelot, qui en avait constitué un stock lors d’une épidémie précédente, au nom du principe de précaution pourtant. Le problème, c’est que dans notre système de santé le meilleur du monde, il n’y a pas non plus de tests ! Ne parlons même pas de la possibilité de tracer numériquement les citoyens ! Tout cela sera inutile, car nous n’avons affaire qu’à une forme de grippe. C’est ce que nos médico-communicants disent au grand public à la télévision française. Quel est le taux de mortalité de la dernière grippe saisonnière française ? 0, 1 %. 8 000 morts en 2019 [3]. Et quel est le taux de mortalité du Covid-19 ? Une enquête avait été menée en Chine, les données épidémiologiques oscillaient autour de 3 % [4]. Même en étant nul en mathématiques, il n’est pas difficile de comprendre que nous changeons d’ordre de grandeur. Il faut ajouter que le Covid-19 prend une forme sévère et dangereuse, dans au moins 10 % des cas. Ces données étaient déjà disponibles, après l’étude chinoise du 17 février 2020. Certes, on ignorait l’importance du nombre de patients asymptomatiques. Et on l’ignore toujours ! Quelle solution avons-nous proposé depuis ? Enfermer les gens chez eux, ruiner notre économie, fabriquer un peu de masques et un peu de tests. Il en faut évidemment beaucoup plus dans un pays où la pandémie a déjà fait près de 27 000 morts que dans un pays où il y en a eu moins de 260…
La crise sanitaire mondiale réclame un changement radical de paradigme. Commençons-nous à comprendre que les humains ne sont pas au-dessus de la nature, encore moins son centre ? Nous ne pouvons pas continuer à détruire de cette manière la biosphère sans attendre un effet de retour des boucles rétroactives qui la sculptent sur cette planète. Le Covid-19 en est simplement l’un des signes, comme l’étaient presque au même moment les incendies australiens. Comprenons-nous que nous ne pouvons consister sur Terre, nous humains, qu’on prenant en compte les autres êtres, qu’en faisant monde avec eux ?
Mais les Occidentaux ne sont pas non plus au centre de la morale ! Combien de temps allons-nous mettre pour commencer à accepter ce fait ! Une civilisation, c’est d’abord un système de valeurs. Le système de valeur occidental n’est qu’un point de vue sur le monde, qui n’a sans doute pas moins de valeur que les autres, mais qui doit composer avec les autres. Combien de temps allons-nous mettre avant de commencer à accepter qu’il faut faire communiquer les points de vue européens, asiatiques, africains, américains plutôt que d’entrer dans une logique d’ignorance, ou d’affrontement ! Non, Mr Moon n’est pas fasciste, non le tracking en période de pandémie n’est pas obligatoirement le signe que nous sommes dans un État policier, s’il respecte au niveau des techniques et des protocoles, les conditions de nos démocraties, et fait clairement la balance entre la vie comme condition de la liberté et l’exercice de cette liberté ! Non il ne faut pas organiser des élections municipales au début d’une pandémie ! Oui, il est absurde de faire entrer les enfants à l’école, quand on sait que cela peut relancer le processus pandémique ! En Corée on peut aller au bar, au restaurant, dans le métro, dans le train, mais les enfants ne vont pas à l’école, et les cours à l’université se font par Zoom, en attendant mieux, en attendant que nous commencions enfin à apprendre à vivre au XXIe Siècle !
Le Covid-19 nous bouscule sur ces deux points. D’abord, il exprime on ne peut mieux ce sentiment nouveau que la précarité est la condition générale de toute existence. Et que dès lors, notre plus immense défi aujourd’hui, nous en prenons tous conscience, est de réussir à ne pas exténuer les relations qui nous constituent, sur le plan écologique, environnemental, biologique. Sur le plan de la résistance à la pandémie elle-même ensuite, le Covid-19 nous contraint de penser avec les autres, et non sans eux, les conduites à tenir afin de lui faire face, sans tabous, ni croyances politiques d’un autre âge, cet âge où n’existaient ni cette pandémie, ni ce réchauffement climatique, ni ce désastre écologique que l’espèce humaine est en train de fabriquer jour après jour.
[1] Jean-Louis Chrétien, Fragilité, Les Éditions de Minuit, Paris, 2017.
[2] Cela fait d’ailleurs contraste avec la presse anglaise, si on pense par exemple à l’excellent article du Guardian qui vient d’être publié aujourd’hui (Test, trace, contain : how South Korea flattened its coronavirus curve, 23 april 2020, Justin McKurry).
[3] Ce chiffre lui-même est d’ailleurs largement surestimé. Il compte l’ensemble des décès susceptibles d’être attribués directement ou indirectement à la grippe. Le nombre de patients effectivement morts de la grippe à l’hôpital est bien plus bas (voir Santé Publique, n° 28, 21 octobre 2019).
[4] Wang W, Tang J, Wei F. Updated understanding of the outbreak of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV ) in Wuhan, China, J Med Virol 2020. (doi : 10.1002/jmv.25689.)
Dernière édition par Florage le Mer 17 Juin - 15:09, édité 1 fois
Invité- Invité
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
c'est à lire, on a lu pire...
Alain de Benoist :
« Les États-Unis sont en guerre contre la Chine.
La France ne doit pas tomber dans le suivisme… »
Boulevard Voltaire, 13 juin 2020
« Les États-Unis sont en guerre contre la Chine.
La France ne doit pas tomber dans le suivisme… »
Boulevard Voltaire, 13 juin 2020
Autrefois, le centre de gravité géopolitique du monde connu était la Méditerranée, avant de basculer vers l’Atlantique, découverte des Amériques oblige. Aujourd’hui, ce rôle semble revenir au Pacifique, le fait dominant, à en croire la plupart des observateurs, étant la montée en puissance de la Chine. Réalité ou fantasme ?
La Chine n’est pas encore la première puissance économique mondiale, mais elle a de bonnes chances de le devenir dans les dix ans qui viennent. Depuis 2012, elle est, en revanche, la première puissance industrielle, devant l’Europe, les États-Unis et le Japon (mais elle retombe au quatrième rang si l’on considère la valeur ajoutée par habitant). Elle est également la principale puissance commerciale du monde et la principale importatrice de matières premières. Elle dispose d’un territoire immense, elle est le pays le plus peuplé de la planète, sa langue est la plus parlée dans le monde, et elle possède une diaspora très active dans le monde entier. Elle possède la plus grande armée du monde et ses moyens militaires se développent à une vitesse exponentielle. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, elle possède l’arme nucléaire, elle est depuis 2003 une puissance spatiale. Elle s’implante massivement en Afrique noire, elle achète des infrastructures de premier plan dans le monde entier et son grand projet de « nouvelles routes de la soie » va encore renforcer ses capacités d’influence et d’investissement. En 1980, le PIB chinois représentait 7 % de celui des États-Unis. Il a bondi, aujourd’hui, à près de 65 % ! Enfin, les Chinois déposent deux fois plus de brevets que les Américains. Cela fait beaucoup.
En 1993, dans son livre sur le choc des civilisations, Huntington anticipait le concept de « modernisation sans occidentalisation ». C’est là le point essentiel. Modèle d’un type inédit, combinant le confucianisme, le nationalisme, le communisme et le capitalisme, le modèle chinois diffère radicalement du modèle occidental de « développement ». Les libéraux croient généralement que l’adoption du système du marché entraîne immanquablement l’avènement d’une démocratie libérale. Les Chinois démentent tous les jours cette prédiction. Toutes ces dernières années, ils n’ont cessé de renforcer le rôle du marché, mais sans jamais cesser de l’encadrer de façon rigoureuse. Résumer ce système à la formule « capitalisme + dictature » est une erreur. La Chine donne plutôt l’exemple surprenant d’un capitalisme qui fonctionne sans subordination du politique à l’économique. L’avenir dira ce qu’il faut en penser.
Les Chinois sont des pragmatiques qui raisonnent sur le long terme. L’idéologie des droits de l’homme leur est totalement étrangère (les mots « droit » et « homme », au sens que nous leur donnons, n’ont même pas d’équivalent en chinois : « droits de l’homme » se dit « ren-quan », « homme-pouvoir », ce qui n’est pas spécialement limpide), l’individualisme également. Pour les Chinois, l’homme doit s’acquitter de ses devoirs envers la communauté plutôt que de revendiquer des droits en tant qu’individu. Durant l’épidémie de Covid-19, les Européens se sont confinés par peur ; les Chinois l’ont fait par discipline. Les Occidentaux ont des références « universelles », les Chinois ont des références chinoises. Grande différence.
Dès la chute du mur de Berlin, des rapports de la CIA annonçaient que la Chine était appelée à devenir le principal adversaire stratégique des États-Unis. Ces dernières années, les rapports entre Pékin et Washington n’ont cessé de détériorer, et pas seulement sur le plan commercial. Une véritable guerre entre la Chine et les États-Unis est-elle concevable ?
Les Américains ont toujours voulu uniformiser le monde selon leurs propres canons identifiés à la marche naturelle du progrès humain. Depuis qu’ils ont atteint une position dominante, ils ont constamment fait en sorte d’empêcher l’émergence de toute puissance montante qui pourrait mettre en danger cette hégémonie. Depuis quelques années, les livres se multiplient aux États-Unis (Geoffrey Murray, David L. Shambaugh, etc.) qui montrent que la Chine est, aujourd’hui, la grande puissance montante, alors que les États-Unis sont sur la pente descendante. Dans un ouvrage dont on a beaucoup parlé (Destined for War), le politologue Graham Allison montre qu’au cours de l’Histoire, à chaque fois qu’une puissance dominante s’est sentie menacée par une nouvelle puissance montante, la guerre s’est profilée à l’horizon, non pour des raisons politiques, mais du simple fait de la logique propre aux rapports de puissance. C’est ce qu’Allison a appelé le « piège de Thucydide », en référence à la façon dont la peur inspirée à Sparte par l’ascension d’Athènes a abouti à la guerre du Péloponnèse. Il y a de bonnes chances qu’il en aille de même avec Washington et Pékin. À court terme, les Chinois feront tout pour éviter une confrontation armée et pour ne pas donner prise aux provocations dont les Américains sont familiers. À plus long terme, en revanche, un tel conflit est parfaitement possible. La grande question est, alors, de savoir si l’Europe basculera du côté américain ou si elle se déclarera solidaire des autres grandes puissances du continent eurasiatique. C’est, évidemment, la question décisive.
Il ne faut pas s’y tromper, les États-Unis sont d’ores et déjà en guerre contre la Chine. La guerre commerciale qu’ils ont engagée se double d’un volet politique dont témoigne, par exemple, leur soutien aux séparatistes de Hong Kong (présentés sans rire comme des « militants pro-démocratie »). Dans les documents de l’administration américaine, la Chine est d’ailleurs désormais qualifiée de « rivale stratégique ». Cette agressivité manifeste moins l’arrogance que la peur. Mais les Chinois n’ont nulle intention de se laisser faire, pas plus qu’ils ne toléreront indéfiniment un ordre mondial régi par des règles dictées aux États-Unis. Comme l’a dit Xi Jinping, « la Chine ne cherche pas les ennuis, mais elle ne les craint pas ». Il ne faut jamais oublier que, pour les Chinois, il existe non pas quatre mais cinq points cardinaux : le nord, le sud, l’est, l’ouest et le milieu. La Chine est l’empire du Milieu.
Dans ce combat de titans, précisément, l’Europe a-t-elle encore une stratégie ? Et la France dispose-t-elle encore de quelques cartes à jouer ?
Il ne fait pas de doute que l’on va voir se multiplier, dans les mois qui viennent, les campagnes antichinoises orchestrées par les Américains afin de s’assurer du soutien de leurs alliés, à commencer par leur « province » européenne, le but étant de recréer à leur profit un nouveau « bloc occidental » opposé à Pékin comparable à celui qui existait face à Moscou durant la guerre froide. Il serait dramatique que la France et l’Europe tombent dans ce piège, comme elles l’ont déjà fait en se ralliant aux sanctions édictées contre la Russie. Nous n’avons pas vocation à être sinisés, mais ce n’est pas une raison pour continuer d’être américanisés, surtout à un moment où les États-Unis accumulent chez eux des problèmes qu’ils ne parviennent plus à régler. La France qui, à l’époque du général de Gaulle, a été la première à reconnaître la Chine populaire devrait se souvenir, au lieu de sombrer à nouveau dans un atlantisme contraire à tous ses intérêts, qu’à cette époque, en pleine guerre froide, elle recherchait avant tout un équilibre entre les puissances respectant l’indépendance des peuples. Maurice Druon disait alors que le français était la « langue des non-alignés » ! C’est à ce rôle qu’elle doit revenir.
Entretien réalisé par Nicolas Gauthier
Dernière édition par Florage le Mer 17 Juin - 15:09, édité 1 fois
Invité- Invité
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
déniché par Ana Cecilia Dinerstein, @CDinerstein, dont paraîtra en 2021, cosigné avec Frederick Harry Pitts, A World Beyond Work?: Labour, Money and the Capitalist State Between Crisis and Utopia. Présentation et sommaire dessous
Ana me dit : « I will start writing "Decolonial Marxism" (Pluto press) next month... submit in April. » Je me disais que Décoloniser le marxisme était mieux que Marxisme décolonial. Ana me dit que le titre actuel serait 'Decolonizing Communisme, Democraty and the Commons', préférable à mon sens à Marxisme décolonial ou Communisme décolonial, une nuance qui donne l'impression d'une double détermination structurelle du capitalisme, "de classe" et "de race", sur le même plan
Interview
'Students want to confront it':
academics on how to decolonise the university
Sadhvi Dar, Manali Desai and Clive Nwonka
The Guardian, 17 Jun 2020
'Students want to confront it':
academics on how to decolonise the university
Sadhvi Dar, Manali Desai and Clive Nwonka
The Guardian, 17 Jun 2020
Students have been calling for decolonised curriculums for years, yet few UK universities have made meaningful changes

The Rhodes Must Fall campaign protests outside University of Oxford’s Oriel College
where a statue of imperialist Cecil John Rhodes looks out over the front door.
Photograph: Christopher Furlong/Getty Images
à paraître en 2021The Black Lives Matter movement has turned up the pressure on all areas of UK society to confront its colonial legacy. Within universities, this follows on from the widespread student campaigns which have been asking for decolonised curriculums and more thinkers of colour on reading lists since 2017. Yet recent research by The Guardian shows that only a fifth of universities have made genuine attempts to address the harmful legacy of colonialism.
Three academics tell us what’s holding universities back from making the changes that their students are demanding.
‘It’s not about how many black or brown authors are on the reading list’
Manali Desai, reader, University of Cambridge
What’s important to hold at the core of all of these discussions is the need for Britain, and white people especially, to really grapple with the colonial legacy. A tick-box approach to inclusion, diversity and equality isn’t going to cut it because these concepts do not address that legacy. It’s really important to hold that line between the colonial past and the racist present.
Universities often shove these things under the carpet. I think there’s something about the word colonial that people are allergic to. There’s a massive reluctance to address the colonial past, and it’s layered with this imperial nostalgia you see all around us. But I think this is a generational issue: frankly, the students want to confront these issues, and at Cambridge a lot of decolonising work has been driven by students and not by staff, despite how the press can sometimes frame it. A lot of the campaigning around it comes from white students as well as students of colour, although the latter shoulder a heavier burden.
Students’ consciousness is not framed in parochial British terms anymore. It can be a lightning rod to see what happened with George Floyd and police violence and to see connections with the UK. Students are thinking internationally and outside of the Eurocentric frames that have traditionally dominated sociology as a discipline. It’s no longer acceptable for us to teach sociology in the old way – the students find it utterly inadequate.
When we created our own decolonising sociology committee three years ago, we held an open meeting in the department that was attended by students and staff at all levels. It was a wide-ranging and honest conversation that covered all aspects of the department’s operations. We’ve since embedded decolonising into the life of the department – we have meetings once a month and we’ve also been looking at how we can connect with social justice and anti-racist campaigns in the city. But if we leave it up to students alone it won’t work because they’re a transient population – more permanent members of staff need to take responsibility on leading these things.
Since I’ve been working on decolonising, we’ve heard so much from detracting voices saying “What percentage of white authors are you going to remove? Does this mean you won’t read Kant and Hegel?” But the point isn’t a calculation about how many black or brown authors are on the reading list, but rather how does your curriculum train students to think critically about the present?
To me the question is: “What tools does decolonisation give us to understand how power works?” “What kind of conceptual intellectual tools does it give us to really understand these mechanics of power?” If we’re not asking these questions, we’re not taking the work seriously.
‘Decolonising is used as a buzzword’
Sadhvi Dar, senior lecturer at Queen Mary, University of London
When we look to the current resurgence of the Rhodes Must Fall campaign at the University of Oxford, we see how universities protect their racist colonial figures while continuing to exclude their black students and students of colour. Equally, the Rhodes Trust (created in line with Cecil Rhodes’ will) at the University of Oxford exists today as an international centre specialising in knowledge from the global south. This paradox exposes the problems with decolonising the curriculum through university management structures, because managers profits from a racialised curriculum while they claim to be working towards inclusion.
Moved by this, I co-wrote a blog piece called Is Decolonising The New Black? with my collaborators, Jenny K Rodriguez and Angela Martinez Dy. We argue that decolonising is increasingly used as a buzzword across university websites, teaching strategies and academic publications suggesting its radical politics are diluted while its usage as rhetoric accrues financial and symbolic value for the institutions and people employing it.
Decolonising movements in universities must recognise that from their inception they have been recolonised by European elites and so they need to be disruptive and aimed at destabilising existing management structures. I see hope in students running their own movements by using digital platforms. For example, POC Squared is a student-led campaign organised by three women of colour in science and produces podcasts, online resources and interrogates curricula to challenge its colonial roots. Equally, the Decolonizing Alliance, an international collective of students and academics, actively challenge exclusion and recently formed a writers collective which interrogates the meaning of solidarity and mutual care. These movements work outside the university capturing their members’ lived experiences while resisting creating value for the university.
‘These efforts can’t be driven by students alone’
Clive Nwonka, fellow at the London School of Economics
There is no universal meaning to decolonisation within UK higher education. This has produced an uncertain and ambiguous set of approaches that differ between universities, departments and subjects. That just 24 of 128 universities have declared that they are committed to decolonising their curriculums is shocking, but we should recognise that there are implicit and explicit forms of decolonising the curriculum.
For example, making a curriculum more diverse, international or inclusive does not necessarily mean it has been decolonised. These interventions can be as minimal as introducing black reading into an otherwise Eurocentric programme of study, or offering a special lecture on race. Often, this focuses on African American and black British history and literature. While this is crucial, it disregards key areas of study from the Africa, the Middle East and the rest of the global south.
There is still an inordinate focus on the curriculum as the primary – sometimes only – area of universities to be decolonised. But student admissions, staffing and recruitment, and campus culture all need to be tackled, too. Decolonisation should be a holistic experience of equality.
These efforts can’t be driven by students alone. Decolonising curriculums solely in response to student protest and demand places an additional burden on the student, particularly on those from black and minority backgrounds who are often at the forefront. Universities must take a more proactive approach to this transformation – one that does not need to be motivated by student disquiet.
A World Beyond Work?:
Labour, Money and the Capitalist State Between Crisis and Utopia
Ana Cecilia Dinerstein, University of Bath, UK
Frederick Harry Pitts, University of Bristol, UK

Labour, Money and the Capitalist State Between Crisis and Utopia
Ana Cecilia Dinerstein, University of Bath, UK
Frederick Harry Pitts, University of Bristol, UK

ReviewsSensing a future beyond work lurking in an age of crisis, the ‘post-capitalist’ utopias of today spread the idea of a permanent escape from work aided by the automation of production, a universal basic income and the reduction of working hours to zero. By skilfully unpicking the political economy of contemporary work and its futures, this book mounts a forceful critique of the post-work society vision.
Dinerstein and Pitts reveal that transitional measures towards a world beyond work do not do enough to break away from the key features of capitalist society, and instead potentially stifle the capacity for transformative social change. Proposing an innovative alternative, the authors envision the construction of ‘concrete utopias’ that shape and anticipate non-capitalist futures.
Chapter 1. Post-work, Post-capitalism, Post-what? An Introduction
Chapter 2. Futures Past and Present: On Automation
Chapter 3. The Post-Work Prospectus: On Labour
Chapter 4. Productivist Mandates: On Value
Chapter 5. Pennies from Heaven: On Money
Chapter 6. Basic Income in One Country: On the State
Chapter 7. Liquidating Labour Struggles? On Social Reproduction
Chapter 8. Hope and Prefigurative Translation: On Utopia
‘Ana Cecilia Dinerstein and Frederick Pitts' book is a fundamental contribution to the debate on post-capitalist utopias. The Coronavirus crisis has accelerated the morbid symptoms of austerity-driven capitalism, and we must develop new strategies to escape the increasingly authoritarian trends of nation-states. A World Beyond Work offers a blueprint ready to develop a future against and beyond capitalism. This will be an essential read for the next decade.’ - Dr Mònica Clua Lozada, The University of Texas Rio Grande Valley
‘A World Beyond Work? is one of the great books of our generation. The future of work and the notion of basic income are topics on which every active citizen must form a view. Too often, these topics are discussed by referring to money and the state in an untheorised and, ultimately, naive way. Dinerstein and Pitts avoid these pitfalls by drawing on the work of Marx. Political issues and issues in the social sciences compete for attention and, sometimes, have an ephemeral feel. A World Beyond Work? is different. It is a landmark. We shall be consulting Dinerstein and Pitts for years.’ - -Richard Gunn, co-founder of open Marxism
‘As we look towards building the economic order of the 21st century, post-capitalist and post-work visions capture the interest of many across the left and beyond. Dinerstein and Pitts undertake the necessary work of taking this stance seriously, offering a balanced, dense, thoughtful and enriching critique.’ - -Alessandro Gandini, University of Milan
‘This is a timely and important book. In it, Dinerstein and Pitts carefully dissect loose arguments that automation and basic income necessarily promise a better future. Their theoretical and empirical rigour offer a vital corrective to misplaced and uncritical hope and invite scholars and activists to think carefully about the demands they are making, how, and why.’ - -Neil Howard, University of Bath
‘This book offers a scholarly contribution to studies of value, work, (un)employment, and social movements in the 21st Century. This is also a book about hope and creativity at a time of narrow horizons and bleak pessimism. It brings to us a world with new possibilities of freedom. Dinerstein and Pitts point to new pathways to this world – pathways broader than postwar social democracy, more radical than the traditional communist parties, and carefully attuned to our own times of overlapping crises of profitability, living standards, health and the environment. A must!’ - -Alfredo Saad-Filho, King’s College London
'This is a ground-breaking contribution to debates about the future of work, mechanisation and social reproduction. Anyone interested in these themes – and particularly the highly topical issue of universal basic income – should read Dinerstein’s and Pitts’ powerful critique. The authors offer a vital antidote to the technological utopianism widespread on the left today.' - Adrian Wilding, Humboldt-Universität zu Berlin
Dernière édition par Florage le Mer 17 Juin - 15:09, édité 1 fois
Invité- Invité
 LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE
déniché par Ana Cecilia Dinerstein, @CDinerstein, dont paraîtra en 2021, cosigné avec Frederick Harry Pitts, A World Beyond Work?: Labour, Money and the Capitalist State Between Crisis and Utopia. Présentation et sommaire dessous
Ana me dit : « I will start writing "Decolonial Marxism" (Pluto press) next month... submit in April. » Je me disais que Décoloniser le marxisme était mieux que Marxisme décolonial. Ana me dit que le titre actuel serait 'Decolonizing Communisme, Democraty and the Commons', préférable à mon sens à Marxisme décolonial ou Communisme décolonial, une nuance qui donne l'impression d'une double détermination structurelle du capitalisme, "de classe" et "de race", sur le même plan
Interview
'Students want to confront it':
academics on how to decolonise the university
Sadhvi Dar, Manali Desai and Clive Nwonka
The Guardian, 17 Jun 2020
'Students want to confront it':
academics on how to decolonise the university
Sadhvi Dar, Manali Desai and Clive Nwonka
The Guardian, 17 Jun 2020
Students have been calling for decolonised curriculums for years, yet few UK universities have made meaningful changes

The Rhodes Must Fall campaign protests outside University of Oxford’s Oriel College
where a statue of imperialist Cecil John Rhodes looks out over the front door.
Photograph: Christopher Furlong/Getty Images
à paraître en 2021The Black Lives Matter movement has turned up the pressure on all areas of UK society to confront its colonial legacy. Within universities, this follows on from the widespread student campaigns which have been asking for decolonised curriculums and more thinkers of colour on reading lists since 2017. Yet recent research by The Guardian shows that only a fifth of universities have made genuine attempts to address the harmful legacy of colonialism.
Three academics tell us what’s holding universities back from making the changes that their students are demanding.
‘It’s not about how many black or brown authors are on the reading list’
Manali Desai, reader, University of Cambridge
What’s important to hold at the core of all of these discussions is the need for Britain, and white people especially, to really grapple with the colonial legacy. A tick-box approach to inclusion, diversity and equality isn’t going to cut it because these concepts do not address that legacy. It’s really important to hold that line between the colonial past and the racist present.
Universities often shove these things under the carpet. I think there’s something about the word colonial that people are allergic to. There’s a massive reluctance to address the colonial past, and it’s layered with this imperial nostalgia you see all around us. But I think this is a generational issue: frankly, the students want to confront these issues, and at Cambridge a lot of decolonising work has been driven by students and not by staff, despite how the press can sometimes frame it. A lot of the campaigning around it comes from white students as well as students of colour, although the latter shoulder a heavier burden.
Students’ consciousness is not framed in parochial British terms anymore. It can be a lightning rod to see what happened with George Floyd and police violence and to see connections with the UK. Students are thinking internationally and outside of the Eurocentric frames that have traditionally dominated sociology as a discipline. It’s no longer acceptable for us to teach sociology in the old way – the students find it utterly inadequate.
When we created our own decolonising sociology committee three years ago, we held an open meeting in the department that was attended by students and staff at all levels. It was a wide-ranging and honest conversation that covered all aspects of the department’s operations. We’ve since embedded decolonising into the life of the department – we have meetings once a month and we’ve also been looking at how we can connect with social justice and anti-racist campaigns in the city. But if we leave it up to students alone it won’t work because they’re a transient population – more permanent members of staff need to take responsibility on leading these things.
Since I’ve been working on decolonising, we’ve heard so much from detracting voices saying “What percentage of white authors are you going to remove? Does this mean you won’t read Kant and Hegel?” But the point isn’t a calculation about how many black or brown authors are on the reading list, but rather how does your curriculum train students to think critically about the present?
To me the question is: “What tools does decolonisation give us to understand how power works?” “What kind of conceptual intellectual tools does it give us to really understand these mechanics of power?” If we’re not asking these questions, we’re not taking the work seriously.
‘Decolonising is used as a buzzword’
Sadhvi Dar, senior lecturer at Queen Mary, University of London
When we look to the current resurgence of the Rhodes Must Fall campaign at the University of Oxford, we see how universities protect their racist colonial figures while continuing to exclude their black students and students of colour. Equally, the Rhodes Trust (created in line with Cecil Rhodes’ will) at the University of Oxford exists today as an international centre specialising in knowledge from the global south. This paradox exposes the problems with decolonising the curriculum through university management structures, because managers profits from a racialised curriculum while they claim to be working towards inclusion.
Moved by this, I co-wrote a blog piece called Is Decolonising The New Black? with my collaborators, Jenny K Rodriguez and Angela Martinez Dy. We argue that decolonising is increasingly used as a buzzword across university websites, teaching strategies and academic publications suggesting its radical politics are diluted while its usage as rhetoric accrues financial and symbolic value for the institutions and people employing it.
Decolonising movements in universities must recognise that from their inception they have been recolonised by European elites and so they need to be disruptive and aimed at destabilising existing management structures. I see hope in students running their own movements by using digital platforms. For example, POC Squared is a student-led campaign organised by three women of colour in science and produces podcasts, online resources and interrogates curricula to challenge its colonial roots. Equally, the Decolonizing Alliance, an international collective of students and academics, actively challenge exclusion and recently formed a writers collective which interrogates the meaning of solidarity and mutual care. These movements work outside the university capturing their members’ lived experiences while resisting creating value for the university.
‘These efforts can’t be driven by students alone’
Clive Nwonka, fellow at the London School of Economics
There is no universal meaning to decolonisation within UK higher education. This has produced an uncertain and ambiguous set of approaches that differ between universities, departments and subjects. That just 24 of 128 universities have declared that they are committed to decolonising their curriculums is shocking, but we should recognise that there are implicit and explicit forms of decolonising the curriculum.
For example, making a curriculum more diverse, international or inclusive does not necessarily mean it has been decolonised. These interventions can be as minimal as introducing black reading into an otherwise Eurocentric programme of study, or offering a special lecture on race. Often, this focuses on African American and black British history and literature. While this is crucial, it disregards key areas of study from the Africa, the Middle East and the rest of the global south.
There is still an inordinate focus on the curriculum as the primary – sometimes only – area of universities to be decolonised. But student admissions, staffing and recruitment, and campus culture all need to be tackled, too. Decolonisation should be a holistic experience of equality.
These efforts can’t be driven by students alone. Decolonising curriculums solely in response to student protest and demand places an additional burden on the student, particularly on those from black and minority backgrounds who are often at the forefront. Universities must take a more proactive approach to this transformation – one that does not need to be motivated by student disquiet.
A World Beyond Work?:
Labour, Money and the Capitalist State Between Crisis and Utopia
Ana Cecilia Dinerstein, University of Bath, UK
Frederick Harry Pitts, University of Bristol, UK

Labour, Money and the Capitalist State Between Crisis and Utopia
Ana Cecilia Dinerstein, University of Bath, UK
Frederick Harry Pitts, University of Bristol, UK

ReviewsSensing a future beyond work lurking in an age of crisis, the ‘post-capitalist’ utopias of today spread the idea of a permanent escape from work aided by the automation of production, a universal basic income and the reduction of working hours to zero. By skilfully unpicking the political economy of contemporary work and its futures, this book mounts a forceful critique of the post-work society vision.
Dinerstein and Pitts reveal that transitional measures towards a world beyond work do not do enough to break away from the key features of capitalist society, and instead potentially stifle the capacity for transformative social change. Proposing an innovative alternative, the authors envision the construction of ‘concrete utopias’ that shape and anticipate non-capitalist futures.
Chapter 1. Post-work, Post-capitalism, Post-what? An Introduction
Chapter 2. Futures Past and Present: On Automation
Chapter 3. The Post-Work Prospectus: On Labour
Chapter 4. Productivist Mandates: On Value
Chapter 5. Pennies from Heaven: On Money
Chapter 6. Basic Income in One Country: On the State
Chapter 7. Liquidating Labour Struggles? On Social Reproduction
Chapter 8. Hope and Prefigurative Translation: On Utopia
‘Ana Cecilia Dinerstein and Frederick Pitts' book is a fundamental contribution to the debate on post-capitalist utopias. The Coronavirus crisis has accelerated the morbid symptoms of austerity-driven capitalism, and we must develop new strategies to escape the increasingly authoritarian trends of nation-states. A World Beyond Work offers a blueprint ready to develop a future against and beyond capitalism. This will be an essential read for the next decade.’ - Dr Mònica Clua Lozada, The University of Texas Rio Grande Valley
‘A World Beyond Work? is one of the great books of our generation. The future of work and the notion of basic income are topics on which every active citizen must form a view. Too often, these topics are discussed by referring to money and the state in an untheorised and, ultimately, naive way. Dinerstein and Pitts avoid these pitfalls by drawing on the work of Marx. Political issues and issues in the social sciences compete for attention and, sometimes, have an ephemeral feel. A World Beyond Work? is different. It is a landmark. We shall be consulting Dinerstein and Pitts for years.’ - -Richard Gunn, co-founder of open Marxism
‘As we look towards building the economic order of the 21st century, post-capitalist and post-work visions capture the interest of many across the left and beyond. Dinerstein and Pitts undertake the necessary work of taking this stance seriously, offering a balanced, dense, thoughtful and enriching critique.’ - -Alessandro Gandini, University of Milan
‘This is a timely and important book. In it, Dinerstein and Pitts carefully dissect loose arguments that automation and basic income necessarily promise a better future. Their theoretical and empirical rigour offer a vital corrective to misplaced and uncritical hope and invite scholars and activists to think carefully about the demands they are making, how, and why.’ - -Neil Howard, University of Bath
‘This book offers a scholarly contribution to studies of value, work, (un)employment, and social movements in the 21st Century. This is also a book about hope and creativity at a time of narrow horizons and bleak pessimism. It brings to us a world with new possibilities of freedom. Dinerstein and Pitts point to new pathways to this world – pathways broader than postwar social democracy, more radical than the traditional communist parties, and carefully attuned to our own times of overlapping crises of profitability, living standards, health and the environment. A must!’ - -Alfredo Saad-Filho, King’s College London
'This is a ground-breaking contribution to debates about the future of work, mechanisation and social reproduction. Anyone interested in these themes – and particularly the highly topical issue of universal basic income – should read Dinerstein’s and Pitts’ powerful critique. The authors offer a vital antidote to the technological utopianism widespread on the left today.' - Adrian Wilding, Humboldt-Universität zu Berlin
Invité- Invité
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
en réponse plutôt subjective à la question-titre, c'est tout-à-fait l'impression que me donnent les Occidentaux, cultivés ou non, et parmi eux en tête les Américains et les Français de toutes obédiences politiques. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'ils continuent, ou du moins qu'ils essayent, y compris par des "théories à part"
Les Occidentaux ont-ils vécu dans un monde à part ?
Hervé Gardette, France Culture, 43 mn

Des mondes. Crédits : FotografiaBasica - Getty
Hervé Gardette, France Culture, 43 mn

Des mondes. Crédits : FotografiaBasica - Getty
Nous pensions être préservés des conflits, de la pauvreté, des épidémies. Mais le terrorisme, le réchauffement climatique, l’arrivée des réfugiés et le coronavirus nous ont fait comprendre que nous étions, nous aussi, vulnérables. L’occasion de repenser la place de l’Occident dans le monde ?
Pour la deuxième émission de ces Rencontres de Pétrarque inédites, un dialogue entre Romain Bertrand, spécialiste de "l'histoire connectée", Laetitia Strauch-Bonart, éditorialiste au Point et Achille M'Bembe, théoricien du post-colonialisme.
l'enfant de la liberté, série 'voilé-dévoilé' peintures 1992
Patlotch, 11 octobre 1992, pigments et transfert sur toile 27 x 40 cm
Invité- Invité
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
France Culture
Capitalisme, d'où viens-tu ?
4 épisodes (3 disponibles)
Quelles sont les origines du capitalisme et qu’en est-il de sa fin ? Des îles tropicales aux pendus de Londres dans le XVIIIe siècle quelles idées et institutions ont permis sa mise en place et sa perpétuation au fil du temps ?
Épisode 1 : Vie et mort du capitalisme
02/12/2019
Difficile de donner une date de naissance au capitalisme : remonte-t-il à la révolution industrielle, à la prise de pouvoir des classes bourgeoises, à la réforme protestante, aux grands voyages de la Renaissance ? Et qu'en est-il de sa mort ? Car souvent annoncée, elle n’en finit plus d’arriver...
Souvent annoncée, la fin du capitalisme n’en finit plus d’arriver. Le système dont on pointe les métamorphoses, les dysfonctionnements, les épuisements, les fissures continue pourtant d’étendre son emprise. Comment dès lors penser la fin d’un monde qui n’en finit jamais ? Le succès dès les années 1970 de la figure du zombie n’est pas étranger à cet état de fait. Nous recevons pour en parler Manouk Borzakian, géographe, postdoctorant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il est l’auteur de Géographie Zombie, les ruines du capitalisme, paru chez Playlist Society en mai 2019.
Épisode 2 : Capitalisme, le meilleur des mondes ?
03/12/2019
Les inégalités sont-elles une fatalité ? En enquêtant dans les discours que les sociétés passées ont tenu sur leurs propres dysfonctionnements, c’est un combat où des idées viennent activement au secours des puissants qui se dessine.
Le capital est une notion qui prend la tête. Comprenez : le mot capital vient du latin caput, la tête. Dans son acception juridique, sous forme d’adjectif, il possède une lecture assez sombre : il postule à avoir la tête tranchée, c’est la peine capitale, l’exécution capitale. Ce qui est « capital » est placé en tête, c’est le cas des lettres capitales, de la ville capitale, voire des péchés capitaux.
Ensuite, le mot capital conduit tête baissée vers la notion de fortune : il y a un peu de capital dans le mot cheptel, l’ensemble du bétail qui se trouve dans une ferme. C’est donc par la tête que le mot glisse vers l’argent, vers la richesse. En tout cas c’est ainsi qu’il apparaît au XVIe siècle : le capital est le principal d’une dette, d’une rente. Le mot devient une vedette au XIXe siècle avec Karl Marx et, pourquoi pas, au XXIe avec Thomas Piketty. Le capital est une notion complexe qui pèse sur notre tête quand n’en fait qu’à sa tête.
Nous recevons aujourd'hui Thomas Piketty, économiste, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'Ecole d'économie de Paris / Paris School of Economics. Il est notamment l’auteur de Capital et idéologie, paru au Seuil, 2019.
Épisode 3 : Les clichés capitaux
04/12/2019
Aujourd'hui Le Cours de l'histoire gratte le vernis du capitalisme, sous ses mots et ses images.
Ce sont des cartes postales que l’on s’échangeait à la Belle-Epoque, et dont le succès ne se dément pas aujourd’hui : on y voit des femmes en métier d’homme, afficheuses, cochères, conductrices de taxi, dans les rues du Paris de 1900. Quelle place la logique marchande a-t-elle eu dans la mise en avant de ces femmes et du progrès social qu’elles représentaient ?
Avec Juliette Rennes, sociologue, maîtresse de conférences à l’EHESS et chercheuse au Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS).
Elle a rédigé l'article « Femmes en métiers d’hommes. Récits de la modernité et usages marchands du féminisme dans le Paris de 1900 », publié dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine n°66 (2019).
Nous verrons que des artistes se sont quant à eux emparés des images et des mythes que produit le capitalisme pour les interroger, avec Marie Koch et Vladimir Demoule, qui signent le commissariat de l’exposition en trois parties Ici sont les dragons, et dont le troisième volet « Juste fais-le » est visible jusqu’au 14 décembre à la Maison Populaire de Montreuil.
Invité- Invité
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
pas trouvé d'autre sujet plus adéquat pour le caser. J'en avais un dans le temps sur la restructuration en cours du capitalisme mondial, c'eût été sa place, et je rajoute le terme au titre du sujet
j'ai trouvé amusant ce petit billet d'Agamben retournant la nature capitaliste des anciens pays "communistes", qui est maintenant éclatante en Chine (ou au Vietnam), en un capitalisme communiste, pour caractériser le capitalisme mondial qui vient par leur domination. Un peu gênant tout de même de qualifier le capitalisme de "communiste" au sens de ce qui ne l'était pas, mais on a l'habitude, et le texte est clair
au fond, je me demande si ce n'est pas plus pertinent, dans le contenu comme dans la forme, que d'annoncer tous les quatre matins un nouveau fascisme. Ce n'est pas tant la conjoncture pandémique qui pousserait à la restructuration capitaliste avec une "dictature sanitaire", que la plus grande efficacité des stratégies asiatiques, et notamment chinoise, pour combattre ce virus. Or cette différence tient à la forme chinoise de gouvernance du capitalisme par l'État
je donne la version traduite pour la revue Ill Will de la version italienne pour Quodlibet : Capitalismo comunista
COMMUNIST CAPITALISM
Giorgio Agamben, Translated by Richard Braude
First published on Quodlibet, December 15th, 2020

Giorgio Agamben, Translated by Richard Braude
First published on Quodlibet, December 15th, 2020

The form of capitalism that is being consolidated on a planetary scale is not that which it had assumed in the West: it is, rather, capitalism in its communist variation, which unites an extremely rapid development of production with a totalitarian political regime. This is the historical significance of the leading role that China is taking on, not only in the realm of the economy in a narrow sense, but also – as the political use of the pandemic has so eloquently demonstrated – as a paradigm for the government of men. That the regimes established in so-called communist countries were a particular form of capitalism, specially adapted for economically backward countries and thus labelled ‘state capitalism’, was perfectly clear to anyone who knows how to read history; what was entirely unexpected, however, is that this form of capitalism, which seemed to have exhausted its function and was thus now obsolete, was instead destined – in a technologically updated configuration – to become the ruling principle of the current phase of globalized capitalism. Indeed, it is possible that today we are observing a conflict between Western capitalism, which used to exist alongside the ‘state of law’ and bourgeois democracy, and this new communist capitalism, a conflict in which the latter version appears to have emerged as the victor. What is certain, however, is that the new regime will combine the most inhumane aspects of capitalism with the most atrocious aspects of state communism, combining the extreme alienation of relations between people with an unprecedented social control.
La forme du capitalisme qui se consolide à l’échelle planétaire n’est pas celle qu’elle avait assumée en Occident : c’est plutôt le capitalisme dans sa variation communiste, qui unit un développement extrêmement rapide de la production à un régime politique totalitaire. C’est l’importance historique du rôle de premier plan que la Chine joue, non seulement dans le domaine de l’économie au sens étroit, mais aussi – comme l’utilisation politique de la pandémie l’a si éloquemment démontré – comme paradigme pour le gouvernement des hommes. Que les régimes établis dans les pays dits communistes soient une forme particulière de capitalisme, spécialement adaptée aux pays économiquement arriérés et ainsi étiquetée « capitalisme d’État », était parfaitement clair pour tous ceux qui savent lire l’histoire; ce qui était tout à fait inattendu, cependant, c’est que cette forme de capitalisme, qui semblait avoir épuisé sa fonction et était donc maintenant obsolète, était plutôt destinée – dans une configuration technologiquement mise à jour – à devenir le principe dirigeant de la phase actuelle du capitalisme mondialisé. En effet, il est possible qu’aujourd’hui nous observions un conflit entre le capitalisme occidental, qui existait aux côtés de l'«État de droit » et de la démocratie bourgeoise, et ce nouveau capitalisme communiste, un conflit dans lequel cette dernière version semble avoir émergé comme le vainqueur. Ce qui est certain, cependant, c’est que le nouveau régime combinera les aspects les plus inhumains du capitalisme avec les aspects les plus atroces du communisme d’État, combinant l’aliénation extrême des relations entre les peuples avec un contrôle social sans précédent.
Invité- Invité
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
du 3 juin, je rajoute une photo, que m'envoie l'ami Adé, "sans commentaire", je crois que c'est l'année de sa naissance, moi j'avais 4 ans, ailleurs j'aurais pu être en cage. C'est à cet âge que, ma grand-mère m'ayant emmené dans un parc à Vichy avec un jardin d'enfants, j'ai découvert mon premier "Noir", un gamin comme moi. Je n'en avais jamais vus, même en photo. Il jouait comme moi à deux pas, j'étais stupéfié
Congo belge, 1955
sur le "décolonialisme" en cours
CAPITALISME OCCIDENTAL : UN NEW DEAL POST-POST-COLONIAL
dessous, 31 mai
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS, à propos des excuses allemandes pour son génocide en Afrique
« Le fait colonial est un thème majeur pour l’Europe, sur deux fronts :les décisions se précipitent de la part des dirigeants occidentaux pour reconnaître des crimes coloniaux et/ou racistes remontant au siècle dernier et parfois plus loin dans l'histoire coloniale et celle de l'esclavage (Macron et le Rwanda, Biden et Tulsa, l'Allemagne et la Namibie, le Canada et ses 'Autochtones'...*), comme s'ils s'étaient donnés le mot. Quelle mouche les a piqués ? Qu'est-ce qui ne pouvait plus continuer comme avant et pourquoi ?
* ajout 3 juin : Kamloops: le Pape invite à «se détourner du modèle colonisateur», VaticanNews
pour le dire très vite, un moment historique s'achève et s'établit un équilibre entre d'une part les luttes antiracistes et la poussée décoloniale depuis une quinzaine d'années et d'autre part les besoins politiques et économiques des pays capitalistes occidentaux concernés confrontés à leur perte de suprématie dans le monde, une sorte de compromis historique comparable avec ceux du deuxième tiers du 20e siècle, entre le keynésianisme et les décolonisations (inachevées). L'article du monde présente l'intérêt de le dire, concernant l'Europe, entre les lignes
un certain feeling de l'histoire
comme écrit plus bas lire les explications du penseur africain Achille Mbembe pour savoir pourquoi il met les pieds dans cette galère. À mon avis, il a senti, comme Macron en face qui multiplie les signes politiques en direction du "monde noir" et de la jeunesse africaine dont immigrée, qu'un tournant historique était possible. Celui-ci représente adéquatement les intérêts du capitalisme français, et peut espérer l'appui sans faille de ses dirigeants dans sa compétition électorale avec la droite traditionnelle et Marine Le Pen qui appartiennent, de ce point de vue, au monde d'avant, comme les Trump, Bolsonaro & Cie
celui de la géopolitique et celui de l’identité »
Sylvie Kauffmann, éditorialiste au « Monde », 1er juin
31 maiChronique. Le saviez-vous ? Rendant compte en « une », le 21 février 1957, d’un progrès décisif dans la négociation des Six sur un marché commun européen, Le Monde titrait : « Première étape vers l’Eurafrique ». Réunis à Matignon, les chefs de gouvernement des six pays fondateurs n’avaient mis que treize heures – déjà ! – pour lever les derniers obstacles au traité qui devait être signé à Rome. Face aux Allemands et aux Néerlandais qui « traînaient les pieds », nous raconte l’article de Pierre Drouin, la France avait notamment réussi à imposer l’association des territoires d’outre-mer au marché commun. A sa signature le 25 mars 1957, le traité de Rome couvrait une zone territoriale dont 75 % étaient situés hors de l’Europe géographique : essentiellement les colonies françaises et belges d’Afrique.
Plus de six décennies plus tard, un président français qui se targue d’être né après la colonisation confie au Journal du dimanche, entre Kigali et Pretoria, sa fierté d’avoir « réussi à bâtir un axe euro-africain ». Rien à voir, bien sûr, avec la défunte « Eurafrique » dont Léopold Sédar Senghor, qui y voyait un véhicule de développement pour son continent, fut le plus ardent défenseur, alors qu’elle n’était qu’un prolongement de l’empire colonial.
Un thème majeur
Mais « l’axe euro-africain » dont rêve Emmanuel Macron, et qui n’a pour l’instant qu’une timide traduction diplomatique, illustre l’idée d’une communauté de destin entre le Vieux Continent et ce continent si jeune où, M. Macron en est convaincu, « se jouera une partie du basculement du monde ». Pour que cette communauté de destin se forme, cependant, il faut l’établir sur des bases fondamentalement différentes. Le président français s’y est attelé, en s’appuyant notamment sur une diplomatie mémorielle volontariste ; la dimension européenne de cet effort, elle, se fait attendre.
C’est pourtant un thème majeur pour l’Union européenne (UE). Sur deux fronts : celui de la géopolitique et celui de l’identité européenne.
Le discours identitaire, avec la montée du mouvement décolonial aux Etats-Unis, « est en passe de détrôner le discours de la guerre froide centré sur l’affrontement entre démocratie et communisme, nous dit l’essayiste Ivan Krastev. Dans un tel contexte, l’Europe est en position de faiblesse en Afrique face à la Chine : la Chine se présente comme une victime du colonialisme qui défend la souveraineté des Etats postcoloniaux contre les pratiques européennes néocoloniales ». Si elle veut contrer l’influence de la Chine, de la Russie ou de la Turquie en Afrique, l’Europe doit se débarrasser de tous soupçons colonialistes.
Le débat sur l’identité européenne ne peut pas non plus se dispenser d’une réflexion sur l’héritage colonial. Chercheur au think tank Chatham House à Londres, Hans Kundnani a lancé la discussion dans un article publié en février par The New Statesman : « Que signifie être pro-européen aujourd’hui » ? De père indien et de mère néerlandaise, élevé en Grande-Bretagne, Kundnani explique que l’affirmation « agressive » de l’identité européenne le met « mal à l’aise », car elle exclut la part asiatique de sa propre identité. A l’époque coloniale, le terme « Européen » désignait les Blancs. Kundnani voit « une sorte de continuité entre le colonialisme européen et le projet européen », le second remplaçant le premier ; il note aussi que le récit de la construction de l’UE « passe sous silence l’histoire du colonialisme et ses implications ».
Le fait est que, si le récit de l’UE puise abondamment dans les guerres meurtrières qui ont ravagé le continent, dans l’indispensable réconciliation franco-allemande puis dans le combat de la liberté contre le communisme pendant la guerre froide, il est muet sur le fait colonial, pourtant présent à la naissance comme le rapportait Le Monde en 1957 et qui, après les différents élargissements, ne concerne pas que la France et la Belgique.
L’héritage des Lumières
Trois mois plus tard, Hans Kundnani nous dit avoir été surpris par la vigueur des réactions à son article au sein de l’establishment européen, sur un débat pourtant installé dans les cercles académiques. Ce qui a le plus choqué, en réalité, est l’autre élément de son argumentaire, selon lequel en se prétendant « civilisationnel », le projet européen serait exclusif de la diversité ethnique. Non, lui a répondu Mark Leonard, directeur du think tank European Council on Foreign Relations ; pour l’Europe, « l’Autre » n’est pas la population non blanche ; « le principal Autre de l’Europe, c’est son propre passé ».
Pour l’économiste et chercheur Shahin Vallée, on peut avoir une conception du projet européen inspiré des Lumières, universaliste et, à ce titre, ouvert à la diversité. Mais, nous dit-il, « la reconnaissance du fait colonial est centrale, car elle explique les origines de la société multiculturelle et multicultuelle » en Europe. C’est aussi ce qui déterminera un débat rationnel sur les migrations. Dans la quête des éléments constitutifs de cette identité européenne, d’autres, comme Martin Sandbu, chroniqueur au Financial Times, préfèrent retenir l’héritage fondateur des Lumières, l’économie sociale de marché et le dépassement de l’Etat-nation.
A l’heure où l’Europe se cherche un nouveau récit susceptible de faire pièce aux récits américain, russe ou chinois, elle n’a plus le luxe de choisir entre les pans de son histoire qu’elle veut bien éclairer et ceux qu’elle préfère laisser dans l’obscurité – surtout quand certains pans, comme la colonisation, ne sont pas communs à tous les Etats européens.
L’héritage des Lumières impose, précisément, ce devoir de mémoire, que boudent les régimes autoritaires et que les extrêmes de tout bord cherchent à travestir. La restitution aux pays d’Afrique du patrimoine culturel saisi pendant la conquête coloniale est un élément de ce processus. Elle a commencé
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
rapidement, parce que pathétique si ce n'était fort tardif aveu de ce qu'écrivait Rosa Amelia Plumelle-Uribe en 2001 dans La férocité blanche: des non-blancs aux non-Aryens : génocides occultés de 1492 à nos jours, et venant d'un pays qui a su si bien, mieux que d'autres, faire "la repentance" de son antisémitisme nazi absolu
on dirait que la pensée décoloniale est passée par là, conspuée de partout, mais au-delà de ses dérives racialistes efficace en lame de fond contre le racisme structurel de l'Occident blanc capitaliste
l'Allemagne de Merkel, donc, comme en écho à la France de Macron de passage au Rwanda et en Afrique du Sud, inspiré par Achille Mbembe* et ses ami.e.s
* note du 2 juin : lire les explications du penseur africain pour savoir pourquoi il met les pieds dans cette galère. À mon avis, il a senti, comme Macron en face, qu'un tournant historique était possible, voir mon chapeau à l'article du Monde plus haut
plus d'un siècle après
L'Allemagne reconnaît son génocide en Namibie

Photographie prise vers 1900 au cours de la guerre allemande de 1904-1908
contre les Herero et les Nama en Namibie.
HANDOUT/AFP
une lecture, sourceL'Allemagne reconnaît son génocide en Namibie

Photographie prise vers 1900 au cours de la guerre allemande de 1904-1908
contre les Herero et les Nama en Namibie.
HANDOUT/AFP
La mission civilisatrice se déplace ensuite vers l’Afrique. En Namibie par exemple, tout est clair dès le départ : “N’épargnez aucun homme, aucune femme, aucun enfant, tuez-les tous.”, dixit le Roi Guillaume II de Prusse en 1904. Il fut entendu, et obéi à la lettre par son General en Chef, Lothar Von Trotha : “A l’intérieur des frontières allemandes, tout Herero, qu’il soit trouvé avec ou sans fusil, avec ou sans bétail, sera abattu.”. Voilà qui a le mérite d’être clair.
Au final, une extermination des Hereros à 90%, qui préfigurait déjà de ce qui se passerait 40 ans plus tard [en Europe]. Au Congo du Roi Léopold, ce sont des mains que l’on tranche et que l’on fume (sic) pour les conserver; ce sont des têtes que l’on coupe et dont le squelette crânien est utilisé pour entourer des parterres de fleurs; ce sont des dizaines de milliers d’africains qui crèvent sous le fouet et la rigueur des travaux forcés. Mais ce sont aussi d’inoubliables souvenirs.
Tenez : “La potence est dressée. La corde est attachée trop haut. On soulève le moricaud et on lui passe le noeud coulant. La corde tourne quelques instants, et puis crac, l’individu est à terre qui gigote. Un coup de feu dans la nuque et le tour est joué. Pas la moindre impression cette fois! Et dire que la première fois que j’ai vu administrer la chicotte, j’en ai pâli d’effroi. L’Afrique a du bon tout de même. J’irai maintenant au feu comme à une noce.” Les mêmes causes produisant les mêmes effets, pas de surprise donc: la population de l’Afrique sub-saharienne passera de 200 à 130 millions d’habitants entre 1860 et 1930.
Puis ce qui devait arriver arriva : la Bête se retourna contre elle-même; elle chercha parmi les Blancs ceux qui étaient les moins Blancs, décida que c’était les Juifs, et les sacrifia sur l’autel de la pureté de la race. Lente descente aux enfers qui se solda par la spoliation, la déshumanisation et l’extermination de 6 millions de Juifs, dans des conditions cauchemardesques, infra-humaines. Et contrairement au cliché commode qui a vu en ce drame la folie paranoïaque d’une minorité fasciste, l’auteur démontre ici, fort brillamment, que la Shoah fut non seulement l’aboutissement d’une philosophie qui germa des siècles auparavant, mais surtout que le peuple allemand lui-même fut plus que complice; nous dirons acteur.
A la fin de la seconde guerre mondiale, pourtant, la blanchitude se réconcilie et recommence à fouetter les chats d’avant. En Afrique du Sud, la suprématie blanche est légalement réinstaurée, avec l’appui de la France, des Etats-Unis d’Amérique, d’Israël même. Aux Etats-Unis, ce sont les Nègres qu’on lynche entre deux barbecues. Dans le reste de l’Afrique, ce sont des “maquisards” et des “rebelles” qu’on nettoie méthodiquement.
Impressionnant tour de force, La férocité blanche d’Amelia Plumelle-Uribe est sans doute l’un des documents les plus incontournables et les plus complets sur les crimes commis sur les sous-hommes au nom de la civilisation et de la suprématie raciale blanche. Car au delà des faits rapportés qui sont par essence indiscutables, le lecteur objectif ne peut que s’incliner devant la limpidité du style, la pertinence des analyses et la profondeur de la réflexion qu’offre ce travail titanesque mais toujours fluide, facile à lire.
Elle aura évité la compilation de drames, l’anecdotique et la superficialité du fait brut, pour proposer une œuvre dont le but est non pas de décrire pour susciter l’émotion, mais d’expliquer pour permettre la compréhension vraie. Le ton dépassionné et sans complaisance donne encore plus de dignité à ces pages sombres de l’Histoire qu'une certaine bien-pensance occidentale veut déchirer en petits morceaux et balayer sous le tapis.
Déjà un classique.
Invité- Invité
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
du 31 août, complété

Un combattant taliban près d'un stand vendant du jus de canne à sucre
sur un marché du quartier de Kote Sangi à Kaboul, le 17 août 2021. AFP, Hoshang Hashimi
17 août
4. LA PAIX, À QUEL PRIX ?
20 aoûtPatlotch a écrit:[color=#0000cc]du point de vue du mot d'ordre 2. ARRÊTER LA GUERRE, force est de constater que la situation actuelle est un succès, et que les dernières semaines ont épargné les vies humaines plus que jamais depuis 20 ans. Voir, sur ond de nostalgie de l'occupation américaine, la presse de ces dernières heures. Cerise sur le gâteau que certains avaient annoncée (dont Olivier Roy), les Talibans pourraient devenir alliés des États-Unis dans la guerre au terrorisme partant d'Afghanistan*
* ajout : déjà le porte parole des talibans appelle les diplomates américains à revenir
doit-on au nom de ce bilan provisoire s'inquiéter plus que nécessaire devant ce qui va suivre de moins réjouissant pour que les Talibans demeurent les Talibans, au nom de la loi par la Charia ? Car c'est là la limite à leur modération. Je n'ai franchement pas sur le sujet d'avis tranché, car je ne pense pas que la religion d'État qui sévit partout sous la loi du capitalisme ait été ou puisse devenir un facteur de paix, pour autant que l'on vise principalement celle-ci, alors que les révolutionnaires visent eux la guerre civile sans laquelle on ne saurait pour eux sortir de ce système. On sait que je n'y crois pas davantage que Jacques Camatte...
on dira aussi, pour reprendre la célèbre formule de Mitterrand*, que les pacifistes sont à l'ouest, mais dans le sens de l'expression anglaise**, et pour l'heure que les roquettes ne tombent pas (encore) sur l'Occident
* « Les pacifistes sont à l’Ouest, et les missiles sont à l’Est. » le 20 janvier 1983 au Bundestag à Bonn, RFA
** de la phrase anglaise "to go west" qui signifie "être tué". Par la suite, la mort a été remplacée par un état d'engourdissement
pourtant, s'il est un combat légitime, crédible et efficace, c'est le pacifisme quand il est possible pour d'autres causes d'arrêter une guerre, ou de ne pas la (re)commencer. C'est pourquoi j'ai critiqué les va-t'en guerre à la Eric Ciotti, qui a renouvelé ce matin son appel à « l'aide logistique » des résistants autour du petit Massoud, qui au demeurant n'entend les armer que défensivement, sans promouvoir une résistance armée. Ciotti plaide aussi pour « une restriction du droit du sol aux seuls enfants de ressortissants européens » et pour « suspendre le regroupement familial dans ce contexte de menace terroriste » : bienvenue aux familles afghanes dans la France qu'il présiderait !
quant à mon analyse dans 1. ADIEUX À L'ORDRE DU MONDE TANT AIMÉ, je la confirme. J'apprécie de lire, ici, l'ancien ambassadeur qui dit "Les Etats-Unis ne doivent plus être les gendarmes du monde". Ce président, qui "entérine une politique de retrait relatif des Etats-Unis de la scène du monde", est celui d'un tournant historique qu'il a assumé face à son opinion publique à courte vue, car il a raison d'affirmer que « c'était le départ ou l'escalade militaire. » L'"éditorialiste internationale" de LCI, Catherine Jentile de Canecaude, n'a pas plus changé de logiciel que la plupart de ses confères qui regardent le présent avec les lunettes d'hier : "Biden devra prouver qu'il est encore capable de gouverner la première puissance mondiale", car lui sait qu'il sera le premier président de la perte de suprématie américaine et qu'il devra piloter le Titanic américain dans ce changement de cap
l'autre côté de la monnaie est le grand remplacement des USA envisagé par la Chine et ses alliésPlus tôt cette semaine, l’envoyé spécial de la Chine pour les affaires afghanes, Yue Xiaoyong, a déclaré au portail d’information chinois Guancha.cn que Pékin était prêt à participer au « reconstruction pacifique » d’Afghanistan et « disposé à fournir de l’aide ».
Notant la volonté de la Chine de développer un « la situation gagnant-gagnant » avec les talibans, Yue a déclaré que les pourparlers avec le groupe avaient été ouverts par l’intermédiaire de l’Organisation de coopération de Shanghai, un bloc commercial, politique et de sécurité de plus en plus influent au sein duquel l’Afghanistan a le statut d’observateur.
source
3. PETIT CHAOS DEVIENDRA GRAND
esquissePatlotch a écrit:le chaos à l'aéroport de Kaboul, dans ce qu'il concentre et condense de causes connues et conséquences largement imprévisibles, est sans doute le premier événement mondial annonçant le basculement dans la suprématie politique et économique, voire militaire, dans la mondialisation capitaliste
la seule idée de la foule des aspirants au départ écrasant à mort quelques-uns des leurs laisse attendre le grand chaos mortifère dans la crise qui accompagne ce tournant historique un peu partout dans le monde, avec une impuissance manifeste du prolétariat des "sans réserve" à engager un combat communiste universel
j'ai peut-être ci-dessous parlé un peu vite d'une possibilité de stabilité avec les Talibans au pouvoir. La formule de Biden est assez juste : « Je crois qu'ils traversent une sorte de crise existentielle pour savoir s'ils veulent ou non être reconnus par la communauté internationale comme un gouvernement légitime »
mais réciproquement, l'Occident aussi est en crise existentielle, ce dont témoignent les contradictions et divergences sur la question migratoire. D'un côté il veut afficher sa morale des droits de l'homme et de la femme partout dans le monde, d'une autre il craint d'y perdre son identité en accueillant qui ne la partage pas
bref, le monde entier est embarqué dans une logique diabolique de chaos, voire de chaos déterministe (voir Théorie du chaos)
[...]
2. ARRÊTER LA GUERRE
quelques remarques engagées sur la situation et les perspectives en Afghanistan
quelques remarques engagées sur la situation et les perspectives en Afghanistan
Patlotch a écrit:ajout 20 août
en considérant ce que j'ai écrit sans trop m'interroger sur ma prise de position tranchée, je pense après coup que le sens général en est Arrêter la guerre, que j'assume et retiens comme titre. Je crois nécessaire, dans la situation, de prendre parti, de façon très immédiate, et sans excès de théorie sur ce qui serait "juste" ou non d'un point de vue communiste. Aussi bien n'est-ce là qu'un parti personnel
toutes choses égales par ailleurs, domination militaire et politique des Talibans acquise et durable, la résistance armée ne ferait qu'empirer les choses et durcir leur position, y compris contre les femmes, y compris pour les risques accrus de terrorisme
Things Ain't What They Used to Be, Duke Ellington
On ne fait pas de politique autrement que sur des réalités.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe ! L'Europe ! L'Europe !
mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien.
Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont.
Charles de Gaulle, 1965
On ne fait pas de politique autrement que sur des réalités.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe ! L'Europe ! L'Europe !
mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien.
Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont.
Charles de Gaulle, 1965

Un combattant taliban près d'un stand vendant du jus de canne à sucre
sur un marché du quartier de Kote Sangi à Kaboul, le 17 août 2021. AFP, Hoshang Hashimi
Patlotch a écrit:je tente une synthèse de ce que j'ai compris jusque-là, avec comme d'hab' les liens pour qui veut approfondir le sujet. Je prends prétexte d'une réaction à un tweet dans un fil de "France-Info" : Afghanistan : la communication, nouvelle arme des Talibans pour tenter de redorer leur imageSénéchal a écrit:Les talibans seront crédibles lorsque leur porte parole sera une femme non voilée et que leurs universités seront classées au niveau mondial
les Talibans sont crédibles dans la mesure où, depuis leur reprise du pouvoir, ils font essentiellement ce qu'ils disent, et ils n'ont pas promis de changer d'idéologie. Une crédibilité, n'en déplaise, que leur accordent les deux plus grandes puissances du monde, les USA en discutant avec eux depuis des années, et la Chine recevant fin juillet leur leader le mollah Baradar pour négocier les conditions de leur retour au pouvoir. Ajout 20 août : De plus, toute leur opposition politique veut négocier avec eux, y compris Amrullah Saleh, chef des derniers résistants armés aux Talibans (voir ici)
vérité à Paris, erreur à Kaboul
alors que le sous-ministre de Le Drian, Clément Beaune, claironne à Paris "Avec les Talibans, on ne discute pas", à Kaboul "Le patron du Raid, J-B Dulion, détaille comment il a «négocié» l’exfiltration de 350 Français et Afghans avec les talibans" : « L’itinéraire était tenu secret et a fait l’objet d’une négociation constante avec une autorité talibane qu’on a réussi à identifier et dont on a senti que c’était quelqu’un avec qui on pouvait discuter et qui avait un vrai pouvoir » source
d'une façon générale, rien ne se passe là-bas comme martelé par les médias français et la plupart des politiques, hormis, prudents car aux manettes, les dirigeants français. Ainsi, force est de constater que le sang n'a pas coulé à Kaboul comme supposé par Guillaume Larrivé (en retard) : « Le sang de Kaboul et les larmes de l’Occident »
à poursuivre dans ce registre d'aveugle panique sur la base des images du "chaos inévitable" provoqué par le retrait (Joe Biden), les politiciens français au grand cœur universel risquent fort de se planter, comme déjà Delphine Batho : "Je ne crois pas du tout à l’histoire des talibans inclusifs, la France ne doit pas reconnaître ce régime et doit l’isoler au maximum sur le plan international"
d'abord, la France ne reconnaît pas des régimes mais des États. Ensuite, la France n'a aucun moyen d'« isoler l'Afghanistan au niveau international », et si elle s'y essayait, c'est elle qui se priverait de relations apaisées avec le peuple afghan lui-même en tâchant de maintenir certains des liens qu'elle a tissés depuis décennies en dehors de sa participation à l'intervention armée de l'OTAN, et elle prendrait alors le risque d'attiser indirectement les menaces terroristes sur son sol, qu'elle combat
il est donc probable que le gouvernement français sera plus réaliste et responsable que ceux qui, avec BHL et Hidalgo [rejoints par l'ultra-droite Éric Ciotti], appellent à soutenir la "résistance" derrière le petit Massoud, qui a passé "7 ans à Londres pour apprendre l'art de la guerre", de retour en Afghanistan en inconnu des Afghans, isolé dans sa vallée du Panchir, avec l'ex-vice-président afghan, Amrullah Saleh, à contre-courant des pourparlers actuels entre Talibans et ex-dirigeants, soutenus par l'ex-Président, l'anthropologue Ashraf Ghani, qui envisage même son retour (source)
la Résistance parigo-afghane en marche, 21 mars 2021. Shutterstock
18:35, ajout après lecture de la résistance qui s'organise dans la vallée du Panshir "n'a pas de perspective de succès", selon Gilles Dorronsoro, corroborant ma compréhension des chosesDans une tribune dans le Washington Post, Ahmad Massoud réclame un soutien américain en armes et munitions pour ses milices. Peut-il l'obtenir ?
Tout dépend de la stratégie de Joe Biden. Aujourd'hui, l'Afghanistan voit une guerre civile de 40 ans se terminer. Donner des armes à Ahmad Massoud et à Amrullah Saleh, l'ancien vice-président avec qui il travaille en ce moment, c'est donc relancer une guerre civile en Afghanistan. C'est un pari politique qui me paraît dangereux. Pourquoi ? Parce que premièrement, il n'y a pas de perspective de succès à moins de combats pendant 10, 15 ou 20 ans. Deuxièmement, ça peut amener à une radicalisation des talibans et on sait que l'Afghanistan peut facilement devenir un endroit dangereux pour les pays occidentaux, notamment du fait de la présence d'Al-Qaïda, etc. Je crois aussi que ce calcul est dangereux pour la population afghane elle-même.
Olivier Roy : « Les Talibans ne sont pas des djihadistes, ils veulent un Etat islamique en Afghanistan. Ils ne veulent pas l'étendre. Ils demandent des relations diplomatiques avec l'ensemble des pays du monde. Ce qui n'est pas tellement un programme djihadiste. »
bref, les spectateurs européens et français pourraient être surpris par les faits, la situation en Afghanistan évoluant tout différemment des annonces catastrophistes qu'on leur assène, en attendant les "experts" émigrés qui seront accueillis sur les plateaux, élites intellectuelles de la classe moyenne ayant fui Kaboul, ignorant ce qui se passe réellement dans le pays, et occultant les conditions dans lesquelles depuis des mois, avec l'assentiment contraint et impuissant des USA dont convient Biden, les Talibans ont gagné la confiance dans les provinces conquises sans combats, y compris en intégrant dans leurs rangs d'autres ethnies que les Pachtounes, geste « inclusif » s'il en est dans ce pays aux divisions ethniques séculaires
« Les Talibans n'auraient jamais repris le pouvoir à Kaboul s'ils avaient perdu la confiance d'une partie de la paysannerie afghane. Dans le sud, ils étaient très soutenus, parce qu'ils assuraient la loi et l'ordre. Et surtout, ils connaissaient les 'règles du jeu' du pouvoir local ce qui les aidaient à régler les disputes entre les clans ou la distribution de l'eau. [La population a donc "fait confiance aux talibans", alors qu'à Kaboul le pouvoir était] « dans la corruption la plus totale. » Olivier Roy. Source
s'il fallait faire une "analyse de classe" de ce qui s'est passé, il faudrait commencer par distinguer les sentiments et intérêts immédiats de la majorité paysanne, - de plus en plus victime collatérale des frappes aériennes américaines depuis le retrait des troupes au sol -, des propos des couches moyennes des villes et particulièrement de tous ceux qui ont compté sur la présence occidentale pour instaurer la démocratie politique depuis Kaboul et Washington, les seuls Afghans et Afghanes qui seraient fréquentables, agréables... et immigrables
ensuite, voir les enjeux économiques et sociaux pour le pouvoir politique d'un pays qui est le 7ème plus pauvre du monde pour le PIB/habitant*, et qui ne pourra s'asseoir éternellement sur la culture du pavot pour ne pas fâcher ses paysans [« L’Afghanistan ne sera plus un pays de culture de l’opium », a assuré le porte-parole des Talibans]
* [size=13]ajout 20 août : « "Une personne sur trois" est en situation d'insécurité alimentaire en Afghanistan. Cette situation est causée par les effets combinés de la guerre dans le pays et des conséquences du réchauffement climatique, selon la représentante du Programme alimentaire mondial en Afghanistan, Mary-Ellen McGroarty. »
bref, comment passer d'une économie de guerre à une économie de paix, transition pour laquelle les relations avec la Chine pourraient être décisives, et qui suppose certes un consensus social entre classes*. Ce n'est pas une perspective très communiste j'en conviens, mais tant pis si je déçois les tenants communisateurs de l'intégration de la paysannerie afghane au prolétariat révolutionnaire mondial
* du point de vue du "genre" dans le rapport au travail, les Talibans ne pourraient plus aujourd'hui, sur le plan économique et sociétal, se passer des femmes qui bossent, donc des futures femmes, qui étudient. Ce n'est pas tant qu'ils feraient mine de changer, ils y sont contraints. Voir le tableau ci-dessous
moi, ce qui me frappe, c'est la maturation politique des Talibans depuis leur passage au pouvoir en 1996-2001. Ils ont beaucoup appris et sont ni plus ni moins machiavéliens et cyniques que tous les dirigeants du monde, à commencer par les nôtres. Même les fous de Dieu doivent agir, en politique, en êtres humains les pieds sur terre, sans quoi ils perdent le pouvoir à brève échéance, sans pour autant gagner le paradis
or ça peut paraître paradoxal, mais les Talibans sont actuellement les seuls garants de la paix et de la stabilité dans un pays dont l'immense majorité de la population a ras le bol de guerres sur son sol depuis 40 ans. Et cela, que ça plaise ou non, sans alternative à l'Islam, qui rend seul aujourd'hui possible l'unité politique au-delà des ethnies, et raison même du succès stratégique taliban : refuser cette réalité c'est vouloir la guerre, et ce ne serait pas la "guerre civile entre classes antagonistes" souhaitée par les communisateurs qui carburent du chapeau, et comme habituellement muets comme des carpes face aux événements du monde qu'ils ne peuvent intégrer à leurs thèses hallucinatoires. Au demeurant aucun blog d'ultragauche et post-ultragauche ne s'exprime sur l'Afghanistan
pour une vision un tant soit peu informée de la situation et des enjeux, on peut lire les interviews d'Olivier Roy
"Nous considérons la technologie moderne, telle qu'internet, comme une bénédiction divine",
Zabihullah Mujahid, porte-parole des Talibans
17 août
1. ADIEUX À L'ORDRE DU MONDE TANT AIMÉ
« Nous assistons à une déroute de l'Occident et de l'Otan,
marque du déclin américain
et de sa capacité à être le gendarme du monde »
Bernard Bajolet, ex-ambassadeur de France à Kaboul et ancien patron de la DGSE
Marianne, 16 août 2021

Joe Biden 16 août 2021, un discours historique
« Nous assistons à une déroute de l'Occident et de l'Otan,
marque du déclin américain
et de sa capacité à être le gendarme du monde »
Bernard Bajolet, ex-ambassadeur de France à Kaboul et ancien patron de la DGSE
Marianne, 16 août 2021

Joe Biden 16 août 2021, un discours historique
j'ai "entendu de traverse" le discours de Joe Biden hier soir, beaucoup plus intéressant que celui, sans surprise, impuissant et sans marges d'actions, d'Emmanuel Macron, accessoire à l'échelle mondiale. Car les USA, même dans le déclin, mènent la danse des décisions occidentales, et c'est d'ailleurs eux qui garantissent encore, militairement*, les conditions du retrait de tous les Occidentaux et de leurs alliés afghans
* dans le retrait, Biden envoie 6000 militaires supplémentaires...
à entendre les commentaires en France, contrairement à l'époque du retrait du Vietnam - cf la comparaison des hélicoptères évacuant les ambassades de Saïgon en 1975 et Kaboul en 2021 - il faudrait regretter le bon temps où les Américains faisaient la pluie et le beau temps dans le monde, autrement dit, la guerre pour la démocratie politique. C'est assez dire où en est la critique de l'idéologie dominante du capitalisme occidental, et le consensus sociétal par "structure of feeling" : on reprocherait aux Américains de n'être plus ce qu'ils étaient, parce qu'ils "abandonnent" les Afghans et surtout les Afghanes à leur sort ? Le mode de vie occidental serait encore pour tous et toutes le meilleur des mondes possibles ?
car c'est cela qui m'a le plus frappé
Biden n'a pas répondu aux attentes de justifier le "fiasco" d'un retrait raté, du moins dans son déroulement, le programme prévu ayant été enrayé par la fulgurante prise de Kaboul par les Talibans, ou plutôt la déroute organisée de l'armée fantoche afghane, sur fond de lassitude de la guerre de tout un peuple (observons que la résistance mâle afghane ne s'est pas précipitée pour protéger les femmes, et l'Afghanistan ne se réduit pas de ce point de vue à Kaboul sa vitrine pour le spectateur féministe occidental)
le principe du retrait faisait consensus aux USA, dans la classe politique comme dans l'opinion publique, et c'est pourtant à ça que Biden a consacré tout son discours, justifiant le retrait par le pragmatisme et la real politique, avec une phrase qui vaut son pesant de dollars dans l'histoire américaine, en substance, on ne peut pas imposer la démocratie par la force. Peu importe, à cette aune, la tartufferie du Président démocrate, qui n'a rien dit en 2001, mentant aujourd'hui sur les objectifs américains d'alors, car tel était bien le plan effectif de l'intervention en Afghanistan, et pas seulement d'aller y "tuer Ben Laden", au demeurant abattu au Pakistan
l'échec et le tournant historiques, acceptés et entérinés par le pouvoir américain, aussi bien Républicain avec Trump que Démocrate avec Biden, sont là, et pas ailleurs. Dans les conditions de l'Afghanistan, la seule alternative eût été un colonialisme direct avec occupation permanente, ce qui n'a jamais été la tradition des États-Unis. Qui leur fait des reproches au nom du droit des femmes afghanes devrait y réfléchir à deux foisBernard Barjolet a écrit:Sur le plan géopolitique, la défaite de l’Occident me semble considérable. Nous vivons un événement de portée historique mondiale aussi fort que le fiasco de Suez pour les Français et les Britanniques ou que la chute de Saïgon pour les Américains. Ces heures marquent une déroute de l’Occident et de l'OTAN. La chute de Kaboul va accélérer la tendance mondiale actuelle, qui est la domination de la Chine, avec la vassalisation de la Russie à ses côtés. En tout cas, eux, ils restent à Kaboul, quand, nous, l’Europe, nous fuyons.
Troguble- Messages : 101
Date d'inscription : 31/07/2021
 Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
la France réclame un vaccin par voie navale
contre son impuissance mondiale
DE BONNE GUERRE
Aukus Pact
AUKUS, c'est le nom du pacte de sécurité qui vient de voir le jour entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, un vaste partenariat en matière de sécurité, de cyberdéfense, d'intelligence artificielle et de technologies quantiques destiné à contrer l'influence de la Chine. Les trois dirigeants ont tenu une conférence de presse virtuelle pour faire leur grande annonce.
"Il s'agit d'investir dans notre plus grande source de force, nos alliances, et de les mettre à jour pour mieux faire face aux menaces d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit de souder les alliés et partenaires actuels de l'Amérique de manière nouvelle et d'amplifier notre capacité à collaborer, en reconnaissant qu'il n'y a pas de fracture régionale séparant les intérêts de nos partenaires de l'Atlantique et du Pacifique" a expliqué Joe Biden, le président des États-Unis.
Ce fut au tour ensuite de Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni de prendre la parole :
"Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis créent un nouveau partenariat de défense trilatéral appelé AUKUS, dans le but de travailler main dans la main pour préserver la sécurité et la stabilité dans la zone indo-Pacifique. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre amitié, et le premier objectif de ce partenariat sera d'aider l'Australie à acquérir une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire."
source : Naissance du pacte de sécurité AUKUS et coup de poignard pour la France, Euronews, 16 septembre
Patlotch a écrit:le gouvernement français, et la plupart des dirigeants politiques, unanimes quand il s'agit de faire du fric avec des armes, font tout un pataquès au sujet de l'affaire des sous-marins vendus à l'Australie. C'est de bonne guerre commerciale, bien que ce genre de "coup dans le dos" (Le Drian) ne soit pas rare en matière de marché mondial des armes. Plus symptomatique est ce que cela signifie dans le changement de pied de la politique étrangère américaine après le retrait d'Afghanistan, dont c'est une des causes essentielles, confirmant les déclarations de Biden lors de ses justifications, une réorientation sur le terrain stratégique de la guerre économique*
* lire États-Unis : face à la Chine, Joe Biden trace froidement sa route
pour le capitalisme en général, la guerre militaire n'est que la conséquence ultime éventuelle de la concurrence économique. Bien qu'il soit menacé, par la Chine entre autres, les États-Unis n'ont aucunement renoncé à leur leadership, et la France n'est qu'un petit poisson dans les eaux du Pacifique
« La nouvelle claque des États-Unis à la France »selon l’ancien ambassadeur
Ouest-France, 16/09/2021
Ouest-France, 16/09/2021
Pour Gérard Araud, l’ancien ambassadeur de France à Washington, les États-Unis ont entamé un virage dans leur politique étrangère. Leur influence dans la décision australienne de rompre le contrat qui la liait à la France en est l’illustration.
Gérard Araud a passé de nombreuses années aux États-Unis pour le compte du gouvernement français. L’ex-ambassadeur de France à Washington (2014-2019). Le diplomate interviendra au forum mondial Normandie pour la paix, à Caen, jeudi 30 septembre 2021.
lire aussiL’Australie a rompu son contrat avec la France portant sur la construction de sous-marins. Comment analysez-vous le rôle des États-Unis dans cette affaire ?
Des bruits ont commencé à se faire entendre ces dernières semaines mais tout le monde a été surpris par l’annonce et la manière dont tout ceci s’est fait. À l’évidence, ils ont négocié dans le dos de la France depuis des mois. Pour arriver à ce genre de décision, il est évident que cela n’a pas été décidé au cours des dernières semaines. Il y aura des leçons à tirer. Il y a une logique de rivalité, de concurrence. Quand nous avions obtenu ce contrat, les États-Unis ne nous soutenaient pas, ils étaient aux côtés du Japon. Ils ont essayé et ont finalement réussi à vendre leurs marchandises aux Australiens. Les Américains se tournent vers l’Asie avec leur brutalité habituelle et une indifférence vis-à-vis de l’Europe. Ils cherchent à contenir la puissance chinoise par tous les moyens.
Quelles conséquences sur les relations franco-américaines ?
Les Américains n’ont pas consulté la France dans leur sortie de l’Afghanistan, ils nous infligent, avec cette rupture, une autre claque. Il faut s’interroger sur leur décision de ne pas nous inclure dans les discussions. On arrive à se dire qu’Obama, Trump ou Biden c’est un peu la même chose. C’est un pays qui est totalement indifférent aux intérêts de ses alliés. C’est plus pratique pour eux de travailler avec l’Australie et la Grande-Bretagne qui accepteront leurs rôles de subordonnés. L’alliance « Five Eyes » (l’alliance des services de renseignements des trois pays avec le Canada et la Nouvelle-Zélande) permet des échanges de confidentialité, une coopération sur des équipements secrets. Ils n’ont pas ça avec les Français. Paris va devoir réviser ses positions avec les États-Unis. Il faut le comprendre. Nous n’avons pas à entrer en guerre avec la Chine, mais nous pouvons être alliés sans l’être vraiment. À l’instar du Général de Gaulle avec l’URSS, face à la Chine il faut peut-être inventer un gaullisme du XXIe siècle.
Vous évoquiez le retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Que vous inspire aujourd’hui cette intervention ?
Initialement, il y a une justification à intervenir. Il s’agit d’abord d’une opération antiterroriste avec des bases juridiques et légitimes pour expliquer les raisons de cette opération militaire. Mais, par la suite, l’Otan et les États-Unis ont dérivé vers une volonté d’installer un état démocratique et de reconstruire le pays. Après la Seconde guerre mondiale, les États-Unis se sont vus comme le gendarme du monde. Ils apparaissaient comme les « rois du monde » d’une certaine manière. Derrière cela, il y avait cette volonté de répandre la démocratie avec la baïonnette.
Comment les États-Unis ressortent-ils de cette guerre ?
Barack Obama avait entamé cette politique de retrait des troupes. Elle répond à une lassitude chez les Américains et Américaines concernant les interventions. Il fallait que les États-Unis se retirent de certains dossiers, notamment en Irak. Ce sont des opérations très coûteuses sur le plan financier et humain. Donald Trump a poursuivi ce travail dans la même lignée qu’Obama. Ce n’est pas une ligne de conduite conçue sous le gouvernement Biden. Le mode opératoire dans le retrait des troupes est un échec et cela a engendré des conséquences dans l’opinion publique. C’est la première fois que la cote de popularité de Joe Biden, ancien vice-président dans le gouvernement Obama, repasse sous les 50 %. Vouloir tout régler en Afghanistan a été l’erreur des Américains.
Comment voyez-vous évoluer la politique étrangère américaine ?
Première chose, je pense que ce n’est pas vécu comme une défaite par le gouvernement. Il y a un changement de logique, les États-Unis ne vont plus intervenir partout. Ils vont agir pour protéger leurs intérêts et ne seront plus les gendarmes du monde. C’était ce que l’on peut appeler une guerre éternelle en Afghanistan, sans espoir de victoire. Les États-Unis vont être plus sélectifs maintenant dans leurs interventions. Ils ne sont pas au Sahel, en Ukraine ou en Libye par exemple car cela ne les concerne pas.
"On vient de se prendre une grande baffe", analyse le journaliste Jean-Dominique Merchet
France Info, 16/09/2021
extraitsFrance Info, 16/09/2021
Même signé un contrat reste incertain ?
Oui, manifestement. Mais plus globalement, ça veut dire, et c'est triste à dire, que la France veut sans doute désormais jouer dans une cour qui n'est plus la sienne, que ce soit en termes diplomatiques et militaires. On vient de se prendre une grande grande baffe. Le constat est qu'on ne pèse pas sur les dossiers de l'Indo-Pacifique où on veut jouer un rôle démesuré par rapport à nos capacités.
Pourtant, nous avons des intérêts stratégiques dans cette région ?
Tout le monde a des intérêts stratégiques dans cette région. On nous raconte des choses parce qu'effectivement, nous avons la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, mais ce n'est pas sérieux. Pour les Australiens, la garantie de sécurité comme pour les Japonais comme pour d'autres, elle est américaine, américaine et américaine. Parce que nous sommes une puissance nucléaire où nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité, on croit qu'on est encore capable de jouer dans cette cour et nous ne le sommes plus.
[...]
Ce n'est pas la première fois que la France se fait "chiper" un contrat au dernier moment ?
Au mois de juin, le Rafale français faisait partie des avions favoris pour ce contrat parmi d'autres. Joe Biden passe à Genève. Le lendemain de la visite de Joe Biden à Genève, le gouvernement suisse annonce qu'il achète des F-35 américains. On voit que les marges de manœuvre françaises sont extrêmement réduites dès lors que Washington, quel que soit le président, a décidé d'imposer sa loi.
Troguble- Messages : 101
Date d'inscription : 31/07/2021
 Sujets similaires
Sujets similaires» L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
» LA CRISE QUI VIENT
» ÉDITORIAUX et PLAN du Journal critique de la crise
» LE CAPITAL À L'ASSAUT DU CIEL
» FACE AU CAPITAL, SUR TOUS LES FRONTS
» LA CRISE QUI VIENT
» ÉDITORIAUX et PLAN du Journal critique de la crise
» LE CAPITAL À L'ASSAUT DU CIEL
» FACE AU CAPITAL, SUR TOUS LES FRONTS
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum


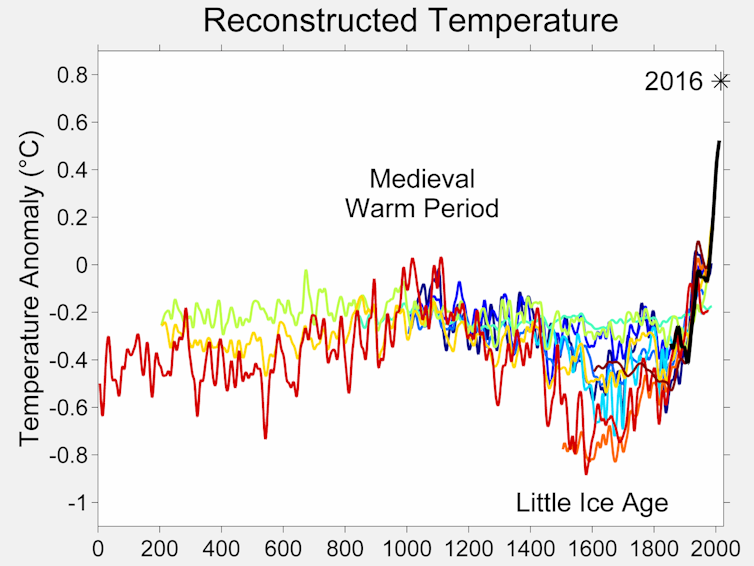





» BIEN CREUSÉ, VIEUX TOP ! Histoires d'une mare
» IRONÈMES, poésie minimaliste, depuis 2018
» MATIÈRES À PENSER
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» I 2. TECHNIQUES et MUSIQUES pour guitares 6, 7 et 8 cordes, IMPRO etc.
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» PETITES HISTWEETOIRES IMPRÉVISÉES
» HOMONÈMES, du même au pas pareil
» LA PAROLE EST À LA DÉFONCE
» KARL MARX : BONNES FEUILLES... BONNES LECTURES ?
» IV. COMBINATOIRE et PERMUTATIONS (tous instruments)
» CLOWNS et CLONES des ARRIÈRE- et AVANT-GARDES
» VI. À LA RECHERCHE DU SON PERDU, ingrédients
» CAMATTE ET MOI
» III. LA BASSE et LES BASSES À LA GUITARE 8 CORDES
» L'ACHRONIQUE À CÔTÉ
» LA CRISE QUI VIENT
» MUSIQUE et RAPPORTS SOCIAUX
» PETITE PHILOSOPHIE PAR LA GUITARE à l'usage de toutes générations, classes, races, sexes...