ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Page 1 sur 1
 ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
je me donne un plan pour clarifier la circulation entre les trois sujets ouverts dans ÉCOLOGIE, science et courant
de très nombreux textes ont déjà été signalés
- en 2014-2016 : le CAPITAL contre le vivant, la RÉVOLUTION pour la VIE
- depuis 2016 dansL'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
- dans la conjoncture pandémique :
. RAPPORTS HUMANITÉ-CAPITAL-NATURE et CONJONCTURE PANDÉMIQUE / Théorisation communiste, suite
. CONTRE L'ANTHROPOCENTRISME... CAPITALISME, HUMANISME, NATURE... Anthropocène vs Capitalocène ?
. ÉCOLOGIE, ÉTAT, CAPITALISME VERT et CORONAVIRUS
d'autres viendront en tant que de besoin
quand un imbécile (un autre) affirme : « l’écologie n’est même plus une idéologie réformiste, elle devient l’idéologie « mainstream ». », rappel d'une banalité de base, qui montre que « l'idéologie mainstream », est d'abord celle qui est enseigné à l'école, au collège, et surtout au lycée, critiquée par des enseignants ("idéologues mainstream" ?) pour répondre aux besoins du capitalisme, alors que le courant communiste du même imbécile n'en a jamais rien dit :
Depuis le succès des grèves scolaires pour le climat, le ministère de l’Éducation nationale multiplie les déclarations en faveur de « l’éducation au développement durable »*. Mais qu’en est-il dans les nouveaux programmes du lycée, voulus par Jean-Michel Blanquer ? Reporterre a enquêté et interrogé des professeurs pour une explication de texte. Bilan : peut mieux faire.
* je rappelle que l'expression même de développement durable, et plus encore celle d'environnement, signalent très explicitement une séparation entre l'humanité et ce qui l'entoure, bien que sous ce dernier label on trouve des textes qui condamnent cette compréhension. Ces labels sont utilisés dans la structure institutionnelle de l'État depuis 50 ans :
ministère de l'Environnement 1971-2007, de l'Écologie et du Développement durable 2007-2017, de la Transition écologique et solidaire depuis (j'y étais responsable de la formation professionnelle lors du rattachement à l'Équipement/Transports en 2007 et jusqu'en 2012). Autrement dit l'écologie environnementale et de développement durable est une idéologie de l'État capitaliste depuis 50 ans, et elle trouve en face d'elle une opposition écologiste radicale à critiquer justement parce que n'extériorisant pas la nature, elle peut se présenter comme révolutionnaire. C'est précisément ce qui monte dans la conjoncture pandémique, et des communistes taperaient à côté, obsédé par le bétonnage d'un corpus prolétarien stérile, car inapte à discerner les adversaires idéologiques actuels du communisme
Pour sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, mardi 27 août, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait choisi un original décor de verdure, et planté le pupitre dans le jardin de son ministère. Une façon de souligner que l’une des trois priorités définies pour l’année scolaire qui s’ouvre est ce qu’il appelle le « défi environnemental ». Tous les établissements sont appelés à participer : « Ici, ce sera un potager, des plantations d’arbres, là le tri des déchets, partout une réflexion sur la consommation d’énergie. À la fin du mois de septembre, toutes les classes de collège et de lycée éliront un écodélégué pour œuvrer concrètement à cette transformation », écrit M. Blanquer dans son message de rentrée.
Le ministre avait semé les premières graines en juin, annonçant « 8 axes d’action » afin de mobiliser l’éducation nationale « en faveur du climat et de la biodiversité ». Une circulaire pour leur mise en œuvre a été publiée le 27 août dernier. Après le succès des grèves scolaires menées par la jeune Greta Thunberg, le ministère veut réaffirmer une ambition environnementale.Jean-Michel Blanquer a écrit:@jmblanquer
Nous ne sommes pas un mammouth mais un peuple de colibris.
L’action pour l’environnement au cœur de cette rentrée scolaire. Avec la feuille de route définie avec les lycéens. Et avec l’engagement de tous:
Rentrée 2019 : une année scolaire sous le signe de la réussite
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, a présenté les priorités de l'année scolaire 2019-2020, le mardi 27 août. L'année 2019-2020 est placée sous le signe de la...
education.gouv.fr
Pourtant, les nouveaux programmes du lycée, voulus par Jean-Michel Blanquer et appliqués en seconde et en première à partir de cette année puis en terminale l’an prochain, avaient suscité un tollé en décembre dernier, en pleine COP24.
« Les nouveaux programmes du lycée pour les cinq prochaines années ne laissent pas assez de place pour la transmission des bases scientifiques essentielles à la compréhension des problèmes majeurs que sont le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, leurs causes, et les solutions permettant d’agir pour les enrayer », dénonçaient dans une tribune dans Mediapart les climatologues Valérie Masson-Delmotte, Jean Jouzel et Hervé Le Treut, et de nombreux autres scientifiques, rejoins par l’ex-ambassadrice pour les questions climatiques Laurence Tubiana, ou encore Pascal Canfin.
Les programmes n’étaient alors pas totalement finalisés. Le ministre semble désormais vouloir rectifier le tir, et le sixième de ses huit « axes » prévoit que les élèves vont « étudier le changement climatique et la biodiversité dans les nouveaux programmes de lycée ». Mais qu’en est-il ?
Le climat, surtout en terminale
Première matière concernée, la SVT — sciences de la vie et de la terre. En seconde générale, un chapitre sur la biodiversité et un autre intitulé « agrosystèmes et développement durable » permettent d’évoquer quelques problématiques écologiques. Le changement climatique, en revanche, n’y figure pas. Sylvain, prof de SVT dans un lycée des Yvelines, souligne également la disparition du chapitre « sur les combustibles fossiles et le cycle du carbone, qui existait dans l’ancien programme ».
Extraits d’un manuel de géographie en lycée professionnel.
En première et terminale, la SVT devient une option. Il faut se tourner vers le programme de la nouvelle matière « enseignement scientifique » pour évaluer ce qui sera enseigné à tous les élèves de lycée général, soit environ 58 % d’entre eux, [1] à raison de deux heures par semaine. L’introduction du programme des deux années fait référence aux effets de « l’espèce humaine » sur la planète, tout en notant que « c’est sans aucun doute la première [espèce] qui s’en préoccupe ». [2].
En première, l’effet de serre est expliqué et le changement climatique peut être « mentionné ». « C’est léger », estime Sylvain. Il faut attendre la terminale générale pour que le « système climatique » et même le « climat du futur » soient étudiés dans le détail, ainsi que les enjeux des choix énergétiques. Une partie du programme plutôt appréciée des professeurs de SVT interrogés par Reporterre, mais qui arrive tardivement. « Le changement climatique passe de la seconde à la terminale, ce qui n’est pas du tout pertinent car les séries technologiques en sont donc privées », déplore Sylvain. Valérie Sipahimalani, secrétaire générale adjointe du Snes (Syndicat national des enseignants de second degré), va dans le même sens : « On aurait souhaité que le dérèglement climatique soit traité à un moment de la scolarité pour tous les élèves, et notamment que cela représente le gros du programme de l’enseignement scientifique en première. »
Au Conseil supérieur des programmes — l’instance chargée de proposer des programmes ensuite validés et éventuellement amendés par le ministère —, on défend ce choix de réserver le sujet aux élèves les plus âgés : « On pense qu’il faut une certaine maturité pour aborder ces sujets, mais cela ne veut pas dire qu’on n’en parle pas avant. »
En géographie, une difficile cohabitation entre enjeux économiques et écologiques
Autre matière où les questions écologiques peuvent être abordées, la géographie. C’est d’ailleurs quasiment la seule dans laquelle les élèves de la filière professionnelle (29 % des lycéens) entendent parler de « rapport de l’homme à son environnement », relève Isabelle Vuillet, professeur de lettres-histoire-géographie en lycée pro, et secrétaire nationale de la CGT éducation. « Avant on avait tout un pan du programme sur le développement durable, les risques technologiques et les risques naturels, qui a sauté. Les programmes sont désormais centrés sur la mondialisation, les transports et les réseaux de communication, sans quasiment aucun aspect critique », regrette-t-elle.
En seconde générale, une des thématiques importantes du programme de géo est intitulée « sociétés et environnement ». Le changement climatique et l’exploitation des ressources y tiennent une bonne place. Les transports plus « respectueux de l’environnement » sont évoqués en fin de chapitre sur les mobilités. Insatisfaisant, pourtant, selon Lila Hébert, professeure d’histoire-géographie à Cannes et membre du collectif Enseignants pour la planète : « Le terme “transition” est utilisé à toutes les sauces, mais c’est de la déclaration d’intentions. Par exemple, on parle de la préservation des milieux naturels en France, mais on oublie de dire que 5.000 hectares de concessions minières ont été accordés en Guyane en juillet. Le pays n’a pas commencé sa transition écologique, dans les faits que décrit la géographie, cela n’est pas une réalité. »
En première et en terminale, ces thématiques s’effacent pour laisser place aux métropoles et à la mondialisation. « Dès qu’on se met à parler d’Europe, de mondialisation et des grandes questions géopolitiques, c’est comme si l’environnement n’avait plus sa place », affirme Amélie Hart-Hutasse, membre du groupe histoire-géographie au Snes. « En terminale, une grosse partie est dédiée aux mers et aux océans, mais on n’y évoque pas une seule fois la pollution plastique, l’acidification ou la surpêche. On est focalisé sur les grands détroits où passent les porte-conteneurs », détaille sa collègue Lila Hébert. « On trouve tout de même le terme de ressources halieutiques, ainsi que le fait qu’il s’agit d’enjeux environnementaux dans la partie sur la France », précise-t-on au Conseil supérieur des programmes.
« Une vision gestionnaire, comptable, consensuelle et marchande de l’écologie »
Enfin, les profs de l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales (SES) (Apses) demandaient eux aussi en juin dernier « une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les programmes de SES », déplorant notamment la suppression, sur décision du ministère, de la référence à la taxe carbone dans les nouveaux programmes. En seconde, donc dans le programme de tronc commun, seules les « limites écologiques de la croissance » sont évoquées. « Mais, il n’y a rien sur l’économie plus durable, on n’interroge pas la quête de croissance en soi, on n’interroge pas les conséquences de l’internationalisation du commerce sur l’environnement, et l’innovation est présentée comme la seule solution à la crise écologique », constate Benoît Guyon, prof à Belfort et coprésident de l’Apses.
Extraits d’un manuel de géographie en lycée professionnel.
Bref, autant de points des programmes qui montrent que l’institution a quelques trains de retard, estime Valérie Sipahimalani, du Snes. « J’ai l’impression, en lisant la littérature scientifique, qu’il y a eu de grandes avancées ces dernières années, et que, à l’Éducation nationale, on reste sur une vision d’il y a vingt ans », dit-elle. Sylvain, notre prof de SVT des Yvelines, est encore plus sévère : « En matière d’environnement, le gouvernement a une vision gestionnaire, comptable, consensuelle et marchande de l’écologie. L’école transmet donc cette vision à travers ses programmes. » Il note par ailleurs que le croisement entre écologie et social n’est pas amorcé : « La dégradation de l’environnement est le fait des “activités humaines”. Les humains sont tous mis sur un pied d’égalité (…). Exit les décisions des investisseurs et le système économique, ce sont tous les individus qui polluent, l’humanité en général. »
Le Conseil supérieur des programmes, auquel le ministère a laissé le soin de nous répondre, souligne de son côté que parmi les experts qui participent à l’élaboration des projets de programme, plusieurs sont particulièrement attentifs aux questions écologiques [3]. Celles-là sont « clairement » plus présentes dans les programmes, « notamment avec la création du nouvel enseignement scientifique en terminale », insiste-t-on.
Dans une lettre au Conseil supérieur des programmes datée du 20 juin, rédigée en réaction à la mobilisation des jeunes pour le climat, Jean-Michel Blanquer se félicitait de « l’effort manifeste » fourni pour introduire le climat et la biodiversité dans les programmes de lycée. Il souhaitait que la même direction soit donnée aux programmes du primaire et du collège, demandant au Conseil de lui faire des propositions d’ici novembre.
Encore insuffisant selon les professeurs. « La majorité des établissements sont des passoires énergétiques, cela paraît dérisoire d’enseigner ces questions-là sans pouvoir les mettre en œuvre », déplore Amélie Hart-Hutasse
Dernière édition par Florage le Sam 6 Juin - 13:46, édité 3 fois
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
mars 2019. Recension de trois livres
le premier présente une histoire de la radicalité environnementale aux États-Unis en s'appuyant sur la vie et l’œuvre de grandes figures inscrites dans cette tradition (H. D. Thoreau, John Muir, Aldo Leopold, David Brower, Dave Foreman et J. Baird Callicot)
les deux autres sont des ouvrages de philosophie environnementale, une "éthique de la terre" présentant une problématique commune à différentes disciplines : l'éco-féminisme, l'éco-phénoménologie et d'autres
Ce livre retrace l'histoire de la radicalité environnementale aux États-Unis en s'appuyant sur la vie et l’œuvre de grandes figures inscrites dans cette tradition (H. D. Thoreau, John Muir, Aldo Leopold, David Brower, Dave Foreman et J. Baird Callicot).
Dans cet ouvrage, la radicalité environnementale désigne le rejet d'une vision purement anthropocentrée du rapport entre les humains et le vivant non-humain. Depuis le milieu du XIXe siècle, des écrivains de la nature, des philosophes et des militants ont plaidé, et parfois agi, en faveur d'un décentrement du point de vue humain aux États-Unis. Ce livre retrace le développement de ce projet écocentriste de l'ère transcendantaliste jusqu'à celle de l'anthropocène. Comment surmonter la distinction moderne entre nature et culture afin de faire advenir une redéfinition de notre rapport éthique avec le vivant non-humain ? Tel est le défi que ces radicaux ont tenté de relever en s'inspirant les uns des autres tout en s'adaptant aux évolutions sociales, culturelles et historiques de leurs époques respectives.
Si l’ouvrage retrace le destin d’une idée, il permet de s’intéresser à de nombreux phénomènes historiques plus larges : la réception des idées de Darwin, le darwinisme social, la naissance de l’industrie nucléaire aux États-Unis, la controverse climatique, l’émergence de groupes comme Greenpeace ou Friends of the Earth, l’évolution du consumérisme américain…
Anthropocène et éthique de la terre
Entretien avec J. Baird Callicott, Fondation de l'écologie politique, 12 septembre 2017
"La deuxième vague de la crise environnementale nous conduit à repenser l'éthique
et la philosophie environnementales par rapport à de nouvelles échelles temporelles et spatiales."J. Baird Callicott a écrit:Nous devons remettre l'échelle de l'imagination humaine et de l'existence humaine en comparaison avec la Terre et donc recentrer paradoxalement notre éthique environnementale sur des bases anthropocentriques plutôt que non-anthropocentriques. Ce fut un dur changement pour moi sachant que j'ai lutté sévèrement contre l'anthropocentrisme depuis les débuts de ma carrière... e t maintenant me voilà néo-anthropocentriste face à la seconde vague de la crise environnementale et les implications que ce changement d'échelle a entraîné pour l'éthique environnementale.en relationComment voyez-vous le futur de la philosophie environnementale ?
La direction prise par mes recherches, notamment dans Ethique de la terre (Éditions Wildproject, 2010), peut vous donner une idée de ce que peut être ma réponse à cette question. Cela tient à la ramification du changement climatique global. Le changement climatique est un phénomène qui à la fois éclipse et exacerbe les autres problèmes environnementaux. Par exemple, ce phénomène accentue les enjeux en terme de perte de biodiversité. Mais cela s'avère vrai également pour pratiquement toutes les préoccupations environnementales. C'est un thème qui va devenir majeur selon moi, sans pour autant dire que tous les philosophes de l'environnement vont le traiter de la même manière, mais qu'il sera étudié sous différentes perspectives, notamment celle de l'éco-féminisme, de l'éco-phénoménologie et bien d'autres. Cela ne réduit en aucun cas la diversité au sein de la philosophie environnementale, mais propose plutôt une problématique commune aux différentes disciplines.
Pour ce qui est de la philosophie en général, on observe une claire séparation entre les sous-branches du domaine: la philosophie analytique anglo-américaine d'un côté et la philosophie continentale anglo-américaine de l'autre (bien que la formulation puisse paraître contradictoire) se sont de plus en plus centrées sur des problématiques spécialisées et techniques, au point d'aboutir à l'exclusion d'autres disciplines. Les personnes appartenant à d'autres disciplines intellectuelles qui assistent aux discussions des philosophes sont abasourdies par ces conversations qui ne font, pour elles, aucun sens. Il n'est d'ailleurs généralement pas courant que les spécialistes de différentes disciplines soient amenés à interagir entre eux, sauf dans quelques rares exceptions. L'une de ces exceptions est justement la philosophie environnementale, qui depuis des dizaines d'années travaille en concertation avec l'écologie, avec la biologie de la conservation, ou encore avec la psychologie morale évolutionniste. Je pense que la philosophie environnementale est, en ce sens, le signe avant coureur du futur de la philosophie en général : elle va de l'avant et collabore avec d'autres disciplines et pourvoit une expertise et une perspective que seuls les philosophes peuvent apporter. Je peux uniquement parler depuis la perspective de la philosophie environnementale mais je pense que, pendant des années, les écologues et les autres scientifiques du vivant pensaient encore, épistémologiquement parlant, selon la logique positiviste des années 1930, prônant l'objectivité des valeurs, tels des enfants se disputant pour savoir quelle couleur est la plus belle. Ils ne savaient pas reconnaître les valeurs ni en débattre d'une façon qui expliquerait pourquoi quelqu'un adopte une opinion particulière et pas une autre.
Ce n'est ici que la surface de ce que la philosophie pourrait apporter aux autres disciplines, par une conversation riche, mais aussi une certaine habilité à prendre du recul et à synthétiser. À l'heure où la science est de plus en plus spécialisée sur des sujets de plus en plus précis, les philosophes pourraient être le ferment qui lie des choses séparées dans une vision du monde plus large et plus cohérente.
Le concept d'Anthropocène est-il utile pour la philosophie environnementale ?
Mon avis sur la question est partagé. Premièrement je pense qu'il est important d'être très clair sur l'origine du terme d'Anthropocène. Ce terme est originellement issu de la géologie. L'idée initiale était de savoir si dans un ou deux millions d'années, les géologues – si tant est qu'il y en ait encore à cette période, humains ou non d'ailleurs – pourraient observer un marqueur dans la couche terrestre prouvant que quelque chose d'unique est arrivé dans la longue histoire de la Terre. Et la réponse est oui. Il sera possible de voir qu'il y a eu le changement climatique, que des éléments artificiels ont été créés, comme les réacteurs nucléaires qui n'existeraient pas sans l'intervention de l'homme et ainsi de suite. Il y a donc différents ‘marqueurs’ et la question est de savoir à quel moment ces marqueurs commencent à être visibles. Cela pourrait donner la date de commencement de l'Anthropocène. En ce sens, oui, je pense que que l'Anthropocène est un concept utile.
Toutefois quand le concept migre de la géologie vers les sciences humaines, nous nous trouvons dans une situation bien différente. Je pense que le discours des sciences humaines apporte une excuse à nos comportements : avec l'Anthropocène, certains n'hésitent pas à affirmer que les préoccupations environnementales sont démodées, que nous vivons dans une nouvelle ère, et que nous devons nous y faire. C'est selon moi un prétexte pour nous détourner de nos préoccupations habituelles. Ce qui est encore plus important à souligner, c'est que, en appliquant une perspective géologique sur le discours des sciences humaines, l'Holocène serait déjà l'Anthropocène. Nous sommes d'accord que nous entrons dans une nouvelle ère géologique mais je l'appellerai davantage le post-Anthropocène. En effet, c'est le climat de l'Holocène qui a permis une agriculture sédentaire. C'est l'agriculture sédentaire qui a permis l'émergence de villes, puis des civilisations, des arts, des sciences et tout ce qui se rapporte au concept de civilisation, incluant les transports et les communications. Le changement climatique met tout cela en danger.
Face à cette situation, deux discours dominants sur le futur coexistent. Le premier est le post-humanisme voire le «cyborganisme», l'idée que nous allons de plus en plus fusionner avec différentes technologies, que la science va rendre possible de plus en plus de modifications génétiques, une vie sans maladie et l'immortalité. Ce n'est pas humain mais bien post-humain. L'autre scénario est celui du cataclysme environnemental, selon lequel le changement climatique va rendre la planète non-habitable et que de grands bouleversements vont se produire – nous pouvons déjà voir cela arriver aujourd'hui – la chute des États, des guerres, des crashs démographiques, des combats de bandes guidées par des chefs de guerres psychopathes et ce genre de choses. Une toute autre vision du post-Anthropocène en somme.
Pour résumer, je pense donc qu'en tant que concept scientifique, l'Anthropocène est défendable, mais qu'au sein des sciences humaines, c'est un prétexte pour ne pas prendre sérieusement en compte les problèmes auxquels nous faisons actuellement face. Le concept échoue, de plus, à reconnaître le rôle du climat de l'Holocène dans tout ce qui nous rend humains après le Paléolithique.
Qu'est-ce qui vous a conduit, dans votre dernier ouvrage Thinking Like a Planet, à opérer une transition d'une éthique de la terre vers une éthique de la planète ?
La question est de savoir pourquoi j'ai fait cette transition dans ma monographie la plus récente, Thinking like a Planet. The Land Ethic and the Earth Ethic. (Oxford University Press, 2014 ; [Penser comme une planète. De l'éthique de la terre, à l'éthique de la planète] Non traduit). La réponse à cette question est une histoire d'échelle, spatiale et temporelle. Prenons premièrement l'échelle spatiale. Nous situons en général le début d'une connaissance générale de la crise environnementale aux années 1960. C'est la période de publication du Printemps Silencieux de Rachel Carson, de The Quiet Crisis de Stewart Udal. Nous réalisons concrètement à cette époque que nous vivons dans une monde pollué: les nuages de pollution au dessus des villes, les rivières polluées par les eaux usées, les déchets industriels... Mais les problèmes environnementaux identifiés durant les années 1960 étaient locaux et limités dans l'espace. La pollution au-dessus des villes, restait au-dessus des villes, les pesticides répandus sur des champs restent au niveau du paysage. Pollutions ponctuelles, marées noires: tout cela restait à l'échelle locale et pouvait être corrigé en quelques décennies, pour retrouver un air propre et des rivières saines. Cela est un peu moins vrai pour l'eau mais toutefois ces problèmes restaient localisés, spécifiques et corrigeables.
Puis, au cours des années 1980, il y a eu une seconde vague de crises environnementales de grande échelle, tant spatiale que temporelle. Il semblerait que je sois le seul à le conceptualiser de cette façon. Je ne saurais précisément définir quel est ce long terme, mais il n'est certainement pas mesurable en dizaines d'années, mais plutôt en siècles et peut-être en millénaires, selon la manière avec laquelle nous identifions ces crises. Trois problèmes principaux ont émergé dans les années 1980. Le premier fut l'étonnante découverte d'un trou dans la couche d'ozone. Le second fut la crise de la biodiversité et la prise de conscience que les disparitions d'espèces n'étaient pas de simples extinctions sporadiques mais que nous nous trouvons désormais au milieu de la sixième grande extinction de masse. Et enfin troisièmement, au cours de ces années 1980, un certain consensus dans le monde scientifique va émerger à propos du réchauffement climatique. Michel Serres en France, par exemple, identifie l'année 1988 comme celle de la prise de conscience, Dale Jamieson dans son premier article de 1992 sur le climat parle lui aussi de 1988, qui fut une année avec des feux massifs dans l'Ouest américain, des vagues de chaleurs en Europe et aux Etats-Unis. C'est dans ce contexte que va émerger une réflexion plus large sur le réchauffement climatique.
L'éthique de la terre est calibrée pour le local et le particulier. Mon livre Ethique de la terre (Éditions Wildproject, 2010) fait écho à l'essai d'Aldo Leopold «Penser comme une montagne». Il nous invite à comparer la taille d'une montagne : elle paraît grande si nous la comparons à nous-même mais anecdotique, tant sur une échelle planétaire qu'une échelle temporelle de long terme. Il y explique aussi qu'un cerf tué par des loups peut être remplacé en trois ans, mais une montagne ravagé par une population trop élevée de cerfs par exemple aura besoin de trois décennies pour se reconstituer. Désormais, avec la crise environnementale que nous connaissons, nous nous devons de nous projeter à l'échelle des siècles et des millénaires. Le nouvel ordre de grandeur adopté durant la deuxième vague de la crise environnementale nous conduit donc à repenser l'éthique environnementale et la philosophie environnementale par rapport à ces nouvelles échelles temporelles et spatiales. Au niveau de ces échelles-là, les choses changent plutôt radicalement. Si nous pensons aux communautés biotiques ou à un écosystème, ils peuvent être détruits par les activités humaines, mais ce n'est certainement pas le cas de la biosphère qui a résisté 3.5 milliards d'années et qui a vécu des changements catastrophiques pour en ressortir plus tenace et plus diverse. La planète n'est donc pas en danger et je suis en parfait désaccord avec mes collègues qui disent que la planète est en train de mourir ou que la planète a de la fièvre... Ce sont des bêtises. Nous devons remettre l'échelle de l'imagination humaine et de l'existence humaine en comparaison avec la Terre et donc recentrer paradoxalement notre éthique environnementale sur des bases anthropocentriques plutôt que non-anthropocentriques. Ce fut un dur changement pour moi sachant que j'ai lutté sévèrement contre l'anthropocentrisme depuis les débuts de ma carrière, dans de vives controverses avec des personnes comme Bryan Norton. Et maintenant me voilà, néo-anthropocentriste, si nous pouvons le dire ainsi, face à la seconde vague de la crise environnementale et les implications que ce changement d'échelle a entraîné pour l'éthique environnementale.
Propos recueillis à Paris le 29 juin 2016 par Rémi Beau et Benoit Monange
Traduction : Matthias Ollivier, Lucie Perrin-Florentin et Benoit MonangeJean-Daniel Collomb a écrit:J. Baird Callicott, Science, and the Unstable Foundation of Environmental Ethics, 20 décembre 2016
Cet article vise à éclairer l’influence de la pensée écologique, et tout particulièrement de notions telles que le changement et la mutation, sur l’éthique environnementale aux États-Unis en analysant l’œuvre de J. Baird Callicott, aujourd’hui l’un des philosophes de l’environnement les plus influents outre-Atlantique. Callicott a dédié une part considérable de sa carrière à la mise en avant de l’éthique du vivant (land ethic) créée par Aldo Leopold au milieu du 20e siècle. Afin de donner ses lettres de noblesse philosophiques à la proposition éthique de Leopold, Callicott s’appuie notamment sur David Hume, Adam Smith et Charles Darwin : en appliquant aux écosystèmes et aux espèces non-humaines les théories des sentiments moraux de Hume et de Smith, Callicott affirme ne faire que poursuivre un processus commencé par Darwin dans La Filiation de l’homme et développé par Aldo Leopold dans son Almanach d’un comté des sables.
Selon Callicott, l’élargissement du sens que l’espèce humaine confère aux liens communautaires est une nécessité impérieuse face à la multiplication des défis environnementaux. Callicott en vient à préconiser l’avènement d’un changement de paradigme, qui devra conduire l’humanité à adhérer à une « modernité déconstructrice » informée par le darwinisme, la science écologique et l’apport de la physique quantique. Callicott espère que cette transition conduira au remplacement du dualisme cartésien entre l’espèce humaine et la nature par une vision écocentriste du monde en vertu de laquelle l’espèce humaine se conçoit comme intégrée au vivant et non comme radicalement différente de lui. Pourtant, c’est la science écologique elle-même qui fragilise le plus les propositions éthiques de Callicott à travers l’apparition, à la fin des années 1970, de ce que l’historien Donald Worster a appelé l’écologie du chaos.
L’attention grandissante que les écologues apportent alors aux perturbations et à l’instabilité du vivant contraint le philosophe à faire évoluer l’éthique léopoldienne en insistant sur le caractère discriminant de l’échelle des perturbations : par la rapidité et l’ampleur des dégâts qu’elles provoquent, certaines perturbations d’origine anthropique ne sont pas moralement acceptables. Le parcours philosophique de Callicott démontre ainsi l’importance de la capacité d’adaptation dans l’évolution intellectuelle et philosophique. Mais il souligne aussi la situation précaire des philosophes de l’environnement qui fondent leurs prescriptions morales sur des savoirs scientifiques. Ces savoirs jouissent d’un grand prestige depuis la révolution scientifique mais ils sont par nature toujours susceptibles d’évoluer.
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
long texte en deux parties, 1ère partie, notes incluses
quand on se met à bosser sur les
RAPPORTS HUMANITÉ-(CAPITAL)-NATURE
ça devient très vite assez "complexe"
ce texte, entre autres mérites, a celui de présenter les différentes "visions" de "la relation homme-nature : anthropocentrique, biocentrique, écocentrique, multicentrique". Il fait appel aux théories de la complexité, dont on sait que je fais un grand usage, en la mariant avec la dialectique
La relation Homme-Nature
Patrick Guérin et Marie Romanens, écopsychologie, 29 mars 2015
Patrick Guérin et Marie Romanens, écopsychologie, 29 mars 2015
« La matière subjective de l’écopsychologie n’est ni l’humain, ni le naturel, mais l’expérience vécue de l’interrelation entre les deux, que la “nature” en question soit humaine ou non-humaine(1). »
Par ces mots, Andy Fisher définit le sujet de l’écopsychologie : la relation homme-nature. Comme toute relation, la relation homme-nature nécessite une démarche dialogique, en ce sens qu’il est nécessaire de prendre en compte deux éléments disjoints, opposés et complémentaires : l’humain et le naturel(2). Par ailleurs, la relation homme-nature implique une double orientation en raison des deux versants, la nature à l’extérieur de soi et la nature à l’intérieur de soi, en sachant que l’une et l’autre interfèrent constamment et se fécondent mutuellement.
Mais, qu’est-ce au juste que la nature ? Et qu’est-ce qu’une relation ?
Qu’est-ce que la nature ?
Quand nous abordons le concept « nature », il faut savoir que nous nous situons alors selon une vision occidentale du monde qui oppose la nature aux hommes et aux œuvres humaines, autrement dit la nature à la culture. Dans d’autres sociétés, celles des peuples premiers, ce concept n’existe pas car plantes et animaux sont inclus dans la sphère globale dont eux-mêmes font partie. Philippe Descola le souligne : « Le concept de nature est une invention de l’Occident(3). »
« Bien des sociétés dites “primitives” nous invitent à un tel dépassement, elles qui n’ont jamais songé que les frontières de l’humanité s’arrêtaient aux portes de l’espèce humaine, elles qui n’hésitent pas à inviter dans le concert de leur vie sociale les plus modestes plantes, les plus insignifiants des animaux(4). »
Au sens commun, la nature regroupe :
– les « forces » et les lois physiques, géologiques, tectoniques, météorologiques, biologiques, qui produisent l’univers, animent les écosystèmes, et génèrent des phénomènes épisodiques (glaciation, cycles géologiques, tremblement de terre, tsunami…),
– les groupes d’espèces animales et végétales (sauvages, domestiqués), les individus de chacune des espèces,
– les mondes qui les abritent, les milieux de vie des individus/espèces humains et non-humains
– les écosystèmes produits par la coexistence des différentes espèces humaines et non-humaines.
Si l’on se tourne vers l’étymologie, « nature » vient du latin natura qui est issu lui-même de nascor :
« naître, provenir ». Le mot évoque ce qui est dans son état natif, qui n’a pas été modifié depuis sa naissance, qui n’a pas été transformé, mélangé ou altéré par un artifice quelconque, ce qui est en train d’émerger, ce qui se produit par soi-même.
Andy Fisher souligne : « Notons comment la nature, dans son sens primordial, est un processus, un verbe. La nature comme un substantif, comme de la matière physique, est ainsi… une nature dans un sens restreint. Le monde naturel est fondamentalement un champ de phénomènes émergeant-et-passant, une myriade d’évènements interactionnels se déployant-et-mourant(5). »
Le sens commun du mot « nature » est donc éloigné du sens étymologique, selon lequel la nature désigne un ensemble de phénomènes et de situations qui sont fortement évolutifs et dont la transformation n’est pas seulement du fait de l’homme mais aussi de sa propre dynamique.
Pour François Terrasson, la nature est « ce qui résiste à la volonté de l’homme », du moins selon la vision occidentale. C’est l’altérité à l’état pur. Fondamentalement, la nature est autre, elle a sa propre logique. Les organismes, les écosystèmes s’autorégulent sans autre finalité que de se maintenir et de se reproduire. Ils obéissent à leurs propres nécessités.
Andy Fisher va dans le même sens et précise : « Nature, dans ce sens, est le monde tout entier de l’altérité et la nature humaine est l’altérité que nous expérimentons en nous-mêmes(6). »
Autrement dit, la nature, processus vivant qui naît, se déploie et meurt, échappe complètement à l’emprise humaine. Elle est ce que nous rencontrons à l’extérieur de nous tout autant que ce que nous rencontrons à l’intérieur : notre nature humaine, notre nature profonde.
Elle est l’altérité qui interagit constamment avec nous, qui façonne notre être jour après jour en lui permettant d’échapper au monde clos que nous risquons à tout moment d’édifier. Francis Hallé (écrivain et botaniste) l’appelle de ses vœux : « J’aimerais préserver l’altérité des arbres comme l’une des plus précieuses ressources parmi celle qui nous aident à vivre, dans un monde submergé par l’humain(7). »
Louis Espinassous confirme cette nécessité : « Nous avons besoin de l’autre non-humain – animal, végétal, ruisseau, montagnes et cosmos – que nous n’avons pas fait, qui n’est pas nous, pour nous sentir à notre juste place, pour nous sentir pleinement nous-mêmes, à la fois autres, radicalement humains, différents, et appartenant aussi à l’animal, au vivant et au cosmos(8. »
Pour le philosophe Gérald Hess, le mot « nature » nous renvoie avant tout à une représentation. Autant les éléments naturels (rocs, nuages, rivières, plantes, animaux…) sont des choses réelles, autant la nature en soi ne constitue en fait aucune réalité. Elle est, précise-t-il, une idée, un métaconcept, qui véhicule des « significations implicites étroitement associées à l’expérience des locuteurs qui en font usage » (9), qui est donc étroitement dépendant de notre manière d’être au monde. Rejoignant Descola, Gérald Hess relie la notion de nature à la culture occidentale et aux nombreux sens que celle-ci lui donne en fonction des orientations prises.
Qu’est-ce qu’une relation ?
En logique, la relation indique un « rapport d’interdépendance entre deux ou plusieurs variables, défini sur la base d’un principe commun tel que toute modification de l’une d’entre elles entraîne la modification des autres »(10).
La relation, c’est l’interdépendance entre deux êtres ou entre deux entités.
Suivant les éléments naturels extérieurs avec lesquels nous entrons en contact, nous n’aurons pas la même réaction. Se retrouver nez à nez avec une laie et ses petits au cœur de la forêt ne provoque évidemment pas le même effet que découvrir une fleur d’hellébore à peine éclose le long du chemin. Les deux situations n’activent pas les mêmes zones neuronales en nous, elles ne déclenchent pas les mêmes émotions et, par conséquent, n’engendrent pas les mêmes comportements.
Concernant la réaction des êtres humains vis-à-vis des éléments naturels, des différences importantes existent également selon qu’ils appartiennent à une culture ou une autre. Aussi parler de la relation homme-nature, comme l’écopsychologie tente de le faire, comporte-t-il un risque, celui de généraliser, de globaliser, de simplifier à l’extrême, comme si cette relation n’était qu’une. En réalité, elle présente des formes multiples en fonction des partenaires en présence.
C’est seulement en acceptant de tenir compte de cette diversité de situations, en refusant la globalisation, que l’écopsychologie gagnera en intelligence, en complexité, en capacité de communiquer et se fera ainsi mieux comprendre.
Connaître les processus qui animent les animaux, les végétaux, les écosystèmes demande de faire appel aux nombreuses disciplines qui en font l’étude : l’éthologie, la phytologie, la géologie, la systémique, l’écologie… Nous avons besoin de tous ces savoirs pour comprendre comment fonctionne la nature puisque celle-ci, n’étant pas dotée de parole, ne peut nous l’expliquer ! Par contre, en tant qu’être humain (et plus particulièrement en tant que psychologue), nous pouvons tenter de comprendre ce qu’il en est des processus qui animent l’homme en relation avec ce qui est « autre ».
Face à ce qui se présente à lui en tant qu’élément naturel, il réagit. De même que tout système vivant, par ses capacités d’auto-organisation, il traite cette réalité (qui est autre, qui est extérieure à lui) avec les aptitudes qui sont les siennes (innées et acquises), et celles-ci diffèrent évidemment selon que la rencontre se fait avec la laie et ses petits ou avec la fleur d’hellébore !
Ces aptitudes s’exercent en fonction de nombreux critères qui déterminent les comportements, en fonction de grilles de lecture au niveau collectif mais aussi au niveau individuel.
Pour les repérer et les étudier, nous ferons le point successivement sur ces deux niveaux de nos représentations. Nous ferons état des influences collectives et des influences personnelles qui conduisent l’être humain à agir d’une manière ou d’une autre vis-à-vis de la nature.
Mais, auparavant, il nous paraît nécessaire de parler du phénomène de la perception. C’est en effet par l’intermédiaire des sens que nous entrons en contact avec l’environnement, que nous entrons en relation avec lui. Nous ne savons ce qu’il en est de lui en dehors de notre présence (ne serait-ce que de simple observateur). Il nous faut donc avoir à l’esprit que ce que nous percevons comme étant la nature n’est pas la nature elle-même (une nature objectivée), comme nous aurions tendance à le croire, mais le résultat de notre propre perception.
La perception de la nature
Par définition, La perception est une « opération psychologique complexe par laquelle l’esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend connaissance du réel »(11). Le philosophe Merleau-Ponty s’est efforcé de décrire le phénomène en levant l’illusion dans laquelle nous nous fourvoyons si souvent dans notre monde occidental moderne : croire à l’objectivité de la réalité.
« On suppose une objectivité absolue… (du réel) et l’on oublie qu’il ne peut se révéler qu’à travers une dimension marquée par la subjectivité…
Pour Merleau-Ponty est première, non pas la chose, mais la perception de la chose, autrement dit une dimension où le surgissement du réel est indissociable de son expression à travers la singularité d’un corps. L’expérience n’est pas une relation entre un sujet et une altérité donnés, mais un moment où ils surgissent de concert, presque indistinctement, dans un “sentir” qui brouille leurs différences même s’il ne l’abolit pas. En oubliant l’implication nécessaire du sujet dans l’expérience, autrement dit en ne voyant pas que derrière tout “donné” se cache aussi une certaine construction subjective, le réalisme prête au réel ses propres présupposés. Plus ces derniers sont niés, plus nos illusions subjectives conservent sur nous leur pouvoir(12). »
En fait, la nature n’existe pas de manière isolée, en tant qu’objet face à nous sujet. Elle est le terme d’un couple indissociable : nature-culture.
« La nature ne se laissant saisir d’abord qu’à travers notre perception, étant donc un ensemble de significations pour la conscience qui la vise, son existence en soi ne saurait avoir de sens déterminé(13). »
L’influence des orientations qui sont les nôtres, en fonction de nos expériences, joue donc un rôle majeur. Ici, nous rejoignons ce que Gérald Hess avance lui-même, comme nous l’avons vu : la nature n’a pas de réalité objective, elle est un métaconcept. Seul existe un rapport entre notre être – et les représentations qui l’habitent – et les éléments naturels que nous contactons.
Selon la psychologie de la forme (gestalt-théorie), les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes comme des ensembles structurés (les formes) et non comme une juxtaposition d’éléments. Dans l’acte de perception nous ne faisons pas que juxtaposer une foule de détails, nous percevons des formes (Gestalt) globales qui rassemblent les éléments entre eux.
Le verbe gestalten peut se traduire par « mettre en forme, donner une structure signifiante ». Le résultat, la « gestalt », est donc une forme structurée, complète qui fait sens pour nous. Par exemple, une table prend une signification différente à nos yeux selon qu’elle est recouverte de livres et de papiers ou d’une nappe et de plats. Sa « gestalt » globale change : dans un cas, la table sert de bureau de travail, dans l’autre, elle est destinée au repas.
Quant au chêne, Francis Hallé interroge : « Qu’est-il, ce grand Chêne ? Pour le géographe, une marque paysagère, témoin d’ancestrales pratiques agricoles ; pour le forestier, un cylindre de bois « noble » susceptible d’être abattu, débité puis vendu à un prix intéressant. L’informaticien y verra un défi pour la simulation graphique et se mettra à la recherche des algorithmes les plus significatifs. Êtes-vous porté vers la mystique ? Alors ce Chêne devient un trait d’union entre le ciel, le monde des hommes et la Terre, un symbole cosmique donnant accès à l’universel ; une approche naturaliste y verra plutôt, affublée d’un nom latin, une forme de vie remarquable par sa longévité et l’ampleur de ses surfaces d’échange. Motif urbain ? Source de glands pour nourrir les porcs ? Simple tâche d’ombre pour le marcheur de l’été ? Pas du tout, dit l’adepte des médecines douces, dans cet arbre circule un flux d’énergie tellurique : adossez-vous à son tronc et vos douleurs lombaires vont s’apaiser. Vous n’y êtes pas, dit le philosophe, ce Chêne est avant tout la matérialisation de l’écoulement du temps, à la fois mémoire naturelle et supports de mémoire culturelle, il est le principe même de la civilisation(14). »
Ainsi, Il n’existe pas de perception isolée, pure, non influencée. Toute perception est initialement structurée par des représentations, liées à l’histoire de la personne, à ses expériences dans un milieu donné. Elle consiste en une distinction de la figure sur le fond car le tout est perçu avant les parties le formant : « le tout est supérieur à la somme des parties » ou, pour le dire autrement, « l’ensemble prime sur les éléments qui le composent ».
« En d’autres mots, ce qui est présent de façon tangible est toujours rempli par ce qui est absent, par une atmosphère intangible que nous ressentons implicitement… La signification de la figure, l’interprétation que nous en faisons, dépend du terrain en jeu. La relation figure/fond (thème/horizon, explicite/implicite, focus/champ) est la structure de base de l’expérience(15). »
Dans une situation donnée, les sensations suscitent l’activation d’informations contenues en mémoire qui provoquent une perception de la « réalité » par le sujet ainsi que ses réactions. C’est pourquoi, quand nous parlons de « grille de lecture » de la réalité, nous signifions par-là que chacun d’entre nous perçoit le réel à travers les « lunettes mentales » qu’il s’est construite au contact de son groupe d’appartenance.
Les différentes visions de la relation homme-nature dans la communauté
Ici, pour la simplicité du propos, nous faisons le choix d’utiliser le mot « nature » dans sa signification « extérieure ». Cependant, nous allons vite nous rendre compte combien la nature intérieure, la nature humaine, est partie prenante de l’affaire.
Nous nous focalisons au niveau collectif pour faire apparaître les visions concernant la relation homme-nature qui sont de l’ordre de la culture. Nous nous demandons quelles sont les grilles de lecture que nous rencontrons au niveau de la communauté des humains ?
Deux représentations l’emportent bien souvent : la première inclut totalement l’humain dans la nature, la seconde les sépare. Pour Edgar Morin, ces deux visions relèvent d’un méta-paradigme, celui de
la « simplification, qui, devant toute complexité conceptuelle, prescrit soit la réduction (ici de l’humain au naturel), soit la disjonction (ici entre l’humain et le naturel), ce qui empêche de concevoir l’unidualité (naturelle et culturelle, cérébrale et psychique) de la réalité humaine, et empêche également de concevoir la relation à la fois d’implication et de séparation entre l’homme et la nature(16). »
Fusion avec l’univers ou, au contraire, sentiment de large distanciation d’avec lui, à chaque fois il s’agit d’une attitude « simplificatrice », qui soulage de l’effort à fournir pour tenir ensemble les deux termes : l’humain et la nature. Cette posture, qui donne la prépondérance à l’un ou à l’autre, empêche de percevoir « l’unidualité » (pour reprendre l’expression d’Edgar Morin) ou, comme le dit Andy Fisher, de ressentir « l’unité-à-l’intérieur-de-la-séparation, le-semblable-à-l’intérieur-de-la-différence, la-continuité-à-l’intérieur-de la-discontinuité »(17).
Nicole Huybens, psychosociologue, qui a mis ses pas dans ceux d’Edgar Morin, se sert de la pensée complexe pour aborder la relation Homme-Nature. Dans l’ouvrage issu de sa thèse, La forêt boréale, l’éco-conseil et la pensée complexe. Comprendre les humains et leurs natures pour agir dans la complexité, elle distingue quatre représentations possibles.
« Pour notre part, nous allons distinguer quatre visions de la relation Homme – Nature : une vision anthropocentrique, une vision biocentrique, une vision écocentrique et une vision multicentrique(18). »
Le centre étant le point, l’élément où convergent et d’où rayonnent les forces, les éléments dispersés, toutes les décisions seront évaluées à l’aune de celui-ci.
1. L’anthropocentrisme : quand l’homme est le centre, l’unité de mesure
Selon la vision anthropocentrique, celle de notre monde occidental, l’être humain se considère comme séparé de la nature.
« L’humain est séparé de la nature, différent d’elle, il est rationnel et libre de construire son destin, il possède la capacité de produire des connaissances et l’éthique qui font défaut à la nature. Dans cette vision, l’humain justifie l’énigme de son existence par la valorisation d’une ou de plusieurs de ses caractéristiques propres : sa liberté, son éthique, sa rationalité et ses sentiments. Il est alors en droit de dominer la nature, de s’en servir comme un propriétaire, sans rituel, sans besoin de réciprocité, sans donner à la nature un caractère sacré(19). »
L’anthropocentrisme s’enracine dans la tradition judéo-chrétienne mais aussi dans la pensée grecque et dans la pensée humaniste. Parce qu’elles considèrent l’homme comme la mesure de toute chose, elles cherchent à l’épanouir en prônant le développement des facultés proprement humaines.
A partir du XVIIe siècle, l’anthropocentrisme s’est vu renforcé par le développement de la science mécaniste qui faisait de la nature un objet évaluable, mesurable, quantifiable : une matière en mouvement que l’on peut scruter, disséquer, classifier, mettre en calculs, pour finalement en tirer parti.
Avec la prédominance de la vision anthropocentrique,
« La nature est un objet parce que seul l’humain est un sujet(20). »
Porté par un élan prométhéen (du nom du héros qui vola le secret du feu aux dieux de l’Olympe afin d’en faire profiter les humains), l’homme se place en position de domination vis-à-vis de la nature(21).
On le comprend, en raison de ses racines humanistes, la vision anthropocentrique s’appuie sur les notions d’égalité entre les humains et de liberté pour chacun. Ce droit, accordé à tout individu mais insuffisamment encadré par la notion de devoir, lui a permis d’acquérir peu à peu un pouvoir sans précédent. Il a autorisé la mise en place de la société de production-consommation effrénée que nous connaissons aujourd’hui.
« Dans un monde d’individus libres et égaux, la logique économique du marché libre semble être un moyen raisonnable et équitable de prendre des décisions(22). »
Pour Nicole Huybens, la vision anthropocentrique se décline en réalité selon deux orientations très différentes : l’exploitation pure et simple de la nature ou bien son gardiennage.
La critique actuelle de l’anthropocentrisme est nécessaire face aux dégradations environnementales provoquées par l’ambition et l’avidité des hommes. Mais souvent cette remise en question occulte la seconde orientation, celle qui place l’être humain en position de gardien de la nature, une conception qui trouve ses racines dans la tradition judéo-chrétienne. Dans la bible, en effet, l’homme n’est pas seulement le maître de la nature que Dieu a institué : « … soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre » (Gn 1 : 28)
Il apparaît aussi comme son intendant : « Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder » (Gn 2 : 15).
A l’égoïsme débridé de l’être humain qui ne voit dans la nature que l’occasion de satisfaire ses envies s’oppose ainsi une attitude de responsabilité : il lui faut être un bon gestionnaire des « ressources naturelles » mises à sa disposition. Dans le premier cas, seul compte son propre intérêt ; dans le second, le jardin est gardé pour qu’il puisse profiter à tous, notamment aux générations futures.
Dès lors, au regard des problèmes écologiques de notre monde, une éthique environnementale qui se baserait sur la vision anthropocentrique nécessiterait de développer cette seconde attitude tout en freinant la première :
« Il s’agit de passer d’une conception despotique (dominer, écraser, réduire, manipuler, se prendre pour Dieu en insistant sur la violence et le pouvoir) à une conception de la gérance (collaborer, améliorer, comprendre, partager, ressembler à Dieu créateur et gérer sous sa conduite comme un intendant serviable et responsable)(23). »
Mais est-ce vraiment l’attitude la plus « juste » à prôner ?
2. Le biocentrisme : quand la vie est le centre à partir duquel se prennent les décisions
La vision biocentrique apparaît en contre-point de l’anthropocentrisme.
« Le biocentrisme se caractérise par l’abandon radical de la perspective anthropocentrique… où l’être humain apparaît comme l’achèvement de la création(24). »
Face aux excès destructeurs de la position anthropocentrique, s’oppose une vision radicalement inverse : la nature est sacralisée car toute vie appelle le respect. Chaque être vivant, quel qu’il soit, humain ou non-humain, possède en soi une valeur intrinsèque qui demande d’être prise en considération. Il est un organisme, destiné à s’accomplir, selon ses propres voies, et, en cela, il mérite d’être considéré et protégé autant qu’un autre.
Le biocentrisme, nous dit Nicole Huybens, est sous-tendu par une tendance, appelée « primitivisme », qui s’inspire du mythe de l’âge d’or. Des textes remontant à l’Antiquité – ceux d’Hésiode, d’Ovide, de Sénèque…- évoquent ce mythe. Il y a très longtemps, la vie était idéalement simple : la terre féconde nourrissait en abondance les hommes qui y vivaient paisiblement, n’ayant pour seul effort à fournir que celui de cueillir ce qui s’offrait à eux.
« Sans répression, sans loi, on y pratiquait la bonne foi et la vertu. Il n’y avait pas de juges, ni de navigation, ni de commerce, ni de guerre, ni d’armes. La terre, sans être cultivée, donnait fruits et moissons(25). »
Depuis ces temps idylliques, la situation a malheureusement dégénéré, la décadence s’est installée et l’essor de la civilisation, avec ses techniques, ses conquêtes, ses actions arrogantes et son lot de chagrins et d’inquiétudes, a commencé. Cette évolution est responsable de l’état de dégradation qui affecte notre planète aujourd’hui.
L’écologie profonde, développée par le philosophe Arne Naess, apparaîtrait comme relevant, du moins en partie, de cette vision biocentrique. Elle invite en effet à un renversement de la perspective anthropocentrée, l’homme ne se situant plus au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s’inscrivant au contraire dans l’écosphère en tant que partie du tout.
L’éthique de l’écologie profonde s’appuie sur huit principes, dont les trois premiers manifestent cette orientation :
« 1. Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines de la Terre ont une valeur en elles-mêmes (synonyme : valeur intrinsèque, valeur inhérente). Ces valeurs sont indépendantes de l’utilité du monde non-humain pour les besoins humains.
2. La richesse et la diversité des formes de vie contribuent à la réalisation de ces valeurs et sont également des valeurs elles-mêmes.
3. L’Homme n’a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux(26). »
La vision biocentrique est souvent critiquée pour son abolition de toute hiérarchie entre les êtres vivants, voire même pour ce qu’elle recèlerait d’anti-humanisme puisqu’elle refuse à homo sapiens toute place spécifique. D’une manière caricaturale, si tout être vivant a droit au respect, il n’y aurait pas de raison de choisir le camp des humains quand ils se trouvent en butte avec d’autres espèces menaçantes ou concurrentes. Les hommes étant considérés comme des agents de destruction de la nature, la tendance, pour quelques tenants du biocentrisme, serait même de ne leur accorder plus guère de crédit ! Parlant de ces militants extrémistes, André Beauchamp écrit : « Entre la terre et l’homme, ils optent pour la terre contre l’homme. L’être humain est la menace de la terre, sa déchéance, son cancer(27). »
3. L’écocentrisme : quand le système est le centre à partir duquel s’évalue les décisions
S’il remet en cause l’anthropocentrisme, le biocentrisme reste cependant tributaire d’une approche individualiste qui n’attribue de réalité qu’aux organismes isolés en négligeant leur intégration dans leur milieu de vie. Or la protection de la biodiversité s’intéresse surtout à des entités supra-individuelles, les espèces et les écosystèmes.
L’écocentrisme propose une approche plus large afin d’inclure ces entités globales : les espèces, les communautés d’êtres vivants, les écosystèmes. Elles ont une valeur intrinsèque car elles sont une matrice pour les organismes. Il s’agit donc de les prendre en considération.
Dans une interview, Philippe Descola déclarait :« Nous aurons accompli un grand pas le jour où nous donnerons des droits non plus seulement aux humains mais à des écosystèmes, c’est-à-dire à des collectifs incluant humains et non-humains, donc à des rapports et plus seulement à des êtres(28). »
La vision écocentrique s’appuie sur les découvertes systémiques de l’écologie scientifique : les éléments vivants (biotiques), et non vivants (a-biotiques) interagissent pour former un tout qui a sa cohérence propre. Elle se fonde sur l’existence même de la valeur systémique dans la nature.
En même temps, note Nicole Huybens, sa philosophie s’enracinerait dans un terreau traditionnel, notamment, le romantisme et le courant de la wilderness, qui considère l’être humain en lien étroit avec les éléments du monde plus-qu’humain et la nature comme un équilibre, plein d’harmonie et de beauté, à contempler et respecter.
L’éthique de l’écocentrisme repose sur l’analyse des conséquences des actes que nous accomplissons sur les écosystèmes. Aldo Leopold en a énoncé le principe fondamental dans Almanach d’un comté des sables : « Une action est juste, quand elle a pour but de préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est répréhensible quand elle a un autre but(29). »
La protection de la biodiversité devient dès lors un enjeu majeur car si une espèce disparaît, c’est tout l’écosystème qui se déséquilibre et ce déséquilibre rejaillit sur les autres espèces, y compris sur nous-mêmes, les hommes. Il nous faut donc favoriser un partenariat avec l’ensemble de la communauté biotique qui exclue toute tendance à privilégier les seuls intérêts humains.
« Quand nous oublions que nous sommes enchâssés dans le monde naturel, nous oublions aussi que c’est à nous-mêmes que nous faisons ce que nous infligeons à notre environnement(30). »
En mettant l’accent sur l’interconnexion des formes de vie au sein d’un tout complexe et harmonieux, l’écocentrisme appelle les humains à respecter les lois de la nature.
« Contempler la beauté du monde, le penser comme un tout et harmoniser les conduites humaines aux lois de la nature sont les piliers de la vision écocentrique(31). »
Soucieux du bon fonctionnement des écosystèmes, les écocentristes considèrent l’espèce humaine comme une espèce parmi d’autres, en lien d’interdépendance avec elles. Ils « font souvent appel au principe de précaution dans son sens restrictif : quand on ne connaît pas avec exactitude les conséquences d’une décision, il importe de ne pas la mettre en œuvre(32). »
Dans cette approche, les sentiments ne sont pas à exclure mais servent au contraire la démarche. Aldo Leopold l’exprime clairement : « Il me paraît inconcevable qu’une relation éthique avec la terre puisse exister sans amour, respect et admiration pour la terre, sans aucun égard pour sa valeur. Par valeur, j’entends, bien sûr, quelque chose de plus fondamental que la simple valeur économique, j’entends la valeur en son sens philosophique(33). »
Pour Nicole Huybens, cette place donnée aux sentiments dans la relation à la nature rejoindrait la démarche des romantiques qui considéraient les émois éprouvés devant la beauté du monde comme la source d’une connaissance d’ordre poétique. En opposition à l’attitude prométhéenne rationnelle et utilitariste, cette vision romantique relève de l’attitude orphique, du nom du héros et poète grec, fils de la muse Calliopé (poésie), qui, par son chant et les accents de sa lyre, charmait les animaux sauvages et parvenait même à émouvoir les végétaux et les éléments inanimés(34).
Sur le plan pratique, l’éthique de l’écocentrisme implique la mise en place d’une éducation du public. L’écologie pourrait, par exemple, être enseignée dans le secondaire par des experts en écosystémique, afin que chacun se trouve informé des lois de la nature et comprenne les conséquences de ses actions sur l’environnement.
La protection de la nature demande en effet des connaissances complexes. Si on néglige les règles de fonctionnement des écosystèmes, on peut en effet agir de manière inutile, voire nuisible, même en croyant « bien faire ». Dans son ouvrage Plaidoyer pour une nouvelle écologie de la nature, l’écologue Jean-Claude Genot en donne plusieurs exemples : vouloir sauver une espèce ou tenter d’agir pour l’amélioration de la planète engendre parfois des mesures artificielles, incohérentes, qui privilégient un élément au détriment du système. Ainsi, préserver la chevêche nécessiterait « la destruction (inutile) de la fouine parce qu’elle est un prédateur de la chevêche » ; pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait transformer nos forêts « en champs d’arbres » qui absorberait le gaz carbonique tout en nous fournissant en bois de chauffage, mais qui supprimerait radicalement la dimension éco-systémique du lieu.
4. Le multicentrisme : quand le centre est dans la coordination de l’un ET l’autre
Nicole Huybens relève que la vision écocentrique est entachée de plusieurs paradoxes :
– Les lois de la nature sont appréhendées et comprises en dehors de la présence de l’homme. Nous étudions les processus naturels en eux-mêmes, comme si l’homme n’y était pas mêlé. Mais qu’en est-il de la situation réelle, celle où il est inséré dans la nature ?
– Par ailleurs, les écosystèmes ne sont pas stables. Faut-il préserver à tout prix leur intégrité, au risque de contrevenir au processus naturel d’évolution ? Si l’on veut conserver les écosystèmes tels qu’ils sont, ne risque-t’on pas de contrevenir à la dynamique de changement, lente et puissante, de la nature ?
« Dans un monde complexe où la destruction de la nature s’accélère, agir efficacement pour la protection de la faune et de la flore n’est plus à la portée de n’importe quelle personne d’aussi bonne volonté soit-elle . »
– Enfin, la nature est autant « barbare » que « bienveillante » et les lois de la nature ne sont pas forcément toutes « bonnes » à suivre.
Si l’écocentrisme introduit à la complexité, il s’agit d’aller plus loin encore en proposant une vision multicentrique qui intègre « des antagonismes et des contradictions dans un cadre qui permet d’envisager leur complémentarité ».
L’écocentrisme « devrait permettre d’intervenir dans la complexité d’une problématique socio-environnementale, qui inclut et dépasse les trois premières visions et présente de manière articulée ce qui peut a priori apparaître comme des contradictions(35). »
Cette nouvelle approche s’articule, selon Nicole Huybens, autour de cinq concepts clés.
1. La co-évolution :
Non seulement, l’humain et la nature sont en lien étroit mais ils se créent mutuellement. « Les humains et la nature sont les produits l’un de l’autre », les produits de leur co-évolution.
La lente marche du monde s’est faite, précise Edgar Morin, « par transformations mutuelles entre une biosphère acentrique, inconsciente, spontanée et une humanité devenant de plus en plus consciente de son devenir et du devenir du monde(36). »
Nicole Huybens ajoute : « L’humain, en devenant conscient du devenir de l’univers, donne une conscience au monde, cela le distingue des autres espèces, sans le séparer(37). ». De tous les acteurs du système, lui seul en effet possède la capacité de réflexion sur ce qui se passe.
En grande partie, aujourd’hui, la planète résulte des activités humaines. Au cours des millénaires, elle s’est peu à peu « anthropisée ». Par ailleurs, notre identité en tant qu’homme ou femme est le résultat de notre interaction renouvelée avec la Terre qui nous porte.
Le multicentrisme ouvre la perspective d’un partenariat qui « associe l’humanité et la nature dans une relation réciproque(38) » mais qui pour autant ne fait pas de l’être humain un être séparé.
« L’homme doit cesser de se concevoir comme maître et même berger de la nature… Il ne peut être le seul pilote. Il doit devenir le co-pilote de la nature qui elle-même doit devenir son co-pilote(39). »
Il s’agit donc de considérer la relation entre l’humain et la nature comme une dynamique de réciprocité créatrice. La spécificité de notre espèce n’est pas à nier, elle a toute sa place. Sur le plan neuro-anatomique, elle est la conséquence du développement exceptionnel du lobe frontal de nos cerveaux, qui nous permet d’être capables de mémoire, de concentration, de gestion des émotions, de pensée réfléchie, et nous met ainsi en position de participer de manière consciente à l’évolution.
« L’humain ne peut nier ni sa dignité, ni sa spécificité, ni la valeur intrinsèque de sa partenaire, la nature(40). »
La spécificité de l’être humain, défendue dans la vision anthropocentrique, est ici reprise mais d’une manière tout à fait différente, puisqu’en lien étroit et co-créateur avec la nature.
2. La responsabilité :
En raison du développement de sa conscience, l’humain est responsable de ses actes.
« On peut voir dans l’apparition des conventions internationales sur le climat ou sur la biodiversité des exemples concrets de l’exercice de cette responsabilité. Ceci sera insuffisant : chaque humain est aussi responsable devant sa conscience sans tribunal pour ce qui concerne les conséquences futures de son agir quotidien(41). »
3. La raison et les sentiments :
Connaître la nature de manière rationnelle et scientifique, est indispensable pour prendre les décisions les plus appropriées possibles. Savoir comment fonctionnent les entités naturelles et les écosystèmes réduit le risque de se comporter selon son seul imaginaire.
Mais l’approche sensible a également sa place. Nous pouvons voir par exemple que la réintroduction des ours provoque des réactions émotionnelles très différentes selon les personnes : réjouissance, peurs, colère… Grâce à sa faculté de se mettre à la place de l’autre, l’être humain est capable d’empathie non seulement à l’égard de ses semblables mais également à l’égard des éléments du monde non-humain.
« La vision multicentrique de la relation homme – nature suppose que la bienveillance, terme générique que nous pouvons utiliser pour désigner les différentes formes d’amour, sous toutes ses formes, guide les décisions humaines autant en relation avec d’autres humains qu’en relation avec la nature(42). »
4. Le holisme et l’individualisme :
Ne voir que l’individu fait oublier l’espèce. Mais ne s’occuper que de l’espèce fait disparaître l’individu.
La vision multicentrique prend en considération l’individu comme le fait le biocentrisme (à l’égard de chaque être vivant) ou l’anthropocentrisme (uniquement à l’égard de chaque être humain), elle prend aussi en considération les espèces et les écosystèmes comme le fait l’écocentrisme.
« Une éthique multicentrique tient compte :
des individus ET des espèces,
d’un animal ET de l’écosystème,
des humains dans leur spécificité ET de la nature dans sa biodiversité(43). »
5. Le dialogue :
« La complexité de la vision multicentrique ne peut s’exprimer de manière adéquate sans recourir à la démocratie dialogique, qui semble le meilleur rempart contre le retour aux discours totalisants(44). »
Pour aller dans le sens de la vision multicentrique, il est nécessaire de donner place à la pluralité des points de vue, sans craindre les conflits qui peuvent en découler. Dans le cadre du débat, les antagonistes sont à entendre si on veut laisser émerger une position qui n’exclut aucun terme. Cette voie d’ouverture trouve son point d’appui dans la reconnaissance de l’altérité : tenir compte de l’autre, respecter sa différence, écouter ce qui lui est particulier.
[à suivre commentaire suivant]
notes
[1] Andy Fisher, Radical ecopsychology, Psychology in the service of life, State University of New York Press, 2002, p. 31-32 (traduction des auteurs).
[2] Cf. le concept de pensée complexe (Edgar Morin)
[3] Philippe Descola, https://www.youtube.com/watch?v=SWaB7bI3MF0
[4] Phillipe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2006, p. 15.
[5] Andy Fisher, Radical ecopsychology, Psychology in the service of life, State University of New York Press, 2002, p. 99 (traduction des auteurs).
[6] Ibid., p. 95.
[7] Francis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, Actes Sud, 2014, p.13.
[8] Louis Espinassous, Besoin de nature, Editions Hesse, 2014, p. ?
[9] Gérald Hess, Ethiques de la nature, PUF, 2013, p. 30.
[10] D’après Thinès-Lemp, 1975. http://www.cnrtl.fr/definition/relation
[11] http://www.cnrtl.fr/definition/Perception
[12] Guillaume Carron, La désillusion créatrice Merleau-Ponty et l’expérience du réel, MétisPresses, 2014, p. 18 et 19.
[13] Ronald Bonan, Apprendre à philosopher avec Merleau-Ponty, ellipses, 2010, p. 176.
[14] Francis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, Actes Sud, 2014, p.11.
[15] Andy Fisher, Radical ecopsychology, Psychology in the service of life, State University of New York Press, 2002, p. 58 (traduction des auteurs).
[16] La méthode IV. Les idées : leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Seuil, Paris, 1991, p.213-214.
[17] Andy Fisher, Radical ecopsychology, Psychology in the service of life, State University of New York Press, 2002, p. 95 (traduction des auteurs).
[18] La forêt boréale, l’éco-conseil et la pensée complexe. Comprendre les humains et leurs natures pour agir dans la complexité, Editions universitaires européennes, 2011, p. 83. A noter que cette description des différentes visions de la relation Homme-Nature par Nicole Huybens diverge de établie par Gérald Hess concernant les postures morales que l’on peut adopter en éthique environnementale : théocentrisme, anthropocentrisme, pathocentrisme, biocentrisme, écocentrisme. Cf. Gérald Hess, op. cit.
[19] Ibid., p. 84
[20] Ibid., p. 85
[21] Voir Marie Romanens, « Les retombées du romantisme : à la découverte des continents oubliés » et Pierre Hadot, Le voile d’Isis, Gallimard, 2004.
[22] Nicole Huybens, op. cit., p.86-87
[23] André Beauchamp, Introduction à l’éthique de l’environnement, Montréal Paris, Editions Paulines, Médiaspaul, 1993. Cité par Nicole Huybens, op. cit., p.85.
[24] Ibid. Cité par Nicole Huybens, op. cit., p.89.
[25] Pierre Hadot, Le voile d’Isis, Gallimard, 2004, p.155.
[26] Wikipedia.
[27] André Beauchamp, Introduction à l’éthique de l’environnement, Montréal Paris, Editions Paulines, Médiaspaul, 1993. Cité par Nicole Huybens, op. cit., p.91.
[28] Télérama, n° 3392, 17-23 janvier 2015.
[29] Almanach d’un Comté des Sables, Flammarion, 2000, p. ?
[30] Suzuki, D ; & Mcconnell, A. (2003) L’équilibre sacré : Redécouvrir sa place dans la nature (Québec, Fides), cité par Nicole Huybens, op. cit. p.93.
[31] Nicole Huybens, op. cit., p. 94.
[32] Nicole Huybens, op. cit., p. 95.
[33] L’almanach d’un Comté des Sables, Flammarion, 2000, p. ?
[34] Voir Marie Romanens, « Les retombées du romantisme : à la découverte des continents oubliés » et Pierre Hadot, Le voile d’Isis, Gallimard, 2004.
[35] Jean-Claude Génot, Plaidoyer pour une nouvelle écologie de la nature, L’Harmattan, 2014, p. 50.
[36] Edgar Morin, La méthode II : La vie de la vie, Paris, Seil, 1980, p. 96-97.
[37] Nicole Huybens, op. cit., p. 99.
[38] Ibid.
[39] Edgar Morin, La méthode II : La vie de la vie, Paris, Seuil, 1980, p. 97.
[40] Nicole Huybens, op. cit., p. 100.
[41] Ibid., p. 101.
[42]Ibid., p. 102.
[43] Ibid., p. 103.
[44] Ibid., p. 105.
Dernière édition par Florage le Sam 30 Mai - 17:14, édité 5 fois
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
deuxième partie
La relation Homme-Nature
Patrick Guérin et Marie Romanens, écopsychologie, 29 mars 2015
Les besoins humains comme grille de lecture
Tout en chaussant les lunettes culturelles de son groupe d’appartenance, l’individu voit la nature en fonction également de son histoire personnelle. En nous tournant vers la théorie des besoins établie par Abraham Maslow, nous trouvons une autre grille de lecture de la relation Homme-Nature qui explique les comportements humains.
Cette fois, nous nous focalisons sur les besoins propres de chacun.
Selon Maslow, l’homme recherche la satisfaction de besoins qui sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Il ne peut passer d’un besoin à un autre que si le premier a été (du moins en partie) « ontologiquement satisfait ». Autrement dit nous ne pouvons accéder au troisième étage d’un immeuble que si nous sommes d’abord passés par le rez-de-chaussée, le premier puis le deuxième étage. Le sentiment de satisfaction éprouvé dépend de l’histoire du sujet et de la culture dans laquelle il baigne.
1. A la base, nous trouvons les besoins de survie : boire, manger, dormir, se reproduire, conserver l’homéostasie du système vivant que nous sommes.
2. Une fois la survie assurée, nous pensons à notre sécurité : éloigner le danger, prévenir le manque en thésaurisant les ressources. Nous sommes alors dans le domaine de l’« avoir ».
3. Maintenant que nous craignons moins pour notre avenir, nous tissons des liens avec notre entourage humain et non-humain. Notre besoin d’appartenance nous incite à nous relier à…
4. Rassurés physiologiquement et affectivement, nous voulons satisfaire le besoin d’estime, de reconnaissance de notre originalité. Nous voulons « être ».
5. De ce mouvement d’affirmation de soi émerge le besoin d’accomplissement de soi, de réalisation des capacités et les dons qui sont en nous.
Si, comme toute modélisation, la pyramide da Maslow montre certaines limites (par exemple, la hiérarchie des besoins n’apparaît pas comme étant aussi stricte), elle a le mérite néanmoins d’avoir un aspect très pratique. Nous pouvons la considérer comme une grille de lecture heuristique pour lire les comportements humains.
Ainsi, dans la relation Homme-Nature, les différents besoins se traduisent par les comportements suivants :
– Le besoin de survie nous incite à regarder la nature comme source de satisfactions primaires : boire, manger, dormir.
– Le besoin de sécurité nous amène à thésauriser, stocker, accumuler des réserves ainsi qu’à nous prémunir contre les déchaînements soudains) dont notre environnement peut être le siège (tempête, raz de marée, avalanches, etc.).
– Le besoin de relation nous incite à voir dans le monde non-humain un univers qui nous accueille, qui est là pour nous apporter la tendresse que notre entourage familial ne sait peut-être pas toujours nous apporter. Qui n’est pas allé se consoler d’un chagrin ou d’une dispute, en se réfugiant dans la forêt ou la campagne environnante, ou en allant parler à « ses » fleurs ?
– Le besoin d’estime peut nous inciter à affirmer notre pouvoir sur notre environnement. Notre société occidentale avec la technologie qu’elle a développée (pesticides, engins de chantier, tracteurs, barrages hydrauliques…) a cherché à compenser son état d’infériorité vis à vis de la nature. Quel garçon quand il était petit n’est pas resté des heures en admiration devant un engin modelant le sol pour une future autoroute ?
– Le besoin d’accomplissement de soi, de la vie en soi, quant à lui, nous permet de changer notre relation à la nature. De rivale ou d’objet à notre disposition, elle devient alter ego, une autre forme du vivant qui nous permet en la comprenant et en l’étudiant d’être à l’écoute de la vie en nous et de ses mouvements. Quelle douceur dans le contact, quelle tendresse dans les propos de certains pépiniéristes quand ils nous parlent de leurs plantes !
Pour résumer, imaginons l’exemple d’un jardin créé par une personne qui cherche à satisfaire ses besoins de base et de sécurité : c’est un potager. Si elle veut satisfaire ses besoins d’appartenance : le voilà couvert de fleurs, avec des endroits où il fait bon venir s’asseoir. Supposons maintenant qu’elle veuille satisfaire son besoin d’estime : le jardin est « à la française » ou couvert de plantes exotiques et rares. Enfin, si elle désire réaliser sa créativité : il est à taille humaine et révèle l’harmonie entre les végétaux qu’il héberge.
Les bases neurologiques des grilles de lecture individuelles
On doit à Paul Mac Lean, qui a forgé dans les années 1950 la théorie des « trois cerveaux en un », de nous avoir montré que le cerveau est le produit de l’évolution et qu’il est constitué de structures différentes présentes chez d’autres espèces(45).
Il se serait construit selon trois grandes étapes :
– le cerveau reptilien, situé sur le tronc cérébral, est à l’origine des comportements archaïques liés à la survie, à la défense du territoire et à l’intégrité de l’individu : se nourrir, se reproduire, s’abriter, fuir ou combattre. Ces comportements sont du registre du pur réflexe instinctif et du binaire : oui/non, lui ou moi, tout ou rien.
Le cerveau reptilien est le siège des émotions primaires, le lieu d’une « violence fondamentale(46) », primitive, d’une poussée instinctuelle qui sert la lutte pour la vie. A ce niveau, pas de discussion possible. Il n’existe pas d’espace pour analyser, comprendre, élaborer des stratégies qui tiennent compte des différents éléments en présence. Il manque le tiers qui permet de penser l’altérité et évite ainsi de réagir de manière manichéenne.
La réaction de panique à la vue d’un serpent est de l’ordre du réflexe reptilien, bien utile lorsque notre existence est véritablement en danger.
Mais le refus obtus de changement prend également sa source dans ce même cerveau reptilien car changer signifie perdre ses repères, ses habitudes (son habitus) et donc (au moins en partie) son identité.
– le cerveau limbique, venu se greffer sur le cerveau reptilien, correspond à la partie centrale du cerveau. Constitué de nombreux noyaux et ganglions, il est considéré comme « le centre des émotions » et des sentiments.
Traitant la réalité en termes de plaisir ou de déplaisir, il joue un rôle important dans la perception et l’expression des émotions. Il est également impliqué dans les phénomènes de résistances au changement car ce dernier est perçu avec ses désagréments.
Le cerveau limbique participe aux mécanismes de projection des sentiments sur la nature, à l’anthropomorphisme(47), mais aussi à l’élaboration des mythes, des contes, de la poésie, de la vie symbolique en général.
– le néocortex, apparu plus tardivement, est situé sur la couche externe des deux hémisphères cérébraux. Particulièrement développé chez les primates supérieurs, il est le siège des activités cognitives les plus élaborées.
Selon ce schéma, élaboré par Mac Lean, on comprend aisément que la rencontre avec la laie et ses petits au cœur de la forêt va stimuler le cerveau archaïque, tandis que la vision de l’hellébore en fleur sollicite d’autres zones du cerveau (limbique et corticale), et qu’ainsi les deux situations sont à l’origine de réactions très différentes. Dans le premier cas, nous redevenons un animal mû uniquement par l’instinct de survie ; dans le second, nous éprouvons une émotion de joie et d’émerveillement, nous nous arrêtons pour contempler et nous avons peut-être envie d’écrire un poème, de prendre une photo, de faire une aquarelle…
Arthur Koestler avait une bonne formule pour imager cette situation : avoir plusieurs cerveaux en un : « Pour parler allégoriquement de ces trois cerveaux dans le cerveau, on peut imaginer que le psychiatre qui fait étendre son patient lui demande de partager le divan avec un cheval et un crocodile(48). »
Aujourd’hui, les recherches scientifiques sont venues remanier la théorie de Paul Mac Lean(49). Nous savons, par exemple, que le cerveau des crocodiles ne se limite pas à une structure archaïque. Il possède également un système limbique et un cortex (le pallium), ce qui explique les comportements maternels développés par ces animaux.
Les vertébrés – les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères – ont en fait des cerveaux qui sont construits selon la même structure. Ce qui diffère entre eux est seulement le développement relatif des différentes parties de cette structure.
Qui plus est, il n’existe pas de cloisonnement entre les différentes régions du cerveau et leurs fonctions, comme la théorie de Mac Lean le laisserait penser. Antonio Damasio, professeur de neurologie, a démontré par exemple que le système limbique est impliqué dans les facultés de raisonnement : le cœur participe à la raison. Les mécanismes neuraux nécessaires aux processus rationnels, que l’on situe habituellement au niveau néocortical, ne peuvent fonctionner que grâce à la participation des niveaux sous-corticaux. Pour reprendre l’image d’Arthur Koestler, le cavalier ne saurait exister sans son cheval !
« Par certains côtés, la capacité d’exprimer et ressentir des émotions est indispensable à la mise en œuvre des comportements rationnels(50). »
« La nature semble avoir construit les mécanismes sous-tendant la faculté de raisonnement non pas seulement au-dessus des mécanismes neuraux sous-tendant la régulation biologique, mais aussi à partir d’eux, et avec eux… Le néocortex fonctionne de pair avec les parties anciennes du cerveau, et la faculté de raisonnement résulte de leur activité concertée(51). »
Cependant, bien que la théorie des trois cerveaux de Mac Lean soit en partie obsolète, elle a le mérite de nous faire comprendre comment, en tant qu’humains, nous pouvons avoir des réactions si différentes suivant les situations que nous rencontrons, comment nous pouvons nous sentir assaillis par des sensations, des émotions, des aspirations parfois très antagonistes(52). Selon les évènements auxquels nous sommes confrontés, selon également le processus de maturation qui a été le nôtre, nous développons des comportements qui prennent leur source à des stades très différents, archaïques ou élaborés.
La maturation psychique au service du dialogue homme-nature
Savoir prendre en considération l’autre, humain ou non-humain, savoir se mettre à son écoute au lieu d’avancer des idées toutes faites, nécessite d’avoir développé une certaine maturité. L’ouverture à l’altérité est le résultat d’un long processus conduisant à l’humanisation de l’être.
A ce niveau, la manière dont chacun se comporte vis-à-vis de la nature dépend des situations qui ont plus ou moins conditionné son accès à la maturité.
Focalisons-nous maintenant sur ce processus et ses aléas.
– Le processus d’humanisation
Dans les premiers mois de vie, disent les psychanalystes, le nourrisson est encore très peu différencié. Dans un état de dépendance extrême, Il se trouve pour une large part confondu avec son environnement: avec sa mère, sa famille proche, mais aussi avec le monde non-humain qui l’entoure (comme le souligne Harold Searles).
Au fur et à mesure de son développement, grâce à l’interaction incessante avec ses proches qui soutiennent ses progrès, l’enfant va pouvoir de mieux en mieux affirmer sa différence. Il traverse différentes étapes, auxquelles on a donné le nom de « castrations symboliques », lors desquelles il perd peu à peu les avantages liés à sa fragilité et son impuissance de tout-petit ainsi que les illusions qui les accompagnent : perte du sein, nécessité de contrôler ses sphincters, de s’habiller seul, de s’assumer de plus en plus lui-même, perte de l’illusion d’être « le centre du monde », perte de l’illusion de pouvoir être le partenaire privilégié du parent de sexe opposé… Il est poussé à renoncer à nombre de prérogatives liées au jeune âge mais, ce faisant, il gagne en identité personnelle. Ce grandissement, lorsqu’il s’effectue sans entraves, autrement dit lorsque l’entourage soutient l’enfant dans son avancée, le conduit à se percevoir progressivement comme un être distinct, différent de sa mère, de son père, de sa fratrie, de tout son environnement au sens large.
Le contact répété avec le monde, à travers l’école, le voisinage, les activités de jeux et d’éveil, les éléments naturels…, contact nourri par sa curiosité, sa soif de découvertes et son esprit d’entreprise, le confirme dans ce processus de différenciation.
De la nébuleuse initiale émerge petit à petit le « dissemblable » et le « pluriel ». Le « Je » apparaît en même temps que le « Tu » et en même temps que le « Nous » et le « Vous ». Cheminement difficile, qui nécessite des conditions favorables : à savoir des parents (ou leurs substituts) disponibles, compréhensifs, soutenants et capables de poser les limites protectrices. Cheminement parsemé de progrès et de régressions, de pas en avant suivis de reculades, avec son lot de rebondissements… mais qui conduit à l’humanisation de l’être : une maturité qui repose sur le sens de l’altérité, de la réciprocité, de la rencontre.
« Le mot fondamental Je-Tu fonde le monde de la relation(53). »
Le sens de l’altérité est la condition sine qua non pour que la pensée complexe émerge.
Tenir compte de mon propre vécu, de mes perceptions et de mes idées, en même temps que je tiens compte du vécu, des perceptions et des idées de l’autre ou des autres, tenir compte de ce qui fait différence, voire de ce qui s’oppose, entre moi et lui, voilà les conditions pour que la réalité complexe puisse se révéler.
Cet accès au sens de l’altérité n’est possible pour l’être que s’il a acquis un sentiment de sécurité interne. Lorsque celui-ci est insuffisamment développé, l’individu aura beaucoup plus tendance à réagir à des niveaux archaïques, c’est-à-dire en termes dualistes et manichéens, sans pouvoir prendre en compte « l’autre ». Il aura tendance à classer le monde sur le mode binaire : le bien/le mal, les bons/les méchants, le sain/le malsain…
– L’expérience psychique
La vie au fondement est interactivité et son mouvement procède par vagues expérientielles. Au contact de l’autre, quelque chose se produit en moi, une sensation émerge. Me voilà engagé dans un processus qui, si je ne le refuse pas, me crée en élargissant ma conscience.
Chaque vague expérientielle se déploie elle-même selon un cycle qui comporte trois moments successifs : celui du sentir, celui du penser et celui de l’agir. Pour désigner ce dynamisme profond qui, inlassablement, est à l’œuvre dans nos vies, le philosophe et psychanalyste Charles Baudouin a proposé le terme d’ « arc réactif »(54).
Le sentir, c’est l’écoute de ce qui se manifeste dans mon corps dans une situation donnée : un besoin, un désir, une émotion… surgissent en moi. Le penser se réfère au processus d’élaboration qui suit cette perception : l’attention que j’accorde à mon ressenti, les images qui me viennent à l’esprit, l’appréciation de la situation, l’hypothèse que je me fais sur ce qui est en jeu, le raisonnement que je développe pour comprendre ce qui se passe, le lien que j’établis entre mes manifestations corporelles et le phénomène qui les a déclenchées, le jugement que j’en tire… L’agir apparaît enfin quand la décision se prend : je passe à l’acte.
Se référant à la méthode du Focusing élaboré par Eugen Glending, Andy Fisher subdivise, quant à lui, le processus de la vague expérientielle en sept phases qui forment ensemble une boucle :
– L’expérience commence par un ressenti : par exemple, besoin de se sustenter, désir sexuel, besoin de bouger, de toucher, d’exprimer une émotion, besoin de reconnaissance, envie de créer…
– Nous prenons conscience de cette sensation corporelle : de ce qui parle en nous. Nous sommes alors tournés entièrement vers nous-mêmes, vers ce qui émerge au-dedans de nous.
– Une fois cette prise de conscience réalisée, une fois notre besoin – mais le plus souvent il s’agit de plusieurs besoins à la fois – élucidé, nous nous préparons pour lui répondre. Dans la mesure des moyens à notre disposition, nous nous mobilisons.
– Nous passons à l’action. Nous nous engageons dans la résolution du problème que notre besoin provoque dans la situation donnée. Nous sommes alors orientés vers l’extérieur.
– Le contact final : notre expérience prend sens. Notre besoin trouve sa réponse, notre tension se relâche. Nous sommes changés.
– Nous éprouvons un sentiment de satisfaction. Nous assimilons la nouvelle expérience, nous en comprenons sa signification.
Ce cycle expérientiel, auquel on donne parfois le nom de « gestalt » (ce qui, nous l’avons vu, signifie « forme » en allemand) est loin de coller à toutes les conduites. Parfois les perceptions n’aboutissent nullement à l’élaboration d’une action. Chez certaines personnes, par exemple, elles sont l’occasion de « ruminations » interminables et stériles. Au contraire, il arrive qu’elles déclenchent des actes impulsifs. Un conducteur qui, au dernier moment, aperçoit un obstacle sur sa route réagira instinctivement par un mouvement d’évitement. Cette fois, la phase de traitement de l’information est totalement réflexe.
Le moment de la prise de conscience du ressenti et la phase d’élaboration qui s’en suit sont essentiels pour la vie psychique. La phase d’élaboration proprement dite est sujette à de nombreuses variances selon notre histoire, nos souvenirs, nos apprentissages cognitifs, notre représentation de nous-mêmes, nos acquisitions culturelles… Là s’inscrit toute la spécificité humaine.
La « prématuration » qui affecte le petit d’homme, autrement dit l’inachèvement de son système nerveux à la naissance, associée à une masse neuronique surnuméraire, a pour conséquence de donner une place déterminante à l’environnement humain, à la culture. En fonction des relations tissées avec les proches et la société, les connexions neuronales vont se faire, permettant ainsi le processus d’hominisation.
Voici comment Antonio Damasio en arrive à décrire les êtres humains : « Il s’agit d’organismes se trouvant à la naissance dotés de mécanismes automatiques de survie, et qui acquièrent par l’éducation et la culture un ensemble de stratégies supplémentaires, désirables et socialement acceptables, leur permettant de prendre des décisions. Ces stratégies, à leur tour, augmentent leurs chances de survie, améliorent remarquablement la qualité de celle-ci, et fournissent la base de la construction de la personne(55). »
On voit ainsi combien l’interaction entre l’enfant et son entourage proche, et à travers lui avec toute la culture, joue un rôle extrêmement important dans sa maturation. Ce processus très actif dans le jeune âge se poursuit en fait toute la vie. Suivant son déroulement, suivant que le degré de maturité atteint sera plus ou moins grand, la capacité de prise de recul, de réflexion et d’analyse lors de chaque vague expérientielle sera différente.
Selon les acquis culturels, la phase d’élaboration aura parfois tendance à se réduire à portion congrue : le penchant est alors de passer très vite de la sensation à l’action, en suivant des certitudes toutes faites, un prêt-à-penser simplificateur, une vision selon le mode binaire, qui reposent sur des fonctionnements archaïques où il n’y a pas de place pour le raisonnement complexe. Quand les conditions familiales n’ont pas permis l’installation véritable d’un sentiment de sécurité interne, l’espace psychologique reste étroit et la personne adhère facilement aux grilles de lecture collective qui manquent de complexité.
A l’inverse, la phase d’élaboration gagne en épaisseur lorsque nous sommes ouverts à l’altérité, capables par conséquent de tenir compte des différents éléments en présence et des besoins qui se manifestent en nous. Alors, elle donne lieu à des réponses parmi les plus adaptées à la complexité des situations.
Faire face à cette complexité extérieure des situations demande une capacité d’accueil de notre complexité interne. Celle-ci provient du fait que, très souvent, plusieurs besoins s’expriment en nous au même moment, plusieurs tendances se manifestent tout à la fois. Par exemple, nous pouvons avoir besoin de nous sentir reconnus par nos pairs tout en nous sentant en désaccord avec eux. Nous nous sentirons alors tiraillés entre deux attitudes possibles : nous conformer à leur manière de faire et de penser ou, au contraire, nous désolidariser d’eux.
Savoir jongler avec cette complexité interne dépend étroitement du processus d’humanisation, dit aussi processus d’individuation, qui a été (et qui continue à être) le nôtre en fonction des relations que nous avons nouées au cours de notre vie (et que nous nouons encore) avec notre entourage. C’est cette aptitude qui nous ouvre à la complexité externe et nous permet d’accéder à des grilles de lecture de ce niveau.
Si notre psyché dépend en grande partie de processus archaïques, si nous n’avons pu développer un sentiment de sécurité interne suffisamment fort, cet accès reste barré. Lorsque nous sommes sous l’influence prédominante de ce mode de fonctionnement primaire (et nous pouvons y revenir à tous moments lorsque les conditions extérieures deviennent menaçantes ou quand les conditions sociales nous y poussent), nos modes de pensée sont de l’ordre de la simplification.
Mais lorsque nous ne vivons plus en mode de survie, quand nous pouvons nous sentir suffisamment en sécurité pour nous ouvrir à l’autre à l’extérieur, ainsi qu’à la subtilité de tous ces « autres » qui sont à l’intérieur de nous – toutes ces tendances diverses qui se manifestent à partir de notre être corporel -, alors nous pouvons reconnaître et tenir ensemble les contradictions apparentes et accéder à une pensée complexe.
Pour en revenir à la relation Homme-Nature, il apparaît que nos représentations sont donc en lien direct avec le chemin de maturation qui vient d’être décrit.
– Dans la vision purement anthropocentrique, par exemple, place est faite surtout aux besoins de sécurité (posséder pour ne pas manquer, pour ne pas se retrouver démuni) et aux envies d’avoir une vie matérielle plus confortable. Nous nous trouvons à un niveau égocentrique, qui manque d’ouverture à l’altérité, au non-humain et même bien souvent aux humains. Les autres besoins, de contact avec le monde, mais aussi de reconnaissance de notre nature propre – écoute des signaux qui viennent de notre corps -, en somme de prise en compte de l’autre en nous, sont en partie négligés. Ce qui a pour conséquence de mettre à mal les processus d’élaboration nécessaires dans notre relation à la nature. Il en résulte des réponses forcément simplistes : l’homme d’un côté et la nature de l’autre, à sa disposition.
– Dans la vision biocentrique, la souffrance que la destruction de la vie autour de nous provoque est entendue. Mais, elle déclenche une réaction qui entraîne le pendule à l’opposé. Il semble essentiel de donner toute sa valeur au vivant. Mais que représente exactement celui-ci ? Que projetons-nous sur lui ? N’y a-t-il pas là non prise en compte cette fois de l’altérité de l’homme ?
Accorder de l’importance à chaque être vivant quel qu’il soit risque de nous conduire à laisser de côté certaines nécessités liées à notre espèce humaine, en particulier les problèmes sociaux. Là encore, les réponses risquent d’être simplistes, par défaut du processus d’élaboration de l’interdépendance.
– Dans la vision écocentrique, la compréhension du vivant est davantage développée, avec ses mécanismes d’interrelation systémiques. Cependant, cette approche a ses limites. Le système ayant une sorte de valeur absolue, on néglige ses évolutions possibles en fonction des mutations des individus ou des écosystèmes qui l’englobent.
« Préserver une intégrité et une stabilité particulière implique d’intervenir. Ne pas le faire implique d’abandonner le processus à lui-même et d’accepter des modifications irréversibles, même si c’est à long terme(56). »
Ici, on a affaire à une difficulté pour accepter l’altérité dans sa radicalité.
– Dans la vision multicentrique, l’altérité des écosystèmes, des systèmes et des individus qui les composent est reconnue en tant que telle. La mise en pratique de cette vision n’est pas aisée. Elle repose sur la maturité des individus, leur capacité de dialogue, de compréhension de l’autre, de mise à plat des situations problématiques plutôt qu’à un recours à des solutions rapides.
Si nous voulons éviter les cataclysmes, il nous faut donc mettre en œuvre des mesures favorisant le développement vers la maturité de chaque individu, favorisant également le changement de nos paradigmes au niveau de la communauté ainsi que le fonctionnement de nos institutions.
Patrick Guérin et Marie Romanens (mars 2015)
notes
[45] Les trois cerveaux de l’homme, Laffont, 1990.
[46] Terme utilisé par le psychiatre et psychanalyste Jean Bergeret, La violence fondamentale, Dunod, 1994.
[47] « Éviter l’anthropomorphisme ne signifie pas qu’il faille s’écarter de la complexe interface que constituent les relations entre les arbres et les êtres humains ; bien au contraire, l’exploration de cette interface étant, je crois, la meilleure manière de saisir la singularité des arbres. » Francis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, Actes Sud, 2014, p.13.
[48] Janus, 1970, rééd. Calmann-Lévy, 1994
[49] Jean-François Dortier, « Le mythe des trois cerveaux », Hors-série spécial des Sciences Humaines, n°14, novembre-décembre 2011.
http://www.bc-cesu.ch/pdf/Sciences_Humaines_Le_Mythe_des_trois_cerveaux.pdf
[50] L’erreur de Descartes, la raison des émotions, Odile Jacob, 1995, p.9
[51] Ibid., p. 170-171.
[52] Comme l’écrit Jean-François Dortier (« Le mythe des trois cerveaux », Hors-série spécial des Sciences Humaines, n°14, novembre-décembre 2011
http://www.bc-cesu.ch/pdf/Sciences_Humaines_Le_Mythe_des_trois_cerveaux.pdf), le modèle de Mac Lean, bien que simple et en partie erroné, a au moins le mérite d’être pédagogique.
[53] Martin Buber, Je et Tu, Aubier, 1992, p. 23.
[54] Charles Baudouin, De l’instinct à l’esprit, Delachaux et Niestlé, 1970, p. 7 à 18.
[55] L’erreur de Descartes, la raison des émotions, Odile Jacob, 1995, p.167.
[56] Nicole Huybens, op. cit., p. 96-97.
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
document dans le contexte de Théorisation communiste II. RAPPORTS HUMANITÉ-CAPITAL-NATURE et CONJONCTURE PANDÉMIQUE et III. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE
Critique dialectique de la nature de la nature humaine
Lawrence Krader
Traducteur : Brigitte Navelet
L'Homme et la société, Année 1968, pp. 21-39




la suite
Lawrence Krader
Traducteur : Brigitte Navelet
L'Homme et la société, Année 1968, pp. 21-39




la suite
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
dessous :
- "la bêtise savante de Temps Critiques" par temps de coronavirus
- Ce que nous dit le coronavirus, Edgar Morin, 12 mars 2020
"Le virus de la recherche"
liens dans l'original
liens dans l'original
Les Presses universitaires de Grenoble ont créé une collection intitulée "Le virus de la recherche", composée d'ebooks en sciences humaines et sociales gratuitement téléchargeables sur leur site
American Anthropological Association : COVID-19 Resources
American Anthropological Association, Society for Medical Anthropology, Anthropological Responses to Health Emergencies SIG : COVID-19 webinars
American Ethnologist : Pandemic Diaries
Anthropology News : Pandemic Insights
Association Française de Science Politique (AFSP), "COVID-19, une pandémie sous le regard de la science politique et des sciences sociales" : revue d’articles et de contributions publiés par des politistes et chercheurs.ses en sciences sociales sur tous les aspects de la crise du Covid-19
Bibliothèque[s] de l'École normale supérieure : bibliographie collaborative Zotero recensant les publications en LSHS en lien avec la pandémie : https://www.zotero.org/groups/2467117/documentation_relative_au_nouveau_coronavirus_sars-cov-2/library
Boston Review : Thinking in a Pandemic
Campaign for Social Science: Social Sciences Responding to COVID-19
Carnets de l'EHESS : perspectives sur le coronavirus : articles écrits par des chercheur.euse.s qui "appréhendent la crise relative au #Covid19 au moyen des sciences sociales"
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University : Corona Chronicles: Voices from the Field
Centre de Recherches Internationales (CERI) de SciencesPo : "Covid-19 - Ressources" : "sélection de ressources en ligne – articles, podcasts, entretiens, interventions dans les médias – sur le Covid-19 dans le monde et ses enjeux internationaux" par les chercheur.se.s et doctorant.e.s du CERI
Centre de Recherches Politiques de SciencesPo : "CORONAVIRUS : suivi de l'opinion en France"
Centre de Sociologie des Organisations (CSO) de SciencesPo : dossier "Sciences sociales en temps de crise" alimenté par les chercheur.se.s du CSO
"Corona Times. Understanding the world through the Covid-19 pandemic" : blog créé sous l'égide de l'institut HUMA de l'université du Cap pour proposer des analyses de la pandémie dans une perspective multidisciplinaire et/ou interdisciplinaire, en mettant notamment en dialogue les humanités et sciences sociales avec les sciences de la santé
Critical Inquiry : Posts from the Pandemic
Cultural Anthropology : Covid-19, Fieldsights
Discover Society : The Covid-19 Chronicles
London School of Economics, "Covid-19 (Coronavirus). Leading the Social Science Response to Covid-19" : ressources en sciences sociales sur la pandémie
Medical Anthropology Quarterly : MAQ COVID-19 Responses
Université de Strasbourg, "Regards croisés de recherche sur le Covid-19", série multidisciplinaire de billets proposés par des chercheur.se.s de l'Unistra sur la pandémie
Social Science Research Council : Covid-19 and the Social Sciences
Stockhausen Ulrike, « Was Geisteswissenschaftler*innen zu Corona zu sagen haben », Redaktionsblog, 3/04/2020 : sélection de billets de carnets de recherche Hypothèses allemands sur les multiples dimensions de la pandémie de Covid-19 saisies par des chercheur.se.s issu.e.s des Geisteswissenschaften ("sciences de l'esprit") allemandes
UCL Centre for Digital Ethnography, Haidy Geismar and Hannah Knox : Collecting COVID-19
UCL Medical Anthropology : Consciously Quarantined
World Pandemic Research Network (WPRN) : répertoire mondial et en temps réel des recherche et ressources de recherche sur les impacts sociétaux et humains de la pandémie de Covid-19
la bêtise savante par temps de coronavirus
quelque chose m'échappe dans la fixette que font les théoriciens de la post-ultragauche sur des textes anciens, faciles à critiquer à l'époque déjà et plus encore aujourd'hui. Ressortir Ivan Illich à propos de la pandémie relève-t-il d'autre chose que de« la bêtise savante de Temps critiques (A propos des frères Jacques, etc.) ? (Benoit Bohy-Bunel, Palim Psao, 30 avril 2017). Certes on ne parle plus d'Ivan Illich, mais pourquoi ne pas parler de ceux qui écrivent aujourd'hui sur ce qui se passe aujourd'hui ? Ces gens-là vivent dans le passé, leur passé, le passé d'une illusion... celle d'avoir l'intelligence de leur temps
Que cette « crise sanitaire » engendre un surcroît de débats et d’écrits sur les rapports des hommes à leur condition d’être vivants ne saurait surprendre. Parmi les innombrables théoriciens et les analystes actuels du système médical, de ses contradictions, de ses avantages et de ses menaces, il en est un, plus ancien et dont on ne parle plus : Ivan Illich. Ayant été proche de l’auteur de Némésis médicale, l’expropriation de la santé, David Cayley, dans un article récent1 cherche à montrer l’actualité des thèses d’Illich sur les aspects funestes et mystificateurs des technosciences médicales contemporaines. Il rappelle les dimensions religieuses qu’Illich attribuait à la science, conduisant à des individus dépossédés de leur jugement et à une société « prise d’hallucinations au sujet de la science » ; de la science et donc des scientifiques qui imposent leur savoir aux populations à travers des « institutions » aux mains des corps professionnels.
Comme il l’avait fait pour sa critique de la scolarisation de la société (cf. Deschooling society, mal traduit en français par Une société sans école) où il désignait « l’institution scolaire » et ses professionnels comme des obstacles aux apprentissages authentiques, Illich dénonce l’appropriation par les professionnels de la santé des capacités naturelles de tous à trouver les voies de la guérison.
Partisan de la décroissance, de l’utilisation des technologies douces et des ressources locales, il se disait proche de Charbonneau et d’Ellul. En matière de politique de santé non soumise au monopole des savoirs professionnels et de leur « système », il admirait la campagne des « médecins aux pieds nus », pendant la révolution culturelle chinoise ; ces paysans formés en quelques mois qui pratiquaient la médecine traditionnelle et quelques bases de médecine « occidentale ». De la même manière, dans les montagnes d’Amérique latine, il a favorisé la conception d’un « mulet mécanique », moteur très simple monté sur roues, outil polyvalent et non dépendant des monopoles industriels du machinisme agricole.
Aussi novatrices qu’elles aient pu être dans leur époque, les thèses d’Illich étaient déjà oblitérées par deux présupposés d’ordre, si ce n’est métaphysique, du moins spéculatif : l’un théologique qui fait de l’homme une créature de Dieu et l’autre économique qui laisse au marché la libre circulation des capitaux. David Cayley reconnait le premier présupposé, mais il semble ne pas percevoir son influence sur la conception illichienne de la Vie. L’homme être de finitude, certes, mais face au Covid-19 conviendrait-il se suivre le précepte d’Illich : celui de faire avec, d’accompagner la pandémie quelles qu’en soient les conséquences… comme il a accompagné la tumeur qui l’a emporté en s’abstenant de toute intervention thérapeutique ?
Il y a là un point aveugle de la démonstration que développe Cayley sous nos yeux, trop enclin à voir en Illich un guide pour le temps présent ; comme si les « institutions » que dénonçaient Illich étaient encore ce qu’elles étaient dans l’Europe et le monde des années soixante.
Aujourd’hui l’utopie d’Illich devient dystopie. Ainsi, dans les actuelles discutailleries sur l’hydroxychloroquine et sur Raoult, tout semble se passer comme si la vision d’Illich sur l’appropriation des savoirs par tous et chacun, se réalisait… mais se réalisait comme funeste farce. Pas un commentateur, pas un internaute qui ne fasse valoir sa science sur les virus et ne la distribue au monde entier, là une critique d’une publication de chercheur en virologie, ici un avis tranché sur les propos méthodologiques du Professeur Raoult…
Il faut dire que « la science » donne parfois le bâton pour se faire battre comme l’admet, contrit, Laurent Joffrin dans son éditorial du 30 mai de Libération et comme le sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS le développe dans un article pour Mediapart2.
Après avoir critiqué la méthode de l’article du Lancet, Mucchielli cite Richard Hurton qui a été son rédacteur en chef pendant 25 ans. Voilà ce qu’il a écrit dans le Lancet d’avril 2015 : « une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est peut-être tout simplement fausse. Affligée par des études portant sur des échantillons de petite taille, des effets minuscules, des analyses exploratoires non valables et des conflits d’intérêts flagrants, ainsi que par une obsession à poursuivre des tendances à la mode d’importance douteuse, la science a pris un virage vers l’obscurité. (…) L’endémicité apparente des mauvais comportements en matière de recherche est alarmante. Dans leur quête d’une histoire convaincante, les scientifiques sculptent trop souvent les données pour qu’elles correspondent à leur théorie du monde préférée. Ou bien ils modifient leurs hypothèses pour les adapter à leurs données. Les rédacteurs en chef des revues scientifiques méritent eux aussi leur part de critiques. Nous aidons et encourageons les pires comportements. Notre acceptation du facteur d’impact alimente une compétition malsaine pour gagner une place dans quelques revues sélectionnées. Notre amour de la “signification” pollue la littérature avec de nombreuses fables statistiques. Nous rejetons les confirmations importantes. Les revues ne sont pas les seuls mécréants. Les universités sont dans une lutte perpétuelle pour l’argent et le talent, des points d’arrivée qui favorisent des mesures réductrices, comme la publication à fort impact. Les procédures d’évaluation nationales, telles que le cadre d’excellence pour la recherche, encouragent les mauvaises pratiques. Et les scientifiques, y compris leurs plus hauts responsables, ne font pas grand-chose pour modifier une culture de la recherche qui frôle parfois l’inconduite ».
1. https://lundi.am/Sur-la-pandemie-actuelle-d-apres-le-point-de-vue-d-Ivan-Illich
2. https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/260520/fin-de-partie-pour-l-hydroxychloroquine-une-escroquerie-intellectuelle.
Ce que nous dit le coronavirus
Edgar Morin, Libération, 12 mars 2020
Edgar Morin, Libération, 12 mars 2020
Cette nouvelle crise nous révèle une fois de plus notre interdépendance. La réponse ne peut être que solidaire et planétaire.
Il a surgi très loin dans une ville inconnue de Chine. Aussitôt les esprits compartimentés, dont celui de notre ministre de la Santé d’alors, nous ont rassurés : ce virus n’arrivera pas chez nous. Et le virus chemine de main en main, de souffle à souffle, prend la route, le bateau, l’avion, va de terre en terre, de toux en salive. Il pénètre en catimini, ici et là, en Lombardie, dans l’Oise, se répand en Europe. La contamination gagne. L’alerte à l’épidémie est déclarée.
Le problème premier est évidemment sanitaire. Les hôpitaux, victimes d’économies insensées, sont déjà débordés, et le virus va amplifier la crise hospitalière. Le remède est encore inconnu, le vaccin inexistant. Les déclarations des médecins sont contradictoires, les unes prévenant d’un grand danger, les autres rassurant sur la faible mortalité prévisible.
Les pouvoirs publics prennent des mesures de protection qui ne peuvent isoler que partiellement soit les malades soit les bien-portants menacés.
Les mesures préventives prises un peu partout sur la planète frappent les écoles, les réunions, freinent les échanges commerciaux, immobilisent les navires de fret ou de passagers, limitent les voyages internationaux, bloquent les produits d’exportation de la Chine notamment les médicaments, diminuent les consommations en carburant, déclenchent une crise entre pays pétroliers, suscitent baisses boursières, et commencent à provoquer une crise économique au sein d’une économie mondiale déjà dérégulée.
De fait le virus apporte une nouvelle crise planétaire dans la crise planétaire de l’humanité à l’ère de la mondialisation. Mais on continue partout à considérer et traiter cette complexité en problèmes et secteurs séparés. Chaque Etat referme sa nation sur elle-même ; l’ONU ne propose aucune grande alliance planétaire de tous les Etats. Faut-il payer, en victimes supplémentaires, le somnambulisme généralisé et la carence des esprits qui séparent ce qui est relié ? Et pourtant, le virus nous révèle ce qui était occulté dans les esprits compartimentés formés dans nos systèmes éducatifs, esprits dominants chez les élites techno-économiques-financières : la complexité de notre monde humain dans l’interdépendance et l’intersolidarité du sanitaire, de l’économique, du social, de tout ce qui est humain et planétaire. Cette interdépendance se manifeste par des interactions et rétroactions innombrables entre les diverses composantes des sociétés et individus. Ainsi les perturbations économiques suscitées par l’épidémie en favorisent la propagation.
Le virus nous dit alors que cette interdépendance devrait susciter une solidarité humaine dans la prise de conscience de notre communauté de destin. Le virus nous révèle aussi ce que j’ai appelé « écologie de l’action » : l’action n’obéit pas nécessairement à l’intention, elle peut être déviée, détournée de son intention et revenir même en boomerang frapper celui qui l’a déclenchée. C’est ce que nous prédit le professeur Eric Caumes de la Pitié-Salpêtrière : « Au final, ce sont les réactions des politiques à ce virus émergeant qui vont aboutir à une crise économique globale… avec un bienfait écologique. » Ultime paradoxe de complexité : le mal économique pourrait générer un mieux écologique. A quel prix ? De toute façon, tout en nous faisant beaucoup de mal, le coronavirus nous dit des vérités essentielles.
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
un (presque) excellent texte publié par le PIR, il y avait longtemps...
excellent parce qu'on y retrouve l'essentiel des analyses et références données dans THÉORIE RADICALE ET CRISE VIRALE, et particulièrement III. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
presque parce Ô combien inutile de s'encombrer du Coran et du pouvoir d' « Allah, « Celui qui élève » mais aussi « Celui qui rabaisse » », une nouvelle "théologie de la libération" qui me semble peu compatible entre autre avec la référence au Capital de Marx. M'enfin, si Wissam Xelfa est ainsi inspiré, disons que pour une fois c'est moindre mal
au fond, on retrouve dans ce texte les liens indissécables que j'avais mis en évidence alors que j'étudiais ensemble, en 2014-2016, luttes et pensées "décoloniales" dans le monde, y compris sans le nom chez les paysans pour la terre, prolétaires ou non, dans leurs rapports à la nature
Covid-19, une vengeance de la Nature ? Pour une approche décoloniale de la Nature
Wissam Xelka, membre du PIR, 1 juin 2020
Wissam Xelka, membre du PIR, 1 juin 2020
« Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance :
car Allah n’aime pas le présomptueux plein de gloriole. »
Coran, sourate 31, verset 18
La Modernité Occidentale mise à mal par un minuscule virus… Ce scénario peut étrangement faire penser au célèbre roman d’H. G. Wells La Guerre des mondes. La Terre doit faire face à une invasion extra-terrestre aux intentions suprémacistes. Le chaos est total, l’humanité est exterminée et exploitée sans aucune pitié et la victoire des martiens s’avère certaine… jusqu’à ce qu’ils soient terrassés par des microbes contre lesquels ils n’avaient pas développé d’immunité collective.
Toutefois, ce n’est pas cette sacro-sainte immunité collective qui motive notre retour sur ce roman, mais plutôt le contexte d’écriture et le message politique que l’on peut lire entre les lignes du récit de ce dernier. Pour le comprendre, il faut replacer ce récit dans son époque : la fin du XIXe siècle. L’empire britannique est à son apogée et sa domination s’étend sur les quatre coins du globe. La référence d’H. G. Wells à la conquête coloniale est limpide et il semblerait même que l’idée d’écrire ce roman lui soit venue suite à une discussion qu’il a eu portant sur le sort des Indigènes de Tasmanie –alors décimés par les britanniques–. Dans La Guerre des mondes, il met en scène une situation dans laquelle le grand empire britannique est lui-même victime de l’invasion d’une race « supérieure » venant piller les richesses du territoire, massacrer une partie de la population et asservir l’autre pour son seul intérêt.
Cependant, ce n’est toujours pas sur cette critique des monstruosités coloniales –critique par ailleurs teintée de paternalisme et de racisme– que nous voulons centrer ici notre regard, mais plutôt sur son dénouement : les martiens, espèce dont la supériorité technologique lui permet d’écraser l’espèce humaine, sont vaincus par un virus et donc, indirectement, par la Nature[1]. La fiction n’est-elle pas devenue réalité, aujourd’hui, avec un système capitaliste –armé de tout son arsenal technologique et technique visant à assurer son hégémonie– qui est mis à mal par un virus ?
La crise politique mondiale actuelle, provoquée par la pandémie de Covid-19, conduit alors certains à penser que la Nature se serait rebiffée et aurait décidé de se venger. Dans cet article, nous souhaitons nous pencher plus longuement sur ce thème, en apportant un regard critique sur cette notion d’une Nature qui se rebelle car, outre qu’elle charrie des idées racistes, elle nous conduit à questionner la notion-même de Nature et plus encore le dualisme occidental Nature/Culture (ou Société), qui est à la source de la catastrophe écologique que nous connaissons.
Division Nature/Culture, une construction occidentale aux relents racistes
Dans un précédent article[2] nous notions que la catastrophe climatique, qui n’est pas à venir mais actuelle, entraînait l’humanité entière dans le précipice, provoquant une plus grande prise de conscience de cet enjeu dans l’opinion publique. Nous soulignions néanmoins que cette prise de conscience était encore loin d’être suffisante, voir même qu’elle risquait fortement d’emprunter la voie plus facile pour une civilisation en déclin : la radicalisation du pouvoir Blanc, l’éco-fascisme, la barbarie. Dans cette perspective, face à un dérèglement climatique qui va causer, d’une part, des catastrophes environnementales de plus en plus nombreuses, intenses et diverses (inondations, sécheresses, canicules, tornades, etc.) et, d’autre part, des déplacements de populations jusque-là inédits (nous parlons, dans les pires des scénarios, de milliards de déplacés), l’Occident, principal responsable de ce désastre, opte pour le choix de l’autoritarisme, de la surveillance de masse, de la fermeture des frontières et du chacun pour soi.
Cette solution, qui est en total adéquation avec le paradigme des États-Nations occidentaux, s’inscrit en droite ligne du rapport qu’entretien le Nord avec ce qu’il appelle la « Nature« . Dans cette vision du monde, la Nature est considérée comme substantielle, c’est-à-dire séparée et indépendante de l’espèce humaine. Avec le dérèglement climatique, elle peut même être perçue comme une « menace » pour l’espèce humaine et contre laquelle il faudrait se prémunir. Les éco-fascistes ne sont pas les seuls à s’inscrire dans ce schéma. Au contraire, nous pouvons affirmer que la séparation Nature/Culture (Société) est commune à l’ensemble de la civilisation moderne occidentale et est même un élément fondateur de celle-ci. D’ailleurs, parler d’un dualisme propre au libéralisme serait trompeur car c’est avant tout un trait occidental, que l’on peut même retrouver dans le marxisme[3].
Tout comme la philosophie occidentale s’est fondée, au moins depuis Descartes, sur une distinction entre le corps et l’esprit, elle a aussi bâti une séparation, une frontière, une différence, entre la « Nature » et la « Culture » (ou la « Société »). Cette séparation est même au fondement de ce qui constituerait « l’humanité« , –ou, pour être exacts, une certaine partie de l’humanité, celle dite « civilisée« –. La civilisation se mesurerait alors au degré d’émancipation d’une population à sa condition « naturelle« . Elle se réaliserait ainsi par elle-même, en tant qu’espèce, non seulement à part, mais au-dessus de la Nature. L’espèce humaine (civilisée), en développant la Culture (la langue, l’écriture, l’art, etc.) et en créant des Sociétés dites « complexes » et « développées », aurait réussi à passer un cap dans l’évolution, et serait même parvenue à renverser la domination. Dorénavant, l’Humain maîtriserait la Nature, et il pourrait en jouir comme il le désire, la seule limite étant le niveau de savoir scientifique et technique dont il dispose.
Nous parlons ici de « l’humain » ou de « l’Homme« , mais il faudrait être plus précis et parler de l’Homme Blanc. Le développement de l’humanisme, qui se fixait comme idéal philosophique et politique de replacer l’être humain et son émancipation au centre de toutes choses, n’a jamais considéré l’humain, au sens véritablement accompli, que comme Blanc, notamment parce qu’il se serait extirpé de l’état de Nature. Cette autonomie nouvelle, considérée comme une avancée, donnerait alors au Blanc le droit et la légitimité de dominer et d’exploiter la Nature. Or, seul l’homme Blanc aurait accompli ce processus. Les autres êtres humains, les non-Blancs, seraient encore –à des degrés plus ou moins élevés selon les catégories raciales– restés à l’état de Nature, entre, d’un côté, l’animal et, de l’autre, l’humain pleinement réalisé. Le lien entre non-Blancs et Nature est essentiel car, comme le souligne Razmig Keucheyan, la construction d’une Nature substantielle s’est réalisée en même temps que la conquête coloniale et impérialiste[4]. Dans son livre Le Loup et le Musulman[5], Ghassan Hage affirme quant à lui que nous ne pouvons pas être écologistes sans être anti-racistes, et inversement. Nous comprenons ici la logique. Rejetés à l’état de Nature, les non-Blanc étaient, comme cette dernière, perçus comme maniables et exploitables à merci, tel du bétail. Nature et non-Blancs, sont imbriqués, ils forment un même tout et donc sont logés à la même enseigne. La période esclavagiste constitue l’illustration de cette idéologie poussée à son paroxysme : les Noirs étaient traités comme les plantations, c’est-à-dire exploités jusqu’au dernier souffle.
L’essence même du racisme étant de nier toute humanité aux non-Blancs, le processus de déshumanisation qui cantonne cet autre à un mi-chemin entre la Nature et la Culture est toujours actuel et prend de l’ampleur avec la crise climatique. G. Hage montre que le lien entre racisme et écologie ne fait pas que se trouver dès l’origine du projet colonial –qui amorça une destruction de l’écosystème à l’échelle planétaire et à un niveau inégalé– mais que ce lien s’est perpétué tout au long de cette Modernité Occidentale[6], et ce jusqu’à aujourd’hui encore. Ainsi, la crise climatique actuelle est directement liée à ce que le Nord appelle la « crise des migrants ». Premièrement, parce que c’est la catastrophe écologique qui pousse ces personnes à fuir leur pays et à chercher refuge dans les pays occidentaux. Deuxièmement, parce que ces deux crises s’entrecroisent et représentent, pour le Nord, une menace existentielle. En effet, crises migratoires et climatiques font toutes deux fi des frontières, se déployant à l’échelle globale, et portent chacune atteinte au mode de vie et aux valeurs de la Modernité Occidentale. Nature et non-Blanc représentent la « sauvagerie » que le Nord tente de dompter sans jamais y parvenir.
L’écologie Blanche, un renversement problématique du rapport Nature/Culture
La Nature n’est pas malléable à souhait, elle ne se plie pas aussi facilement à la volonté des humains et parait parfois se rebeller, provoquant alors des catastrophes humaines énormes. Cet état de fait laisse certains penser qu’il y aurait une lutte intense entre la Nature et l’Homme. Elle devient un élément que l’Homme doit parvenir à dompter et à maîtriser pour réussir à prospérer, instaurant l’idée d’un rapport conflictuel. Mais cette vision n’est pas le propre de ceux qui, dans cette civilisation, désirent contrôler la Nature, puisqu’elle est aussi partagée par les plus « écologistes » d’entre eux. Pour ces derniers, le souhait est inversé, en ce qu’ils n’espèrent pas la victoire de l’espèce humaine, mais celle de la Nature. Cette perspective, qui tend à être positivement reçue dans notre période de crise écologique majeure, se doit d’être interrogée tant elle charrie les mêmes visions biaisées et racistes (notamment une fétichisation de certaines populations indigènes qui seraient restés en contact avec la Nature) puisqu’elle se contente de renverser le rapport de domination sans remettre en cause les présupposés qui la sous-tendent. La séparation Nature/Société persiste et la différence réside seulement dans l’avis que l’Homme aurait pris trop de pouvoir, qu’il aurait entre ses mains une trop grande capacité à nuire et que sa domination serait trop dévastatrice. Décrite comme une victime de la folie de l’Homme, les catastrophes qu’elle produirait ne seraient qu’un moyen pour la Nature de se défendre et de préserver un équilibre fragile. Pour l’aider à atteindre ce but honorable, il faudrait alors que la Nature reprenne « ses droits ».
Nous assistons à un renversement de l’idéal humaniste. La Nature est maintenant idéalisée tandis que l’être humain est diabolisé. Toutefois, l’approche n’est en rien décoloniale. Il est d’ailleurs important de souligner que cette conception du rapport entre la Nature et l’Homme a d’abord émergé, en Europe, dans les mouvements réactionnaires et conservateurs du début du siècle dernier, qui voyaient dans le progrès technique et technologique le signe de la déchéance et de la dépravation morale et physique de l’humanité. Ils prônaient alors un retour à la Nature, hostile et sauvage, pour retrouver l’essence même de ce qui constitue l’Homme (Blanc), c’est-à-dire un être fort, dominateur et conquérant. Il n’y a donc ici aucune remise en cause de la séparation Nature/Culture, alors qu’elle porte en elle deux problèmes majeurs : l’espèce humaine est extirpée de la Nature, et l’espèce humaine est homogénéisée comme une entité intrinsèquement nocive à la Nature.
Idéaliser la Nature au dépend de l’humain est aussi absurde et dangereux que de la voir comme un terrain à dominer et exploiter à son profit. Le retour en force des discours malthusianistes –prônant un contrôle drastique des naissances, surtout dans les pays du Sud, pour lutter contre la « surpopulation« – est l’une des conséquences de cette pensée. Ce qu’on appelle la Nature n’est pas dotée d’une volonté propre et indépendante qui serait, de surcroît, fondamentalement en contradiction avec les désirs de l’espèce humaine. Elle n’est pas non plus foncièrement « bonne« , « pure» , « généreuse » et « innocente« . Nous pouvons observer dans la Nature des actes qui, pour la morale humaine, sont particulièrement choquants et cruels : viol, cannibalisme, sadisme, infanticides, etc. La Nature n’est pas non plus un espace barbare, dans lequel régnerait la « loi de la jungle » du tous contre tous. Cette vision pseudo-darwinienne est celle popularisée par l’idéologie capitaliste malthusianienne et eugéniste qui voudrait nous convaincre que l’évolution par « la sélection naturelle » passe par la loi du plus fort, la concurrence et l’individualisme, ignorant de fait les propres travaux de Darwin, mais aussi de ceux d’autres penseurs, qui ont souligné l’importance de la « solidarité » pour de nombreuses espèces vivantes[7].
Ceux qui souhaitent la victoire de la Nature sur l’humain sont tombés dans une misanthropie absurde, idéaliste, mais aussi raciste puisqu’ils font comme si l’espèce humaine, dans son ensemble et dans son essence, était hostile à la Nature. Nous pouvons retrouver cela dans le concept d’anthropocène qui attribue la responsabilité de la catastrophe écologique à l’ensemble de l’espèce humaine alors que seule une partie, totalement mineure dans l’histoire humaine, l’est véritablement. C’est pourquoi certains préfèrent parler de Capitalocène, de Plantationocène ou encore de Thanatocène, termes plus précis dans la désignation des systèmes économiques, philosophiques et politiques qui sont à l’origine de ce dérèglement climatique. Toutefois, et bien qu’il existe depuis quelques années un retour critique de leur part, la grande majorité des écologistes s’inscrivent encore dans ce schéma d’une humanité toute entière responsable.
Il existe aussi une variante de cette logique qui ne pointe pas l’espèce humaine en tant que telle mais plutôt une période de son histoire : le moment où elle s’est sédentarisée, faisant apparaître les civilisations. Nommés couramment les « anti-civ« , ces militants affirment que le problème réside dans le concept-même de civilisation et non pas seulement chez la civilisation « thermo-industrielle ». Cependant, quand bien même ils s’en distinguent, ils rejoignent les écologistes Blancs les plus traditionnels de par le récit extrêmement caricatural et homogénéisant qu’ils livrent des civilisations humaines, prétendant tout d’abord qu’elles se seraient échappées de l’état de Nature, puis qu’elles seraient foncièrement nocives pour l’espèce humaine et la Nature. Certes, les sédentaires, contrairement aux nomades qui adaptaient totalement leur mode de vie aux aléas de l’environnement, ont exercé en tout temps une pression sur leur éco-système –notamment à travers l’agriculture–, pour avoir un minimum de contrôle et d’indépendance face aux variations météorologiques et climatiques. Toutefois, il serait malhonnête d’affirmer que ces adaptations portent en elles le péché originel qui conduirait, fatalement (dans une vision évolutionniste de l’histoire), à la catastrophe écologique actuelle.
Ainsi, nombre d’entre eux souhaitent nous montrer les côtés positifs de la crise sanitaire qu’a entraîné la pandémie de Covid-19. Il y a tout d’abord une forme de jubilation dans l’idée que la Nature se serait vengée des méfaits commis par l’être humain, comme si la Nature était douée d’une intention, habitée qu’elle serait par des codes moraux parfois vils. Dans ces discours, on peut entendre que la Nature ne ferait que « reprendre » ses droits et imposerait son diktat en stoppant l’activité humaine mondiale. Les images –il faut l’avouer, plaisantes– d’animaux s’aventurant dans des villes désertes, les avions cloués au sol, la baisse historique du prix du pétrole, la pollution de l’air en chute libre, etc., seraient autant de signes d’une revanche qui comporterait, néanmoins, une leçon, car la Nature est généreuse même dans ses accès de colère. Par l’intermédiaire du coronavirus, elle nous aurait contraints à stopper notre course effrénée vers le profit pour nous recentrer sur l’essentiel. Cette dernière idée n’est pas mauvaise ni problématique en soi, au contraire. Elle peut contenir une base de réflexion utile puisque l’actualité nous laisse en effet penser que l’humanité est devant un STOP, et qu’elle doit maintenant décider quelle voie choisir. Toutefois, pour que ce sentiment puisse être exploitable à bon escient, il est nécessaire qu’il soit politisé afin d’aller plus loin que l’idée d’une Nature revancharde sur une espèce humaine entièrement fautive.
Il faut sans cesse le rappeler : depuis le début de la sédentarisation, l’espèce humaines a connu de très nombreuses civilisations, dont l’énorme majorité n’avait pas un rapport conflictuel avec la Nature, en premier lieu parce que cette dichotomie n’existait pas. La distinction Nature/Culture n’est pas le propre de l’espèce humaine ou des civilisations en tant que telles, mais plutôt de la Modernité Occidentale. Les penseurs décoloniaux ne sont pas les seuls à pointer du doigt le caractère historiquement et géographiquement situé de ce dualisme puisque d’autres chercheurs, comme Philippe Descola[8] ou Bruno Latour[9], font le même constat.
Il est donc absolument crucial de faire comprendre que la catastrophe écologique actuelle n’est pas causée par l’essence de l'espèce humaine ou de la civilisation mais par une partie bien précise de ces deux entités : la Modernité Occidentale Capitaliste, dont le processus de destruction a débuté avec l’accumulation primitive du capital[10]. C’est elle, et pas une autre ni l’ensemble des êtres humains, qui a produit les paradigmes philosophiques, politiques, économiques, sociétaux, moraux, etc., propices à détruire l’écosystème global actuel et à exploiter jusqu’à la dernière goutte les ressources de la planète, tout en imposant son modèle au reste de la planète. Et, une fois la pandémie terminée, cette civilisation mortifère compte bien, non pas reprendre, mais accentuer son rythme destructeur pour rattraper le retard pris durant cette parenthèse, balayant ainsi tous les petits points positifs soulignés par les écolos naïfs.
Perspective décoloniale : détruire la frontière Nature/Culture
Tout le problème réside dans cette division. L’être humain n’est pas séparé de la Nature, il en est une des composantes. Mais, surtout, la Nature, comme entité distincte, extérieure à l’homme et homogène, n’existe pas. Si nous devons repenser notre relation à la Nature, nous devons déjà questionner la notion-même de Nature. Lorsque R. Keucheyan affirme que « la Nature est un champ de bataille », il entend que la lutte se déroule aussi dans la définition-même du concept de Nature[11]. Malheureusement, établir ici une définition satisfaisante de la Nature butte sur deux obstacles insurmontables : la longueur du présent article et les compétences de son auteur. Toutefois, nous préférerons dorénavant utiliser le terme « environnement » qui, malgré ses imperfections, peut davantage faire passer l’image d’un tout, d’un écosystème, d’une cosmologie, desquels l’Homme n’est pas étranger mais est en relation avec les autres éléments. De plus, l’environnement n’a pas une essence pure, une condition « naturelle« , qui serait préexistante à l’Homme. L’environnement n’a jamais été stable, il a changé au fil du temps, avec ou sans l’intervention de l’Homme. Les animaux eux-mêmes ont pu le modifier. Toutefois, ce qui a changé avec la Modernité Occidentale, c’est le degré de l’impact humain sur l’environnement, atteignant un niveau inconnu jusqu’alors, précipitant des changements climatiques et géologiques en un temps record et menaçant –malgré la courte existence de cette civilisation– l’ensemble de l’humanité d’extinction.
La pandémie actuelle est une excellente démonstration de l’incurie de cette séparation de la Nature de l’Homme. Le coronavirus, comme tout virus –même le plus létal–, n’a pas pour but ou pour « volonté » –qu’il ne possède pas– de nous tuer. Son seul objectif est de se démultiplier et nos corps ne sont qu’une occasion de le faire. Il n’y a donc pas une agression en tant que telle mais une interaction et une cohabitation, quoique néfastes pour l’hôte. Pour autant, et par ailleurs, le corps humain est aussi habité et colonisé par une multitude d’autres « bactéries » qui lui sont au contraire bénéfiques. Il permet à ces êtres microscopiques de vivre, et ces derniers peuvent lui apporter des bienfaits. Il y a ainsi une cohabitation harmonieuse, un équilibre plus ou moins établi entre les deux entités, une relation, et non une frontière
Comme nous le soulignons depuis le début, dans la grande majorité des civilisations qu’a connue l’histoire humaine il n’y avait pas cette distinction entre l’Homme et son environnement. Ne se voyant pas comme extérieurs à ce grand tout, les êtres humains cherchaient plutôt à fonctionner de sorte à ce que cet « équilibre » –qui n’est pas un concept naturel puisque l’écosystème n’a pas véritablement d’équilibre, de stade « normal », ou « optimal » ; par équilibre nous entendons un écosystème dans lequel la vie humaine est viable de manière qualitative– soit préservé. Nous pouvons prendre, à titre d’exemple, la civilisation islamique qui est une illustration intéressante puisqu’elle fait de l’Homme un être spécial, sans pour autant le séparer de ce « tout » qu’est la création Divine.
Dans la tradition islamique, cette frontière entre l’Homme et la Nature n’est pas aussi prononcée. En effet, tout ce qui existe « sur la Terre et dans les Cieux« fait partie de la création Divine, et est ainsi soumis à Allah. Les êtres humains, les djinns, mais aussi les animaux, les plantes, les océans, les montagnes, etc., sont autant de créations d’Allah qui L’adorent, chacun à leur manière. Nous faisons ainsi partie de ce tout, de cette création. Toutefois, comme il est indiqué à plusieurs reprise dans le Coran, Allah a « soumis » certaines de ces entités (les animaux, les terres, les mers, etc.) à l’Homme. Néanmoins, il serait erroné, anachronique et occidentalo-centré de penser que cette soumission instituerait les hommes en maîtres absolu de ces entités et dont ils pourraient jouir à leur bon plaisir. Il faut plutôt comprendre cela dans le sens que, de par Sa grâce, Allah a permis aux hommes de trouver des bienfaits, des moyens d’assurer leur subsistance, avec les animaux, l’agriculture, la mer, etc. Autrement dit, ces entités ne sont pas soumises directement à l’humanité mais à Allah. C’est grâce à Sa seule volonté, et non à celle de l’Homme, que nous pouvons en jouir.
L’humanité ne doit pas cesser d’oublier cette faveur accordée par l’Être supérieur. Al Hamdoulilah, ou Bismillah, sont autant d’expressions dont l’une des fonctions est de rappeler à l’Homme qu’il n’a pas acquis tous ses avantages, toutes ses richesses, toutes ses subsistances, par lui-même, mais qu’il doit tout à Allah. Nous retrouvons cette logique avec l’alimentation halal, en particulier vis-à-vis de la nourriture en provenance des animaux. Tout d’abord, pour être licite à la consommation, l’animal doit avoir vécu une vie digne[12]. Ensuite, lors de son abattage, tout le rituel est organisé de sorte que le fidèle ne cesse d’oublier qu’il n’aurait jamais pu obtenir une certaine supériorité sur cet animal, lui permettant de le tuer, sans l’accord d’Allah. Cette supériorité ne dépend donc pas de lui-même. L’être humain doit alors se montrer reconnaissant pour cette faveur qu’on lui accorde, d’autant plus qu’il n’aurait pu l’obtenir sans la volonté d’Allah, car Il est « Celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous, des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leurs dos, et qu’ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez: « Gloire à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n’étions pas capables de les dominer. ». »[13]
Le « dîn», qui est maladroitement traduit par « religion » –faisant de la religion une sphère séparée et autonome, ce qui est anachronique pour l’époque de la naissance de l’Islam–, peut, entre autres, être rapproché de l’idée de « redevance« . Être dans le « dîn« , c’est adopter une vision du monde dans laquelle nous nous sentons « redevables« , « reconnaissants » des bienfaits dont nous jouissons dans notre vie, ce qui implique, en contrepartie, d’adopter un comportement qui prouve cette reconnaissance. Une reconnaissance à Allah tout d’abord, donc transcendantale, mais la reconnaissance s’institue aussi dans un rapport horizontal, dans la relation que nous entretenons avec les autres êtres, vivants ou non vivants. L’adoration d’Allah, la dévotion, passe ainsi énormément par le bon comportement envers son prochain et son milieu, qui sont tous des créations Divines. Nombreux sont les hadiths qui rapportent à quel point le Prophète Mohammed (saws) insistait sur l’importance de cette attitude respectable envers les êtres vivants et non vivants qui peuplent notre univers.
Lors d’une émission de Paroles d’Honneur, Ghassan Hage faisait remarquer que la Covid-19 et la catastrophe climatique réapprenaient à l’homme qu’il est, non pas maître, mais soumis à son environnement[14]. Il continuait en expliquant que le concept de soumission est très péjoratif dans la Modernité Occidentale, alors qu’il ne l’est pas partout ailleurs, comme dans l’islam. En effet, c’est même par la soumission consentie, celle à une entité supérieure et parfaite, Allah, que le musulman s’élève, dans la piété, dans la droiture et même, ce qui peut sembler paradoxal, dans la dignité. Il apprend par là même une valeur extrêmement importante : l’humilité. Cette valeur, trop oubliée dans nos paradigmes actuels, mérite d’être remise au goût du jour, y compris chez nous, musulmans. En effet, nous-même, musulmans, nous n’échappons pas à l’hégémonie de la Modernité Occidentale, nous l’avons nous aussi incorporée, adoptant maintenant une attitude orgueilleuse et outrecuidante à l’encontre de notre environnement. Il suffit de jeter un œil sur certaines sociétés musulmanes, comme l’Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, etc. et sur ces aberrations que sont ces villes ultra-modernes en plein milieu du désert qui rivalisent d’ingéniosités morbides et malsaines pour outrepasser les contraintes de leur écosystème afin de satisfaire leurs désirs (îles artificielles, nuages ensemencés pour faire tomber la pluie, stations de ski, etc.). Nous, musulmans, nous tendons à adopter de plus en plus les codes et valeurs de la modernité capitaliste, dont sa démesure et son arrogance, au détriment de l’esprit d’humilité propre à l’Islam.
Parmi les noms attribués à Allah, il y a « Celui qui élève » mais aussi « Celui qui rabaisse ». Beaucoup de musulmans, comme d’autres religieux ou personnes aux croyances diverses, peuvent voir dans la période actuelle une « épreuve » pour l’espèce humaine qui serait envoyée par Dieu –ou par toute autre entité métaphysique comme la Nature–. L’épreuve, que l’individu peut réussir ou échouer, contient toujours une leçon. Ces propos peuvent paraître d’une totale absurdité pour les cartésiens, pourtant, ils auraient tout intérêt, sans pour autant adhérer à toute la cosmologie croyante, à réfléchir sérieusement à ces leçons, même dans une perspective parfaitement rationaliste et laïque. L’actualité et les prévisions scientifiques nous montrent que l’espèce humaine court à sa perte, que la catastrophe écologique mondiale actuelle se transforme en cataclysme. Le tout causé, non pas par un simple modèle économique, mais par tout un paradigme philosophico-politique, celui de la Modernité Occidentale. La pandémie actuelle et les répercussions qu’elle a entraîné –et qu’elle va continuer à entraîner même après sa fin–, peuvent, et doivent, être saisies comme un avertissement des calamités bien plus graves qui nous attendent. La Nature ne se venge pas, elle réagit seulement aux perturbations qu’on lui cause, et ces perturbations menacent notre existence. C’est de cela que nous devons tirer des leçons. La période actuelle nous montre les limites insurmontables qui s’imposent à l’espèce humaine dans son désir de toute-puissance. Pour être « maître de lui-même », un individu libre de tout contrainte –tel est notamment l’objectif de la philosophie kantienne– l’Homme devrait être maître de la Nature. Or, ce projet nous conduit au suicide collectif. Il est temps, de changer de voie.
La Modernité Occidentale a trop longtemps rejeté une valeur fondamentale : l’humilité. Cette suffisance peut lui causer sa perte, et nous allons y participer. À nous, maintenant, de réapprendre cette humilité. Pour y parvenir, nous comptons nous inspirer des cultures qui ont été spoliées et détruites, des valeurs et savoir-faire issus des sociétés précoloniales. Toutefois, et contrairement aux critiques caricaturales qui nous sont parfois adressées, le mouvement décolonial n’a pas pour objectif politique d’opérer un retour vers le passé. Nous ne sommes pas des admirateurs béats d’un passé fantasmé qui n’existe que dans l’imaginaire collectif. Si nous nous opposons à ce que nous appelons la Modernité Occidentale, ce n’est pas au titre de son caractère « moderne » en tant que tel. Nous ne sommes pas opposés, de manière intrinsèque, à ce qui serait « moderne » dans son sens temporel, c’est-à-dire ce qui serait « actuel» , « présent« . Nous nous opposons à la « modernité » dans son sens philosophique, ou plutôt à la manière dont la « modernité » a été accaparée par un certain paradigme philosophico-politique qui a pris naissance en Occident. La décolonialité, ce n’est donc pas le retour à la période pré-coloniale, c’est l’ouverture vers un nouveau monde, qui puise autant dans les savoirs du passé que dans ceux du présent, pour un futur émancipé.
Ce désir de retour au passé n’est pas seulement infaisable mais est aussi indésirable et insensé. Si l’on adopte un point de vue matérialiste et dialecticien, c’est le monde actuel, avec toute ses réalités, évolutions, complexités et contradictions, que nous devons prendre en compte si nous voulons instituer un changement, et la société future ne pourra alors se faire qu’avec les éléments actuels dont nous disposons… ou, plutôt, avec les débris dans lesquels nous vivons. Car la Modernité Occidentale a déjà causé trop de dégâts pour que nous puissions imaginer –si cela même était possible– revenir au « monde d’avant« . Le monde d’après sera forcément mutilé, estropié, amputé… La catastrophe n’est pas à venir, elle est déjà là, et il nous faut maintenant construire avec elle.
« Habiter le trouble », c’est ce que nous invite à faire la chercheuse Donna Haraway[15]. C’est-à-dire, ni nier l’étendu de la catastrophe, ni tomber dans un fatalisme paralysant, mais prendre compte l’état de la situation et tenter, autant que faire se peut, de construire un monde viable et encore désirable avec ce que nous avons. Pour ce projet, la pensée décoloniale est plus que nécessaire, elle est cruciale. Pas seulement pour la critique qu’elle adresse au système responsable de la situation actuelle, mais pour les pistes qu’elle propose d’explorer. Il faut penser l’écologie par le Sud, comme nous l’invite Malcolm Ferdinand[16], pour lutter contre « l’habiter colonial » qui est à la source de la destruction de notre écosystème planétaire. Les peuples du Sud, les Indigènes, ont développé des savoirs de diverses natures qu’il est essentiel pour les habitants du Nord d’intégrer.
Que ce soient ceux traditionnels, ancestraux, hérités de longues dates, qui nous donnent à voir un autre rapport à l’écosystème, aux êtres vivants et non-vivants, et qui peuvent nous apporter des réponses aux problématiques actuelles. Nous pouvons citer, à titre d’exemple et pour rester dans l’actualité, le cas des « sentinelles », étudiées par Frédérick Keck[17] en Asie, où la coopération entre les animaux et les êtres humains, à travers des méthodes tirées de savoirs anciens, permet de mieux prévenir les épidémies. Sans oublier qu’une cohabitation plus respectueuse peut, en elle-même, limiter l’émergence des maladies.
Mais ils peuvent aussi apporter une précieuse aide par l’esprit de résilience que ces habitants du Sud sont parvenus à développer face à la catastrophe provoquée par la colonisation, provoquant la destruction de leur habitat, de leurs cultures et de leurs modes de vies. Un désastre accentué par la catastrophe climatique actuelle.
Car les peuples du Sud « habitent le trouble » depuis 1492.
Wissam Xelka, membre du PIR
[1] Évidemment, un virus et encore moins une épidémie ne sont le pur produit de la Nature. Ils sont le résultat d’une interaction, souvent problématique, entre l’humain et son environnement. Dans le cas du Covid-19, le système de production capitaliste actuel est en grande partie responsable de son apparition puis de sa diffusion dans le monde. Le présent article n’a toutefois pas pour objectif de creuser la question des causes de l’apparition du virus et de la pandémie. Pour en savoir plus sur le sujet : Wallace Rob, Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science, Monthly Review Press, U.S, 2016 ; Daniel Tanuro, « Pandémie, capitalisme et climat », Revue Contretemps, Paris, 16 avril 2020 ; « Agriculture, paysannerie et pandémie. Entretien avec Roxanne Mitralias », Revue Contretemps, Paris, 4 avril 2020
[2] « Face à la barbarie qui vient, l’utopie décoloniale »
[3] Il y a toutefois ces dernières années un retour critique important sur ce dualisme de la part de certains marxistes travaillant sur la question. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, les travaux de Jason W. Moore et son concept de « Web of life » : Moore Jason W., Capitalism in the Web of Life Ecology and the Accumulation of Capital, New York, 2015. Ou ceux d’Andréas Malm, notamment sa critique du concept d’anthropocène : Malm Andreas, L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, La Fabrique, Paris, 2017.
[4] Keucheyan Razmig, La nature est un champ de bataille, essai d’écologie politique, Editions Zones, 2014, Paris
[5] Hage Ghassan, Le loup et le Musulman, Wildproject Editions, Paris, 2017.
[6] Pour rappel, nous entendons, par « Modernité Occidentale« , le paradigme philosophique, politique, idéologique, sociologique et économique dont le processus de création a débuté, en 1492, avec la naissance de l’Occident moderne, et s’est par la suite diffusé à l’échelle planétaire à travers l’expansion coloniale et impérialiste.
[7] Nous pouvons citer, à titre d’exemple, le fameux ouvrage de l’anarchiste Pierre Kropotkine, L’entraide, un facteur d’évolution, Editions Aden, Bruxelles, 2015
[8] Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Editions Gallimard, 2005, Paris
[9] Latour, Bruno, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, La Découverte, 1999, Paris
[10] Rappelons que la colonisation, l’esclavage et le pillage des ressources du Sud ont été les éléments essentiels de l’accumulation primitive du capital, et donc fondateurs du capitalisme, comme le souligne Karl Marx : « La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore » Karl Marx, Le Capital – Livre premier
[11] Keucheyan Razmig, La nature est un champ de bataille, essai d’écologie politique, Editions Zones, 2014, Paris
[12] Ainsi, nous devrions sérieusement remettre en doute l’idée d’une viande « halal » qui serait compatible avec le mode de production actuel qui pousse à élever, parquer et tuer des animaux dans des conditions abominables
[13] Coran, sourate 43, verset 13
[14] https://www.youtube.com/watch?v=fo2YWwLoT_U
[15] Haraway Donna, Staying with the Trouble: Making kin in the Chthulucene, Duke University Press, Experimental Future, 2016. Une traduction française des textes de Donna Haraway sur ces questions est aussi disponible : Haraway Donna, Caeymaex Florence, Despret Vinciane, Piero Julien, Habiter le trouble avec Donna Haraway, Editions Dehors, Paris, 2019
[16] Ferdinand Malcolm, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Editions du Seuil, Paris, 2019
[17] Keck Frédéric, Les Sentinelles des pandémies Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine, Editions Zones Sensibles, Paris, 2020.
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Sous les voix dominantes de l’anthropologie, certaines dissonent, et à raison. Celle de Pierre Déléage en fait partie. Américaniste, spécialiste du chamanisme des Sharanahua du Pérou, il alterne depuis une dizaine d’années les ouvrages sur l’invention et la stabilisation d’une écriture, la traduction des traditions orales autochtones ou, désormais, la fabrique des théories et du savoir anthropologiques. Son dernier ouvrage, L’Autre-mental, exhume « une lignée souterraine d’anthropologues » et la met en regard avec des écrivains de science-fiction. Une façon de susciter l’invention au sein d’une discipline qui tend trop souvent, à ses yeux, à dissimuler les êtres et les peuples qu’elle questionne.
Vous êtes entré dans l’univers de l’anthropologie pour « rendre la parole au chamane », une parole selon vous recouverte par les commentaires ethnographiques. 15 ans plus tard, vous dénoncez chez votre contemporain Eduardo Viveiros de Castro une anthropologie qui n’hésite pas, « débarrassée de tout scrupule épistémologique, à recouvrir [la voix des Amérindiens] par la sienne ». Rien n’a donc changé ?
« Rendre la parole au chamane », ce n’est pas vraiment un programme de recherche révolutionnaire. C’est plutôt le minimum de ce que l’on peut attendre des anthropologues, et ils sont encore quelques-uns à bien le faire. Je ne dirais pas que je « dénonce » l’anthropologie d’Eduardo Viveiros de Castro : après tout, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Je dirais plutôt que j’essaie de requalifier ou de réajuster son propos. Pour édifier sa théorie du perspectivisme amérindien1, Viveiros de Castro a bien sûr puisé son inspiration dans quelques mythes amazoniens. Mais il est tout aussi évident qu’il formule la théorie dans les termes, à partir des problèmes et avec les ressources de la philosophie telle qu’elle se construit et se transmet dans le monde universitaire. D’ailleurs jusqu’ici, tout va bien. Là où je ne suis plus d’accord, c’est lorsque ce perspectivisme est présenté comme étant la philosophie des Indiens d’Amazonie. Pire encore, lorsqu’il est dit que c’est comme ça que pensent habituellement les Indiens d’Amazonie, comme si cette expression avait le moindre sens dans toute sa généralité.
Je crois plutôt qu’un anthropologue commence, en effet, par rendre la parole aux chamanes, c’est-à-dire par être attentif aux subtilités de son discours, par prendre toutes les précautions nécessaires pour que ce discours puisse être réellement entendu. Et s’il a ensuite envie de monter en généralité, il lui faut toujours prendre garde à ne pas substituer sa parole à celle du chamane, à bien faire la part des choses entre ce qui vient de lui et ce qui vient des gens avec lesquels il a travaillé. Il lui faut absolument éviter de pratiquer une anthropologie ventriloque. Beaucoup trop d’anthropologues, aujourd’hui, plutôt que de restituer avec minutie les paroles des Amérindiens, de les recontextualiser, d’essayer de comprendre ce qu’elles veulent dire, n’hésitent pas à mettre des énoncés philosophiques parisiens dans leur bouche. Ça me choque profondément, c’est une sorte de colonisation mentale. C’est cet agacement qui m’a amené à retracer dans L’Autre-mental une petite généalogie d’anthropologues restreinte au XXe siècle (Lucien Lévy-Bruhl, Benjamin Lee Worf, Carlos Castaneda), qui mène tout droit à Viveiros de Castro.
Nombre d’anthropologues qui sont venus — et viennent encore — de la philosophie usent d’un raisonnement spéculatif avant d’aller sur le terrain pour décrire ce qui s’y passe. L’origine du problème ne réside-t-elle pas là ?
Je ne pense pas. Tout d’abord, c’est une situation très française. Pour des raisons historiques, l’anthropologie n’a qu’une place discrète à l’université et nombreux sont ceux qui, comme moi, ont commencé à l’étudier tardivement. Et parmi eux il y a en effet bon nombre de philosophes défroqués. De ce fait, les anthropologues français se sont intéressés, peut-être plus encore que d’autres, à des objets intellectuels : des traditions rituelles, des mythes, des cosmologies, etc. Ce n’est donc pas une mauvaise chose qu’ils disposent, pour les étudier, d’une formation de philosophe. Le problème est plutôt affaire de modestie et d’ethnographie. Les Français sont passés à côté du grand moment ethnographique américain du début du XXe siècle. Les membres de la première école de Franz Boas, des gens comme Truman Michelson, Edward Sapir ou Gladys Reichard étaient eux aussi fascinés par les modes de pensée des Amérindiens. Paul Radin, par exemple, a écrit un livre intitulé Primitive Man as Philosopher. Mais avant d’avancer des généralisations, ils se sont donnés comme tâche de transcrire des discours, d’éditer des textes, de rester le plus fidèle possible à la parole des Amérindiens, dans leur langue et en la contextualisant. Ces anthropologues se sont efforcés d’éditer des œuvres qui ne soient pas les leurs, mais bien celles des Amérindiens — des mythes, des descriptions de cérémonies, des autobiographies, etc. C’est un courant qui existe toujours, bien qu’il soit désormais minoritaire, dont Keith Basso était encore il y a peu l’un des représentants les plus intéressants — il n’a d’ailleurs été traduit que très récemment en français. C’est quelque chose qui a manqué et qui continue à manquer en France. Plutôt que de lecteurs de philosophes à la mode, nous avons besoin d’anthropologues qui connaissent la linguistique, élaborent des textes, assument le travail compliqué de transposition d’un discours oral en un texte traduit et écrit. Si ensuite on souhaite être créatif, on le fait un peu avant, un peu après, sur les côtés : on peut faire tout ce qu’on veut, mais on ne mélange pas. C’est précisément ce que je reproche aux anthropologues de la généalogie de L’Autre-mental. Certes ils ont été créatifs, mais il aurait fallu placer cette créativité ailleurs : pas dans la bouche des Amérindiens. Je suis très attaché à cette approche critique et j’essaie d’y convertir les étudiants ; pour le moment, de toute évidence, c’est un échec, mais je ne désespère pas !
Vous avez traduit la nouvelle d’un écrivain inuit. Comment passer d’une littérature orale à sa traduction écrite ?
Il y a quelques années j’ai publié un petit livre, Repartir de zéro, qui prend justement pour objet le problème de la transposition et de la traduction des traditions orales. Une revue parue dans les années 1970, Alcheringa, m’a particulièrement intéressé parce qu’elle a été une sorte de plateforme de discussion entre anthropologues et écrivains pour réfléchir à toutes les complexités, subtilités et impasses soulevées par les problèmes de la traduction. Les interrogations étaient avant tout d’ordre poétique — comment parvient-on à rendre un style oral dans un texte écrit ? Mais elles étaient aussi épistémologiques — qui est l’auteur de ces textes ? traduire ces textes n’est-ce pas leur ajouter un auteur ? Or ce sont précisément les questions que je m’étais posées lors de mon enquête ethnographique chez les Sharanahua d’Amazonie péruvienne. L’objectif de mon premier livre, Le Chant de l’anaconda, avait été de donner à lire leur tradition orale, c’est-à-dire des versions de leurs mythes et des chants de leurs chamanes. Mais pour cela, il fallait d’abord en passer par un travail de traduction très riche, philologique en quelque sorte, qui puisse acclimater une poétique orale à notre langue écrite. Il fallait aussi faire un pas en arrière et demander aux Sharanahua ce qu’eux-mêmes pensaient de leurs mythes et de leurs chants. Ne surtout pas leur imposer mes conceptions de l’auteur, du mythe ou du chamanisme, mais me mettre à l’écoute de ce que j’ai ensuite appelé leur épistémologie traditionnelle. C’est toujours comme ça que je conçois l’ethnographie des savoirs.
La tradition structuraliste française a longtemps dominé la pratique anthropologique en France, empêchant peut-être ainsi de s’ouvrir à de telles méthodes. Qu’en est-il de son actualité ?
Pour autant que je sache, le structuralisme orthodoxe n’existe plus vraiment. Il s’est transformé en autre chose. Mais il est vrai qu’en France les anthropologues qui ont une ambition comparative demeurent très influencés par le structuralisme. Je crois que ce qu’ils ont retenu de l’œuvre de Claude Lévi-Strauss, c’est la pratique de la typologie et aussi l’idée que la typologie doit être fondée en raison, que la définition de bonnes catégories d’analyse est une fin en soi. C’est quelque chose qui vient du Totémisme aujourd’hui ou de La Pensée sauvage, mais pas vraiment des Mythologiques qui, elles, explosent tout cadre typologique et font ouvertement proliférer des chaînes d’association et d’opposition sémantiques étranges et pour tout dire souvent assez arbitraires2. Le structuralisme des Mythologiques, parfois un peu fantastique, est resté lettre morte. Aujourd’hui les successeurs de Lévi-Strauss — comme Eduardo Viveiros de Castro, Philippe Descola, Emmanuel Désveaux, etc. — préfèrent établir des typologies fermées où les modes de pensée ou de relation des sociétés humaines se différencient les uns des autres en fonction d’un petit nombre de critères. C’est très utile, ça oriente la pensée. On ne peut pas commencer à réfléchir sans au moins quelques catégories. Mais ça ne devrait pas être le but ultime de l’anthropologie.
Pour ma part, j’ai l’impression de faire partie de la première génération, en France, qui non seulement n’est pas structuraliste, mais qui n’a pas même éprouvé le besoin de se positionner par rapport au structuralisme. Les bases théoriques à partir desquelles j’ai construit mes objets d’étude en ont été d’emblée très éloignées. Je crois que replacer l’apprentissage et la transmission des phénomènes culturels au cœur de l’anthropologie m’a permis de me passer de définitions rigoureuses du chamanisme, du rituel, de l’animisme, etc., de ne considérer ces catégories que comme des heuristiques qui certes orientent le regard, mais qui ne doivent pas trop nous préoccuper. Quand on se situe à ce niveau-là, quand on s’intéresse avant tout aux processus d’invention, de propagation, de stabilisation ou d’extinction des phénomènes culturels, alors les typologies apparaissent comme ce qu’elles sont : floues, éphémères, travaillées de l’intérieur par des micro-processus beaucoup plus fondamentaux.
Vous dites que le structuralisme des Mythologiques était « un peu fantastique ». N’y a‑t-il pas là une piste à explorer ?
Il y a aujourd’hui un défi : trouver une manière d’aborder les mythologies qui soit au moins aussi intéressante que la méthode structurale. La quantité de livres qui transcrivent les mythes de telle ou telle population amazonienne a décuplé depuis les Mythologiques. Or il n’existe aucune tentative d’abordage théorique de ce corpus gigantesque ! Il convient d’aller au-delà des problématiques de traduction dont nous avons parlé et qui ne sont qu’une première étape. Il faut se demander comment construire un objet anthropologique qui puisse rendre compte de ce torrent de récits mythiques. Et cet objet, on l’attend encore. C’est là probablement l’un des enjeux de l’anthropologie du futur : revenir à des objets considérés dorénavant comme un peu archaïques — n’importe quel étudiant à qui l’on parle de mythologie soupire et se dit « Oh non, encore de l’anthropologie coloniale ! » —, mais pour les reproblématiser. Il y a là un champ extraordinaire, qui ne doit plus simplement servir à vérifier que les Amazoniens sont animistes, ou perspectivistes : la mythologie va bien au-delà de ces schèmes d’une extrême généralité.
Vous définissez l’anthropologue du XXe siècle comme tour à tour — ou tout à la fois — l’idiot, l’élu et le sceptique. Vous ajoutez à ces trois figures celle typique de ces dernières années, « le diplomate cosmique » qui, dites-vous, « ne peut s’empêcher de soumettre la pensée d’autrui […] à une perpétuelle recolonisation », là où son projet annoncé est tout à fait opposé…
J’ai pris l’expression « diplomate cosmique » à Eduardo Kohn, qui est un des représentants de ce courant d’anthropologues. Je ne suis d’ailleurs pas certain de bien savoir ce qu’il veut dire par là. Pour moi les diplomates sont des gens qui habitent les beaux quartiers des grandes métropoles et qui adorent parler à la place des autres. Quant à l’adjectif « cosmique », j’imagine qu’il lui permet d’insister sur l’ultime décentrement de la discipline, sur la perte par l’anthropos de sa centralité. Mais alors on ne s’intéresse plus trop à ce que disent les humains. On ne se demande plus ce que les Indiens d’Amazonie pensent de la manière de penser des forêts. On se demande seulement comment pensent les forêts. On fait sauter les guillemets et l’énonciateur de tel ou tel énoncé disparaît, en l’occurrence ici les Amérindiens. Je crois qu’il faut alors avoir l’honnêteté de se présenter comme philosophe ou même, comme je le propose dans L’Autre-mental, comme écrivain de science-fiction. Il y a beaucoup de diplomates cosmiques dans la littérature de science-fiction. Mais ce n’est plus de l’anthropologie. Or il faut que subsiste un espace où la parole des Indiens soit présentée pour elle-même et non pour une finalité exogène, quelle qu’elle soit. Et si l’on transforme les discours des Amérindiens en autre chose, il faut dire qu’on le fait.
Ce courant de l’anthropologie est le plus médiatisé en ce moment, ce qui peut brouiller sa réception et simplifier ses conclusions…
Déjà, c’est très bien que beaucoup de choses différentes se passent. Il ne faut surtout pas chercher à faire intervenir la police épistémologique, on n’en a pas besoin. Si l’anthropologie a une vertu, c’est quand même sa méfiance vis-à-vis de l’universalité des lois, des institutions, des traditions. Rien d’étonnant à ce que l’on trouve tant d’anarchistes chez les anthropologues. Il faut donc qu’une multitude d’approches puissent se développer librement.
L’une d’elles se retrouve dans de nouvelles formes littéraires. Dans Croire aux fauves, par exemple, Nastassja Martin use de formules brèves et poétiques, au risque, parfois, de schématiser la pensée des peuples concernés — en l’occurrence ici les Évènes du Kamtchatka…
Mon point de vue sur ce livre — que j’ai beaucoup aimé — est qu’il s’agit de l’intensification maximale d’une expérience personnelle. La narratrice engage son corps et sa pensée dans l’expérience la plus forte possible, une rencontre avec un ours. C’est quand même extraordinaire. Ensuite, qu’on soit en accord avec ce corps ou avec cette pensée, ce n’est pas en soi un problème ! Je dois dire que ma conception de l’anthropologie est très éloignée de celle de Nastassja Martin : j’aime les voyages immobiles et quand je pars en Amazonie, c’est pour passer l’essentiel de mon temps dans un hamac à écouter les histoires que les gens veulent bien me raconter. Je ne suis clairement pas un héros tragique. Et puis je reste comme vous dubitatif sur la pensée animiste un peu immédiate qu’elle attribue aux Évènes. Mais ce qu’elle fait de cet animisme, fantasmé ou non, sa mise en récit, est impressionnant et émouvant. Je crois, avec Dan Sperber, que chaque ethnographe devrait repenser le genre ethnographique, comme chaque vrai romancier repense le roman.
Être convaincu par la forme de pensée étudiée, jusqu’à s’en réclamer — Jean Malaurie nous avait dit avoir été « presque animiste » à une époque de sa vie, Philippe Descola a plus récemment affirmé l’être « un peu » avec les oiseaux — n’est-il pas néanmoins problématique ?
Quand on passe beaucoup de temps chez des gens, on finit par vivre des choses très proches de ce qu’ils vivent. Heureusement qu’on finit par rêver un peu comme eux ! Le contraire serait effrayant. J’aurais tendance à atténuer plutôt qu’à accentuer cette extériorité parfois présentée comme radicale. D’ailleurs dans vos deux citations, il y a « presque » et « un peu » : j’imagine que Malaurie et Descola seraient donc d’accord avec moi. Plus généralement, je ne crois pas que le mode de pensée des Sharanahua d’Amazonie, si tant est qu’il existe en dehors de ce qui sédimente dans des mythes et des chants, dans des discours institués, soit d’une différence plus radicale que celui, par exemple, d’un écrivain comme Philip K. Dick. La stupéfaction que j’éprouve en traduisant un chant chamanique compliqué, aux implications métaphysiques étranges, n’est finalement pas différente en nature de celle que je ressens en lisant une nouvelle de Philip K. Dick ou un dialogue de Giordano Bruno. Tout ça ne me paraît être qu’une question de degré. Essentialiser une forme de pensée, ce que j’appelle un « autre-mental », et prétendre s’y convertir me semble assez artificiel et contribue à une image héroïque de l’anthropologue en tant que maître de la pensée d’autrui — ce qui ne me convient pas.
Vous présentez K. Dick comme ayant plus de rigueur scientifique que certains anthropologues, aux premiers rangs desquels Viveiros de Castro. Ne vous attendez-vous pas à une levée de boucliers de la part du monde académique ?
Le monde académique fera bien ce qu’il veut ! Plus sérieusement, je pense qu’il y a au moins deux aspects qui rapprochent les anthropologues des écrivains de science-fiction. Le premier, c’est que les uns comme les autres s’intéressent aux échelles les plus vastes possibles. La machine de H. G. Wells permet de voyager 800 000 ans dans le futur. Un écrivain comme Olaf Stapledon pense ses histoires en milliards d’années. Il faut une perspective de quelques millions d’années pour commencer à intéresser un auteur de science-fiction. Même chose du point de vue spatial, l’unité minimale c’est la planète. Il y a là une forme d’hubris intellectuelle qui définit également bien l’ambition des anthropologues, cette manière de concevoir les humains comme des fourmis et de se placer d’emblée aux échelles comparatives les plus larges.
Le second aspect ne concerne peut-être qu’un sous-ensemble d’anthropologues et d’écrivains, parmi lesquels Philip K. Dick me semble très représentatif. C’est la recherche d’une sorte de stupéfaction, la quête perpétuellement recommencée d’idées bizarres et de pratiques étranges — quitte à montrer qu’en fait, c’était beaucoup moins étrange qu’on ne le pensait. Anthropologues et écrivains de science-fiction essaient de rendre compte, cette fois à un niveau microscopique, de ce qui les a stupéfiés, de rendre ces bizarreries plus intuitives, plus compréhensibles, et une fois satisfaits ils recommencent tout le processus avec d’autres idées étranges, sautant continuellement d’un objet à un autre. Philip K. Dick est le spécialiste de ce genre de choses. Il y a toute une métaphysique délirante dans son œuvre, mise en récit plutôt qu’argumentée — j’essaie dans mon livre de la décortiquer, le plus simplement et clairement possible. Mais beaucoup d’autres auteurs de science-fiction, ceux que je préfère et que je mentionne dans un exercice de name dropping3, sont eux aussi à la recherche de ces expériences de pensée, de cette stupéfaction mentale. Il y a donc comme un lien secret. Ou alors ce n’est qu’une de mes particularités autobiographiques — dans ce cas, je vous ai donné ma définition de l’anthropologue…
Vous présentez d’ailleurs dans ce livre la fiction, voire la science-fiction, comme un moteur puissant de la créativité anthropologique — qui risque toutefois de tomber dans le n’importe quoi à tout moment… Comment parvenir à l’exploiter ?
Il faut commencer par évacuer le problème de la différence entre fiction et réalité. Une fois dit qu’il faut éviter les glissements épistémiques entre les deux, à savoir qu’il faut être clair sur le statut de ce que l’on raconte, tout est possible et les relations entre fiction et science restent en grande partie à explorer. Pour mon compte, ça s’est fait de deux manières. La première s’inscrit dans la continuité de mes travaux sur l’épistémologie traditionnelle, c’est-à-dire sur ce que les sociétés de tradition orale pensent de leurs savoirs, du mode adéquat de leur transmission, de la nature de leurs auteurs, de leur valeur de vérité, etc. Cette problématique m’a conduit à travailler avec des Amérindiens qui étaient ou voulaient être les auteurs de leurs propres livres, comme Mataliwa Kulijaman ou Alfonso García Téllez. Mon rôle se limitait à les accompagner dans cet accès à la position d’auteur, processus fascinant mais aussi nourri par toutes sortes de conflits et de relations de pouvoir compliquées à démêler. Peu à peu, j’en suis venu à me poser à moi-même cette question de « l’auctorialité », comme disent les chercheurs en littérature, c’est-à-dire des liens entre autorité et position d’auteur. Dans un moment un peu pessimiste et dépressif, cette question m’a conduit à écrire Lettres mortes où je mets en scène, par le biais d’une série de portraits, les apories du savoir anthropologique, toujours issu d’une société et d’une culture dominantes.
Certains de vos articles et ouvrages récents partent eux aussi de matériaux biographiques : une pratique peu commune. Pourquoi ce choix ?
C’est une histoire de positionnement. C’est quelque chose par quoi devraient passer tous les anthropologues, au moins depuis les travaux de Jeanne Favret-Saada. Dans les premiers chapitres de Les Mots, la mort, les sorts, elle construit avec une grande rigueur un point de vue, un positionnement à la fois théorique et politique qui s’intègre à sa démonstration et définit en même temps un objet de recherche. Expliciter sa position d’auteur, en explorer les soubassements, c’est fondamental, en particulier quand des rapports de domination aigus sont en jeu. C’est d’ailleurs un excellent remède contre l’anthropologie ventriloque. Les anthropologues se prêtent à ce jeu-là, mais la plupart du temps de manière anecdotique : en début, en fin d’ouvrage ou dans ses marges. Ou alors — c’est l’horreur — ils écrivent des traités pour stipuler quelles sont les règles de la méthode ethnographique (ce sont souvent ceux-là qui finissent par diriger les institutions). Je sentais bien que l’explicitation de ma position d’auteur était nécessaire, mais je ne voulais pas la réduire à l’anecdote ni commettre un traité dogmatique. M’investir dans des personnages conceptuels, dans des sortes de médiateurs, a représenté pour moi une solution à ce problème — de là ces biographies qui n’en sont pas vraiment, qui sont une manière indirecte de circonscrire, à un moment donné, un problème et de ménager les conditions d’une position d’auteur. D’où le missionnaire Émile Petitot dans La Folie arctique, d’où le Bororo Tiago Marques Aipoburéu, d’où le personnage de roman Pierre Darriand, d’où l’écrivain anthropologue Robert H. Barlow. Tous m’ont permis d’aborder les problèmes théoriques, politiques et même esthétiques qui m’intéressaient de la manière la plus concrète et narrative qui soit, sans dogmatisme ni prosélytisme.
Il y a aussi cette manière d’écrire différente en fonction des anthropologues dont vous faites le portrait : un récit, une chronique, un dialogue, un collage de textes théoriques et ethnographiques…
Oui, ça c’est la deuxième voie d’exploration de la fiction que j’ai ouverte. L’anthropologie a toujours affaire d’une manière ou d’une autre au récit, à la narration, mais elle a peut-être un peu laissé de côté cet aspect, devenu académique et ennuyeux. C’est assez triste. Une partie de mon travail consiste donc à rappeler que la littérature au XXe siècle a inventé un grand nombre de formes d’expression différentes et à demander s’il n’est pas temps que les sciences sociales s’en emparent, à leur manière, pour répondre à leurs propres problèmes. Dans L’Autre-mental, ça a pris une tournure quasiment expérimentale. Je voulais contourner le mode strictement argumentatif pour approcher au plus près, sans leur faire violence, les philosophies un peu fabuleuses de chacun des anthropologues portraiturés. À partir de là, pour aborder la pensée de Lucien Lévy-Bruhl, il m’a paru intéressant de reconstruire, dans un style très classique, sa psychogéographie4 — celle d’un notable parisien du XVIe arrondissement, avec le parc de Bagatelles comme horizon et la rêvasserie comme méthode. Pour Benjamin Lee Whorf, j’ai employé une écriture qui diffractait complètement la temporalité, fidèle en cela à la philosophie de l’événement qu’il impute à la langue des Indiens Hopi. La restitution de ses arguments est donc séquencée par des chronologies où le temps paraît éparpillé, comme dans certaines œuvres d’Alan Moore. Pour Carlos Castaneda, j’ai mis en place une sorte d’anthropologie dialogique, un peu folle, un peu pop, un peu sixties, qui commence par une anecdote trouvée dans un article publié par le magazine Penthouse ! Pour Viveiros de Castro, c’était plus difficile : on n’écrit pas à propos des vivants comme on écrit à propos des morts. J’ai opté, sobrement, pour un montage parallèle qui fasse apparaître un contraste net entre les paroles des Amérindiens, citées avec exactitude, et les libertés théoriques — souvent fascinantes je le répète — que prend Viveiros de Castro. L’enjeu stylistique a été de trouver à chaque fois la forme d’expression la plus adaptée à un certain type de pensée, ou du moins à la manière dont je voulais le présenter.
Le récit, vous l’avez mentionné, a été très employé en anthropologie, au risque de se standardiser — la collection Terre Humaine en forme l’archétype : Tristes tropiques, Les Derniers rois de Thulé, Les Lances du crépuscule… Est-ce que cette forme peut se réinventer ou faut-il l’oublier pour se tourner vers de l’expérimentation ?
Tout est possible ! Mais Terre Humaine me semble quand même appartenir au passé. Je fais partie des anthropologues qui, avant même de le devenir, n’aimaient pas Tristes tropiques, simplement en raison de son style. J’ai appris depuis à domestiquer ce genre de livre et à lui trouver beaucoup d’intérêt, mais du point de vue formel ça m’exaspère toujours autant — et d’une certaine manière, je crois que tout le XXe siècle a été exaspéré par ce type de littérature surplombante et édifiante… C’est étonnant d’ailleurs de la part de Lévi-Strauss, dont le premier texte fut une recension du Voyage au bout de la nuit de Céline, qu’il considérait comme un manifeste libérateur ! Cela dit, Terre Humaine a représenté pendant longtemps une échappatoire pour les anthropologues qui se sentaient frustrés par des débouchés éditoriaux trop contraints : l’article scientifique d’une vingtaine de pages, très formaté, et la monographie le plus souvent issue d’une thèse, ça ne suffit pas. Pendant longtemps je me suis moi aussi débattu avec le problème de ce que l’on peut faire avec un texte qui n’est ni un article, ni un livre, mais qui doit nécessairement compter une centaine de pages pour exposer correctement à la fois les données empiriques et l’argumentation théorique. La Croix et les hiéroglyphes ou Le Geste et l’écriture, par exemple, ne sont pas vraiment des livres, ce sont avant tout des articles trop longs pour les revues d’aujourd’hui. C’est pourquoi, en désespoir de cause, j’ai fini par m’autopublier en créant un blog, Trop tard, trop tôt. Ce fut une émancipation extraordinaire. Lettres mortes est entièrement issu de cette expérience. Aucune contrainte de format, mais surtout aucun horizon d’attente, aucun censeur virtuel penché par-dessus mon épaule. Il fallait ce contexte, cet affranchissement, pour que la problématique de la fiction puisse prendre forme. Et puis c’était aussi en continuité avec mon engagement pour le libre accès à l’information.
À la fin de L’Autre-mental, vous mettez en scène un professeur d’anthropologie donnant une conférence délirante devant un auditoire se vidant peu à peu, dans une forme proche de la science-fiction : peut-on imaginer une telle expérimentation dépouillée de tout appareil théorique, comme c’est le cas ici ?
Tout d’abord il faut dire que ce professeur Challenger, c’est moi, poussé à un degré d’intensité et de délire un peu extrême. J’exprime à travers lui ma façon de conceptualiser l’anthropologie et son objet, c’est-à-dire la transmission des savoirs, à partir d’une approche en termes de populations de discours plutôt que de catégories de pensée. C’est la théorie qui sous-tend tous mes travaux sur les traditions orales, sur l’origine de l’écriture, sur les mouvements prophétiques, qui sous-tend mon livre Inventer l’écriture par exemple. Donc, quelque part, je prends ça relativement au sérieux. Mais c’est aussi pour moi une manière de dire que les théories des anthropologues ne sont pas si importantes : c’est souvent amusant, parfois intéressant, mais probablement très périssable. Ça a en général le défaut d’être très contraignant pour les disciples ou les générations à venir, les obligeant à se positionner vis-à-vis d’elles ou — pire encore — à les répéter. Alors il faudrait s’en moquer un peu et leur donner leur vrai statut : des notions permettant à un moment donné d’offrir un nouveau point de vue sur les phénomènes culturels et sociaux, mais qui n’ont en réalité pas grand-chose de scientifique, même en prenant en compte toute la diversité des sciences. Et puis, dernière chose, la conférence du professeur Challenger c’est probablement une façon de m’emparer des passages obligés de la science-fiction : le savant fou, le lent processus de décorporation, la recherche de visions sublimes, etc. Je réactive ainsi, à la fin du livre, son ressort principal qui consiste peut-être moins à recadrer les fabulations de quelques anthropologues imaginatifs qu’à explorer une sensibilité commune aux anthropologues et aux écrivains de science-fiction.
1. Le perspectivisme est une catégorie généralisant la manière dont les peuples autochtones d’Amérique du Sud et les autres êtres vivants résidant avec eux percevraient le monde. Le perspectivisme est pensé comme symétriquement opposé à l’ontologie occidentale dominante : si dans celle-ci le corps a des propriétés partagées avec tous les êtres tandis que l’intériorité (la conscience, l’âme) est strictement humaine, le perspectivisme implique que tous les êtres vivants, ou presque, ont en partage une même intériorité qui s’exprime différemment selon leurs corps propres. Humains et animaux seraient tous des personnes ayant les mêmes besoins et rituels, exprimés différemment en raison de leurs diverses enveloppes corporelles. Cette notion n’est toutefois pas autonome chez Viveiros de Castro, et s’accompagne d’un « multinaturalisme ontologique », symétriquement opposé au multiculturalisme occidental.↑
2. Les Mythologiques est une œuvre en quatre volumes (1964–1971) dans laquelle Claude Lévi-Strauss a élaboré son approche structurale des mythes. La Pensée sauvage (1962) aborde pour sa part l’universalité de la connaissance humaine, tandis que Le Totémisme aujourd’hui (1962) entend redéfinir le totémisme et, dans le même temps, les phénomènes qui y étaient jusqu’alors rapportés.↑
3. « [L]a littérature de Howard P. Lovecraft, Franz Kafka, Edogawa Ranpo, Jorge Luis Borges, Christopher Priest, Steven Millhauser, Marc-Antoine Mathieu, Brian Evenson, ou encore d’Alfred Bester, Philip K. Dick, Willliam S. Burroughs, James G. Ballard, Alan Moore, Greg Egan et de quelques autres. »↑
4. Notion introduite par Guy Debord et les Situationnistes, que le premier définissait comme « l’étude des lois exactes, et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur les émotions et le comportement des individus ».↑
Au moins 500 espèces de vertébrés terrestres sont au bord de l'extinction
Anne-Sophie Tassart, Sciences et Avenir, 4 juin

Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction

Anne-Sophie Tassart, Sciences et Avenir, 4 juin

Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction

Population size of terrestrial vertebrate species on the brink (i.e., with under 1,000 individuals). Most of these species are especially close to extinction because they consist of fewer than 250 individuals. In most cases, those few individuals are scattered through several small populations.
Des chercheurs américains ont évalué près de 30.000 espèces de vertébrés terrestres. Près de 500 d'entre elles disparaîtront sans doute bientôt pour plusieurs raisons.
Un rhinocéros de Sumatra, une espèce extrêmement menacée
TATAN SYUFLANA/AP/SIPA
La sixième extinction de masse est en cours. Mais ce que des chercheurs américains et mexicains ont remarqué, c'est qu'elle s'accélère pour plusieurs raisons. Ils ont partagé le 1er juin dans la revue PNAS leurs sombres constatations.
Des espèces qui "disparaîtront probablement bientôt"
"Les pertes massives que nous connaissons sont causées, directement ou indirectement, par les activités d'Homo sapiens, notent en préambule les auteurs de l'étude. Ils se sont presque tous produits depuis que nos ancêtres ont développé l'agriculture, il y a environ 11.000 ans". Depuis, notre nombre n'a cessé de croître, ce qui entraîne une véritable érosion des écosystèmes de la planète. Les taux d'extinction des espèces "sont des centaines ou des milliers de fois plus rapides que les taux 'normaux'". Plus de 400 espèces de vertébrés ont disparu au cours du siècle dernier. Durant une évolution normale, une telle perte aurait pris 10.000 ans. Et ce pourrait-il en plus que dans le futur, tout cela s'accélère ?
Pour répondre à cette question, les chercheurs ont épluché les données concernant 29.400 espèces de vertébrés terrestres. Ils ont souhaité déterminer lesquelles sont au bord de l'extinction c'est-à-dire, comprenant moins de 1.000 individus. Elles sont 515 soit environ 1,7% des espèces évaluées, à être dans ce cas. "Bon nombre des espèces qui ont été poussées au bord du gouffre disparaîtront probablement bientôt", ne cachent pas les auteurs de l'étude. On compte parmi elles le rhinocéros de Sumatra ou encore l'espèce de tortue Chelonoidis hoodensis.
"L'extinction engendre des extinctions"
Déjà affaiblie, une espèce peine à jouer son rôle dans l'écosystème. Les espèces dont la population est si faible que leurs fonctions écosystémiques sont perdues sont parfois qualifiées de "zombies écologiques". Leur affaiblissement, puis leur extinction, conduit parfois à des cascades d'extinction : "une série d'extinctions déclenchées par la disparition d'une espèce clé dans un écosystème". Elles se produisent fréquemment. Car quand une espèce disparaît, ses caractéristiques sont à jamais perdues et son rôle peut ne pas être joué par une autre. Et "les interactions écologiques étroites des espèces au bord du gouffre tendent à déplacer d'autres espèces vers l'anéantissement lorsqu'elles disparaissent - l'extinction engendre des extinctions", souligne l'étude. 84% des espèces de plus de 5.000 spécimens étudiés se trouvent dans les mêmes régions que celles grandement menacées. Pour les chercheurs, il s'agit là du signe que des effondrements régionaux de la biodiversité sont en cours. La perte progressive d'une espèce entraîne une pression sur les autres espèces avec qui elle interagit.
Un taux d'extinction qui augmentera sûrement à l'avenir
Pour les chercheurs, le taux d'extinction futur des espèces animales est probablement sous-estimé. Un tiers de toutes les espèces de vertébrés seront sans doute en danger d'extinction d'ici le milieu du siècle et la moitié ou plus d'ici la fin du siècle. "Le taux actuel d'extinction rapide des vertébrés augmentera fortement à l'avenir", préviennent les auteurs de l'étude. D'ailleurs, les pressions anthropiques sur la biosphère augmentent elles-mêmes très rapidement. "Un exemple récent est la pandémie actuelle de la maladie du coronavirus (Covid-19), liée au commerce des espèces sauvages", précise les chercheurs. Ils espèrent que l'interdiction du commerce des animaux sauvages imposée par le gouvernement chinois sera maintenue. Elle pourrait alors devenir une mesure majeure de protection des espèces les plus fébriles. Si non, les pandémies se multiplieront à mesure que la biodiversité s'effondrera.
Dernière édition par Florage le Dim 7 Juin - 3:24, édité 1 fois
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
les textes

- Anthropocènes Noirs. Décoloniser la géologie pour faire monde avec la Terre, Malcolm Ferdinand, Terrestres, 1er juin
- L'accaparement bureaucratique des terres pour une colonisation par les infrastructures
Les énergies renouvelables, l’Amassada et les résistances dans le sud de la France, Alexander Dunlap, chercheur en écologie politique et en anthropologie à l’université d’Oslo, lundimatin#245, 2 juin 2020
- Philippe Descola : « Il faut repenser les rapports entre humains et non-humains, CNRS Le Journal, 3 juin
- Au moins 500 espèces de vertébrés terrestres sont au bord de l'extinction
Anne-Sophie Tassart, Sciences et Avenir, 4 juin
- Pierre Déléage : « Si l’anthropologie a une vertu, c’est sa méfiance vis-à-vis de l’universalité des lois », Ballast, 3 juin
- Covid-19, une vengeance de la Nature ? Pour une approche décoloniale de la Nature, Wissam Xelka, membre du PIR, 1 juin
- Ce que nous dit le coronavirus, Edgar Morin, Libération, 12 mars
- "Le virus de la recherche", recension de textes
- Critique dialectique de la nature de la nature humaine, Lawrence Krader, L'Homme et la société, 1968
- La relation Homme-Nature : écopsychologie, Patrick Guérin et Marie Romanens, écopsychologie, 29 mars 2015
- J. Baird Callicott, Science, and the Unstable Foundation of Environmental Ethics, 20 décembre 2016
- Anthropocène et éthique de la terre
Entretien avec J. Baird Callicott, Fondation de l'écologie politique, 12 septembre 2017
- Programmes scolaires : l’écologie reste à la marge, Marie Astier, Reporterre, 10 septembre 2019[/b]
Anthropocènes Noirs. Décoloniser la géologie pour faire monde avec la Terre
Malcolm Ferdinand, Terrestres, 1er juin
Malcolm Ferdinand, Terrestres, 1er juin
Pour ce numéro 14, la revue "Terrestres" propose notamment de relire l’anthropocène depuis une perspective décoloniale, d’écouter la parole imaginée d’un migrant cherchant à traverser la frontière à Calais, d’envisager ce que serait une vie avec les virus, de repenser notre rapport à la nature et à la Terre, de revisiter la révolution à l’aune de Benjamin et de la catastrophe écologique en cours...

Quelles places pour les Noirs et les peuples indigènes au sein des savoirs de l’Anthropocène ? Pour Kathryn Yusoff, l’hégémonie du critère géologique y prolonge le silence de l’histoire coloniale. En résulte une responsabilité de tous envers la planète qui est conditionnée à l’irresponsabilité vis-à-vis des destructions de la colonisation et de l’esclavage.
- ANTHROPOCÈNES NOIRS. DÉCOLONISER LA GÉOLOGIE POUR FAIRE LE MONDE AVEC LA TERRE. La recension du livre de Kathryn Yusoff, A billion Black Anthropocenes or None (2018), est l’occasion de s’interroger sur les places laissées aux noirs et aux peuples indigènes au sein des savoirs de l’Anthropocène.
. LA GÉOLOGIE DE L’ANTHROPOCÈNE N’EST PAS NEUTRE NI INNOCENTE
. RACISME DE LA GÉOLOGIE, GÉOLOGIE DU RACISME
. LE SILENCE COLONIAL DANS L’ANTHROPOCÈNE : UNE CULTURE DE L’IRRESPONSABILITÉ
. DES RÉVOLTES GÉOLOGIQUES NOIRES
. PREMIÈRE LIMITE : DES ABSENCES NON JUSTIFIÉES
. DEUXIÈME LIMITE: L’OUBLI DE LA QUESTION POLITIQUE ET DU MONDE
. TROISIÈME LIMITE : LA REPRODUCTION D’UNE FRACTURE ?
7 autres textes
- Pluribiose. Vivre avec les virus. Mais comment ? L’anthropologue Charlotte Brives tente de répondre à l’injonction lancée par notre ministre sur la nécessité de « vivre avec le virus ».
- Tentative d’atterrisage. Ce récit raconte les dernières rencontres de la Ferme de Lachaud au cours desquelles tentent de s’imaginer et de s’élaborer des « devenirs terrestres ».
- Exercices en infra-physique, pour une nouvelle philosophie de la nature. Cette recension du livre de Bartoli et Gosselin retrace le mouvement d’une pensée qui cherche à répondre au besoin existentiel de vivre et de s’inscrire dans les plis d’une Terre animée.
- Le choc des éco-marxismes face au dérèglement climatique, s’interroge sur les relations entre capitalisme et nature à partir des travaux de Jason Moore et d’Andreas Malm.
- Heroic Land, ce récit poignant met en scène un dialogue entre un passeur et un migrant qui, à Calais, cherche à traverser la frontière entre la France et l’Angleterre.
- Révolution sans arche, cette recension du livre de Michael Löwy s’interroge sur la manière dont la pensée de Walter Benjamin peut nous aider à faire face au désastre de la catastrophe écologique et à repenser la révolution.
- Peut-on s’opposer à l’informatisation du monde ? L’auteur met en lumière la manière dont les technologies numériques sont imposées aux citoyens contre leur volonté alors même que leur développement accélère la catastrophe écologique.
Terrestres — revue des livres, des idées et des écologies
Les esclaves de l’anthropocène
Petrodollar, intérêts financiers, manipulation de masse
présentation par Up'Magazine, 5 juin 2020

Petrodollar, intérêts financiers, manipulation de masse
présentation par Up'Magazine, 5 juin 2020

Nicolas Teterel défend la thèse selon laquelle notre système de création monétaire par la dette assortie d’intérêts nous oblige mathématiquement à générer de nouvelles dettes plus grandes que les précédentes.
Ce livre met en lumière la manipulation médiatique, la géopolitique, l’endettement, le système monétaire, le changement climatique et les limites de la croissance. Il parle d’un système civilisationnel à la dérive qui ne va pas tarder à imploser si nous ne mettons pas fin à l’esclavage par la dette et ses conséquences : la quête de production et de croissance infinie.
L’auteur avance que les politiques ne sont plus que l’émanation de banques et de multinationales qui espionnent et manipulent les masses. Il alerte sur le réchauffement climatique et l’extinction de masse que l’empire étasunien ignore royalement, obsédé qu’il est par la Chine et le besoin vital de protéger le pétrodollar, quoi qu’il en coûte.
Dans un style simple et direct, Nicolas Teterel lève le voile sur l’arnaque de la création monétaire et décortique le fonctionnement de notre système. Il dévoile sa recette pour effacer la dette. Il préconise aussi d’abandonner le dollar ainsi que l’indice de richesse PIB, pour ne plus être les esclaves de notre temps.
« Aujourd’hui, les gens savent le prix de tout et ne connaissent la valeur de rien »
Oscar Wilde
Quatrième de couv'Nicolas Teterel vit à Prague et à Paris. Il est présent sur les réseaux sociaux et membre du mouvement Extinction-Rebellion. Grand voyageur, il change régulièrement de pays et de continent pour prendre le pouls de la planète. Longtemps journaliste économique, il raconte aujourd’hui ce qu’il a découvert à force de commenter l’absurdité du gaspillage ostentatoire sur fond d’endettement esclavagiste et de catastrophe climatique.
La Boétie disait que le peuple a non pas perdu sa liberté mais gagné sa servitude. L’homme moderne, lui, se fait offrir sa servitude. Il se fait offrir un taux d’intérêt comme l’esclave se voit offrir de nouvelles chaines par son négrier. Dans ce livre, Nicolas Teterel met en cause le système de création monétaire kafkaïen voulant que l’argent soit créé à partir de dettes et d’intérêts qui nous obligent mécaniquement, mathématiquement, à générer perpétuellement de nouvelles dettes plus grandes que les précédentes. Un système d’esclavage financier qui porte en lui les germes de l’autodestruction puisqu’une dette en constante augmentation exige une croissance en constante augmentation et donc des émissions de CO2 toujours plus grandes.
L’auteur décortique le fonctionnement de notre système et ses principales têtes d’hydre que sont le contrôle des esprits par l’idéologie et la propagande médiatique, le joug artificiel de la dette ou encore la sujétion des nations aux États-Unis grâce au privilège exorbitant du pétrodollar. Plongez enfin dans un livre qui met en parallèle le réchauffement climatique et la création monétaire !
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
de l'amie Isabelle Stengers, via l'ami Stanislas Brown
« une forme d’« idéalisme »,
une incapacité inculquée de prendre au sérieux ce qui peut entraver, voire seulement compliquer,
la logique de marché devenue aujourd’hui la seule source légitime de réponse à nos questions.
Le virus n’a pas créé d’égalité, il a exacerbé les inégalités.
Au nom de sa menace, ce sont les vulnérables,
les encaqués, les précarisés, les racisés qui ont trinqué.»
Isabelle Stengers :
« La science est balbutiante face aux enchevêtrements du vivant »
une incapacité inculquée de prendre au sérieux ce qui peut entraver, voire seulement compliquer,
la logique de marché devenue aujourd’hui la seule source légitime de réponse à nos questions.
Le virus n’a pas créé d’égalité, il a exacerbé les inégalités.
Au nom de sa menace, ce sont les vulnérables,
les encaqués, les précarisés, les racisés qui ont trinqué.»
Isabelle Stengers :
« La science est balbutiante face aux enchevêtrements du vivant »
La philosophe considère, dans un entretien au « Monde », que la crise sanitaire a révélé l’incapacité du pouvoir politique et des « experts » à sortir de l’idéalisme de la croissance et à penser la réalité qui nous attend. Propos recueillis par Antoine Reverchon
Isabelle Stengers est professeure de philosophie des sciences, retraitée de l’Université libre de Bruxelles. Après avoir longtemps étudié la construction des discours et des concepts scientifiques et les relations entre sciences et pouvoirs (L’Invention des sciences modernes, La Découverte, 1993), elle analyse les risques que l’idéal scientifico-capitaliste fait courir au vivant (Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, La Découverte, 2008) et s’engage dans un combat intellectuel pour une refondation des rapports sociaux et biologiques (Réactiver le sens commun. Lecture de Whitehead en temps de débâcle, La Découverte, 208 pages, 18 euros) à partir de la pensée du mathématicien britannique Alfred North Whitehead (1861-1947).
Que nous montre le coup d’arrêt provoqué par le virus sur la fragilité du système global de croissance ?
Le premier trait de l’événement pandémique est le rapport étonnant qu’il établit entre le local et le global. Bien qu’il ait partie liée avec les désordres écologiques que provoque l’exploitation tous azimuts du vivant et de son milieu, cet événement a pour point de départ une affaire hyper-locale : un être, qui n’existe que pour cette éventualité rare, rencontre un hôte accueillant, avec lequel, grâce auquel, il pourra participer à l’aventure de la vie.
Une telle rencontre est parfaitement contingente, même si les virus ne cessent de muter, c’est-à-dire d’en augmenter la probabilité. Mais elle a ouvert à celui-ci un destin étonnant, bien différent de celui de ses cousins, qui participent de manière plus ou moins pacifique à la vie de chauve-souris ou de pangolins. Ce qui, pour le virus, est l’accomplissement de sa vocation première et dernière, a réussi à susciter ce qu’a été incapable de provoquer une menace qui, elle, est globale et prévisible : celle du désastre climatique dont les signes avant-coureurs se multiplient aujourd’hui. Certes, des catastrophes se succèdent désormais, imposant le fait qu’il y a « comme un problème », mais il semble entendu que celui-ci devra se résoudre dans le respect de l’impératif de croissance. Quoi que ce soit d’autre est inconcevable. La réussite virale a pourtant provoqué l’inconcevable.
Il y a un contraste assez sidérant entre le désordre climatique, explicable, implacable et indifférent à ses conséquences, et le virus, prince de l’opportunisme, qui n’existe que grâce aux conséquences qu’il provoque, mais sans les expliquer. Car le virus n’explique pas les effets de la rencontre, et encore moins l’« arrêt » sinon du monde, en tout cas de tout ce que ce monde fait circuler. C’est bien plutôt ce monde qui s’est bloqué à son épreuve. Panique générale, sauf en Afrique, où les épidémies, on connaît.
Gouvernements, experts et opinion n’ont-ils pas réaffirmé à cette occasion leur confiance dans la science ?
Nos responsables nous disent qu’ils ont été surpris, qu’ils n’étaient pas préparés à cela. Mais cela veut dire qu’ils n’avaient pas pu ou pas su entendre les experts, pour qui ce monde écologiquement dévasté, où tout circule dans tous les sens (sauf les migrants), verra se succéder des pandémies. De même qu’ils n’entendent pas l’avertissement selon lequel nos monocultures clonées sont hautement vulnérables à des infections épidémiques. Cette incapacité à entendre est une forme d’« idéalisme », une incapacité inculquée de prendre au sérieux ce qui peut entraver, voire seulement compliquer, la logique de marché devenue aujourd’hui la seule source légitime de réponse à nos questions.
L’idéaliste dit : « On sait bien, mais quand même. » Quand même, les masques et les médicaments sont bien meilleur marché en Chine. Quand même, le commerce à flux tendu est le plus efficace. Et lorsque les choses vont mal, l’idéaliste se tourne vers la science. Certes, en quelques mois, les scientifiques ont beaucoup appris du virus. Ils peuvent même, à partir de ses variations génétiques, suivre les trajets de l’épidémie. Mais lorsque des médecins-experts parlent de la science, on ne sait s’il faut rire ou pleurer. [à considérer leurs positions diamétralement opposées, j'avais conclu que "LA science" ne pouvait que se tromper au moins une fois]
Nos sciences sont balbutiantes face aux enchevêtrements des vivants. Ce que, au nom de la science, les médecins réclament, ce sont des guérisons qui se produisent pour de « bonnes raisons », sanctionnées par des données statistiques aveugles, mais parfois trafiquées par ceux qui savent profiter de tous les idéalismes, favoriser tous les aveuglements. Qu’importe, ils font de la « science » puisqu’ils savent que, comme le serinait Gaston Bachelard [1884-1962], « l’opinion a toujours tort ».
Avez-vous une vision optimiste ou pessimiste de cet épisode quant à notre capacité commune à être, comme vous l’avez écrit, « à la hauteur du monde tel qu’il se fait » ?
Nos gouvernants demandent aujourd’hui aux Français d’être fiers d’avoir gagné sinon « la guerre » contre le virus, du moins cette bataille. C’est du plus haut comique quand on pense aux contrôles policiers tatillons, à une soumission exigée, faisant des habitants des enfants qui profiteraient de la moindre faille. Tolérance zéro. Mais c’est aussi sinistre quand on pense à l’angoisse et au désespoir des vieux qui sont morts seuls, à la souffrance de leurs proches. Non, il n’y a pas eu de « capacité commune ». Le virus n’a pas créé d’égalité, il a exacerbé les inégalités. Au nom de sa menace, ce sont les vulnérables, les encaqués, les précarisés, les racisés qui ont trinqué.
Les seules capacités communes qui se soient portées à sa hauteur, outre celles des soignants, sont celles des collectifs qui se sont démenés pour aider, prendre soin, secourir. A cause d’eux, je ne me sens pas le droit d’être pessimiste, mais il serait stupide d’être optimiste, de faire confiance à ceux qui nous gouvernent. Même s’ils ont été ébranlés, ils seront vite ramenés sur le « juste chemin » d’une croissance qu’il faut d’abord et avant tout relancer.
De manière prévisible va résonner l’appel à l’unité pour cette cause commune, mais ce sera un échec. Il se heurtera au souvenir des mensonges dissimulant l’irresponsabilité foncière de ceux qui « savent », mais aussi à celui de la crise de 2008, où le renflouement des banques s’est payé par l’austérité frappant d’abord les plus pauvres alors que les violences policières se démultipliaient.
La perte de confiance en ceux qui nous gouvernent n’est pas un phénomène sociologique sur lequel disserter. Elle est fondée. Mais ce qu’elle pourra engendrer, personne ne le sait. Les différentes manières de diviser seront utilisées. Les alternatives infernales seront brandies – choisissez entre baisse de salaire ou licenciement. La peur du désordre sera activée.
Tout cela suffira-t-il à étouffer les pensées qui, peut-être, ont germé dans bien des cerveaux perplexes quant à l’avenir qui se prépare ? Nous vivons un moment d’incertitude radicale, mais l’affaire du Covid-19 nous aura avertis. Nous sommes gouvernés par des « idéalistes », incapables de penser avec ce qui, que nous le voulions ou non, nous attend.
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
The promise of harnessing market forces to combat climate change has been unsettled by low carbon prices, financial losses, and ongoing controversies in global carbon markets. And yet governments around the world remain committed to market-based solutions to bring down greenhouse gas emissions. This book discusses what went wrong with the marketisation of climate change and what this means for the future of action on climate change.
The book explores the co-production of capitalism and climate change by developing new understandings of relationships between the appropriation, commodification and capitalisation of nature. The book reveals contradictions in carbon markets for addressing climate change as a socio-ecological, economic and political crisis, and points towards more targeted and democratic policies to combat climate change. This book will appeal to students, researchers, policy makers and campaigners who are interested in climate change and climate policy, and the political economy of capitalism and the environment.
en relation
New enclosures of the carbon market,
Part I: Sub-Saharan ‘land-grabs’ as accumulation by dispossession
11th January 2012
Naomi Millnerby Naomi Millner, University of Bristol
New enclosures of the carbon market,
Part I: Sub-Saharan ‘land-grabs’ as accumulation by dispossession
11th January 2012
Naomi Millnerby Naomi Millner, University of Bristol
In late September 2011, news of another ‘land grabbing’ fiasco briefly hit the international headlines (Al Jazeera 2011; Lang 2011; Vidal 2011a; 2011b) before being added to the encyclopaedic archive of cases pursued by international advocates and activists across the last decade. This time, more than 20,000 farmers had been evicted from the Mubende and Kiboga districts of Uganda after a deal made by the Ugandan government with The New Forests Company, a ‘sustainable and socially responsible’ forestry company which is 20% owned by the HSBC bank. An Oxfam report released in September had evidenced that, despite the company’s insistence it had appropriately consulted all inhabitants of the land before their ‘voluntary’ departure, thousands of families had been forced from their long-term homes. Residents – who were called ‘illegal encroachers’ by the company and the Ugandan government – had lived on the land for up to 40 years as a result of inherited and bought tenancies, but were presented by armed police with only three months notice, and received no compensation (Grainger and Geary 2011). The former village school in Kiboga is now a Headquarters for the New Forests Company (Vidal 2011a), whilst the majority of the previous infrastructure – of village and government structures, local council systems, schools, health centres, churches, permanent homes and farms – has been destroyed. Nor is this an isolated case. Oxfam estimates that 227 million hectares of land – an area the size of north-west Europe – has been sold, leased or licensed in Sub-Saharan Africa since 2001, predominantly to international investors of secretive deals (Grainger and Geary 2011). Similar stories are also being told in Central Asia and Latin America (Alden Wily 2011).
Associated with new fears over food security, such large-scale land acquisitions are justified as a necessary securing of food production sites – especially as more land is given over to biofuel production (Li 2010). But in the Ugandan case the land acquired was to be used for ‘carbon-offsetting’. Its use was not directly linked with the issues of food scarcity and energy in Uganda itself – despite the fact that large areas of the country have been wasted across the last five years by flooding associated with climate change. Instead the plantation’s value is measured in terms of foreign investment into the country – an investment judged ‘ethical’ by international standards, as a reforestation project planned to balance carbon usage elsewhere. Of course, the 22,500 or so farmers who have lost their means to support themselves do not figure in this ‘ethical’ calculation – and Oxfam warns that, correspondingly, such projects are ironically likely to worsen, rather than mitigate, food security (Grainger and Geary 2011).
But what initially appears as a terribly dark quirk of global capitalism – that poor farmers are being forced from their land to pay off the global North’s bad conscience – turns out to be all rather logical. Harvey (2003) develops the term ‘accumulation by dispossession’ to explain how the appropriation and enclosure of common lands marks a continuation of the capitalist logic. For him, the privatisation and commodification of common assets like land and water are part of a further commercialisation of basic goods, which see the means of basic subsistence in the global South converted into commodities. Meanwhile, the manipulation of global crises by global actors, and the pressure of institutions like the World Bank and IMF forces already crippled national economies to place such goods on the international market (Li 2010). This issue is further amplified as investors seek new speculative outlets to match the flooding of the new market with capital, its devaluation, and a crisis of overaccumulation. And while some investors into land like the Mubende and Kigoga plantations might claim to have experience in agricultural production, others are only buying lands speculatively, anticipating price increases – a practice known as ‘land banking’ (Alden Wily 2011).
Geographers have recently used Harvey’s terminology to explain and disturb the way that carbon-offsetting in particular has provided a new rationale for international investments into foreign land, especially in the global South (Bond 2011; Bumpus and Liverman 2008; Lohman 2008). The need for radical adjustments in production and energy use have been finally acknowledged at an international level, as fossil fuels deplete, and the evidence of climate change becomes more difficult to deny. But the conversion of responsibilities for such changes into tradable ‘credits’ and ‘offsets’ has opened a whole new market for international investment. Rather than reducing emissions, offsetting means producing the equivalent reduction elsewhere – for example, by planting a lot of trees in another country, even if the land for this use is currently being used by thousands of farmers for subsistence living. The conversion of the climate issues into abstract, equivalent – and therefore tradable – units which apply to any time and place in practice results in the real cost being distributed unevenly – in the main, becoming displaced onto areas already affected by poverty and resource inequalities. Offsetting credits are portrayed as the production of a kind of a ‘commons’ – an investment in breathable air and fertile land which it is in everyone’s interest to protect. But the administration of this commons through financial markets results in new forms of enclosure, which in practice make a mockery of the common land and air which precede social life and markets. This is land parcelled up for foreign investors, for the benefit of governments and companies in the global North who would rather not acknowledge their own historical role in either climate change and dispossession.
Besides the emerging critical work in this area, creative imaginations and actions are also called for which reclaim the ‘commons’ as part of practices which don’t just pay lip-service to ideas of sustainability. The creative tactics developed by subsistence farmers to cope with resource crises in apparent ‘wastelands’ offer one important resource (Alden Wily 2011). The mobilisation of ‘climate justice’ terminology by global activists, especially in South America, offer another (Bond 2011). Here the rationale behind carbon credits is reversed, with imaginations for change which direct responsibility proportionally towards countries whose economies are built on environmental destruction and colonial appropriation. The new kinds of authority being established at such sites of experience and exchange are sites of the production of a commons which debunks the ‘common good’ marketed by carbon off-setting. Through such acts of taking and reappropriation we may insist that such a commons is not the only one – and it is certainly not a sustainable one.
Acknowledgement
I would like to acknowledge the input of Dr Mark Jackson to this post; Mark brought these news articles to my attention and raised many of the academic references cited in a highly stimulating conversation.
References
Al Jazeera (2011) Oxfam warns of ‘land grabs’ in Africa. 22 September http://english.aljazeera.net/video/africa/2011/09/2011922111515150690.html (last accessed 22 December 2011)
Alden Wily L (2011) The tragedy of public lands: Understanding the fate of the commons under global commercial pressure. International Land Coalition. http://www.landcoalition.org/publications/tragedy-public-lands-fate-commons-under-global-commercial-pressure (last accessed 22 December 2011)
Bond P (2011) Emissions trading, new enclosures and eco-social contestation. Antipode doi: 10.1111/j.1467-8330.2011.00890.x
Bridge G (2011) Resource geographies I: Making carbon economies, old and new. Progress in Human Geography 35(6):820-834
Bumpus A and Liverman D (2008) Accumulation by decarbonization and the governance of carbon offsets. Economic Geography 84(2):127-155
Glassman J (2006) Primitive accumulation, accumulation by dispossession, accumulation by ‘extra-economic’ means. Progress in Human Geography 30(5):608-625
Grainger M and Geary K (2011) The New Forests Company and its Uganda plantations. Oxfam Case Study 22 September https://oxfam.ca/sites/default/files/imce/case-study-new-forest-company-uganda-plantations-2011-09-22.pdf (last accessed 22 December 2011)
Harvey D (2003) The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press
Lang C (2011) Ugandan farmers kicked off their land for New Forests Company’s carbon project. 23 September http://www.redd-monitor.org/2011/09/23/ugandan-farmers-kicked-off-their-land-for-new-forests-companys-carbon-project/ (last accessed 22 December 2011)
Li T M (2010) To make live or let die? Rural dispossession and the protection of surplus populations. Antipode 41(s1):63-93
Lohmann L (2008) Carbon trading, climate justice and the production of ignorance: Ten examples. Development 51(3):359-365
McGroarty P (2011) Moves to snap up land in Africa draw scrutiny. Wall Street Journal 22 September http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904563904576584673419328758.html (last accessed 22 December 2011)
Vidal J (2011a) Ugandan farmer: ‘My land gave me everything. Now I’m one of the poorest.’ The Guardian 22 September http://www.guardian.co.uk/environment/2011/sep/22/uganda-farmer-land-gave-me-everything (last accessed 22 December 2011)
Vidal J (2011b) Oxfam warns of spiralling land grab in developing countries. The Guardian 22 September http://www.guardian.co.uk/environment/2011/sep/22/oxfam-land-grab-developing-countries (last accessed 22 December 2011)
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
une excellente étude qui expose une poétique avec laquelle je me sens en phase (on n'est pas loi d'Édouard Glissant, Maryse Condé et Toni Morrison). Nombre de références déjà croisées, une bibliographie comme je les aime : on est chez nous !
Cosmo-poétique du refuge
Dénètem Touam Bona, Terrestres, 15 janvier 2019
Dénètem Touam Bona, Terrestres, 15 janvier 2019
Ce texte a initialement été publié dans le numéro 12 de la revue Z, qui l’a aimablement mis à notre disposition. Il s’agit ici d’une version légèrement remaniée par l’auteur.
Le marronnage se déploie sur près de quatre siècles dans les Amériques et les archipels de l'océan Indien. A Haïti, le monde afro-diasporique s'est construit contre la propriété privée et la quête du profit. De la colonie à notre société de contrôle, la sécession marronne ne demande qu'à être réinventée.
« Nous sommes la semence de la Terre
La vie en perpétuel devenir. »
Octavia E. Butler, La Parabole du semeur

Extrait du roman graphique Angola Janga, de Marcelo D’Salete, Traduction de Dominique Nédellec, Editions ça et là. Marcelo D’Salete, auteur brésilien, a mené onze ans de recherches afin de raconter la “petite Angola”, le plus grand quilombos du Brésil, créé à la fin du XVIe siècle et détruit cent ans plus tard. Ce lieu de refuge pour esclaves marron.nes rassembla pendant des décennies jusqu’à 30 000 habitant.es.La vie en perpétuel devenir. »
Octavia E. Butler, La Parabole du semeur

« À São Tomé, les esclaves se révoltent, se réfugient dans les montagnes d’où ils opèrent de véritables raids sur les plantations quelques années après la mise en place de ce régime de culture1. ». Nous sommes en 1555, au large des côtes africaines, dans un des nombreux archipels portugais de l’océan Atlantique, lors d’une des premières insurrections marronnes d’envergure. Le marronnage sera désormais indissociable du système proto-industriel de la plantation dont l’île de Sao Tomé fut le principal laboratoire africain avant son transfert et son perfectionnement au Brésil. Tout comme l’esclavage colonial, le marronnage commence sur les terres africaines : il est d’emblée transatlantique. Mais c’est bien sûr dans les Amériques – devenues le cœur du système esclavagiste – que cette forme de vie et de résistance connaîtra son plus grand essor, jusqu’à devenir la matrice de véritables sociétés marronnes.
Le marronnage – le phénomène général de la fuite des esclaves – peut être occasionnel ou définitif, individuel ou collectif, discret ou violent ; il peut alimenter un banditisme (cow-boys noirs du Far West, cangaceiros du Brésil, pirates noirs des Caraïbes, etc.) ou accélérer une révolution (Haïti, Cuba) ; il peut recourir à l’anonymat des villes ou à l’ombre des forêts. Inutile donc de chercher une définition précise car, profondément polyphonique, la notion de « marronnage »2 renvoie à une multitude d’expériences sociales et politiques, se déployant sur près de quatre siècles, sur des territoires aussi vastes et variés que ceux des Amériques ou des archipels de l’océan Indien. L’essentiel est de comprendre que sur l’ensemble de ces territoires, la mémoire des neg mawons (Antilles francophones), des quilombolas (Brésil), des palenqueros (Amérique latine) continue à irriguer les luttes contemporaines à travers des pratiques culturelles (maloya, capoeira, cultes « afro-diasporiques », etc.) qui, parce qu’elles réactivent la vision des vaincu.es ‒ leur version de l’histoire et donc de la « réalité » ‒, subvertissent l’ordre dominant. Si, dans mon travail, je privilégie la « sécession marronne » ‒ et par « sécession » j’entends ici le retranchement sylvestre de subalternes, quels qu’ils soient, sous la forme de communautés furtives ‒, c’est parce que le marronnage y apparaît pleinement comme matrice de formes de vie inouïes.
Situées dans des zones tropicales, les plantations sont souvent entourées de bois denses et inextricables, de marais et mangroves labyrinthiques, de mornes (collines) escarpés à la végétation touffue, de caatingas [arbrisseaux épineux, ndlr] arides et agressives ; et toutes ces étendues hostiles – à la pénétration de la ci-vi-li-sa-tion – constituent autant d’espaces de disparition. La « Forêt » ‒ l’ensemble des lignes et éléments qui recouvrent l’homme d’un treillis végétal ‒ offre donc aux marrons un refuge, une citadelle, un lieu de vie privilégié.
La racine latine de « forêt », « foras » (« en dehors »), nous indique que les espaces sylvestres ont toujours constitué un « dehors » pour la « civilisation » : le dehors de la « sauvagerie »3 ‒ de la « zone de non-droit », dirait-on aujourd’hui. Si l’on veut riposter à l’offensive globalisée des conquistadores sans visage (les multinationales de l’extractivisme, de la marchandisation du vivant, etc.), il nous faut, sous la conduite des chamans, des n’ganga, des fundi madjini et autres maîtres de l’invisible, redécouvrir dans la forêt notre propre puissance : celle du vivant qui s’y manifeste, mais aussi de communautés et de peuples qui se dressent dans leurs replis forestiers (marrons et Amérindiens des Amériques, zapatistes, ZAD, « jungle » de Calais, etc.).
Extrait du roman graphique Angola Janga, de Marcelo D’Salete, Traduction de Dominique Nédellec, Editions ça et là
« BABYLON SYSTEM IS THE VAMPIRE »
« L’expression “pays en dehors”, par laquelle on désigne le monde rural haïtien, exprime une exclusion séculaire. Toute la paysannerie, la majorité de la population haïtienne, s’est organisée en poche de résistance face à un État vampire ; elle s’est donc organisée avec sa religion, sa culture, son mode de vie propre. […] La société est marronne car depuis sa constitution l’État haïtien incarne la nouvelle figure du maître. »4 Il serait bien trop long de revenir sur le détail et les enjeux de la Révolution haïtienne qui donne naissance en 1804 à la première république noire. Certes, elle est dans son principe anti-esclavagiste, mais la réalité est plus complexe car, dès le départ, les leaders officiels de cette insurrection ont tendance pour toute une série de raisons à reproduire le modèle qu’ils étaient censés abattre. La Révolution haïtienne ne renverse le système esclavagiste que pour inaugurer une république noire qui se comportera vis-à-vis de sa propre population comme un État colonial : les « grandons » (grands propriétaires terriens) et l’armée constitueront pour la masse des cultivateurs et cultivatrices « bossales » (« né.es en Afrique ») autant de forces d’occupation et d’exploitation. Il est nécessaire de préciser qu’au moment de la Révolution, les deux tiers de la population de l’île sont des « nègres bossales » perçu.es par les « libres de couleur » (les « créoles » nés sur place) comme des « sauvages africain.es ». Or la nouvelle élite créole qui prend les rênes du pouvoir, après l’indépendance, n’aspire qu’à reproduire la « civilisation », le mode de vie et de développement occidental.
Un des intérêts de cette territorialité paradoxale du « pays en dehors », c’est de rappeler que le marronnage est un type de résistance qui peut être activé et se penser au-delà même du contexte esclavagiste. La sécession marronne est la première forme d’anarchisme afro-diasporique : elle déjoue autant les prises du capital que celles de l’État.
« Le grand man (chef) ne possède à peu près aucun pouvoir temporel. (…) Pour tout ce qui concerne la vie matérielle, chacun a le droit absolu, on pourrait même dire le devoir, d’agir comme bon lui semble, dans la mesure où il ne lèse personne. (…) On ne pratiquait chez eux aucune forme de commerce, cette activité étant manifestement liée pour eux à l’idée d’exploitation d’autrui. »5 Africains de Guyane, Jean Hurault, éd. Mouton, 1970, p. 20-22. Comme le souligne Jean Hurault, les Bonis (un des peuples bushinengués de Guyane) ont mis au point une série de mécanismes prévenant l’accumulation du pouvoir et de la richesse. Il s’agit pour la communauté marronne de conjurer le risque de la formation en son sein d’un pouvoir séparée d’elle-même : la domination d’un appareil étatique6. L’expérience du marronnage a modelé l’ensemble de la culture bushinenguée, ce qui explique les interdits pesant traditionnellement sur le commerce ou l’emploi d’autrui (ce n’est plus le cas à présent) et le caractère sacré, comme dans le rastafarisme, de l’autonomie de la personne.
Quand en 1940, en Jamaïque, au sommet d’une montagne boisée, Leonard Percival Howell fonde la première communauté rastafarie qu’il baptise « le Pinnacle »7, il reprend en fait le geste des « maroons » (Noir.es marron.nes jamaïcain.es). À travers la recherche d’une autosuffisance alimentaire et la mise en commun des terres et des moyens de production, Howell rejoue la quête marronne d’un « dehors » de la société coloniale. « Babylon system is the vampire », nous rappelle Bob Marley. Dans la lecture marxiste, libertaire et panafricaniste de la Bible qu’opère le rastafarisme, Babylon figure tout système de prédation, d’exploitation, d’aliénation. L’esclavage colonial ne représentant qu’une des modalités du capitalisme et de l’État, Babylon se perpétue sous de nouvelles formes comme les multinationales, le consumérisme, le star-system, etc. Pourquoi cette référence au vampire ? Parce que ce que le vampire chasse, c’est l’homme. Or le système esclavagiste est un système de chasse à l’homme. Et le maître ‒ c’est-à-dire, selon Karl Marx, le « capital », dont le premier serviteur est l’État ‒ s’apparente au « vampire qui ne s’anime qu’en suçant le travail vivant, et sa vie est d’autant plus allègre qu’il en pompe davantage »8.
L’ORGANISATION RYTHMIQUE DU « COUMBITE » S’OPPOSE À TOUTES LES HIÉRARCHIES
Dans les mornes d’Haïti, c’est à travers le rythme que se transmet et se réinvente la tradition des sociétés de travail africaines, au fur et à mesure que les ancien.nes esclaves s’approprient des lopins de terre pour garantir une liberté conquise de haute lutte contre les troupes napoléoniennes, mais aussi, après la Révolution, contre les tentatives des nouvelles élites créoles de rétablir le régime disciplinaire des grandes plantations (instauration du travail forcé par le biais de lois criminalisant, comme en Occident, le « vagabondage »). Reprenant à leur compte les pratiques d’alliance développées au sein des communautés marronnes, ces groupements de paysans reposent sur des principes de réciprocité et d’égalité : on cultive la terre du prochain qui, à son tour, cultivera la vôtre. Le travail n’est pas payé mais échangé. Dans le cas de l’« escouade » haïtienne, huit cultivateurs travaillent ensemble toute l’année sur les terres respectives de chacun des membres ; chaque « compère » bénéficiant du travail de tous les autres un jour par semaine. C’est un système extrêmement égalitaire : celui qui commande l’escouade est le propriétaire du champ. La rotation des champs entraîne donc la rotation du « commandement ».
« ‒ Alignez ! criaient les chefs d’escouade.
Le Simidor [le maître tambour, ndlr] Antoine passait en travers de ses épaules la bandoulière du tambour. Bienaimé prenait sa place de commandement devant la rangée de ses hommes. Le Simidor préludait un bref battement, puis le rythme crépitait sous ses doigts. D’un élan unanime, ils levaient les houes haut en l’air. Un éclair de lumière en frappait le fer : ils brandissaient, une seconde, un arc de soleil.
La voix du Simidor montait rauque et forte :
‒ A tè…
D’un seul coup les houes s’abattaient avec un choc sourd, attaquant le pelage de la terre. (…) Les hommes avançaient en ligne. Ils sentaient dans leurs bras le chant d’Antoine, les pulsations précipitées du tambour comme un sang plus ardent. (…) Une circulation rythmique s’établissait entre le cœur battant du tambour et les mouvements des hommes : le rythme était comme un flux puissant qui les pénétrait jusqu’au profond de leurs artères et nourrissait leurs muscles d’une vigueur renouvelée. »
Gouverneurs de la rosée, Jacques Roumain, éd. Le Temps des cerises, 1944, p. 17-19.
En assurant la synchronie des gestes, la cadence régulière des efforts, l’alignement chorégraphique des corps, le rythme produit la communauté fraternelle des « compè » (« paysan.nes », « compères »). Cette tradition du travail dansé et chanté a pris dans le sud des États-Unis la forme des work songs, la matrice du blues. Travailler ensemble, c’est épouser une pulsation collective, vibrer à l’unisson, communier en un même chant. « Cette société refuse les structures sociales dès qu’elles peuvent déboucher sur des structures de pouvoir (…). Elle a trouvé dans le rythme l’outil idéal pour faire émerger des modes spontanés et immédiats d’organisation lui permettant de maîtriser aussi bien la production matérielle que le sacré. »9 Dans le monde rural haïtien, le rythme représente un principe d’organisation sociale à part entière qui, par le biais de pratiques telles que le coumbite (société de travail), s’oppose à toute hiérarchie.
Extrait du roman graphique Angola Janga, de Marcelo D’Salete, Traduction de Dominique Nédellec, Editions ça et là
LE VODOU, UNE ÉCOLOGIE POLITIQUE
Aujourd’hui, le puissant hululement du lambi (conque marine) ‒ ancien signal de ralliement des marron.nes – résonne encore parfois, d’une vallée à l’autre, sur les pentes abruptes des montagnes d’Haïti. Avec la rhapsodie des chants de travail, la palpitation des tambours, le martèlement des houes, il fait du monde paysan un paysage musical et mystique. La nuit venue, les sociétés de l’« avant-jour » (sociétés de travail) se transforment parfois en confréries vodoues ; au labeur diurne succède alors la transe nocturne. Des coumbites aux cérémonies mystiques, c’est une même rythmique qui se propage, et avec elle une même cosmovision afro-diasporique : une conception du monde qui s’oppose, point par point, aux valeurs du système capitaliste (propriété privée, quête du profit, etc.). La dispersion aléatoire de l’habitat, la mobilité extrême des cultivateurs, le rapport cosmique à la terre, toute une série d’éléments font de la culture paysanne haïtienne une formidable riposte au système de la plantation. Loin de se réduire à des pratiques de « magie noire » ou à des superstitions, le vodou met en oeuvre une spiritualité (j’ai enlevé « religion » qui n’est pas approprié vu l’absence de dogmes, la plasticité des rituels, etc.) et un rapport au monde singulier, la matrice d’une agriculture cosmique : hériter d’un champ, c’est en effet hériter des lwas (esprits vodous) qui l’habitent, les seuls vrais possesseurs de la terre. Le vodou constitue une écologie politique, car il institue un rapport d’alliance entre les communautés qui cultivent et le milieu de vie dont elles ont le devoir de prendre soin, par le dialogue avec les plantes et les éléments.
Passage optionnel pour étayer davantage l’idée d’une écologie intégrée aux cosmologies des peuples autochtones et communautés coutumières des Suds : L’institution du « lakou » ou « demanbré » est l’une des expressions les plus puissantes de l’écologie marronne d’Haïti : il s’agit d’une portion de terre familiale qu’on ne peut vendre, diviser, démembrer, transformer en propriété parce qu’elle est liée aux « lwa heritaj » – les ancêtres et divinités tutélaires de la famille. L’ancrage de la famille paysanne dans une territorialité ancestrale constitue, à Haïti, le plus puissant outil d’auto-défense 10 contre les processus d’enclosure, de privatisation, d’accaparement capitaliste des terres. L’écologie intégrée du vodou se manifeste également dans les luttes contemporaines de certains collectifs haïtiens visant à créer ou à réactiver des « forêts sacrées » : réarmer la « nature » en la réenchantant11…La nanm [âme, force cosmique, ndlr] des plantes est conçue de façon plus personnelle que celle des autres objets. Les “docteurs-feuilles” [guérisseurs, ndlr] profitent du moment où ils les croient engourdies par le sommeil pour s’en approcher et les cueillir tout doucement afin de ne pas effaroucher leur nanm. En les arrachant, ils murmurent : “Lève-toi, lève-toi, va guérir un malade. Je sais que tu dors, mais j’ai besoin de toi.” Ils ont soin de déposer au pied de la tige quelques sous qui représentent le salaire offert à l’âme pour l’effort qui lui sera demandé. (…) Le bûcheron qui s’apprête à abattre un arbre frappera le tronc du revers de sa hache afin d’avertir l’âme qui l’habite et lui donner le temps de s’en aller. (…) À côté de la “grande âme de la terre” (gâ nâm tè), chaque champ est animé par un esprit qui, agissant sur les plantes, en assure la fertilité. L’âme de la terre n’est pas immatérielle. Le cultivateur qui, en plein midi, travaille son champ peut sentir sa présence comme une brise sur son visage et voir son ombre se profiler derrière lui.
Le Vaudou haïtien, Alfred Métraux, éd. Gallimard, 1977, p. 137.
Dans Gouverneurs de la rosée, en 1944, l’écrivain communiste haïtien Jacques Roumain met en lumière la portée utopique des sociétés de travail haïtiennes dont il rêva, un temps, de généraliser le modèle politique et social à l’ensemble de son pays : « Nous [les paysans, ndlr] ne savons pas encore que nous sommes une force, une seule force (…). Un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d’un point à l’autre du pays et nous ferons l’assemblée générale des gouverneurs de la rosée, le grand coumbite des travailleurs de la terre pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. »12 Le « gouverneur de la rosée », c’est le « maître de l’arrosage » (« mèt lawouze »), celui qui est chargé dans la communauté paysanne de la distribution de l’eau et de la répartition entre les paysan.nes des travaux d’irrigation. Ce personnage incarne un idéal de justice, d’équité, de solidarité et de vie harmonieuse avec la nature. Parce qu’elle suppose une organisation autonome et égalitaire, à l’opposé du régime disciplinaire de la plantation, la rythmique mystique du coumbite aura contribué à la genèse d’une Haïti marronne : le « péyi an déyo » (« pays en dehors »).
LA LIBÉRATION DE L’ESCLAVE EXIGE SON « DÉ-CHAÎNEMENT »
Les « nègres » sont des « migrants nus », nous rappelle le penseur martiniquais Édouard Glissant : des hommes, des femmes, des enfants dénudés et réduits à la « vie nue » – strictement biologique – du ventre du bateau négrier. Pourtant, il semble que, dès l’embarquement, quelque chose d’inscrit dans les corps ait résisté à la mise à nu, au raturage de la mémoire, à la zombification, à toute cette sorcellerie esclavagiste qui s’acharne à transformer des humains en bétail de plantation. En effet, ce ne sont pas des corps nus que décrivent les documents de l’époque, mais des corps-hiéroglyphes, des corps parcourus de motifs indélébiles. Une description parmi d’autres : « Congo portant des marques du pays formant une croix sur chaque sein. » Ces scarifications sont les seules traces visibles que les déporté.es subsaharien.nes conservent de leur terre natale : une cartographie existentielle gravée à même la peau. Le corps scarifié est corps-mémoire : surface où se déploie l’écriture d’un peuple, le récit singulier d’une vie, la généalogie d’un clan. Dans les sillons, les crevasses, le relief accidenté de sa chair, le « nègre » trouvera toujours l’assurance de son humanité : d’où il vient et quelle est son histoire.
Mais à cette écriture à vif se juxtapose un marquage invisible, plus intime, opérant à la jonction de l’esprit et de la chair : le tatouage rythmique des corps afro-diasporiques. La mémoire du corps n’est pas statique, elle est motrice, dynamique, ne s’actualise que dans des gestes, des postures, dans toute une série de pratiques corporelles telles que la danse ou la musique. Les rythmes de l’Atlantique noir se confondent souvent avec la répétition même du mythe : son actualisation rituelle. Ce dont témoignent les cérémonies du candomblé, du vodou ou de la santeria où chaque « divinité a ses motifs joués par les tambours, répétés indéfiniment et qui constituent comme une sorte de leitmotiv wagnérien de cette mystique africaine » 13 Roger Bastide voit dans le rythme la source d’un véritable « mysticisme africain ». À cette mystique « afro » qui s’enracine dans les résonances du corps, il oppose la mystique chrétienne qui suppose, à l’inverse, l’extinction de ce dernier. À travers le tatouage rythmique de leurs corps, c’est donc toute une cosmovision que les migrant.es nu.es ont apportée avec eux dans la cale du négrier. Et les résistances noires se déploieront précisément à partir de la réactivation créatrice de cette mémoire, à partir de la pensée incarnée qu’est le rythme. La libération de l’esclave exige la réappropriation de son corps : son « dé-chaînement »…
Marcelo D’Salete / extrait du roman graphique “Angola Janga”
LES MÉTAMORPHOSES DE LA TRANSE
À l’origine, tout rythme est rythme d’une course : martèlement des pieds sur le sol, martèlement du cœur sous la poitrine, martèlement des mains sur la peau tendue. C’est d’abord au moyen du rythme que le « nègre » trace une ligne de fuite. Propulseur de rêves, le phrasé rythmique opère des distorsions à même les corps et l’espace-temps. Dans la transe, le possédé est le cheval des dieux. En terre d’esclavage, ce théâtre de l’invisible ne peut être que subversif : le temps d’une cérémonie, la condition d’esclave est suspendue, niée, renversée, « abolie ». Traversant le cycle des métamorphoses mystiques, le « nègre » passe ainsi de l’esclavage à l’épiphanie des dieux : « Le visage se métamorphose ; le corps tout entier devient le simulacre du dieu. »14 Or de quoi une divinité pourrait-elle avoir peur ? « Ce qu’ils firent en premier lieu, ce fut entrer dans les cœurs et les têtes de leurs fils, insufflant dans leurs gorges les cris de guerre de leurs ancêtres, les Ochossi les plus assourdissants, les Changô les plus irrésistibles, chacun ne ressentant ni peur ni douleur, tous combattant comme le vent qui fait ployer les herbes. »15 C’est ainsi que l’écrivain brésilien João Ubaldo Ribeiro décrit la montée en puissance des quilombolas, les marron.nes du Brésil.
La transe est une technique d’intensification des flux : le corps n’est plus collection d’organes mais onde vibratoire. La métamorphose advient à travers les pulsations rythmiques d’un érotisme sacré. Le corps possédé est corps carnavalesque, utopique, où s’opère la subversion de l’identité, de l’état civil, de la machine binaire des genres. Des métamorphoses de la transe aux transformations carnavalesques, on retrouve les mêmes phénomènes d’inversion des rôles, de renversement des hiérarchies, de parodie des conformismes et des pouvoirs. La transe implique d’emblée une « trans-sexualité », car les lwas chevauchent les ounsi (initiés) indépendamment de leur sexe 16.
Chevauchée par Ogun, le dieu yoruba de la guerre, la plus frêle des jeunes filles brandira en l’air une machette en guise d’épée, affectera un langage de soudard, réclamera haut et fort du rhum et courra après les jupons de l’assemblée. Monté par Erzulie Freda, l’équivalent vodou de Vénus, le plus athlétique des hommes se maquillera avec application, délaissera le pantalon au profit de la robe, et, balançant les hanches, jetant des œillades langoureuses, déambulera parmi les mâles en quête d’un baiser ou d’une caresse. Parce qu’ils transgressent quotidiennement l’ordre social hétéronormé « consacré » par l’Église (une des matrices de l’ordre colonial), parce que leur mode de vie même suppose déjà une sorte de métamorphose, travestis et homosexuels occupent une place privilégiée dans le vodou17.
LA SOCIÉTÉ SECRÈTE, L’ALLIANCE NOCTURNE DU MARRONNAGE ET DU VODOULa commission, informée que des rassemblements dangereux, connus sous le nom de Vaudou, continuent malgré les défenses qui avaient été faites par les autorités constituées ; Considérant que cette danse semble avoir pour but de rappeler des idées dangereuses sous un gouvernement républicain (…). La commission a arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1. Les rassemblements connus sous le nom de Danse du Vaudou sont sévèrement défendus.
Extrait du Bulletin officiel de Saint-Domingue (1797)18
C’est dans l’appel aux dieux de « Guinée » 19‒ mobilisation d’une mémoire africaine composite ‒ que les résistances populaires afro-américaines puisent leur fougue et leur puissance. Expérience spirituelle où le corps devient lieu d’initiation et de konesans, la transe fournit le modèle général du dé-chaînement de l’esclave. Le déclenchement des révoltes correspond toujours au déchaînement des puissances cosmiques. En témoigne l’événement fondateur de la Révolution haïtienne, « Bois-Caïman », la cérémonie vodoue où fut scellée dans le sang, en 1791, la conjuration des esclaves et des marron.nes insurgé.es. L’abolitionnisme des Jacobins noirs fut à la fois mouvement révolutionnaire et accomplissement de la Révolution française20 dans sa pleine radicalité ; et cela bien avant le décret d’abolition de Victor Schoelcher (1848) dont la célébration tend à exclure les afro-descendant.es de leur propre libération.
Ce qui distingue radicalement la Révolution haïtienne des Révolutions française et américaine, c’est précisément la façon dont elle est travaillée en profondeur par une spiritualité politique afro-diasporique. À la fin du XVIIIe siècle, c’est au cours des réunions nocturnes des « calendas » et « vaudous » que se diffuse la subversion, que s’organisent des réseaux de dissident.es, que se nouent des solidarités et des engagements secrets. Le marronnage est précisément le secret comme « sécrétion », comme forme de vie, comme mode opératoire. Il commence dans le recours à la nuit quand, profitant de l’ombre, les esclaves s’esquivent des « habitations » (plantations et cases) pour communier dans des danses, des prières, des serments cachés. Les familles mystiques (les initié.es des cultes afrodescendants sont considéré.es comme des fils et filles des dieux) qui naissent à l’occasion de ces réunions nocturnes constituent autant de microcosmes clandestins : des sociétés parallèles qui, subrepticement, ne cessent de travailler, d’infiltrer, de subvertir l’ordre esclavagiste. Quelle que soit la forme de dissidence envisagée, le secret y joue toujours un rôle créateur et dynamique : pratique du secret (mots de passe, chiffrements, itinéraires chantés, etc.), expérience du secret (souvent une expérience du sacré, le secret constituant un savoir interdit), communauté du secret (celle des conjuré.es que le secret lie). Dans le contexte esclavagiste, cultes et sociétés secrètes constituent des formes privilégiées de résistance populaire ; elles servent en effet de ciment unificateur aux esclaves et marron.nes. « Les sociétés secrètes ont constitué à travers l’histoire d’Haïti une expression de la résistance populaire face à la tyrannie et au désordre de l’État. Apparues durant la période coloniale, resurgissant au début du XIXe siècle (…), elles continuaient l’esprit du marronnage et s’inscrivaient dans l’imaginaire du vodou. »21 C’est dans la société secrète que se perçoit le mieux, à Haïti, l’alliance nocturne du marronnage et du vodou.
Extrait du roman graphique Angola Janga, de Marcelo D’Salete, Traduction de Dominique Nédellec, Editions ça et là
LA DISSIDENCE PROCÈDE TOUJOURS D’UNE RUPTURE DU CONTINUUM TEMPOREL
Des confréries secrètes vodoues aux bandes marronnes furtives, c’est un même mode mineur d’« exi-stance », une même stance poétique, une même puissance opaque qui se déploie : la nuit, on complote, on danse, on rêve, on prie, on écrit, on débat, on sacrifie. À l’image des afro-descendant.es, des artisan.nes et prolétaires d’Europe ont eux aussi recouru à l’opacité de la nuit et au chiffrement des chuchotis : « La Société des fondeurs de fer, créée en 1810, se serait réunie durant les nuits noires, sur les sommets, les landes et les friches des régions montagneuses des Midlands. (…) Les prestations de serment et les cérémonies d’initiation destinées à frapper les esprits étaient probablement assez répandues. »22 La dissidence procède toujours d’une rupture du continuum temporel. Rupture du récit des vainqueurs – cette fable qui rend les subalternes hideux à leurs propres yeux –, mais aussi rupture de la succession aliénante du travail et du repos, comme l’explique Jacques Rancière dans son essai consacré à la genèse du mouvement ouvrier : « Tout commence à la tombée de la nuit quand, dans les années 1830, un certain nombre de prolétaires décident de briser le cercle qui place le sommeil réparateur entre les jours du salaire. »23
L’histoire des révoltes amérindiennes présente des similitudes avec celle des révoltes afro-américaines. Dans les sociétés autochtones, la conquête espagnole provoqua un traumatisme collectif inouï : la mort des dieux, la chute et la brisure du Soleil (un « effondrement » qui préfigure celui du monde globalisé contemporain). Aussi, les grandes révoltes amérindiennes débutaient-elles toujours par la résurrection des divinités et l’abjuration de la foi chrétienne. C’est ainsi qu’en 1541 éclate dans le nord du Mexique, sur les terres des nomades chichimèques, une des plus terribles rébellions indigènes qu’ait connues l’Empire espagnol : la « guerre de Mixton ». Elle avait pour leaders des sorciers « sauvages » qui « annonçaient la venue de “Tlatol”, accompagné de tous les ancêtres ressuscités »24. De la même façon, c’est en ressuscitant Ogun, Changô, Legba et en composant de nouvelles divinités que les afro-descendant.es donnèrent un esprit à leurs combats. La ligne de fuite du marron se conjugue avec la ligne d’« au-delà » du sorcier : un au-delà du visible qui est aussi un au-delà de la réalité coloniale, une projection d’un monde à la fois passé et à venir, ce qu’Édouard Glissant appelle une « vision prophétique du passé » : « À l’intérieur de cette contestation globale qu’est le marronnage, le quimboiseur [devin-guérisseur, ndlr] est en quelque sorte l’idéologue, le prêtre, l’inspiré. C’est en principe le dépositaire d’une grande idée, celle du maintien de l’Afrique, et, par voie de conséquence, d’un grand espoir, celui du retour à l’Afrique. »25
LE CONTINUUM DES RÉSISTANCES
« L’idéalisation de l’esclave révolté, voire révolutionnaire, tendait à privilégier le combat des hommes aux dépens de celui des femmes et à sous-estimer les formes de lutte et de résistance moins manifestes grâce auxquelles l’immense majorité des esclaves avaient survécu et une minorité d’entre eux, dont de nombreuses femmes, s’étaient libérés. (…) La résistance discrète ou “subtile” était plus efficace à long terme que la révolte violente, laquelle, à quelques exceptions près, conduisait irrémédiablement à la répression massive, sanglante et exemplaire. »26 Aussi, pour dépasser le syndrome de Spartacus ‒ cette manie de voir dans l’esclave mâle rebelle le modèle ultime du combat contre l’esclavage ‒, nous faut-il concevoir les résistances afro-descendantes comme un continuum qui va du ralentissement du travail à la sécession marronne, en passant par les révoltes à mains nues et les suicides sur les bateaux négriers. Il n’y a donc pas à opposer des « nègres.ses » qui seraient resté.es docilement sur les plantations à d’autres, les « nègres.ses marron.nes », qui auraient été héroïques. À moins d’exclure, par exemple, les résistances « subtiles » développées par les femmes noires : la richesse des modes de transmission de la mémoire, la maîtrise de la pharmacopée et des cosmologies associées27, le pouvoir d’influence et de nuisance de la « Cocotte » (la favorite) sur le maître, l’infanticide en tant que geste d’amour paradoxal (magnifiquement dépeint dans l’incandescent Beloved de Toni Morrisson28), etc. Pour comprendre comment il trace une ligne de fuite depuis le « dedans » même du système esclavagiste, le marronnage doit être pensé comme un processus continuel de libération. En effet, c’est par le biais de pratiques culturelles telles que les communions mystiques et festives des macumbas [équivalent brésilien du vodou, ndlr], les joutes verbales des veillées de contes, les variations créatrices des parlers créoles et des negro speeches que les esclaves conquièrent des espaces de liberté au sein même de la plantation. La communauté marronne n’est que l’aboutissement ultime de ces processus de subjectivation, de ces arts de soi au moyen desquels – par l’improvisation, la variation continue des rythmes, du phrasé corporel et vocal – l’esclavagisé.e échappe à la néantisation propre à la condition d’esclave, et advient à l’être, c’est-à-dire redevient, pour lui-même et les autres, sujets d’actions et de créations.
Extrait du roman graphique Angola Janga, de Marcelo D’Salete, Traduction de Dominique Nédellec, Editions ça et là
LES NEG MAWONS, L’ART DE LA MÉTAMORPHOSE ET DE LA DISSOLUTION DE SOI
À la rupture du continuum temporel, à travers le breakbeat des rythmes afro-diasporiques, correspond une diffraction de l’espace en une multitudes de spatialités inédites (espace-temps du culte, du conte, de la danse martiale, etc.). Mais avec la sécession marronne le combat contre le système esclavagiste entre dans une phase stratégique29 qui déplace et pérennise le théâtre des opérations. Forme collective de la fugue, la « sécession » est résistance « territoriale » : elle fait corps avec un territoire labyrinthique dont les méandres et accidents constituent autant d’alliés naturels pour les rebelles. Le Marron ne fuit pas, il s’esquive, se dérobe, s’évanouit ; et à travers son repli, il se métamorphose et se crée un « dehors » : le Quilombo, le Palenque, le Mocambo, le « péyi an déyo »…
Mais comment ce qui au départ n’est qu’une fuite (même si elle est collective) – un recul face à l’adversité – peut-il donc devenir une forme de lutte remarquable ? La « fuite » des esclaves n’apparaît comme une lâcheté, comme un phénomène passif que si l’on a une conception réductrice de la résistance, que si l’on confond résistance et affrontement, que si l’on en reste à une vision virile et héroïque du combat. De même que la bataille n’est qu’une modalité particulière de la guerre, le face-à-face n’est qu’une modalité particulière de la résistance. La guérilla – la tactique privilégiée des nomades, des marron.nes, de toutes les bandes et minorités en rupture de ban – se présente ainsi comme une « non-bataille » où la ruse, la tromperie, le travestissement, le camouflage, les fuites et attaques surprises se rient de la morale des puissant.es.
À la fin du XIXe siècle, dans le sertão30brésilien, une insurrection millénariste débouche sur la création de Canudos, la « Troie de torchis ». Cette expérience spirituelle et politique s’inscrit dans la continuité des quilombolas dont elle reprend les tactiques de guérilla : « La nature tout entière protège le sertanejo. Elle le taille comme Antée – indomptable. (…) Les caatingas sont un allié fidèle du sertanejo révolté. (…) Elles s’arment pour le combat ; elles agressent. Alors qu’elles s’entrelacent pour l’étranger et se font impénétrables, elles s’ouvrent en de multiples sentiers pour le matuto [le « broussard », ndlr] qui naquit et grandit dans la région. (…) Les soldats s’éparpillent, courent au hasard, dans un labyrinthe de branches. Ils tombent, pris dans les nœuds coulants des quipas [cactées] rampants ; ou s’arrêtent, les jambes immobilisées par des tentacules de fer. »31 Dans Hautes terres, Euclides da Cunha peint avec maestria cette « tactique étourdissante de la fuite » qui modela des formes de vie furtives, ainsi que les paysages torsadés et confus dans lesquels ces dernières s’enchâssaient. Se fondre dans la nature, une des tactiques de base de L’Art de la guerre (Sun Tzu), c’est en épouser le cycle des mutations. Les neg mawons sont des nègres et négresses ninjas qui maîtrisent parfaitement cet art de la métamorphose et de la dissolution de soi. Par leurs gestes et mouvements virtuoses, par leur dislocation rythmique, leurs corps s’épurent, s’effacent, se virtualisent dans le suspens d’une blue note indocile. À l’instar des marron.nes, les insurgé.es de Canudos font corps avec le territoire déployé dans leur repli.
« Cet établissement était très fort ; un marais étendu l’environnait de toutes parts et en formait une île. On ne pouvait y arriver que par des sentiers couverts d’eau, connus seulement des rebelles. »32 Qu’elle épouse la rectitude d’une ligne géométrique ou le serpentement d’une rivière, qu’elle soit fixe ou mouvante, qu’elle ait la matérialité d’une muraille ou la spiritualité d’un relais de forces invisibles (esprits et ancêtres protecteurs séjournant dans les pierres, les animaux, les rivières), une frontière opère l’inscription spatiale d’une collectivité humaine dans un territoire donné. Parce qu’elle instaure et délimite un territoire, une hétérotopie qui court-circuite l’ordre esclavagiste, la sécession marronne produit nécessairement des frontières. Mais celles-ci ne se maintiennent que dans leur propre effacement. La frontière marronne doit en effet marquer, coder le territoire de la communauté sans laisser de traces « visibles », sans laisser prise au repérage de l’appareil de capture colonial. Voilà pourquoi le système défensif des communautés marronnes se présente d’emblée comme un système de camouflage. La sécession marronne est paradoxale car, loin d’inaugurer la naissance officielle d’un nouvel État, elle consacre l’entrée en clandestinité d’une communauté d’indociles. Il s’agit non seulement de combattre l’État esclavagiste mais d’en conjurer le principe même. Que le maître ne puisse jamais faire retour au sein de la société marronne.
LE « DEHORS » EST EN COURS D’ABOLITION
MÉMENTO
Contempler des images de la Terre illuminée la nuit
Observer les synapses phosphorescentes qui s’agitent à sa surface
Et nous enveloppent à notre insu
Comprendre que nous vivons sous un dôme invisible
Faire le deuil de la transgression en tant que geste ultime et héroïque de résistance
Faire le deuil de la pleine lumière virile de l’affrontement
La visibilité est un piège (Foucault)
Cultiver l’ombre des forêts
Prolonger la brume des marais
Ruisseler le long des lignes de faille des cirques et montagnes acérés
Le « dehors » est en cours d’abolition
« Là, tu as le grillage et les barbelés, je coupe, je coupe et j’entre. Le scanner se lève pour contrôler le camion. Je regarde s’il y a la police. J’ouvre le camion, je grimpe dedans. Si personne me voit et qu’il n’y a pas de chien, c’est bon. C’est lui le dernier contrôle, le chien. Si le chien ne sent pas mon odeur, je pars pour l’Angleterre. » 33 C’est ainsi qu’un jeune réfugié éthiopien décrit ses tentatives pour embarquer dans un ferry, depuis Calais. Le nègre marron et le molosse forment un couple indissociable, autant dans l’imaginaire que dans la réalité des sociétés esclavagistes. À l’ère de la cybernétique, le flair et les crocs du limier ont pris les traits d’une frontière mobile et réticulaire34 qui ne se confond plus avec les limites territoriales de l’État-nation. Les frontières sont devenues « smart » (« intelligentes »), de véritables microprocesseurs qui ne cessent de déborder les bordures des nations, de proliférer au sein même de leur dedans au point de transformer en checkpoint le moindre point d’accès à un lieu public ou privé, et en suspect tout élément humain composant un flux. Pour séparer le bon grain de l’ivraie, on a fini par étendre à l’ensemble des humains des procédés dont ne relevaient jusqu’ici que les bipèdes « clandestins » : l’enregistrement des empreintes, l’inquisition biométrique, la détection des « personnes à risque ».
La « smart border »35 est devenue un élément central du système de prédation capitaliste et de la nouvelle gouvernementalité algorithmique : elle joue un rôle essentiel dans la production, par toute une série de dispositifs (un appareil juridique, des institutions transnationales comme Frontex, des camps et centres d’internement, etc.), d’une humanité corvéable et jetable à volonté, sous la figure du « migrant », objet désormais d’une chasse à l’homme perpétuelle le maintenant hors du droit, dans une condition d’apatride et de paria proche de celle de l’esclave. Les reportages consacrés aux marchés d’esclaves en Libye recouvrent du voile du sensationnel ce qui, loin d’être une exception, est devenu la norme : la déshumanisation des « infiltrés »36 à travers des procédures de triage. En décembre 2013, la désinfection au karcher de migrants nus sur l’île de Lampedusa avait suscité des réactions indignées dans les médias internationaux : cela ne pouvait manquer d’évoquer le fonctionnement des camps de concentration nazis. Que le monde ne voie plus rien de sacré dans la nudité d’un être humain (Hannah Arendt), voilà le scandale à la source de tous les autres : les trafics d’organes, l’enfermement d’enfants en centres de rétention (séparés parfois des parents), l’expulsion de réfugiés vers des pays aux régimes autocratiques où ils risquent torture et exécution, etc.
« Le pouvoir spatial de la société de contrôle ne se caractérise plus par l’opposition entre un dedans et un dehors, mais par une gestion différentielle de la perméabilité des lieux. Dès lors, le geste de la transgression n’a plus aucun sens politique. (…) Il n’y a plus de dehors à viser, sortir d’une bulle c’est entrer dans une autre », analyse avec pertinence le philosophe Olivier Razac37. Avec l’abolition en cours du droit d’asile à l’échelle internationale et l’accélération de la sixième extinction de masse des espèces vivantes, c’est la possibilité même du refuge qui, désormais, se dérobe à nous. Quête et production d’un « dehors » de la société esclavagiste, le marronnage ne demande qu’à être réinventé, car il met en œuvre l’utopie en acte du « refuge » dans un monde régi par la chasse à l’homme et le pillage du vivant, duquel nous ne sommes toujours pas sorti.es. La sécession marronne relève donc d’une « cosmo-poétique » (des grecs « kosmos », le « monde » dans la beauté de son ordonnancement, et « poiêsis », la « production » d’une œuvre) : elle est « production d’un monde », création d’un « dehors » qui aura valeur de refuge et d’utopie concrète pour tous ceux et celles resté.es en captivité. Les quilombos représentent en effet « un constant appel, un stimulant, un étendard pour les esclaves noirs » 38.
Il faut insister sur ce fait : le refuge ne préexiste pas à la fugue qui le produit, le « sécrète » et le « chiffre ». L’art de la fugue, dont l’expérience historique du marronnage ne représente qu’une des modalités, est « sub-version » d’un « dedans » (que ce soit la colonie ou notre société de contrôle), aussi fermé et sans issue puisse-t-il nous paraître. La fugue n’est pas transgression illusoire vers un dehors transcendant, mais sécrétion d’une version souterraine ‒ clandestine et hérétique – de la réalité. Car fuguer, ce n’est pas être mis en fuite, c’est au contraire faire fuir le réel, y opérer des variations sans fin pour déjouer toute saisie. Un texte de 2016 contre le projet d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, à Bure, dans le département français de la Meuse, enjoint justement à jouer au caméléon, à brouiller les procédures d’identification et de profilage : « Une stratégie de résistance générale et collective peut consister à se rendre indiscernables. (…) Les tactiques et les rôles que nous jouons doivent (…) se transformer au gré des circonstances, des rapports de force (…). Émeutier d’un champ un jour, citoyen légaliste qui demande des comptes le lendemain, danseur fou le surlendemain. »39 Usant de subterfuges, le fugueur se produit comme simulacre, se fait transfuges…
En ces temps sombres où prolifèrent les dispositifs de contrôle, les résistances se doivent d’être furtives plutôt que frontales. Attaquer en terrain découvert, c’est offrir une prise aux multiples pouvoirs qui nous assujettissent et s’exposer à être capturé, discrédité, criminalisé. Il s’agit de résister en mode mineur, car être majeur, mature, responsable, c’est forcément se rendre quand la police, les services secrets, les agences de sécurité nous convoquent pour répondre de nos vies furtives.
Le marronnage relève donc moins de la conquête du pouvoir que de la soustraction à ce dernier. Les tactiques « furtives » sont des tactiques de dé-prise : elles opposent le vide à toute prise. C’est cette puissance corrosive du marronnage vis-à-vis des appareils de capture et des simulacres qu’ils produisent que j’appelle « fugue ». Et par ce mot, j’entends une forme de vie et de résistance qui, loin du face-à-face lumineux de la révolte héroïque, opère dans l’ombre un retrait, une dissolution de soi continuelle. La fugue est ascèse :art paradoxal de la défaite – un « dé-faire » qui s’applique autant aux instances de domination qu’à leur réverbération au plus profond de nous.
Quel sens aurait une vie marronne aujourd’hui ?… Celui, je crois, d’une vie buissonnière qui ne cesserait de se dérober à l’amour du pouvoir et au devenir-fasciste 40 qu’il implique.
Notes
1. ↟ De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, Yann Moulier Boutang, éd. PUF, 1998, p. 133.
2. ↟ Le terme français « marronnage », centré sur l’individu qui fuit – le « nègre marron » –, ne peut rendre compte de la dimension territoriale de ce type de résistance. À la différence des toponymes « quilombo » et « palenque ».
3. ↟ La racine latine de « sauvage », « silva », signifie « forêt ». Le sauvage est d’abord un homme de la forêt.
4. ↟ Citation de Gary Victor interviewé par Détètem Touam Bona, dans « “Écrire” Haïti… », Africultures, 24/05/2004 (africultures.com).
5. ↟ Africains de Guyane, Jean Hurault, éd. Mouton, 1970, p. 20-22.
6. ↟ La Société contre l’État, Pierre Clastres, éd. De Minuit, 1974
7. ↟ Cf. Le Pinnacle, le paradis perdu des Rastas, Hélène Lee, éd. Afromundi, 2018.
8. ↟ Le Capital, Karl Marx, 1867
9. ↟ Créoles ‒ Bossales. Conflit en Haïti, Gérard Barthélemy, éd. Ibis Rouge, 2000, p. 156.
10. ↟ Au-delà des corps subalternes, on peut étendre les tactiques d’auto-défense qu’analyse Elsa Dorlin, dans Se défendre, aux territoires de résistance institués par les pratiques populaires d’enchantement : cultes, rites agraires, etc.
11. ↟ Cf. Le savant et le politique où Max Weber définit la modernité comme un processus de « désenchantement du monde » : une rationalisation techno-scientifique de la nature.
12. ↟ Gouverneurs de la rosée, op. cit., p. 72.
13. ↟ Images du Nordeste mystique en noir et blanc, Roger Bastide, éd. Actes Sud-Babel, 1995, p. 53.
14. ↟ Le Candomblé de Bahia, Roger Bastide, éd. Plon, 2001, p. 220.
15. ↟ Vive le peuple brésilien, João Ubaldo Ribeiro, éd. Le Serpent à plumes, 1999, p. 381.
16. ↟ La remise en question de la naturalisation du dualisme des genres, des rôles sexuels ne se limite pas au temps de la cérémonie. Ces pratiques spirituelles ne sont pas structurées autour d’un ordre moral.
17. ↟ Voir l’excellent documentaire Des hommes et des dieux, Anne Lescot et Laurence Magloire, prod. Collectif 2004 Images (52 min.).
18. ↟ Les Marrons de la liberté, Jean Fouchard, éd. Henri Deschamps, 1988, p. 360.
19. ↟ Un des termes génériques qui désignent l’Afrique en tant que terre des ancêtres, rapport fantasmé à une origine perdue, comme « Angola » ou « Congo ».
20. ↟ Voir L’Armée indigène. La défaite de Napoléon en Haïti, de l’historien canadien Jean-Pierre Le Glaunec, éd. Lux, 2014.
21. ↟ Misère, religion et politique en Haïti. Diabolisation et mal politique, André Corten, éd. Karthala, 2001, p. 62.
22. ↟ La Formation de la classe ouvrière anglaise, Edward P. Thompson, éd. Gallimard-Seuil, 1988, p. 459.
23. ↟ La Nuit des prolétaires, Jacques Rancière, éd. Fayard, 1997, quatrième de couverture.
24. ↟ La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole (1530-1570), Nathan Wachtel, éd. Gallimard, 1999, p. 279.
25. ↟ Le Discours antillais, Édouard Glissant, éd. Gallimard, 1997, p. 181.
26. ↟ Plus jamais esclaves ! De l’insoumission à la révolte, le grand récit d’une émancipation (1492-1838), Aline Helg, éd. La Découverte, 2016, p. 23.
27. ↟ Moi, Tituba sorcière…, Maryse Condé, éd. Gallimard, 1988, ou Rosalie l’infâme, Évelyne Trouillot, Dapper, 2003
28. ↟ Beloved, Toni Morrison, éd. Babelio, 2004 (trad. de l’américain, première parution 1987
29. ↟ Je reprends ici la distinction établie par Michel de Certeau entre « stratégie » qui suppose un lieu propre (un territoire) d’où conduire des actions, et « tactiques » qui renvoie à des actions, des usages, des ruses qui ne peuvent s’appuyer sur aucun lieu, si ce n’est le corps lui-même. Cf. L’invention du quotidien, M. de Certeau.
30. ↟ Du portugais signifiant « arrière-pays » ou « fin fond », le sertão désigne une région du Nordeste brésilien caractérisée par un climat aride et une végétation composée de cactées et broussailles épineuses.
31. ↟ Euclides da Cunha couvrira cette épopée en tant que correspondant de guerre, de novembre 1896 à l’écrasement de la révolte en octobre 1897. Une année entière, sous la conduite du chef mystique Antônio Conselheiro (« le Conseiller »), les Sertanejos ‒ des paysans pauvres, d’anciens esclaves, des Amérindiens, des déserteurs, avec leurs familles ‒ vont défier l’« ordre et le progrès » (devise) de la jeune République brésilienne, et lui imposer de lourdes pertes militaires. Hautes terres. La guerre de Canudos, Euclides da Cunha, trad. Jorge Coli et Antoine Seel, Métailié, 1997.
32. ↟ Capitaine au Suriname. Une campagne de cinq ans contre les nègres révoltés, John Gabriel Stedman, Sylvie Messinger, 1989 (trad. de l’anglais, première parution 1799), p. 62.
33. ↟ L’Héroïque Lande. La frontière brûle, film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, prod. Shellac, 2018 (3 h 40). Fresque poétique et politique consacrée à la Jungle de Calais.
34. ↟ Un archipel de checkpoints de plus en plus interconnectés, par le biais notamment de bases de données mutualisées entre États, agences de sécurité, transporteurs, etc.
35. ↟ Il s’agit d’anticiper l’événement. Dans le domaine des politiques migratoires : stopper le migrant dans son pays même (visa, traitement des données des transporteurs, externalisation des frontières de l’Union européenne, etc.).
36. ↟ Terme israélien désignant à l’origine les Palestiniens travaillant en Israël après 1948, étendu depuis aux réfugiés africains.
37. ↟ « Utopies banales », Olivier Razac, sur son blog Une philosophie plébéienne, 29/08/2013 (philoplebe.lautre.net).
38. ↟ La Commune des Palmares, Benjamin Péret, éd. Syllepse, 1999 (original en 1956), p. 75. Le poète surréaliste y compare le quilombo de la zone des Palmares (dans le Nordeste brésilien) – qui, au XVIIe siècle, tint en échec pendant près de soixante-dix ans les expéditions militaires hollandaises et portugaises – à des expériences libertaires comme celle de la Commune de Paris.
39. ↟ « La Meuse : ses vaches, ses éoliennes, ses flics », anonyme, sur le site Plus Bure sera leur chute…, 8/08/2016 (vmc.camp).
40. ↟ cf. « Introduction à la vie non-fasciste », Foucault, in Dits et écrits T3, Gallimard.
Invité- Invité
 Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Re: ÉCOLOGIE, SOCIO-ANTHROPOLOGIE, TEXTES et LIVRES UTILES, sciences, politiques, critiques...
Anthropologie de la nature,
leçon inaugurale de Philippe Descola
France Culture, 13 janvier 2020/ 29 janvier 2021
Comment l’anthropologie peut-elle s’affranchir d’une approche qui sépare la nature et l’homme en Occident? "Notre singularité par rapport au reste des existants est relative, tout comme est relative aussi la conscience que les hommes s’en font", rappelle Philippe Descola dans sa leçon inaugurale.

Petroglyphes achuars en Equateur, en 1991.
Crédits : Photo by François ANCELLET/Gamma-Rapho via Getty Images - Getty
Que peut être l' « anthropologie de la nature », s’interroge l’anthropologue, Philippe Descola.
Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature de 2000 à 2019, directeur d'études à l’EHESS, normalien, philosophe de formation, Philippe Descola a mené une enquête ethnographique de 1976 à 1979 chez les Jivaros Achuar de l’Amazonie équatorienne, dont il a étudié plus particulièrement les relations à l’environnement, sujet de la thèse de doctorat d’ethnologie qu’il a soutenu en 1983 sous la direction de Claude Lévi-Strauss.
Alors que son enseignement vient de s’achever au Collège de France et avant de retrouver son ultime série de cours, cette semaine, "Qu'est-ce que comparer?", nous vous proposons d’écouter aujourd’hui sa leçon inaugurale, intitulée "anthropologie de la nature".
Philippe Descola explique :
"L’anthropologie n’a cessé de se confronter au problème des rapports de continuité et de discontinuité entre la nature et la culture, un problème dont on a souvent dit qu’il constituait le terrain d’élection de cette forme originale de connaissance (…) En apparence, note-t-il, l’anthropologie de la nature est une sorte d’oxymore puisque, depuis plusieurs siècles en Occident, la nature se caractérise par l’absence de l’homme, et l’homme par ce qu’il a su surmonter de naturel en lui".
Invitant à dépasser cette « antinomie » qui lui paraît « suggestive » et cette aporie de la pensée moderne,
"Il est temps, proclame-t-il, que l’anthropologie jette sur le monde un regard plus émancipé, nettoyé d’un voile dualiste que le mouvement des sciences de la nature et de la vie a rendu en partie désuet et qui fut à l’origine de maintes distorsions pernicieuses dans l’appréhension des peuples dont les usages différaient par trop des nôtres".
Dans une stimulante interview, donnée en 2019 pour le site indépendant "Le Vent se lève" (série de Pierre Gilbert, "Les Armes de la transition"), Philippe Descola, revenant sur son parcours et sur son choix de s'intéresser à ce qu'il appelait "l'environnement" dès les années 1970, explique pourquoi il a cherché à "décentrer l’approche anthropologique, en y faisant mieux apparaître le rôle des non-humains – dans un premier temps, des plantes, des animaux, des esprits... " et à "déplacer le regard par rapport à l’eurocentrisme très caractéristique de l’approche des sciences sociales en général".
Dans sa leçon inaugurale, c'est bien ce projet de refonte de sa discipline, l'anthropologie, et ce refus de l'anthropocentrisme qui est défendu :
"L’analyse des interactions entre les habitants du monde ne peut plus se cantonner aux seules institutions régissant la société des hommes, ce club de producteurs de normes, de signes et de richesses où les non-humains ne sont admis qu’à titre d’accessoires pittoresques pour décorer le grand théâtre dont les détenteurs du langage monopolisent la scène. Bien des sociétés dites « primitives » nous invitent à un tel dépassement, elles qui n’ont jamais songé que les frontières de l’humanité s’arrêtaient aux portes de l’espèce humaine, elles qui n’hésitent pas à inviter dans le concert de leur vie sociale les plus modestes plantes, les plus insignifiants des animaux. L’anthropologie est donc confrontée à un défi formidable : soit disparaître avec une forme épuisée d’anthropocentrisme, soit se métamorphoser en repensant son domaine et ses outils de manière à inclure dans son objet bien plus que l’anthropos, toute cette collectivité des existants liée à lui et longtemps reléguée dans une fonction d’entourage. C’est en ce sens, volontiers militant nous le concédons, que l’on peut parler d’une anthropologie de la nature."
Nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France, le 29 mars 2001, pour la leçon inaugurale de Philippe Descola.
Il a récemment publié Une écologie des relations aux éditions du CNRS et sa monographie La nature domestique : symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuar fait l'objet d'une nouvelle publication aux Editions de la Maison des sciences de l'homme (MSH).
Nous rappelons aussi son ouvrage majeur Par-delà nature et culture publié en 2005 chez Gallimard
Invité- Invité
 Sujets similaires
Sujets similaires» II. CRITIQUE DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE, complément à la Critique de l'économie politique
» musique, sons de la nature, et société (acoustique, anthropologie et ethnologie de la musique, études, livres)
» DÉCISIONS ÉCONOMIQUES et POLITIQUES (coronavirus et suites)
» ÉCOLOGIE, ÉTAT, CAPITALISME VERT (et coronavirus)
» L'ÉCOLOGIE COMME SCIENCE des interactions dans le vivant
» musique, sons de la nature, et société (acoustique, anthropologie et ethnologie de la musique, études, livres)
» DÉCISIONS ÉCONOMIQUES et POLITIQUES (coronavirus et suites)
» ÉCOLOGIE, ÉTAT, CAPITALISME VERT (et coronavirus)
» L'ÉCOLOGIE COMME SCIENCE des interactions dans le vivant
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum










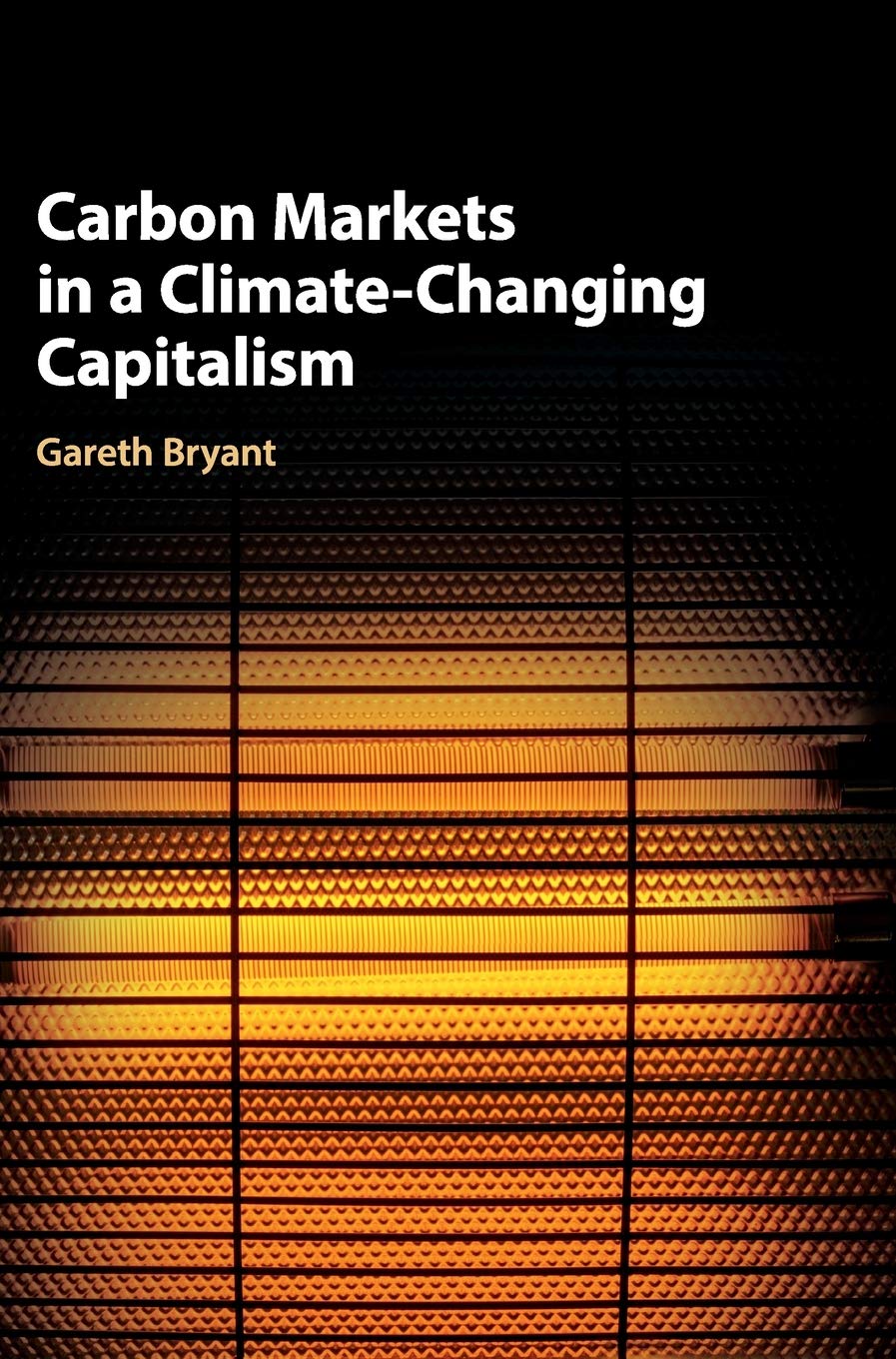





» BIEN CREUSÉ, VIEUX TOP ! Histoires d'une mare
» IRONÈMES, poésie minimaliste, depuis 2018
» MATIÈRES À PENSER
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» I 2. TECHNIQUES et MUSIQUES pour guitares 6, 7 et 8 cordes, IMPRO etc.
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» PETITES HISTWEETOIRES IMPRÉVISÉES
» HOMONÈMES, du même au pas pareil
» LA PAROLE EST À LA DÉFONCE
» KARL MARX : BONNES FEUILLES... BONNES LECTURES ?
» IV. COMBINATOIRE et PERMUTATIONS (tous instruments)
» CLOWNS et CLONES des ARRIÈRE- et AVANT-GARDES
» VI. À LA RECHERCHE DU SON PERDU, ingrédients
» CAMATTE ET MOI
» III. LA BASSE et LES BASSES À LA GUITARE 8 CORDES
» L'ACHRONIQUE À CÔTÉ
» LA CRISE QUI VIENT
» MUSIQUE et RAPPORTS SOCIAUX
» PETITE PHILOSOPHIE PAR LA GUITARE à l'usage de toutes générations, classes, races, sexes...