L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Page 1 sur 1
 L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
qui oserait prétendre que le propre de l'homme est de détruire les autres espèces jusqu'à se détruire lui-même ? C'est aussi malheureusement une réalité. On peut toujours constater que les 44 ans évoqués par l'article ci-dessous correspondent à la restructuration mondiale du capital chère aux théoriciens de la communisation, ça nous fait une belle jambe, et ne nous dit pas la part active qu'y auront prises les autres classes que celle dominante. M'est avis qu'elles furent au moins complices, et qu'en tant que telles ne sont pas prêtes à en sortir. Le fait est que cela correspond aussi, depuis les années 70, au doublement de la population humaine
Mammifères, oiseaux, poissons... sous la pression de l'homme, la Terre a vu sa population de vertébrés sauvages décliner de 60% entre 1970 et 2014, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF). Le rapport

Carte du monde montrant la répartition des menaces potentielles pour la biodiversité des sols.
Tous les ensembles de données ont été harmonisés sur une échelle de 0 à 1 et additionnés,
les scores totaux étant classés en cinq catégories de risque (de très faible, en vert à très élevé en rouge)
 WWF
WWF

Déforestation en Amazonie en 2007 pour développer l'agriculture. (cc) Matt Zimmerman
quoi qu'il en soit, cela n'a pas commencé avec le capitalisme. Exemple
La déforestation du «Sahara vert» par des tribus d’éleveurs à l’ère du néolithique aurait contribué à transformer en désert la région riche en végétation…

Phénomène climatique très rare, de la neige tombe sur la ville de Ain Sefra (Algérie) dans le désert du Sahara, le 21 janvier 2017. Photography/Shutterstoc/SIPA
le plus gros "choc" en cours n'est pas entre civilisation mais entre la civilisation capitaliste et le vivant, dernier stade de l'expansion humaine sur la terre
La planète a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans
BFMTV 30 octobre 2018
La région Caraïbes-Amérique du Sud est particulièrement touchée avec 89% d'espèces en moins en 44 ans. BFMTV 30 octobre 2018
Mammifères, oiseaux, poissons... sous la pression de l'homme, la Terre a vu sa population de vertébrés sauvages décliner de 60% entre 1970 et 2014, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF). Le rapport

Carte du monde montrant la répartition des menaces potentielles pour la biodiversité des sols.
Tous les ensembles de données ont été harmonisés sur une échelle de 0 à 1 et additionnés,
les scores totaux étant classés en cinq catégories de risque (de très faible, en vert à très élevé en rouge)
 WWF
WWFLe déclin de la faune concerne tout le globe, avec des régions particulièrement affectées, comme les Tropiques, selon le 12e rapport "Planète vivante", publié mardi avec la Société zoologique de Londres et basé sur le suivi de 16.700 populations (4000 espèces). Le dixième rapport faisait déjà état de -52% entre 1970 et 2010.
-89% dans les Caraïbes
La zone Caraïbes et Amérique du sud affiche un bilan "effrayant" : -89% en 44 ans. Amérique du nord et Groënland s'en sortent un peu mieux, avec une faune à -23%. La vaste zone Europe, Afrique du nord et Moyen-Orient est à -31%.
Explication première, la perte des habitats, avec l'agriculture intensive, l'extraction minière, l'urbanisation, qui poussent à la déforestation, à l'épuisement ou à l'artificialisation des sols. Au Brésil, qui vient d'élire un président dont le programme n'évoque ni la déforestation ni le réchauffement, la forêt amazonienne rétrécit toujours plus, comme la savane du Cerrado, au profit du soja et de l'élevage bovin.
Mondialement, seuls 25% des sols sont exempts de l'empreinte de l'homme; en 2050 ce ne sera plus que 10%, selon les scientifiques de l'IPBES (le "Giec de la biodiversité"). S'ajoutent à cela surpêche, braconnage, pollutions, espèces invasives, maladies, dérèglement climatique...
"Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis"
"La disparition du capital naturel est un problème éthique, elle a aussi des conséquences sur notre développement, nos emplois, et on commence à le voir", souligne le DG du WWF France Pascal Canfin. "On pêche moins qu'il y a 20 ans car le stock diminue. Le rendement de certaines cultures commence à baisser; en France celui du blé stagne depuis les années 2000," dit-il: "Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis".
Les "services rendus par la nature" (eau, pollinisation, stabilité des sols, etc) ont été estimés par des économistes à 125.000 milliards de dollars annuels, soit une fois et demi le PIB mondial. Chaque année, le "jour du dépassement" avance, ce jour à partir duquel le monde a consommé toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. En 2018 c'était le 1er août.
Et pourtant "l'avenir des espèces semble ne pas retenir suffisamment l'attention des dirigeants", s'alarme le WWF pour qui il faut "relever le niveau d'alerte", provoquer un vaste mouvement comme ce fut le cas pour le climat. "Que tout le monde comprenne que le statu quo n'est pas une option".
Un combat d'autant plus gratifiant que les efforts peuvent payer vite, comme l'a montré le retour du tigre au Népal, du thon rouge de l'Atlantique ou du saumon de la Loire...
"Un moment décisif dans l'histoire"
"Nous sommes la première génération à avoir une vision claire de la valeur de la nature et de notre impact sur elle. Nous pourrions aussi être la dernière à pouvoir inverser la tendance", prévient le WWF, qui appelle à agir d'ici 2020, "un moment décisif dans l'histoire".
Cette année-là les Etats seront appelés à renforcer leurs engagements pour réduire les gaz à effet de serre, et aussi à s'accorder pour protéger la nature lors d'une conférence spéciale à Pékin - avec pour objectif "zéro perte nette de biodiversité en 2030", souhaite le WWF.
"Nous devons passer urgemment à une société neutre en CO2, renverser la perte de nature - via la finance verte, les énergies propres, une autre production agroalimentaire - restaurer suffisamment de sols et d'océan", liste Marco Lambertini. "Peu de personnes ont eu la chance de participer à de vraies transformations historiques. C'est notre chance".

Déforestation en Amazonie en 2007 pour développer l'agriculture. (cc) Matt Zimmerman
quoi qu'il en soit, cela n'a pas commencé avec le capitalisme. Exemple
Sahara : Et si l'homme avait causé sa désertification ?
20 Minutes 16/03/17
20 Minutes 16/03/17
La déforestation du «Sahara vert» par des tribus d’éleveurs à l’ère du néolithique aurait contribué à transformer en désert la région riche en végétation…

Phénomène climatique très rare, de la neige tombe sur la ville de Ain Sefra (Algérie) dans le désert du Sahara, le 21 janvier 2017. Photography/Shutterstoc/SIPA
L’homme pourrait être à l’origine de la désertification du Sahara, qui était il y a 10.000 ans une zone pluvieuse et riche en végétation. La fin de la période qualifiée de « Sahara vert » pourrait être la conséquence du développement des tribus d’éleveurs.
Ce serait le premier exemple de changement climatique provoqué par l’homme, selon une étude publiée par des chercheurs américains et suédois 18 janvier dernier dans Science Advances.
Civilisations humaines
Grâce à l’analyse de sédiments marins, les spécialistes ont déterminé la pluviométrie de la région ces 25.000 dernières années. L’Homo Sapiens avait quitté le Sahara il y a 8.000 ans, alors que celui-ci était encore pluvieux mais connaissait déjà un léger assèchement.
Selon David Wright, archéologue à l’université nationale de Séoul (Corée du Sud), cette modification serait due à des civilisations installées initialement dans la vallée du Nil avant de s’étendre vers l’ouest.
L’élevage en cause
Ces nouveaux habitants auraient brûlé la végétation et procédé à la déforestation de nombreuses zones pour l’élevage, avance le scientifique dans une étude publiée le 26 janvier dernier dans Frontiers in Earth Science.
La réflexion de la lumière du soleil au sol aurait été modifiée, bouleversant au passage la circulation atmosphérique et limitant l’intensité de la mousson, rapporte L’Obs. Une situation qui aurait finalement contribué à la désertification du Sahara.
La région africaine ne serait pas la seule victime de l’influence humaine. « En Asie de l’est, il y a des théories bien établies sur la manière dont les populations néolithiques ont changé le paysage de manière si profonde que les moussons ont cessé de pénétrer loin dans les terres », note ainsi David Wright.
le plus gros "choc" en cours n'est pas entre civilisation mais entre la civilisation capitaliste et le vivant, dernier stade de l'expansion humaine sur la terre
Dernière édition par Patlotch le Sam 17 Nov - 14:54, édité 1 fois
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
anthropocène vs capitalocène...
en lien avec LE MONDE BRÛLE-T-IL ? CAPITALISME et CHANGEMENT CLIMATIQUE
un débat s'est instauré dans la communauté scientifique et au-delà sur la caractérisation de notre époque dans la périodisation en ères de l'histoire de la planète terre, avec la définition d'une nouvelle ère baptisée anthropocène et pour certains d'une ère ou sous-ère depuis celle du capitalisme, le capitalocène. Voir sur Internet anthropocène / capitalocène
France Culture diffuse à une conférence d'une heure enregistrée en avril 2018 : Anthropocène : quand l'histoire humaine rencontre celle de la Terre...
Dresser l'inventaire écologique d'un modèle de développement devenu insoutenable, qui ébranle bien des idées reçues sur notre prétendue "prise de conscience environnementale" et ouvre des pistes pour vivre et agir politiquement dans l'Anthropocène.
Crédits : Ahmed Areef / EyeEm - Getty
Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque : l’Anthropocène. Ce qui nous arrive n’est pas une crise environnementale, c’est une révolution géologique d’origine humaine. Depuis la révolution industrielle, notre planète a basculé vers un état inédit. Les traces de notre âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire resteront des milliers voire des millions d’années dans les archives géologiques de la planète et soumettront les sociétés humaines à des difficultés considérables. Faisant dialoguer science et histoire, cette conférence vise à donner une réponse historique à une question simple : comment en sommes-nous arrivés là ? Un monde fini ?
Jean-Baptiste Fressoz, historien au CNRS et professeur au King’s College de Londres, auteur notamment de L’Apocalypse joyeuse et de L'événement anthropocène : la Terre, l'histoire et nous.
j'ai soutenu ailleurs qu'il n'y avait pas de "société industrielle" sans capitalisme, et que ladite révolution industrielle ne peut se comprendre sans le mode de production capitaliste, et que l'on ne peut sortir de l'une sans sortir de l'autre. Autrement dit pas de solution par la décroissance*, ni capitalisme vert.
* voir cette critique de Véloce : La réaction verte
cela posé il devient clair que toutes les conceptions marxistes concernant le contenu de la révolution et le "communisme" comme monde post-capitaliste sont restées en deçà de ce qui apparaît aujourd'hui nécessaire pour accomplir ce changement de civilisation. C'est la raison de l'intérêt que j'ai porté à Jacques Camatte dans sa critique du concept marxiste, et même marxien, de révolution, a fortiori de révolution accomplie par le seul prolétariat. Voir LE CONCEPT DE RÉVOLUTION et CAMATTE et NOUS
la réduction de la problématique à une définition d'une ère capitalocène pourrait s'inscrire dans une sous-estimation du problème quand elle glisse vers la théorie de la communisation. Cf l'entretien par ailleurs très intéressant avec Armel Campagne L’écologie peut-elle se passer d’une critique du capitalisme ?, Grozeille 20 janvier 2018
parmi ces apories, la critique écologiste, dont je vois mal comment elle pourrait être intégré au structuralisme prolétarien de la théorie de la communisationLe scénario qui me parle le plus en ce moment, mais qui n’est pas forcément le plus crédible, est celui de la communisation, c’est-à-dire celui d’une crise violente du capitalisme, une contradiction capital-travail qui arrive à un tel point que les logiques capitalistes ne fonctionneront plus et les gens seront obligés d’inventer de nouveaux rapports sociaux. C’est une vue qui a l’avantage de ne pas être programmatique, dans le sens où ce n’est pas « on va construire une conscience de classe, un parti, etc. », mais d’un autre côté ça peut paraître attentiste, et ça semble supposer que les gens vont créer d’eux-mêmes le communisme sans y avoir réfléchi. La théorie de la communisation souffre donc, en apparence du moins, d’un certain nombre d’apories.
je reviendra avec des commentaires après l'écoute de cette émission
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
reçu de Adé ce matin, avec sa traduction. Je le retiens ici pour cette affirmation en sous-titre :

« La contradiction de l'époque se situe entre la survie de l'humanité et de son écosystème
ou la subsistance du régime capitaliste dans son ère (auto)destructrice. »
Nación Mapuche / Chile. Para ejercer la soberanía de los pueblos, todos/as se manifiestan este 15 de noviembre
Pour exercer la souveraineté des peuples, toutes et tous manifestent ce 15 novembre.
Por Andrés Figueroa Cornejo, Kaosenlared, 15 de noviembre
La contradicción de la época se ubica entre la sobrevivencia de la humanidad y su ecosistema versus la subsistencia del régimen capitalista en su era (auto)destructiva.

ou la subsistance du régime capitaliste dans son ère (auto)destructrice. »
Nación Mapuche / Chile. Para ejercer la soberanía de los pueblos, todos/as se manifiestan este 15 de noviembre
Pour exercer la souveraineté des peuples, toutes et tous manifestent ce 15 novembre.
Por Andrés Figueroa Cornejo, Kaosenlared, 15 de noviembre
La contradicción de la época se ubica entre la sobrevivencia de la humanidad y su ecosistema versus la subsistencia del régimen capitalista en su era (auto)destructiva.

Tanto organizaciones mapuche, como chilenas; tanto indígenas en resistencia, como mestizos en lucha, han resuelto reunir el grano, agrupar la primavera y concentrar la voluntad contra los efectos criminales del régimen capitalista en el territorio del Pueblo Nación Mapuche y en las zonas de sacrificio que destruyen humanidad y naturaleza.
Des organisations aussi bien mapuche que chiliennes; tant indigènes en résistance que métis en lutte se sont résolues à rassembler le grain , à regrouper le printemps et à concentrer la volonté contre les effets criminels du régime capitaliste sur le territoire du Peuple Nation Mapuche et dans les espaces sacrifiés qui détruisent humanité et nature.
[Como se argumentó en otras notas], es el desenvolvimiento real de la recomposición del movimiento popular en los pueblos que coexisten en territorio chileno, o sea, es el proceso genuino de lucha concreta lo que conjuntará paulatinamente las resistencias sociales frente a la crisis de acumulación, reproducción y los intentos desesperados de la mantención de la tasa de ganancia de los monopolios corporativos. En Chile y en el Wallmapu, la forma que adquiere la destrucción de comunidades y biodiversidad, se llama industria extractiva, sea forestal, hidroeléctrica, pesquera, agroexportadora, minera.
[...] c'est le déroulement réel de la recomposition du mouvement populaire au sein des peuples coexistants sur la territoire chilien, c'est-à-dire le processus particulier de la lutte concrète qui fera lentement converger les résistances sociales face à la crise d'accumulation, reproduction et tentatives désespérées de maintien du taux de profit par les monopoles corporatifs. Au Chili, et au Wallmapu la forme que prend la destruction des communautés et de la biodiversité est l'industrie extractive, soit forestière, hydroélectrique, pêcheries, agro-exportatrices, minières.
En lo contingente, en lo que cambia rápidamente, el ambientalismo consecuente se dio cita este 15 de noviembre en en todo Chile (en Santiago, en la Plaza Italia a las 19.00 horas), para solidarizar activamente con las comunidades de Quintero-Puchuncaví que sufren los estragos tóxicos y mortales del cordón industrial de esa zona, que ya cobró la vida del dirigente de los pescadores Alejandro Castro, cuya muerte aún no está esclarecida, pero las sospechas caen como plomo sobre los intereses de las grandes empresas contaminantes del territorio.
Dans la contingence, dans ce qui change rapidement,les environnementalistes conséquents, se sont donnés rendez-vous dans tout le Chili (à Santiago, Plaza Italia à 19h.) en solidarité active avec les communautés de Quintero-Puchuncavi qui souffrent des effets toxiques et mortels de cette zone industrielle, qui a déjà pris la vie du dirigeant des pêcheurs, Alejandro Castro, dans des circonstances non encore élucidées, mais les soupçons tombent comme plomb sur les intérêts des grandes entreprises polluantes du territoire.
Sin embargo, el 14 de noviembre, y esta vez se trata de la resistencia estructural, orgánica, ancestral del Pueblo Nación Mapuche, fue asesinado por el Comando Jungla de carabineros, el joven comunero Camilo Catrillanca, mientras otros permanecen heridos de gravedad. La infamia gatilló inmediatamente una convocatoria, también en todo Chile, contra la militarización fascista del Wallmapu en resistencia, para el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora, al menos en la capital chilena.
Cependant, le 14 novembre, et cette fois c'est de la résistance structurelle, organique, ancestrale du Peuple Mapuche qu'il s'agit, le jeune comunero Camilo Catrillanca fut assassiné par le Comando Jungla des carabiniers, alors que d'autres personnes ont été gravement blessées. L'acte infâme a tout de suite déclenché une convocation, aussi partout au Chili contre la militarisation fasciste du Wallmapu en résistance, les mêmes jours et heures et au mêmes lieux, au moins dans la capitale chilienne.
¿Se niegan ambas luchas? No. Por el contrario, ambos movimientos resolvieron conjuntarse y confundirse virtuosamente contra el enemigo común: el régimen capitalista en su forma extractivista, determinada por la situación de Chile en la división internacional del capital y del trabajo como economía primario exportadora. Esto es, vendedora de materias primas, parte esencial de la composición orgánica del capital (tecnología, materias primas, fuerza de trabajo, o trabajo muerto y trabajo vivo).
Les deux luttes s'excluent-elles ? Non. Au contraire les deux mouvements se sont conjoints et confondus de manière virtuose contre l'ennemi commun: le régime capitaliste dans sa forme extractiviste, déterminée par la situation du Chili dans la division internationale du capital et du travail en tant qu'économie primaire exportatrice. C'est-à-dire, vendeur de matières premières, part essentielle dans la composition organique du capital ( technologie, matières premières, force de travail, ou travail mort et travail vivant).
La administración gubernamental de ultraderecha en el país andino es otro accidente, en una época signada por el derrumbe de las democracias representativas y liberales, y la franca y abierta dictadura de los monopolios empresariales. Hay quienes aún hablan de oligopolios, pero lo cierto es que, en medio de una competencia intercapitalista frenética y voraz, la tasa de ganancia y, en consecuencia, los precios de la mercancía (que no su valor) son impuestos unilateralmente mediante las colusiones, como por la propia competencia. Aquellos capitalistas que no soportan la competencia, simplemente deben aliarse o fundirse en ella, o perecer. Y los monopolios tutelares en la actual fase, se encuentran en el momento financiero (venta de dinero con interés, o sea, deuda) de la formación capitalista, en las principales bolsas del planeta. Allí caen, sobreviven o dominan los monopolios corporativos centrales del mundo.
L'administration gouvernementale d'ultra-droite dans le pays andin est un autre accident, dans une époque marquée par la ruine des démocraties représentatives libérales, et par la dictature franche et ouverte des monopoles capitalistes. Certains parlent encore d'oligopoles, mais qui est certain, c'est qu'au milieu d'une concurrence inter-capitaliste frénétique et vorace, le taux de profit, et conséquemment les prix de la marchandise (mais non sa valeur) est imposé unilatéralement par des collusions, ou par la concurrence elle-même. Ces capitalistes qui ne supportent pas la concurrence doivent s'allier, se fondre en elle, ou périr. Et les monopoles tutélaires dans la phase actuelle se trouvent dans le moment financier (vente d'argent avec intérêt, c'est-à-dire dette) de la formation capitaliste dans les principales bourses du monde. C'est là que chutent, survivent, ou dominent les monopoles corporatifs centraux du monde.
En gran parte del globo, los monopolios empresariales, cada vez más concentrados (y esto no tiene que ver con “los más ricos”, sino que con los cada vez menos dueños de las materias primas (el suelo), la tecnología (el conocimiento técnico súper especializado) y la fuerza de trabajo), objetiva y positivamente desde la crisis de los 70 del siglo pasado, ya no pueden tolerar en sus regímenes políticos aparentemente “democráticos” ni siquiera reformas. ¿Por qué? Porque debido al propio desarrollo de las fuerzas productivas que ha copado los mercados a escala mundial, se ha llegado a un punto en que les resulta imposible obtener las mismas utilidades que obtenían antes.
Dans une grande partie du globe, les monopoles capitalistiques, toujours plus concentrés (et ceci n'a rien à voir avec "les plus riches", mais tout à voir avec ceux qui sont de plus en plus dépossédés des matières premières- le sol-, la technologie - savoir technique très spécialisé - et la force de travail), objectivement et positivement depuis la crise des années 70 du siècle passé, ne peuvent tolérer dans leurs régimes apparemment "démocratique" ne serait-ce que des réformes. Pourquoi? Parce que à cause du développement des forces productives qui a touché les marchés au niveau mondial, on est arrivé au point où il leur est devenu impossible d'obtenir les mêmes bénéfices qu'auparavant.
En fin. La contradicción de la época se ubica entre la sobrevivencia de la humanidad y su ecosistema versus la subsistencia del régimen capitalista en su era (auto)destructiva.
Enfin, la contradiction de l'époque se situe entre survivance de l'humanité et de son écosystème ou subsistance du capitalisme dans son ère (auto)destructrice.
Este 15 de noviembre, aunque aún se trate de una minoría activa, se inaugura en Chile lo que ya se venía, pero no terminaba de verse: la lucha explícita por el ecosocialismo, movimiento que conjunta el antifascismo, el anticapitalismo, el antiimperialismo, el feminismo de lucha, el ambientalismo consecuente, la resistencia mapuche, la crítica práctica contra el desarrollismo consumista y la exigencia de socializar todos los aspectos de la vida.
Ce 15 novembre,, bien que s'agissant d'une minorité active, s'inaugure au Chili ce qui venait mais qu'on ne voyait pas venir: la lutte explicite pour l'écosocialisme, mouvement qui réunit l'antifascisme, l'anticapitalisme, l'anti-impérialisme, le féminisme de lutte, l'environnementalisme conséquent, la résistance mapuche, la critique pratique du développementisme consumériste et l'exigence de socialiser tout les aspects de la vie.
La misión es multiplicar por abajo y por las que se consideran clases medias el movimiento arriba caracterizado. Ahí está la voluntad reunida de la lucha de clases, la imaginación popular, las pistas del proyecto emancipador y la promesa de la libertad plena. Ya no desde sujetos sociales “integrados” en la institucionalidad, sino que “integrales” en el combate multidimensional por la liberación de las y los oprimidos, y cuya condición material es la igualdad social, que no tiene nada que ver con el igualitarismo.
La mission est de multiplier vers le bas et vers ceux et celles se considérant comme classe moyenne le mouvement ici caractérisé. Là se trouve la volonté réunie de luttes de classes, l'imagination populaire, les pistes du projet émancipateur et la promesse d'une liberté pleine. Non plus depuis des sujets sociaux "intégrés" dans l'institutionnalité, mais "intègres" dans le combat multidimensionnel en vue de la libération de toutes et tous les opprimés, et dont la condition matérielle est l'égalité sociale, qui n'a rien à voir avec l'égalitarisme.
La Historia, en desarrollo.
L'Histoire, en développement
https://kaosenlared.net/nacion-mapuche-chile-para-ejercer-la-soberania-de-los-pueblos-todos-as-se-manifiestan-este-15-de-noviembre/
https://kaosenlared.net/nacion-mapuche-registros-audiovisuales-del-asesinado-comunero-camilo-catrillanca-no-habra-noche-que-nos-detenga/
https://kaosenlared.net/nacion-mapuche-diversas-manifestaciones-y-acciones-de-sabotaje-se-han-realizado-en-diversos-punto-tras-el-asesinato-del-comunero-camilo-catrillanca/
https://kaosenlared.net/nacion-mapuche-machi-celestino-cordova-inicia-nueva-huelga-de-hambre-por-justicia-para-camilo-catrillanca/
https://kaosenlared.net/nacion-mapuche-machi-celestino-cordova-inicia-nueva-huelga-de-hambre-por-justicia-para-camilo-catrillanca/
https://kaosenlared.net/chile-la-propiedad-por-sobre-la-vida-el-infalible-argumento-de-chadwick-para-justificar-la-muerte-de-catrillanca/
https://kaosenlared.net/chile-asi-se-vivieron-las-jornadas-de-protestas-contra-zonas-de-sacrificio-y-asesinato-de-catrillanca-en-distintos-puntos-del-pais/
Liens en rapport avec ces manifestations, plusieurs avec photos.

 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
je m'aperçois que j'avais créé un sujet plus approprié que LE MONDE BRÛLE-T-IL ? CAPITALISME et CHANGEMENT CLIMATIQUE pour placer ce débat sur la contradiction entre le capital et le vivant, qui ne relève qu'indirectement, et pas seulement de "l'extractivisme", de la rente foncière et énergétique, et ceux-là dépassant le problème du réchauffement climatique. Deux commentaires les 16 et 18 décembre, et placé en haut une intervention de adé chez dndf
1. où en étions-nous, avant les gilets jaunes ?
2. à propose de "capitalisme vert" et d'extractivisme
3. TC, “le vivant” ou la “nature” et le prolétariat, une intervention de adé chez dndf
19 décembre maj 14:10
18 décembre
16 décembre
RS de Théorie Communiste écrit dans sa Réponse à Patlotch que « le "capitalisme vert" n'existe pas »
ce n'est pas parce qu'occupé depuis un mois à rendre compte de ce qui se passe, dans le sujet avec ou sans GILETS JAUNES, couleurs d'une colère sociale, que le capitalisme destructeur du vivant a disparu de l'arrière-scène déterminante pour ce qui vient
par conséquent, ce n'est qu'un début, continuons le combat
Les fondations philanthropiques s’engagent dans la lutte contre le changement climatique, avec des actions célébrées. Mais pour quels résultats ? Selon Edouard Morena, ces fondations contribuent en fait à maintenir l’ordre économique qui aggrave la crise climatique.

nous attendons sans impatience ce que Théorie Communiste et le structuralisme prolétarien du marxisme fossilisé hors du vivant pourraient bien nous dire de tout ça

1. où en étions-nous, avant les gilets jaunes ?
2. à propose de "capitalisme vert" et d'extractivisme
3. TC, “le vivant” ou la “nature” et le prolétariat, une intervention de adé chez dndf
19 décembre maj 14:10
3. TC, “le vivant” ou la “nature” et le prolétariat
une intervention de adé chez dndf
une intervention de adé chez dndf
adé a écrit:18/12/2018 à 17:18 #12
R.S. se demande ce que “le vivant” ou la “nature” veulent bien dire, et cette confidence, dont on se doutait au vu de la production de T.C., en dit en elle-même beaucoup de l’évincement du sensible dans toute cette production post-programme, n’ayant toutefois jamais dépassé ce point de vue, au bonneteau la contradiction a substitué le sujet prolétarien, le tour était joué, mais ce n’était qu’un tour.
18/12/2018 à 17:23 #13
Pour la bonne bouche
BIOCENOSE définition :
Le terme de biocénose fut inventé et introduit dans la littérature scientifique par le biologiste allemand Karl August Möbius en 1877, alors qu’il étudiait les huîtres après qu’il eut noté que, chez ces animaux comme chez d’autres, il fallait placer le cadre d’étude au niveau non pas d’une seule espèce mais de l’ensemble des espèces qui cohabitent dans un espace déterminé..
La biocénose diffère du biote car elle intègre la description de l’organisation des espèces et leur richesse spécifique.
Placer le cadre d’étude au niveau non pas d’une seule espèce, MAIS DE L’ENSEMBLE DES ESPÈCES QUI COHABITENT DANS UN ESPACE DÉTERMINÉ.
Quelle concept flou, n’est-ce pas ? [allusion à RS : « [Pour Patlotch] le capital devient un concept aussi flou que ceux de « nature » et d’ « humanité ». Il est vrai que Patlotch a annoncé une nouvelle cible : le « conceptualisme », plus de théorie manipulant des concepts, maintenant Patlotch est en connexion directe avec le « réel », le « vivant » et la « nature » »]
Entre IV et V a écrit:19/12/2018 à 09:58 #15
5. L’étude de la biocénose pourrait aider à comprendre les lois qui régissent les rapports entre les intellectuels de la bibliothèque et les ouvriers des ronds-points. Il parait que des gilets jaunes ont rencontré l’amour sur le rond-point. Pour l’amour de la théorie ça prendra plus de temps, et il faut se déplacer à Paris, mais la conjoncture, ou la rupture on ne sait plus très bien, vient compléter la violence de l’émeute pour donner au prolétariat le visage qui n’a jamais cessé d’être le sien.
Adé a écrit:19/12/2018 à 12:30 #17
La biocénose, un gros nuage de fumée conceptuelle ? pepe dixit
Enfumage donc, faut-il être totalement hors-sol pour ne pas comprendre la gravité de la situation du point de vue “environnemental” ?
Situation sans précédent qui n’est finalement qu’un détail pour les enfumés (intoxiqués?) du sujet et/ou de LA contradiction.
Symptomatique ce déni, conforme au manque de lucidité dicté par une foi immuable quant à la venue d’une révolution à titre strictement prolétarien (et le genre, au fait ?).
pepe a écrit:19/12/2018 à 13:33 #18
Comme je ne peux pas te faire l’insulte de penser que tu ne sais pas lire, je pense que c’est donc sciemment que tu fais semblant de ne pas comprendre que je parlais uniquement de ton utilisation du concept de biocénose dans le contexte très précis du “biotope” du mouvement des gilet jaunes , qui mêle fachos et autres révoltés, comme tu l’as fait plus haut. Arrête de penser que l’avenir de cette planète ne concerne que toi ou quelques esprits éclairés. C’est pénible et inutile au débat.
Patlotch a écrit:alias ânonime @adé et pepe
mouais... quand ça arrange de ne pas comprendre... Il ne me semble pas qu'Adé ait fait cette remarque « dans le contexte très précis du biotope des gilets jaunes » [d'autant qu'il en a fait un commentaire à part] mais relativement au sujet, la réponse de TC à mes commentaires, au sein de quoi elle se comprend fort bien. Il y a donc une discussion qui serait mieux sous mes critiques à TC, incluant la réponse de RS dans
“Les gilets jaunes, l’État, et le capital”, remarques critiques sur l’analyse de Théorie communiste https://dndf.org/?p=17341 , car franchement la "visionneuse Patlotch" me fait trop d'honneur surtout quand elle piétine allègrement mes positions
c'est un débat que je distingue chez moi dans plusieurs sujets, et quand c'est clair pas de raisons pour se chamailler
il faudra naturellement (sic) revenir sur le rapport entre l'écologie et ce mouvement, car, je le rappelle, tout ce qui les a explicitement reliés jusqu'ici, et probablement dans ce qui suivra à moyen terme, relève d'une critique du "prétexte écologique de Macron pour augmenter les taxes", et en aucun cas d'une critique écologique radicale du capitalisme, au sens où "la révolution communiste sera écologiste ou ne sera pas", ce qui était mon propos, entendant par "révolution" à la fois le 'moment de rupture insurrectionnel' et le processus révolutionnaire de long terme
le débat théorique entre nous est là, pas à trier comme des lentilles le jaune-vert et les cailloux de l'anti-vert dans le jaune, merci à toussétoutes de le comprendre et de n'y point mêler leurs poux dans la tête
18 décembre
2. capitalisme extractiviste
Brésil : Bolsonaro veut exploiter les ressources d'une réserve indigène
ActuOrange/AFP décembre 2018

Des autochtones lors d'une manifestation contre le gouvernement à Brasilia, au Brésil, le 25 avril 2018
 Carl de Souza, AFP
Carl de Souza, AFP
Brésil : Bolsonaro veut exploiter les ressources d'une réserve indigène
ActuOrange/AFP décembre 2018

Des autochtones lors d'une manifestation contre le gouvernement à Brasilia, au Brésil, le 25 avril 2018
 Carl de Souza, AFP
Carl de Souza, AFPLe président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, cherchera à exploiter les ressources naturelles d'une gigantesque réserve indigène dans l'Amazone, à la frontière du Venezuela et de la Guyane, a-t-il promis lundi.
Lors d'une cérémonie d'inauguration à Rio, il a évoqué le potentiel de la réserve Raposa Serra do Sol, dans l'État de Roraima (nord).
"C'est la région la plus riche du monde. Il y a moyen d'exploiter de manière rationnelle. Et du côté des indigènes, de leur verser des redevances et de les intégrer à la société" a déclaré M. Bolsonaro lors d'une cérémonie à Rio de Janeiro.
La Raposa Serra do Sol, délimitée en 2005, s'étend sur 17.000 km², sur lesquels vivent quelque 17.000 autochtones. Elle renferme d'importants gisements de minerais comme le niobium, un métal léger utilisé dans la sidérurgie et l'aéronautique, et la deuxième plus grande réserve d'uranium au monde. Cette zone abrite également d'abondantes réserves d'or, d'étain, de cuivre et de diamants.
Pendant sa campagne et peu après avoir gagné l'élection présidentielle en octobre dernier, l'ancien militaire avait déclaré qu'il reverrait la carte des réserves indigènes, les jugeant "surdimensionnées".
"L'indigène ne peut pas rester confiné dans une zone délimitée comme s'il s'agissait d'un animal dans un zoo", estimait M. Bolsonaro dans un entretien il y a quelques mois. Ces personnes sont des "êtres humains comme nous, qui veulent évoluer, avoir l'électricité, un médecin, un dentiste, internet, jouer au football".
Le président élu, qui a remis en question la participation de son pays à l'accord de Paris sur le changement climatique, a également évoqué la possibilité de reprendre les études pour la construction de centrales hydroélectriques en Amazonie. Selon les experts, une telle initiative bouleverserait l'écosystème du fleuve Amazone et de ses affluents, et forcerait le déplacement des populations.
La Constitution brésilienne protège les droits des peuples autochtones sur leurs terres.
comme à l'époque de Fin de partie truquée (2014), RS aura beau triturer mes positions, ce ne sera jamais la preuve que d'un malaise dans sa théorie. Toujours aussi honnête, il sait lire, et me cite même : « nous sommes entrés dans un nouveau paradigme du dépassement du capitalisme, et que les luttes qui en rendent compte aujourd’hui ne sont pas des luttes prolétariennes, sauf chez les paysans contre l’extractivisme. » Ficelle rhétorique, il inverse la logique de mon raisonnement, car pour moi, les luttes prolétariennes existent mais celles de la classe ouvrière industrielle ne rendent pas compte, ou à l'envers, de la lutte contre le capitalisme destructeur du vivant. Dit autrement, par d'autres :RS/TC a écrit:Patlotch a une nouvelle marotte : « le vivant », « l’extractivisme » [...] « L’extractivisme », c’est joli, cela a même des sonorités barbares propres à provoquer l’opposition. [...] Nous n’avons là qu’une description du capitalisme (avec un peu d’anti-impérialisme) et en plus pas si nouvelle.
Patlotch précise : « ces [les luttes prolétariennes] n’existent pas ». Ne sont « sauvées » que celles des si pittoresques, vus d’ici, paysans andins contre « l’extractivisme ». Ici, non seulement les luttes prolétariennes ne sont plus « absolutisées », mais encore elles n’ont plus aucun rôle dans le « dépassement du capitalisme ».
pour RS, le terme d'extractivisme est réservé aux « happy few » dans mon genre « chamane », qui n'ont pas compris comment le prolétariat industriel pouvait faire seul la révolution. On les trouve en croisant capitalisme et extractivismeUn autre problème se pose donc : dans le capitalisme, la non-dévaluation de la classe ouvrière peut être incompatible avec les questions environnementales. Ceci, d’une part, montre que la solution à l’environnementalisme est aussi la solution du capitalisme dans son ensemble, mais jusqu’à ce que cela se produise, une question de priorités à l’intérieur des luttes se pose peut-être, la classe ouvrière apparaissant ici plus conservatrice que progressiste.
“Le jaune n’est pas la couleur du printemps” A ruthless critique against everything existing 6 déc 2018
16 décembre
1. où en étions-nous, avant les gilets jaunes ?
RS de Théorie Communiste écrit dans sa Réponse à Patlotch que « le "capitalisme vert" n'existe pas »
il s'en fout si peu (de l'écologie, pas de l'écologie chez les gilets jaunes) qu'à continuer comme ça, car « le capital possède le monde et aucun propriétaire ne peut s'offrir de ne pas prendre soins de ses possessions », (Gilles Dauvé, Lettre sur la libération animale, 2009), il serait plus rapidement « son propre fossoyeur » (Marx) qu'en exploitant seulement le prolétariat de RS et pas le vivant, sa condition pour exploiter les deux (rente foncière, rente énergétique fossile ou non, terres rares, extractivisme, etc.)TC a écrit:La « révolution Macron » du « capitalisme vert ». C’est de la blague, comme le « capitalisme vert » en général, macronien ou non. Il y a des investissements et des profits à attendre (peut-être) des éoliennes, du solaire, etc., c’est le capitalisme tout court. [...] La « contradiction entre le capital et le vivant ». A la rigueur, « le capital » on peut avoir quelques idées, mais le « vivant » c’est quoi ? Quant à la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, il s’en fout.
concept ou pas, je pense connaître les réalités du capital aussi bien que RS, et ce n'est pas ma faute s'il ne voit que flou dans l'humanité et le vivant, concept scientifique peu "flou" au demeurant (cf LE VIVANT (la 'NATURE')). Si je parle du « capitalisme vert », c'est comme idéologie et politique de l'économie dans un pays comme la France de Macron, différent comme concernant le racisme des États-Unis de Trump ou du Brésil de Bolsonaro. À trop insister, TC en oublierait que la tendance à la baisse du taux de profit, si chère à sa théorie, s'explique par la concurrence entre capitalistes nonobstant ses "contre-tendances", du moins ai-je compris ainsi Le Capital - Livre III § 3, mais je suis moins bon marxologue que RSTC a écrit:[pour Patlotch] Le capital devient un concept aussi flou que ceux de « nature » et d’ « humanité ». Il est vrai que Patlotch a annoncé une nouvelle cible : le « conceptualisme », plus de théorie manipulant des concepts, maintenant Patlotch est en connexion directe avec le « réel », le « vivant » et la « nature »... Devenu chamane, Patlotch nous les transmet.
ce n'est pas parce qu'occupé depuis un mois à rendre compte de ce qui se passe, dans le sujet avec ou sans GILETS JAUNES, couleurs d'une colère sociale, que le capitalisme destructeur du vivant a disparu de l'arrière-scène déterminante pour ce qui vient
par conséquent, ce n'est qu'un début, continuons le combat
Les philanthropes aiment-ils la planète ?
Capitalisme, changement climatique et philanthropie
Edouard Morena La vie des idées, Collège de France, 11 décembre
traduit par Arianne Dorval
Une collaboration entre Public Books et La Vie des idées/Books&Ideas.
Capitalisme, changement climatique et philanthropie
Edouard Morena La vie des idées, Collège de France, 11 décembre
traduit par Arianne Dorval
Une collaboration entre Public Books et La Vie des idées/Books&Ideas.
Les fondations philanthropiques s’engagent dans la lutte contre le changement climatique, avec des actions célébrées. Mais pour quels résultats ? Selon Edouard Morena, ces fondations contribuent en fait à maintenir l’ordre économique qui aggrave la crise climatique.

Au-delà des appels à l’action et des promesses d’engager davantage de ressources dans la lutte contre le changement climatique, le One Planet Summit, qui s’est tenu à Paris en décembre 2017, a été marqué par l’importance accordée aux philanthropes et aux fondations philanthropiques. Loin d’occuper un rôle secondaire ou d’appui (Bloomberg Philanthropies a financé et orchestré l’événement), les fondations ont été publiquement reconnues et célébrées comme des acteurs essentiels de la lutte contre le changement climatique, aux côtés des gouvernements, des entreprises, des investisseurs et d’autres organisations de la société civile (en particulier les villes et les gouvernements locaux). Le matin du Sommet (12 décembre), le Président Macron a tenu à l’Élysée une réunion avec un groupe de philanthropes de premier plan – y compris Michael Bloomberg, Bill Gates et Richard Branson – au cours de laquelle il a insisté sur la place particulière de la philanthropie comme catalyseur de l’action climatique. Il a en outre appelé ses invités à « créer un groupe de travail pour cibler et élargir le rôle de la philanthropie dans la réalisation accélérée des objectifs ambitieux de l’Accord de Paris, notamment par le développement de partenariats avec les gouvernements et les bailleurs de fonds publics ».
La quinzaine d’individus présents à l’Élysée était représentative d’une poignée de riches fondations privées [1] qui dominent le paysage de la philanthropie climatique. En 2012, on estime que les dépenses combinées des fondations Oak, Hewlett, Packard, Sea Change, Rockefeller et Energy – qui font toutes partie de ce groupe – représentaient environ 70 % des quelque 350 à 450 millions de dollars philanthropiques alloués annuellement à l’atténuation du changement climatique. Ces « big players » partagent des caractéristiques communes. Conformément à la tradition libérale, ils se considèrent comme des agents neutres agissant dans l’intérêt général, et ils présentent le changement climatique comme un « problème résoluble » nécessitant des solutions pragmatiques, non idéologiques, bipartisanes et scientifiquement fondées. Or, un examen plus approfondi montre que leurs priorités de financement et leurs approches en matière de philanthropie reflètent une vision du monde et une conviction singulières et imprégnées d’idéologie, à savoir que les logiques de marché et la poursuite de l’intérêt personnel sont à même de sauver le climat. Pour la plupart de ces grands bailleurs de fonds du climat, la défense de l’environnement et l’ordre économique libéral sont non seulement compatibles mais se renforcent mutuellement. Derrière leur vernis altruiste et pragmatique se cache une volonté réelle de résoudre la crise climatique tout en perpétuant l’ordre économique dominant – ordre que de nombreux observateurs tiennent pour responsable de l’aggravation de la crise climatique.
Continuité et changement
La philanthropie est engagée depuis longtemps dans le débat climatique. Dans les années 1980, de grandes fondations libérales – telles que les fondations Rockefeller, Ford et Alton Jones et le Rockefeller Brothers Fund – ont financé la recherche scientifique sur les « changements environnementaux mondiaux » et ont contribué à mettre en place les processus mondiaux et les institutions multilatérales qui sous-tendent le régime climatique international actuel (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)). Mus par la conviction que les bonnes institutions multilatérales, ainsi que les ressources et l’information adéquates, permettraient de trouver une solution globale et mutuellement avantageuse, ils ont participé à la création d’une « société civile mondiale » climatique par le biais du financement d’ONG et de think tanks (Institut des ressources mondiales, Réseau Action Climat…), du soutien à la recherche et aux communications, et de l’organisation de symposiums internationaux.
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, divers facteurs contextuels ont amené certaines de ces fondations à délaisser l’enjeu climatique, et en ont conduit d’autres à réévaluer et adapter leurs stratégies d’engagement. Parmi ces facteurs, il y a notamment les réticences du gouvernement fédéral américain à s’engager sur des objectifs d’atténuation ambitieux, la montée du climato-scepticisme et des doutes quant à la capacité de la CCNUCC de parvenir à un accord ambitieux et légalement contraignant dans le contexte post-Kyoto.
Cette période coïncide également avec l’arrivée d’une nouvelle génération de philanthropes et de fondations qui ont subséquemment remodelé le paysage du financement climatique. Tout en se revendiquant des valeurs et principes libéraux, ces nouveaux venus ont promu une théorie du changement distincte concernant la philanthropie dans le domaine climatique. Plusieurs de ces nouveaux philanthropes sont issus de l’essor technologique et financier de la fin des années 1990 et du début des années 2000. C’est le cas de la Schmidt Family Foundation, lancée en 2006 par le PDG de Google, ou de la Gordon & Betty Moore Foundation, créée en 2000 par le co-fondateur d’Intel. S’agissant de la Sea Change Foundation et du Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), leurs fondateurs ont bâti leurs fortunes dans la finance. Pour ces fondations d’un nouveau genre, dont plusieurs sont implantées dans la région de la baie de San Francisco, l’engagement dans le débat climatique représente un moyen de se distinguer et de se légitimer dans l’espace public et dans les cercles libéraux de l’élite américaine. Ces cercles étaient traditionnellement dominés par les élites de la côte Est, dont la fortune remonte au boom industriel du début du XXe siècle et dont les noms sont souvent associés à des fondations libérales plus anciennes et solidement établies telles que Ford et Rockefeller.
Ces « philanthrocapitalistes » ou « venture philanthropists » « [mobilisent] leur sens des affaires, leur ambition et leur mentalité « stratégique » » pour relever le défi climatique. En réponse à l’irrationalité de la politique climatique et au faibles ressources disponibles au regard de l’énormité de l’enjeu, ils ont développé et mis en œuvre des approches dites « stratégiques » ou « ciblées » de la philanthropie climatique. Ces approches incluent un suivi approfondi des bénéficiaires de subventions et la création de plateformes formelles et informelles pour mieux coordonner et aligner les efforts des fondations. C’est le cas, par exemple, de la « Climate Funders Table », une plateforme informelle de fondations très actives sur le climat et dont l’objectif est d’identifier collectivement les priorités, de partager des renseignements et de développer des initiatives communes. Ces « philanthrocapitalistes » ont également créé et financé des fondations de type pass-through (spécialisées dans la redistribution de fonds d’autres fondations) comme ClimateWorks, la Energy Foundation (centrée sur les États-Unis) et la European Climate Foundation (ECF). Ces fondations conseillent et travaillent avec les acteurs - régulateurs, entités publiques, groupements d’entreprises… – dotés de l’autorité et du pouvoir économique nécessaires pour impulser des changements significatifs. Par ailleurs, elles orientent de façon stratégique les fonds philanthropiques vers un nombre limité d’acteurs et de projets soigneusement sélectionnés dans des secteurs - services énergétiques, industrie, transports – et des régions – sous-nationales, nationales et supranationales – à fort potentiel d’atténuation. En 2013, dans le contexte de l’avant-COP21, des fondations ont également mis en place l’International Policies and Politics Initiative (IPPI) pour « souligner les opportunités de collaboration philanthropique, de développement stratégique conjoint, de mise en commun des ressources et d’alignement des subventions en matière de politiques climatiques internationales » et pour créer les conditions d’un accord à Paris.
À travers leurs efforts, les principales fondations climatiques ont cherché à créer un environnement propice à une transition de la société vers une économie bas carbone. Dès le départ, ce sont les investisseurs et les entreprises – et non les États – qui ont été placés au cœur de ce processus. La priorité a été accordée aux politiques, initiatives et projets qui envoyaient des signaux positifs aux marchés et incitaient les investisseurs et entreprises à investir dans l’économie verte. Des efforts ont également été déployés dans le domaine de la recherche et du développement pour soutenir la diffusion à grande échelle de nouvelles technologies et procédés industriels propres. Par exemple, de grands bailleurs de fonds du climat comme les fondations Hewlett et MacArthur ont récemment décidé de financer la recherche sur les technologies controversées de captage et de stockage du carbone (CSC).
Un vernis de respectabilité
En dépit de leurs ressources relativement limitées – la philanthropie climatique représente moins de 0,1 % de l’ensemble du financement climatique –, les efforts combinés des fondations au cours des trente dernières années ont eu un impact significatif sur le débat climatique international. Comme je l’ai soutenu ailleurs, celles-ci ont joué un rôle actif et influent dans la préparation de la COP de Paris. Ainsi, peu après la Conférence de Paris, la European Climate Foundation (ECF) affirmait que « tout en veillant à ne pas trop exagérer notre rôle, il faut reconnaître que les activités menées par la communauté des philanthropes climatiques en amont et pendant la COP ont contribué à créer les conditions de [l’accord] ». Comme nous l’avons évoqué plus haut, le One Planet Summit de 2017 signale le fait que les dirigeants politiques et autres acteurs clés du débat climatique international reconnaissent eux aussi l’importance cruciale des fondations philanthropiques.
Compte tenu de leur rôle, les fondations ont-elles contribué à atténuer le changement climatique ? Selon l’ONU, 2017 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée et 2018 devrait battre ce record. Bien que les fondations ne soient pas directement responsables de cette hausse des températures, il convient néanmoins d’examiner de près les efforts qu’elles ont fournis pour freiner le changement climatique. Il faut notamment tenir compte de leur rôle dans l’élaboration et la promotion de l’approche non-contraignante, « par le bas » et centrée sur le marché qui domine aujourd’hui l’espace climatique international ; une approche qui n’a manifestement pas donné les résultats nécessaires. Comme l’écrivait Marc Gunther dans un récent éditorial, « s’il fallait juger la philanthropie à l’aune de ses résultats – et comment pourrait-elle être jugée autrement ? – on pourrait dire que la philanthropie climatique a échoué ».
Comment expliquer alors que, malgré quelques voix isolées (dont celle de Marc Gunther), peu de questions aient été soulevées sur le rôle et la responsabilité de la philanthropie climatique dans l’aggravation de la crise climatique ? Trois raisons principales peuvent être avancées pour expliquer cela.
La première est liée au fait que plusieurs ONG et réseaux d’ONG de premier plan – Climate Action Network International (CAN International), Friends of the Earth International, 350.org – dépendent partiellement ou entièrement de l’argent des fondations. Compte tenu des faibles ressources disponibles – en particulier pour les organisations actives au niveau international – et des particularités de la philanthropie climatique – dominée par une poignée de riches fondations étroitement alignées –, les bailleurs de fonds du climat exercent une forte influence sur l’espace de la société civile. Par exemple, la European Climate Foundation (ECF) – qui redistribue l’argent de plusieurs grosses fondations climatiques (Oak, Hewlett, ClimateWorks) – est un interlocuteur incontournable pour quiconque souhaite participer activement au débat climatique européen et international. Pour un bénéficiaire éventuel, il peut être utile de n’avoir « [qu’]un seul interlocuteur plutôt que de devoir présenter la même demande [de financement] à trois reprises ou plus ». Or, le fait qu’une proportion importante des fonds dédiés au climat transite par une fondation risque aussi de concentrer le pouvoir dans les mains d’une seule organisation et, par conséquent, vers une seule approche - au détriment de groupes qui portent des visions alternatives ou qui souhaitent poursuivre des stratégies différentes. La ECF et les autres grandes fondations climatiques deviennent de facto des points de référence et, du fait de leur position dominante, difficiles à critiquer.
La deuxième raison tient à la lenteur et à la réticence des entreprises et des gouvernements - en particulier chez les gros émetteurs – à prendre des mesures décisives contre le changement climatique. Avec la bénédiction de nombreux gouvernements et organisations internationales, les fondations se présentent de plus en plus comme les seules à pouvoir rompre « l’impasse climatique ». Au lieu d’être un problème, leur manque de redevabilité et de légitimité se transforme en atout. Comme l’explique George Polk, ancien président du comité exécutif de la EFC, « l’un des avantages des fondations dans l’arène politique est qu’elles sont à l’abri tant des cycles électoraux qui interrompent la continuité et la cohérence des politiques que des entraves au marché qui freinent l’adoption de solutions déjà disponibles comme l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Cela signifie que les fondations peuvent souvent surmonter des obstacles que les gouvernements et les entreprises hésitent à franchir ».
La troisième raison a trait à la fonction plus large des fondations libérales dans l’espace politique américain et international. Comme l’explique Inderjeet Parmar dans Foundations of the American Century, historiquement, les fondations libérales ont joué un rôle influent dans le passage des Etats-Unis d’une nation « isolationniste » à une superpuissance mondiale, ainsi que dans la promotion et l’enracinement des idées libérales sur le plan national et international. En affaiblissant le caractère « Étato-centré » de la CCNUCC, le retrait de l’administration Trump de l’Accord de Paris a un peu plus renforcé la position des fondations, et par extension, leur position dans le débat climatique international. Comme l’illustre l’exemple de Bloomberg, l’isolationnisme de Trump a incité les fondations et les philanthropes libéraux à intensifier leurs efforts dans le débat climatique, lequel constitue historiquement un champ de bataille symbolique dans la guerre entre libéraux et conservateurs. Les fondations philanthropiques sont non seulement engagées pour le climat, mais aussi pour la sauvegarde de l’ordre libéral – ordre qui a longtemps été porté par les États-Unis et qui est actuellement mis à mal par Trump et par d’autres conservateurs à travers le monde.
Notre maison brûle
C’est dans ce contexte politique de plus en plus instable, et face à l’aggravation de la crise climatique, que les fondations philanthropiques sont de plus en plus célébrées comme des « champions du climat ». Comme nous l’avons vu, le consensus qui entoure la philanthropie climatique masque une implication ancienne, active et idéologiquement motivée dans le débat climatique. Il minimise en outre les erreurs et les responsabilités des fondations. Pour paraphraser l’ancien président français Jacques Chirac en 2002, notre maison brûle, et désormais nous regardons les philanthropes.
Dossier(s) :
Qui sauvera le climat ?
Aller plus loin
• Mark Dowie, American Foundations : An Investigative History (MIT Press, 2001) [longue section sur la philanthropie environnementale]
• Marc Abélès, Les Nouveaux Riches : Un Ethnologue dans la Sillicon Valley (Odile Jacob, 2002) [sur la nouvelle génération de philanthrocapitalistes]
Une institution exemplaire :
• La fondation ClimateWorks me parait particulièrement représentative de l’approche dominante en matière de philanthropie climatique.
Autres fondations philanthropiques
The Children’s Investment Fund Foundation
The Energy Foundation
The Ford Foundation
The William & Flora Hewlett Foundation
The W. Alton Jones Foundation
The David & Lucile Packard Foundation
The Gordon & Betty Moore Foundation
The Oak Foundation
Rockfeller Brothers Fund
The Rockfeller Foundation
The Schmidt Family Foundation
The Sea Change Foundation[
nous attendons sans impatience ce que Théorie Communiste et le structuralisme prolétarien du marxisme fossilisé hors du vivant pourraient bien nous dire de tout ça
Dernière édition par Patlotch le Mer 19 Déc - 19:48, édité 1 fois
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
j'intègre ici le peu d'un sujet qui faisait doublon LE CAPITAL EXPLOITE LA NATURE, DONC LES PROLÉTERRES, 26 octobre
c'est sciemment que je place ici cet article, qui relèverait dans une autre approche de "la défense de l'environnement" sans lien fait avec la double exploitation par le capitalisme des prolétaires et de la terre. Je poursuis la méthode dialectique complexe du précédent forum, chaque point de vue étant mis en rotation avec les autres dans une danse de la dialectique (Bertell Ollman), mais je le fais dans une structure et avec un plan qui remet les choses dans la hiérarchie qu'elles ont, historiquement et structurellement
un exemple, après Trump, des tensions entre capitalistes sur la question de l'environnement, avec derrière la logique de l'extractivisme, à laquelle Macron aura du mal à faire croire qu'il est opposé. Ne soyons donc pas dupes du point de vue critique des opposants politiques au fascisme qui vient au Brésil. En attendant, on en est là...
Au Brésil, le candidat Bolsonaro menace l’Amazonie et les peuples autochtones
Abiano Maisonnave Climate Home news, via Reporterre 26 octobre 2018
Jair Bolsonaro, le favori de l’élection présidentielle de ce dimanche 28 octobre, souhaite abolir le ministère de l’Environnement du Brésil, exposant ainsi la plus grande forêt tropicale du monde et ses habitants à des bandes criminelles de bûcherons et de mineurs.

bien avant l'époque de Marx, l'appropriation des terres ne donnait lieu qu'à des luttes paysannes, pas encore prolétaires. Il décrit ce changement qu'il a sous les yeux, et dont nous connaissons les ultimes développements avec d'autres luttes, pas essentiellement prolétaires ou en tant que prolétaires, qui conduisent à envisager autrement et plus largement une sortie radicale du capitalisme
on peut supposer que les marxistes, ne voyant pas de sujet dans la nature exploitée, ont négligé les luttes de ceux par qui cela était possible, soit les paysans (esclaves, serfs, métayers, fermiers...), soit toutes les populations occupant les terres en question sources de rente foncière, d'où ils ont été et sont encore chassés, le colonialisme étant partie prenante du capitalisme, dans sa genèse esclavagiste comme dans son évolution néo-coloniales et ses séquelles actuelles. Comme on le voit, il ne s'agit pas d'une simple prolétarisation sur le modèle de l'extorsion de plus-value en usine, sans quoi le problème ne prendrait pas la forme d'une sous-prolétarisation des "expulsés" (Saskia Sassen) ou "Négres du monde" (Achille Mbembe) au delà de la couleur de peau (ladite 'race'), qui population en surplus (Endnotes) n'étant pas même exploitable, peut être jetée à la mer des calculs égoïstes (migrants...)
c'était oublier que ces luttes pourraient un jour prendre de l'ampleur et même le pas sur celles du prolétariat industriel, en mettant la barre du mouvement communisme bien plus haut. Sans réserves, nous le serons tous et toutes bientôt. Nous voilà
du prolétariat aux proléterres
passation de témoin
passation de témoin
c'est sciemment que je place ici cet article, qui relèverait dans une autre approche de "la défense de l'environnement" sans lien fait avec la double exploitation par le capitalisme des prolétaires et de la terre. Je poursuis la méthode dialectique complexe du précédent forum, chaque point de vue étant mis en rotation avec les autres dans une danse de la dialectique (Bertell Ollman), mais je le fais dans une structure et avec un plan qui remet les choses dans la hiérarchie qu'elles ont, historiquement et structurellement
Karl Marx a écrit:La grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum, à un chiffre qui baisse constamment en face d’une population industrielle concentrée dans les grandes villes et qui s’accroît sans cesse ; elle crée ainsi des conditions qui provoquent un hiatus irrémédiable dans l’équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie ; il s’ensuit un gaspillage des forces du sol, gaspillage que le commerce transfère bien au-delà des frontières du pays considéré. (…) La grande industrie et la grande agriculture exploitée industriellement agissent dans le même sens. Si, à l’origine, elles se distinguent parce que la première ravage et ruine davantage la force de travail, donc la force naturelle de l’homme, l’autre plus directement la force naturelle de la terre, elles finissent, en se développant, par se donner la main : le système industriel à la campagne finissant aussi par débiliter les ouvriers, et l’industrie et le commerce, de leur côté, fournissant à l’agriculture les moyens d’exploiter la terre.
Le Capital, livre III, cité par John Bellamy Foster dans Karl Marx et l’exploitation de la nature
un exemple, après Trump, des tensions entre capitalistes sur la question de l'environnement, avec derrière la logique de l'extractivisme, à laquelle Macron aura du mal à faire croire qu'il est opposé. Ne soyons donc pas dupes du point de vue critique des opposants politiques au fascisme qui vient au Brésil. En attendant, on en est là...
Au Brésil, le candidat Bolsonaro menace l’Amazonie et les peuples autochtones
Abiano Maisonnave Climate Home news, via Reporterre 26 octobre 2018
Jair Bolsonaro, le favori de l’élection présidentielle de ce dimanche 28 octobre, souhaite abolir le ministère de l’Environnement du Brésil, exposant ainsi la plus grande forêt tropicale du monde et ses habitants à des bandes criminelles de bûcherons et de mineurs.

au passage, relevons que les considérations décoloniales ne sont pas aussi stupides que le prétendent certains marxistes arriérés, Théorie communiste n°26 ou Alexandru Cistelecan en les réduisant à l'idéalisme contre-révolutionnaire d'un problème épistémologique ‘Epistemic Revolution’ and Counterrevolution. A Marxist Critique of Decolonial ReasonSi Jair Bolsonaro est élu dimanche face au candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, le Brésil quittera l’Accord de Paris, il n’y aura plus de ministère de l’Environnement, et une nouvelle autoroute pavée sera lancée à travers l’Amazonie.
Et ce n’est pas tout. Le candidat favori, qui a obtenu une quasi-majorité des votes lors du premier tour de l’élection présidentielle le 7 octobre, entend ouvrir des territoires autochtones à l’exploitation minière, assouplir l’application de la loi en matière d’environnement et l’octroi de permis d’exploitation. Tandis que les ONG internationales, telles que Greenpeace et WWF, pourraient être interdites dans le pays, M. Bolsonaro entretient une alliance étroite avec le lobby du bœuf.
Nostalgique de la dictature militaire de 1964 à 1985, ce capitaine de l’armée à la retraite est désormais célèbre pour sa rhétorique raciste, homophobe, autoritaire et misogyne. Bolsonaro a galvanisé les électeurs des centres urbains désabusés par les scandales de corruption et attirés par ses positions « tough on crime » [« intransigeant contre le crime »] dans un contexte de hausse des taux de criminalité. Mais ses vues sur la façon de gérer la plus grande forêt tropicale humide de la planète sont tout aussi sombres et épouvantables.
En Amazonie, des bûcherons, des mineurs, des accapareurs de terres ainsi que de grands propriétaires terriens se sont ralliés à lui. Ils ne s’attendent pas à ce que Bolsonaro fasse respecter la loi. Au contraire, ils espèrent qu’il tiendra sa promesse d’anéantir presque toutes les législations environnementales et pro-indigènes. Il a obtenu un soutien massif dans les États ruraux du centre-ouest et dans tous les États amazoniens sauf un.
L’Accord de Paris, un « complot de l’ONU » pour déposséder le Brésil de l’Amazonie
En août, Bolsonaro s’est engagé à retirer le Brésil de l’Accord de Paris. Ainsi, le pays ne chercherait plus à réduire ses émissions, notamment celles dues à la déforestation de l’Amazonie, qui est pour le pays une source de gaz à effet de serre plus importante que la combustion des énergies fossiles.
Bolsonaro reconnaît que le climat change dangereusement. Mais quand Climate Home News l’a interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse en avril, il a expliqué que la solution résidait dans un contrôle strict de la croissance de la population humaine. « Cette croissance démographique explosive conduit à la déforestation, a-t-il dit. Parce que vous ne cultiverez pas de soja sur la terrasse de votre immeuble ou n’élèverez pas de bétail dans la cour. Nous devons donc avoir une politique de planification familiale. Ainsi, vous commencez à réduire la pression de ce qui conduit, oui, à mon avis, au réchauffement de la planète, ce qui pourrait être la fin de l’espèce humaine. »
Il a également fait l’éloge de la politique du président Trump sur l’Accord de Paris - les États-Unis s’en sont retirés en juin 2017 -, et laissé entendre que cet accord faisait partie d’un complot de l’ONU visant à déposséder le Brésil de sa souveraineté sur l’Amazonie. « Félicitations à Trump. Si cela avait été bon pour eux, [les États-Unis] ne l’auraient pas dénoncé », a-t-il dit, ajoutant qu’un « concept de corridor écologique de 136 millions d’hectares (…) sous le contrôle du monde, pas le nôtre, » avait été « discuté ». « Je ne sais pas à quel point », a-t-il admis.
En réaction, l’actuel ministre brésilien de l’Environnement, Edson Duarte, a déclaré : « Au lieu de faire passer le message qu’il luttera contre la déforestation et le crime organisé, il s’attaquera au ministère de l’Environnement, à Ibama et à ICMBio [les agences fédérales de l’environnement du Brésil]. C’est la même chose que de dire qu’il retirera la police des rues. »
S’adressant au journal O Estado de Sao Paulo, Duarte a craint « une augmentation immédiate de la déforestation » en cas de victoire de M. Bolsonaro : « J’ai peur d’une ruée vers l’or vert. Ils sauront que, s’ils occupent illégalement des terres, les autorités feront preuve de complaisance. Ils seront certains que personne ne les dérangera. »
Les politiques environnementales de Bolsonaro sont à mettre en lien avec son attitude raciste envers les minorités et les peuples autochtones du Brésil. Dans un discours prononcé l’an dernier, il a déclaré : « Les minorités doivent se plier à la majorité… Les minorités [devraient] s’adapter ou simplement disparaître. »
« S’il gagne, il institutionnalisera le génocide »
Exprimant un point de vue commun dans le milieu militaire, il a affirmé, sans preuve, que les droits fonciers autochtones fesaient partie d’un complot occidental visant à créer des États amazoniens séparatistes soutenus par l’ONU. « Tôt ou tard, nous aurons des douzaines de pays à l’intérieur du Brésil. Nous n’aurons pas de droit d’ingérence dans ces pays, le premier monde exploitera les Indiens, et il ne nous restera plus rien », a-t-il dit l’année dernière.
Bolsonaro a promis d’ouvrir les terres autochtones à l’exploitation minière et à d’autres activités économiques. Environ 13 % du territoire brésilien est constitué de terres indigènes reconnues, la plupart situées en Amazonie. Ces réserves constituent un rempart contre la destruction de la forêt, seulement 2 % de la déforestation de la forêt tropicale humide ayant eu lieu à l’intérieur du territoire autochtone.
La loi protège les droits des peuples natifs. L’article 231 de la Constitution de 1988 dispose ainsi qu’ils ont « des droits originaux sur les terres qu’ils occupent traditionnellement », bien que ces terres appartiennent à l’État et qu’ils n’aient aucun droit de propriété sur les minéraux.
Mais Bolsonaro respectera-t-il ces lois ? Plusieurs analystes craignent que le Brésil glisse vers un régime autoritaire. Son colistier, le général Antonio Mourão, a plaidé pour une nouvelle Constitution sans participation populaire et a même évoqué la possibilité que Bolsonaro puisse proclamer un coup d’État.
Bolsonaro et Mourão ont tous deux défendu les excès de la dictature militaire brésilienne, qui a déplacé et tué (intentionnellement ou par des maladies) des milliers d’habitants autochtones en Amazonie, dans son effort pour construire des routes et des barrages hydroélectriques dans la forêt. Les forces armées n’ont jamais reconnu aucun acte répréhensible.
« S’il gagne, il institutionnalisera le génocide, a déclaré Dinamamam Tuxá, coordinateur national de l’Association brésilienne des peuples autochtones, dans une interview téléphonique avec Climate Home News. Il a déjà dit que le gouvernement fédéral ne défendrait plus les droits des autochtones, comme celui de l’accès à la terre. Nous avons très peur. Je crains pour ma propre vie. En tant que dirigeant national, je suis sûr que je serai puni par le gouvernement fédéral pour avoir défendu les droits des peuples autochtones. »
Opération conjointe de l’agence Ibama et du secrétariat d’État à l’environnement (Sema) du Mato Grosso contre l’exploitation illégale de la forêt, en juin 2018.
Au cours de la campagne électorale, Bolsonaro a promis d’abolir le ministère de l’Environnement et de transférer ses fonctions au ministère de l’Agriculture. Le portefeuille de l’Agriculture sera remis aux politiciens du « parti du bœuf », un groupe conservateur de parlementaires qui contrôlent environ un tiers du Congrès. Ils se sont opposés à la démarcation des terres autochtones et ont préconisé la réduction des unités de conservation (aires protégées), entre autres mesures, afin d’augmenter les surfaces agricoles. Depuis début octobre, ils soutiennent officiellement Bolsonaro.
Dans plusieurs discours, ce dernier a déclaré qu’il mettrait fin à l’« industrie de qualité » dirigée par Ibama et ICMBio, qui tentent de contrôler l’exploitation minière illégale, la déforestation et l’exploitation forestière. Juste après le premier tour, il a également assuré vouloir « châtrer » Ibama.
Une affaire personnelle pour Bolsonaro. En 2012, il a été pris en train de pêcher illégalement dans une réserve fédérale au large des côtes de Rio de Janeiro et s’est vu imposer une amende de 2.700 dollars. Depuis lors, en tant que membre de la Chambre des députés brésilienne, il a pris l’agence Ibama pour cible, allant jusqu’à présenter un projet de loi qui interdirait à ses agents de porter des armes, même s’ils opèrent dans certaines des régions les plus dangereuses du pays.
« Ibama sera privé de ses pouvoirs de délivrance de permis environnementaux », a-t-il dit au cours de la campagne. Ces fonds seraient redistribués à d’autres organismes officiels. Cela signifie, par exemple, que l’agence fédérale ne pourra plus s’opposer à des projets controversés tels que la réouverture de la BR-319 — une autoroute désaffectée de 890 km qui traverse l’une des zones les plus préservées de l’Amazonie —, ou São Luiz do Tapajós, une immense centrale hydroélectrique qui doit être construite dans une zone habitée notamment par le peuple Munduruku.
La BR-319, qui relie Manaus à Porto Velho, serait particulièrement néfaste à la forêt, car elle permettrait la construction de routes secondaires. Selon une étude de l’ONG Idesam, cette autoroute pourrait accélérer l’accaparement et la déforestation d’une zone aussi vaste que l’Allemagne et la Belgique. Les récentes tentatives de pavage ont été interdites par Ibama.
« Il a désigné Ibama et ICMBio comme ses ennemis publics numéro un et a indiqué qu’il mettrait à bas les lois environnementales et sociales, a noté André Guimarães, directeur de l’Amazon Environmental Research Institute. Cependant, une chose est ce qu’il a dit pendant la campagne électorale. Une autre chose est ce qu’il sera capable de faire s’il prend le pouvoir. »
D’après M. Guimarães, le « parti du bœuf » a récemment tenté d’assouplir la législation sur l’environnement et le travail forcé, en vain. Il a échoué dans la plupart de ces tentatives en raison de la forte opposition.
« Bolsonaro va essayer et il est obstiné, mais c’est à la société civile de réagir. Il y aura des conflits intenses et presque permanents, a-t-il déclaré. Nous devons nous indigner. »
bien avant l'époque de Marx, l'appropriation des terres ne donnait lieu qu'à des luttes paysannes, pas encore prolétaires. Il décrit ce changement qu'il a sous les yeux, et dont nous connaissons les ultimes développements avec d'autres luttes, pas essentiellement prolétaires ou en tant que prolétaires, qui conduisent à envisager autrement et plus largement une sortie radicale du capitalisme
on peut supposer que les marxistes, ne voyant pas de sujet dans la nature exploitée, ont négligé les luttes de ceux par qui cela était possible, soit les paysans (esclaves, serfs, métayers, fermiers...), soit toutes les populations occupant les terres en question sources de rente foncière, d'où ils ont été et sont encore chassés, le colonialisme étant partie prenante du capitalisme, dans sa genèse esclavagiste comme dans son évolution néo-coloniales et ses séquelles actuelles. Comme on le voit, il ne s'agit pas d'une simple prolétarisation sur le modèle de l'extorsion de plus-value en usine, sans quoi le problème ne prendrait pas la forme d'une sous-prolétarisation des "expulsés" (Saskia Sassen) ou "Négres du monde" (Achille Mbembe) au delà de la couleur de peau (ladite 'race'), qui population en surplus (Endnotes) n'étant pas même exploitable, peut être jetée à la mer des calculs égoïstes (migrants...)
c'était oublier que ces luttes pourraient un jour prendre de l'ampleur et même le pas sur celles du prolétariat industriel, en mettant la barre du mouvement communisme bien plus haut. Sans réserves, nous le serons tous et toutes bientôt. Nous voilà
Proléterres de tous les pays, unissez-vous !
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
19 décembre, mis à jour
suite et nouveau commentaire, lire les deux précédents pour comprendre dans quel contexte ce débat fragile a été relancé 13 ans après avoir été refusé par Théorie Communiste, lors de la discussion en 2005 d'un texte de Joachim Fleur pour la revue Meeting, qu'on trouvera plus bas. J'y répondais entre autre à cette critique : « le "capitalisme vert" n'existe pas »
1. où en étions-nous, avant les gilets jaunes ? 16 décembre
2. capitalisme extractiviste : Brésil : Bolsonaro veut exploiter les ressources d'une réserve indigène 18/12
3. TC, “le vivant” ou la “nature” et le prolétariat (une intervention d'Adé), 19 décembre
mais ici, on entre dans le gras, le lourd, la bonne question mal posée
celui avec qui l'on est en désaccord pose parfois la bonne question, et s'il est, par malheur, arrivé que Théorie Communiste prenne un retard de 40 ans, là dndf est en avance, d'une heure précisément (pourquoi j'en enlève une au compteur des commentaires)
italique dans le texte, gras de mézigue
24 décembre 03:49
Argumentaire : défendre le mouvement des gilets jaunes durant les fêtes 19h17 23 décembre
Pour les fêtes de fin d’année, LaREM publie un guide pour défendre le pouvoir durant les discussions de famille. Voici un guide pour défendre plutôt le mouvement.

- « Stopper la catastrophe c’est stopper le capitalisme ». Certes, ça mange pas de pain, tout ira mieux après. Après la révolution. Ne l'a-t-on pas déjà entendu depuis les années 70 à propos du féminisme, bien avant de l'antiracisme... bref, de toutes les luttes qui, parce qu'elles ne remettaient pas en cause le capitalisme directement (et explicitement, car souvent ce n'était qu'une question de condamnation, une ligne dans le programme prolétarien, ligne absente des dizaines de milliers de pages de Théorie Communiste), il fallait considérer qu'elles avaient « dans la bouche un cadavre »...
que dire face à ça ? C'est du RS/TC militant (en l'occurrence, 19h17 = un type derrière un clavier) : « la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, [le capitalisme] s’en fout. ». Alors, en attendant "la catastrophe", de ce "marxisme"-là, le capitalisme s'en fout. Et il peut rajouter autant d'étages à sa fusée qu'il voudra, ce ne sera que pétards mouillés, pas comme Le Capital « un missile contre la bourgeoisie »
pendant ce temps-là, une pétition contre l'inaction climatique de l'État récolte en 5 jours plus d'1,6 million de signatures, « les questions liées au réchauffement climatique sont au centre des préoccupations, et les recours en justice se multiplient dans le monde entier » : des cadavres ?
21 décembre 10:05
- de l'extractivisme aux gilets jaunes, en passant par la police de l'État français post-colonial, et d'une "jonction" marginale, mais symptomatique
20 décembre 20:05
- en 2005 déjà, RS/TC s'opposait dans Meeting à un texte abordant le problème écologique
Joachim Fleur fut un participant à la revue Meeting, où il se distingua par ce texte dont RS/TC dit alors, je cite de mémoire : « Je ne peux pas être d'accord avec ça...» Il fut publié dans Meeting n°2 : Prolétaires, encore un effort pour être communisateurs..., 9 mai 2005. Y était notamment abordée la question écologique
- les ratés politiques du « capitalisme vert » face à la conscience écologique
Plus d’un million de personnes soutiennent le recours contre l’Etat sur le climat Le Monde avec AFP 12h38
j'attire l'attention notamment pour la lecture des deux textes suivants de 2009 et 2010 : pour moi, le "capitalisme vert" n'est pas une "nouvelle phase" appelée à remplacer le "capitalisme traditionnel". Pour l'heure c'est une concurrence entre secteurs industriels et commerciaux, qui rythme la concurrence pour le taux de profits, et décide(ra) aussi la survie de certains, on le voit par exemple avec la décision récente du gouvernement français de l'arrêt total de la filière charbon, ce qu'il en restait : intéressant d'observer, comme le suggère Adé, pour quoi se bat le prolétariat de ce secteur dans le monde...
cette hypothèse répond à la question de Pepe sur la dynamique révolutionnaire de l'écologie : elle anticipe donc de façon optimiste le fait que l'impossibilité d'un capitalisme entièrement vert donne une place essentielle à l'écologie dans une crise de reproduction, et par suite à un mouvement communiste proprement écologiste : proprement...
ces articles ont été écrits avant le bras de fer hyper-médiatisé entre Macron et Trump et autour des COPS (sic), qui symbolise un tournant, en gros la réalité de l'économie politique verte réalise son idéologie. Selon moi il est impossible que le "capitalisme vert" définisse entièrement le capitalisme qui vient, car même avec l'épuisement des dites énergies fossiles, les technologies telles que celles des éoliennes, du solaire, et du numérique en général exigent des matières premières toutes aussi soumises à l'extractivisme (terres rares, etc), et comme l'écrit Maxime Combes : « Le "vert" est difficile à différencier »
contrairement à mon ancien forum où durant des années j'avais accumulé sur toutes ces questions une solide matière première de documentation, je laisse ma lectorate creuser par elle-même, en jeune taupe qu'elle est
Réflexions sur le « capitalisme vert » Maxime Combes, Mouvements 2010/3 (n° 63), pages 99 à 110. Extraits
"Le capitalisme vert est un oxymore" Un capitalisme vert est-il possible ? Michel Husson 8 décembre 2009
19 décembre
Lola hors (ce) débat
suite et nouveau commentaire, lire les deux précédents pour comprendre dans quel contexte ce débat fragile a été relancé 13 ans après avoir été refusé par Théorie Communiste, lors de la discussion en 2005 d'un texte de Joachim Fleur pour la revue Meeting, qu'on trouvera plus bas. J'y répondais entre autre à cette critique : « le "capitalisme vert" n'existe pas »
il y avait trois points :TC a écrit:La « révolution Macron » du « capitalisme vert ». C’est de la blague, comme le « capitalisme vert » en général, macronien ou non. Il y a des investissements et des profits à attendre (peut-être) des éoliennes, du solaire, etc., c’est le capitalisme tout court. [...] La « contradiction entre le capital et le vivant ». A la rigueur, « le capital » on peut avoir quelques idées, mais le « vivant » c’est quoi ? Quant à la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, il s’en fout.
1. où en étions-nous, avant les gilets jaunes ? 16 décembre
2. capitalisme extractiviste : Brésil : Bolsonaro veut exploiter les ressources d'une réserve indigène 18/12
3. TC, “le vivant” ou la “nature” et le prolétariat (une intervention d'Adé), 19 décembre
mais ici, on entre dans le gras, le lourd, la bonne question mal posée
re-début de partie
celui avec qui l'on est en désaccord pose parfois la bonne question, et s'il est, par malheur, arrivé que Théorie Communiste prenne un retard de 40 ans, là dndf est en avance, d'une heure précisément (pourquoi j'en enlève une au compteur des commentaires)
italique dans le texte, gras de mézigue
pepe@dndf a écrit:19/12/2018 à 18:08 #23à Adé
Peut être que le problème que tu poses (Patloch aussi le fait de son coté) interpelle en fait TC ou d’autres sur la hiérarchies des problématiques, ou même la hiérarchie des contradictions s’il y en a une. C’est vrai que poser deux contradictions comme fondamentales (contradiction de classes- contradiction de genre), inséparables, consubstantielles, s’impliquant réciproquement, structurant l’histoire de l’humanité, c’est automatiquement poser d’autres contradictions ou problématiques comme… secondaires (Aie!) ou plutôt, secondes. La racialisation par exemple, sur laquelle TC a du se mettre au travail sous la pression des débats du “milieu” (normal qu’on réfléchisse sous la contrainte de la réalité, même si cela parait tardif, cf les reproches faits a TC de s’intéresser au “genre” avec 40 ans de retard, ce qui est une critique bien… inintéressante).
Et c’est vrai que l’écologie, posée comme problématique séparée et autonome, et quand bien même elle traite de ce qui est le plus fondamental (la survie ou pas de la planète), n’apparaît pas vraiment comme une problématique “dynamique” dans la compréhension de l’histoire moderne de l’humanité.
réponses à la question de Pepe
24 décembre 03:49
Argumentaire : défendre le mouvement des gilets jaunes durant les fêtes 19h17 23 décembre
Pour les fêtes de fin d’année, LaREM publie un guide pour défendre le pouvoir durant les discussions de famille. Voici un guide pour défendre plutôt le mouvement.

- non, la plupart des courants écologistes ne remettent pas en cause la société capitaliste, ni depuis qu'elle existe comme écologie politique, ni avec l'écologie Macron-Hulot. Il est vrai que la critique des "taxes punitives" dans le mouvement des gilets jaunes ne le fait pas. Mais rappelons Dauvé, "les propriétaires du monde" se soucie naturellement de leur propriété, car si elle meurt ils ne pourront plus l'exploiter19h17 a écrit:1) « Tout ça pour continuer à polluer… et l’écologie ? »
La pollution est un problème grave. Les premières victimes en sont d’ailleurs les prolos, tout ceux qui bouffent des particules fines tous les jours sur le périph’, qui habitent près des zones industrielles qui polluent. Nous vivons une période de bouleversement climatique catastrophique et nous savons bien qui en fera les frais. Sans parler des catastrophes comme AZF et de leurs conséquences sur les quartiers ouvriers.
[...]
- Les sources de pollutions sont diverses, mais pour la plupart industrielles. Les gros constructeurs automobiles ont fraudé pendant des années sur leurs taux d’émission de particules fines. Les industries polluantes sont légions. On ne peut agir sur la pollution sans agir sur la source de celle-ci : la course au profit.
- L’écologie était une remise en cause générale de la société capitaliste. Elle voulait changer la vie, les villes, la façon de produire. Aujourd’hui, les « écolos » qui ne parlent que de taxes punitives ont dans la bouche un cadavre. C’est que les propriétaires du monde n’en ont rien à faire, de l’écologie, à part comme argument pour nous pressurer encore plus. Stopper la catastrophe c’est stopper le capitalisme.
- « Stopper la catastrophe c’est stopper le capitalisme ». Certes, ça mange pas de pain, tout ira mieux après. Après la révolution. Ne l'a-t-on pas déjà entendu depuis les années 70 à propos du féminisme, bien avant de l'antiracisme... bref, de toutes les luttes qui, parce qu'elles ne remettaient pas en cause le capitalisme directement (et explicitement, car souvent ce n'était qu'une question de condamnation, une ligne dans le programme prolétarien, ligne absente des dizaines de milliers de pages de Théorie Communiste), il fallait considérer qu'elles avaient « dans la bouche un cadavre »...
que dire face à ça ? C'est du RS/TC militant (en l'occurrence, 19h17 = un type derrière un clavier) : « la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, [le capitalisme] s’en fout. ». Alors, en attendant "la catastrophe", de ce "marxisme"-là, le capitalisme s'en fout. Et il peut rajouter autant d'étages à sa fusée qu'il voudra, ce ne sera que pétards mouillés, pas comme Le Capital « un missile contre la bourgeoisie »
pendant ce temps-là, une pétition contre l'inaction climatique de l'État récolte en 5 jours plus d'1,6 million de signatures, « les questions liées au réchauffement climatique sont au centre des préoccupations, et les recours en justice se multiplient dans le monde entier » : des cadavres ?
21 décembre 10:05
- de l'extractivisme aux gilets jaunes, en passant par la police de l'État français post-colonial, et d'une "jonction" marginale, mais symptomatique
Paroles d’Amérindiens sur la Montagne d’or, en Guyane
Stéphane Trouille Reporterre 21 décembre 2018
Contre le projet minier de la Montagne d’or, en Guyane, se dressent notamment les premières nations. Reportage en vidéo sur une mobilisation pour défendre des terres ancestrales autant que de la forêt primaire.
L’auteur de ce reportage, Stéphane Trouille, est en ce moment même en prison. Il a été interpellé par la police à Valence le 8 décembre lors d’une manifestation des Gilets jaunes, parce qu’il s’était opposé à une violence policière.
20 décembre 20:05
- en 2005 déjà, RS/TC s'opposait dans Meeting à un texte abordant le problème écologique
Joachim Fleur fut un participant à la revue Meeting, où il se distingua par ce texte dont RS/TC dit alors, je cite de mémoire : « Je ne peux pas être d'accord avec ça...» Il fut publié dans Meeting n°2 : Prolétaires, encore un effort pour être communisateurs..., 9 mai 2005. Y était notamment abordée la question écologique
Joachim Fleur a écrit:J’ai abordé le problème de la crise « écologique ». Marx était progressiste, divers courants programmatistes aussi, parfois jusqu’au délire mystique, ce qui est à peine un paradoxe. Or le mode de production capitaliste apparaît désormais comme tendanciellement destructeur des conditions même de la vie sur cette planète. Peut-être pas pour les rats, les cafards et quelques autres espèces mais pour nous, humains et pas mal d’autres. Pas parce qu’il est méchant mais parce que sa dynamique est celle de l’illimité dans un monde physiquement, objectivement limité. Accroissement de soi par tous les moyens, les « positifs » comme les négatifs. Et il est clair, aveuglant même semble-t-il, que rien ne sera fait que de dérisoire contre, par exemple, le réchauffement climatique, la diminution de nombreuses ressources (halieutiques et autres), la baisse de la biodiversité, l’érosion des sols, etc1.
Dissipons tout de suite un possible malentendu : l’écologie dans ses diverses variantes de gauche, du centre ou d’extrême droite même est une idéologie capitaliste. Utile à des discours lénifiants, démagogiques (cf le Grand Leader Chirac), à la création de quelques marchés « de qualité ». Mais jamais ce système ne se convertira raisonnablement et vertueusement à un fonctionnement écologique rigoureux tout en n’abandonnant rien de son essence. Les salauds néo-malthusiens du World Watch Institute s’effraient à juste titre d’une Chine aussi proportionnellement pourvue en bagnoles que les États-Unis, ou aussi dévoratrice de pétrole (qui manquera dans quelques décennies, intéressante certitude) et d’électricité (nucléaire par exemple contre le réchauffement climatique, merveilleuse idée). Ils recommandent que les pays émergents empruntent d’autres voies mais se gardent bien des mêmes conseils concernant justement l’Occident, États-Unis en tête mais pas seuls pollueurs. Les dégradations sont déjà considérables et c’est le mode de production-consommation dans ses caractéristiques « techniques » fondamentales qui est intenable à moyen terme. Ce point crucial ne supprime évidemment pas la contradiction qu’est l’exploitation mais risque fort de peser sur son cours de diverses façons... Si « conversion » il y a, elle sera plutôt à tendance autoritaire, inégalitaire bien sûr dans les efforts demandés, les sacrifices, etc. Au pied du mur et pas avant, peut-être même un peu après avoir tâté dudit mur. Et avec des tensions entre États, entreprises, avivées, des guerres pour les ressources fort probables. Ce processus peut être long à l’échelle humaine (quelques siècles), court à l’échelle historique et relativement à l’espèce. Le tsunami (pas ses conséquences sociales) n’est pas « capitaliste », ne le serait pas non plus un gros corps céleste percutant notre planète, mais hors ce type de catastrophe les autres sont de moins en moins exclusivement naturelles. La conversion devrait aussi être rentable, c’est irréel.
- les ratés politiques du « capitalisme vert » face à la conscience écologique
Plus d’un million de personnes soutiennent le recours contre l’Etat sur le climat Le Monde avec AFP 12h38
sur l'enjeu climatique plus particulièrement : LE MONDE BRÛLE-T-IL ? CAPITALISME et CHANGEMENT CLIMATIQUEPlus d’un million de personnes ont signé en moins de deux jours un appel de soutien au recours lancé contre l’Etat pour inaction climatique, ont annoncé, jeudi 20 décembre, les quatre ONG à l’origine de l’action, qu’elles qualifient d’« affaire du siècle ». « La Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France souhaitaient un électrochoc. Il a eu lieu », soulignent-elles dans un communiqué commun.
Les quatre associations ont adressé lundi une requête préalable au gouvernement, accusé de « carence fautive » par son « action défaillante » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le défendeur a deux mois pour répondre, les ONG planifiant ensuite un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une première à l’échelle française.
Jeudi matin, plus d’un million de personnes avaient signé le texte de soutien, publié mardi sur le site de l’initiative. Pour ces quatre ONG, c’est « une mobilisation d’une ampleur inédite, en un temps record, qui démontre l’évolution de la prise de conscience citoyenne, la soif de justice et la volonté d’actes concrets sur le climat. Et elle ne fait que commencer ».
« Un million de personnes et sans doute plus demandent des comptes à l’Etat pour son inaction climatique, c’est historique », dit Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, pour qui « Emmanuel Macron ne peut plus se contenter d’effets de manche sur le climat ».
Selon les ONG, le site a reçu mardi et mercredi 1,25 million de visites uniques, avec des pics à 100 000 par heure. La vidéo l’accompagnant, à laquelle participent Juliette Binoche, Abd Al-Malik, Elie Semoun ou encore des youtubeurs comme McFly et Carlito, a enregistré 8,4 millions de vues sur Facebook.
j'attire l'attention notamment pour la lecture des deux textes suivants de 2009 et 2010 : pour moi, le "capitalisme vert" n'est pas une "nouvelle phase" appelée à remplacer le "capitalisme traditionnel". Pour l'heure c'est une concurrence entre secteurs industriels et commerciaux, qui rythme la concurrence pour le taux de profits, et décide(ra) aussi la survie de certains, on le voit par exemple avec la décision récente du gouvernement français de l'arrêt total de la filière charbon, ce qu'il en restait : intéressant d'observer, comme le suggère Adé, pour quoi se bat le prolétariat de ce secteur dans le monde...
cette hypothèse répond à la question de Pepe sur la dynamique révolutionnaire de l'écologie : elle anticipe donc de façon optimiste le fait que l'impossibilité d'un capitalisme entièrement vert donne une place essentielle à l'écologie dans une crise de reproduction, et par suite à un mouvement communiste proprement écologiste : proprement...
ces articles ont été écrits avant le bras de fer hyper-médiatisé entre Macron et Trump et autour des COPS (sic), qui symbolise un tournant, en gros la réalité de l'économie politique verte réalise son idéologie. Selon moi il est impossible que le "capitalisme vert" définisse entièrement le capitalisme qui vient, car même avec l'épuisement des dites énergies fossiles, les technologies telles que celles des éoliennes, du solaire, et du numérique en général exigent des matières premières toutes aussi soumises à l'extractivisme (terres rares, etc), et comme l'écrit Maxime Combes : « Le "vert" est difficile à différencier »
contrairement à mon ancien forum où durant des années j'avais accumulé sur toutes ces questions une solide matière première de documentation, je laisse ma lectorate creuser par elle-même, en jeune taupe qu'elle est
Réflexions sur le « capitalisme vert » Maxime Combes, Mouvements 2010/3 (n° 63), pages 99 à 110. Extraits
Quelle que soit l’appréciation que l’on puisse avoir de la réalité de ce « capitalisme vert » et de sa capacité à résoudre durablement les défis écologiques que nous connaissons, l’hypothèse d’une Green Economy pénètre les cénacles diplomatiques et les négociations internationales, révélant les différentes stratégies et positionnements des États de la planète.
« Les pionniers de l’or Vert », révolutionnaires ou simples capitalistes ?
Le capitalisme « traditionnel » ébranlé par le capitalisme « vert » ?
Le vert ne connaît pas la crise
Un modèle pas si différent…
Ces innovations « vertes » pouvant réduire la teneur en carbone de nos économies sont-elles suffisantes pour caractériser l’émergence d’une nouvelle phase du capitalisme ? Il est sans doute possible de leur attribuer des vertus dans la résolution de certains enjeux climatiques, parfois au détriment d’autres problèmes environnementaux. Mais ce n’est pas évident : l’économie de ressources naturelles obtenues par des technologies moins prédatrices ne serait-elle pas vite compensée par l’envolée de leur consommation (effet rebond) ? Il est improbable qu’elles puissent définir à elles seules la naissance d’un nouveau régime d’accumulation, et il semble difficile de définir une nouvelle phase du capitalisme par le seul niveau de technologies utilisées, sans tenir compte de l’évolution des rapports sociaux, de l’organisation de la société, de l’articulation entre les institutions étatiques et le marché. Est-on entré dans un « capitalisme vert » lorsque le foisonnement de ces innovations technologiques devrait aboutir à la disparition de 90 % d’entre elles, car elles sont non rentables de l’aveu même de leurs promoteurs ? Les fonds de capital-risque ne sont pas des philanthropes : s’ils se sont jetés à corps perdu dans ces nouveaux secteurs émergents, les taux de rentabilité financière exigés sont les mêmes que pour l’économie classique ! Toutes ces innovations technologiques sont supposées intégrer le modèle de rentabilité existant : autrement dit, l’intensité énergétique ne pourra baisser que jusqu’au point où cette baisse ne constitue pas une menace pour les taux de profit, même si les objectifs environnementaux nécessitent d’aller au-delà. Quand les perspectives de profits ne sont pas assurées, les acteurs économiques en appellent d’ailleurs à l’intervention publique, forcément limitée par les temps qui courent (la période est plus à la réduction des coûts et à sauver ce qui peut l’être qu’au lancement de grands plans d’investissement publics), afin d’assurer le développement de ces secteurs : ainsi, en France, le gouvernement devrait prendre en charge une grande partie des investissements initiaux pour implanter la voiture électrique. Pour mettre 2 millions de voitures propres sur les routes en France d’ici 2020, le gouvernement a consenti à investir plus d’un milliard d’euros pour développer des batteries (usine Renault/CEA de Flins) et les infrastrctures publiques de recharge, tout en promettant l’achat de 100 000 véhicules par les pouvoirs publics ; ou développer les techniques de séquestration du carbone dans le sol. L’Ademe doit engager 100 millions d’euros pour les cinq projets démonstrateurs français (Total, ArcelorMittal, Veolia, EDF, Alstom). Ce qui représente un investissement estimé à plus de 650 milliards entre 2020 et 2030, sur la base d’une réduction par trois des coûts de stockage (actuellement 100 euros la tonne) là où le prix de la tonne carbone est estimé à 100 ? : des profits considérables à venir. Rien de bien nouveau sous le soleil : sur la base de ces éléments, le modèle d’accumulation capitaliste actuel, par ailleurs en crise, ne semble pas dépassé. Il est tout au plus étendu par une vague d’innovations créant de nouveaux biens et services profitables. Verdir un monde industriel, ce n’est pas changer de modèle ! En effet, dans le même temps, les multinationales actuelles ne sont pas complètement dépassées par la montée de ce capitalisme vert : les multinationales de l’automobile multiplient les partenariats avec les start-up de la voiture électrique , tandis que les multinationales pétrolières suivent ces enjeux de près.
Le « vert » est difficile à différencier
Onu : la « Green Economy » va-t-elle supplanter le développement durable ?
Du côté des mouvements, l’hypothèse d’un « capitalisme vert » divise
Une hypothèse fondatrice
S’il paraît difficile d’accréditer la thèse d’une nouvelle phase du capitalisme, considérez que nous sommes à l’aube d’une véritable révolution énergétique est une hypothèse utile. Elle permet d’interroger en quoi les rapports entre les hommes, leur outil de travail et l’organisation de la société pourraient être profondément transformés. Là où la machine à vapeur a facilité le développement de l’usine et les grandes unités de production, l’électricité a été utilisée par les détenteurs de capitaux pour étendre la division du travail. Confrontées à la raréfaction des ressources énergétiques fossiles et au défi du changement climatique, nos sociétés s’engagent sans doute dans une nouvelle transition énergétique dont il n’est pas évident de prédire les effets. Sans même verser dans un déterminisme technologique naïf et simpliste, ceux-ci pourraient être très significatifs en fonction des choix qui seront effectués.
La « Terre-Mère » pour revisiter nos modèles ?
Questionner en profondeur l’hypothèse d’un « capitalisme vert » peut nous écarter de réponses toutes faites tout en éclairant les rapports de force et alliances à l’œuvre, dans la société, et dans les mouvements sociaux. Faut-il conclure que la seule évolution des prix ne pourra pas nous conduire vers une société sobre sur le plan énergétique, qu’aucun instrument fiscal n’est utile et efficace ? Certainement pas, une véritable transition écologique juste et égalitaire nécessiterait des investissements considérables. Comme l’écrit Isabelle Stengers, « on ne peut pas se fier au capitalisme pour réparer les dégâts dont il est le responsable. » Faut-il en conclure qu’il suffirait d’appeler à la « sortie du capitalisme » pour avoir résolu les problèmes conceptuels auxquels nous sommes confrontés ? Elle considère que « l’intrusion de la nature et notre appartenance à celle-ci » doit nous amener à modifier considérablement nos façons de penser la transformation du monde dans lequel nous vivons. De leur côté, les populations autochtones, notamment amérindiennes ont fait de la « Terre-Mère » la référence pour repenser l’articulation des activités humaines et les écosystèmes dans lesquelles elles se déploient. Quoique nous pensions de cette référence qui peut apparaître en partie mystique et donc étrangère à nos référentiels conceptuels hérités des Lumières, elle nous interpelle sur la nécessité de ne pas simplement repeindre en vert nos grilles d’analyses keynésiennes ou marxistes : les exigences du syndicalisme international demandant un accord international et le développement « d’emplois vert » sont à la fois insuffisantes et intéressantes car elles autorisent ces débats. En clair, si s’intéresser à la distribution – très inégalitaire – des biens et des maux environnementaux entre les peuples et les classes sociales est absolument nécessaire, le concept de Terre-Mère nous incite à considérer également les rapports entre êtres humains et le reste du monde naturel. Difficile, mais décisif...
"Le capitalisme vert est un oxymore" Un capitalisme vert est-il possible ? Michel Husson 8 décembre 2009
Sur le plan « strictement économique » il est possible d’imaginer un capitalisme vert compatible avec le maintien du taux de profit. Mais rien ne garantit que cette compatibilité soit assurée pour des niveaux d’économie d’énergie correspondant aux objectifs requis. Il faudrait postuler la possibilité de gains de productivité élevés et durables dans les branches produisant les technologies vertes qui rendraient viable un « fordisme vert » où ces gains de productivité compenseraient les coûts initiaux et permettraient (à condition de supposer que la part des salaires cesse de baisse, voire remonte au détriment des rentes financières) de garantir une croissance correspondante des débouchés salariaux. Dans le cas contraire, bien plus vraisemblable, on irait vers un capitalisme verdi plutôt qu’un capitalisme vert.
Le scénario du capitalisme vert suppose que l’on impose au capitalisme des règles qui ne lui sont pas naturelles. Sur bien des points, un tel scénario entre en contradiction avec les mécanismes fondamentaux de ce mode de production. L’introduction massive d’une écotaxe perturberait profondément le principe de concurrence entre capitaux individuels, elle freinerait la rotation du capital et ne déboucherait pas sur une structuration stable de l’économie mondiale.
Fondamentalement, l’hypothèse du capitalisme vert suppose un « choc exogène » brutal qui viendrait bouleverser profondément la configuration actuelle du capitalisme. Elle suppose en outre l’existence d’une instance planétaire assurant un degré accru de centralisation et l’édiction de normes mondiales qui vont, encore une fois, à l’encontre de l’essence concurrentielle du mode de production capitaliste.
Le capitalisme vert est donc un oxymore. L’hypothèse d’un tel régime d’accumulation repose sur une mauvaise compréhension des lois du capitalisme et sur une surestimation de sa capacité à faire face de manière rationnelle au défis environnementaux. Cette conclusion négative permet de pointer les spécificités d’une alternative éco-socialiste. Elle implique une planification à l’échelle mondiale et une remise en cause des modes de production et de consommation adéquats à la logique capitaliste. En termes économiques, cette alternative revendique une baisse significative du taux de surplus social ou en tout cas une transformation profonde de son contenu. Pour ne prendre qu’un exemple, la durabilité accrue des biens de consommation est en soi un facteur de baisse de la rentabilité.
Patlotch a écrit:Le "capitalisme vert", c'est la contradiction entre capital et écologie. C'est un "oxymore" (une contradiction dans les termes) dans la mesure où le capital ne peut pas accomplir l'écologie. Il en fait idéologie, économie politique pour sauver sa peau en se tirant une balle dans le cœur.
TAMBOURS SUR TEMPÊTES
Aux petits soldats de l'administration du désastre et de la soumission durable, de l'écologisme d'Etat et du capitalisme vert. Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. couverture. René Riesel et Jaime Semprun Encyclopédie des nuisances, 2008
12 attendus
Au temps pour tous importe
peu le vent amer
à contretemps
Qu'une saine colère
mette à la porte
l'ombre d'une chimère
Quand passe sur hier
la serpillière de l'hiver
un propre vers printemps
Que sombre dans l'oubli
le moment des poisons
pipi sur la moquette
Que s'efface la trace
de crasse et pollution
durable de l'esprit
Et leur autorité de la dissolution
mentale
à l'environ dément
Que brûle en sa poubelle
le déchet étatique
de l'égocitoyen
Qu'on lui décerne en prix
de sa bioconnerie
l'écolabel démocratique
Que sa gestion du même
crève d'indigestion
managériale
Que gronde la raison
quand tonne le critère
de notre exploitation
Qu'un sens impur génial
de la rébellion générale
abreuve nos sillons
D'une musique nouvelle
faites par tous non contre uns
avec tambours et tempêtes
Patlotch, 19 février 2010
19 décembre
Lola hors (ce) débat
Lola Miesseroff a écrit:« Je n'étais pas, en 1971, à la manifestation de Bugey qui marqua « l'irruption de l'écologie en tant que champ d'activité de toute première importance » et je dois avouer qu'il me fallut très longtemps pour prendre conscience du poids des préoccupations environnementales.»
Voyage en outre-gauche, paroles de francs-tireurs des années 68, Libertalia, février 2018, p.276
Adé a écrit:20:21 #25
Alors ce qui est “fondamental”,” n’apparaît pas l’être, et c’est bien là le problème, car en fait c’est l’inverse qui apparaît vraiment comme problématique séparée et autonome : l’histoire comme histoire de la lutte de classe. Les rapports entre sociétés et natures, ou milieux, ou biocénoses est une problématique dynamique dans la compréhension de l’histoire - pas seulement “moderne”- de l’humanité.
Et spécialement de l’humanité occidentale, dont le rôle, à cet égard a été décisif : c’est à partir de la “révolution Industrielle” que le taux de CO2 a grimpé en flèche. C’est à partir de là que le mouvement ouvrier prend force et lutte contre le capital pour le travail, et pour le développement des forces productives, à présent l’intégration parachevée, la classe strictement ouvrière se retrouve prise à son piège même et tenue de défendre sa position dans les secteurs les plus critiques (Nucléaire, Pétrole, Extractivisme, Automobile et Transports, Armement…).
C’est ce que les syndicats ouvriers continuent à faire : défendre le travail, et leurs clients de moins en moins nombreux, il est vrai.
La responsabilité du mouvement ouvrier est énorme, aboutissant à des luttes défensives à rebours de l’intérêt de tous, y compris d’eux-mêmes, par indifférence (teintée d’hostilité) envers l’environnement, de mépris envers les secteurs non-prolétarisés et indigènes sous couvert de nécessité historique inéluctable (le progrès, la civilisation et le toutime*), contribuant par là au colonialisme, au racisme et à l’idéologie dominante ethnocentrée et anthropocentrée.
* toutime : tout ce qui va avec, tout le reste...
Pas dynamique ça ?
Patlotch a écrit:19:15
"dynamique", ça dépend
1) ça dépend d'abord si l'on parle de la dynamique de la compréhension ou de celle de l'histoire, et ceci bien avant qu'elle ne devienne "moderne"
- la dynamique de la compréhension, ce serait la théorie de cette histoire
- la dynamique de l'écologie, c'est en tant qu'elle est, même avant d'être une science et nommée ainsi (à l'instar de la biologie), le fonctionnement systémique du vivant : humains, animaux, végétaux, minéraux compris, pour m'en tenir à des 'ordres' à l'ancienne. Voir mes rubriques et sujets de "chamane"
2) ça dépend ensuite si l'on parle d'écologie comme étant les luttes écologistes et/ou écologiques, avec la question militante... (même pb entre lutte de femmes et luttes féministes, luttes de racisé.e.s et luttes antiracistes, etc.) ou des rapports entre l'évolution du vivant (telle qu'initiée par Darwin comme combat pour la vie) et l'évolution des sociétés, ramenée ou pas à la lutte des classes
il y aurait des deux qui nous préoccupe dans une perspective révolutionnaire, mais on peut s'en tenir au point 2) partir des dits rapports, sociaux donc et "à la nature", et ceci bien entendu dans la phase historique qu'est le mode de production capitaliste (MPC), et secondairement de l'activité de tous so called si cool écologistes : les militants et les luttes c'est en tout deux choses différentes
et l'on peut commencer par l'influence de l'activité humaine sur son "environnement", terme qui dit déjà une extériorité à la nature, alors qu'il y a eu séparation, avant même la création des sociétés et la division du travail. Là, il faut chercher chez les anthropologues, historiens et même psychanalystes, des textes décoloniaux très instructifs en la matière, et chez Camatte, d'où mon intérêt non chamanique pour son œuvre > CAMATTE et NOUS
je parle du Camatte à partir des années 1980 (et un peu avant), c'est-à-dire de la période qui n'intéresse plus ceux qu'il avait inspirés à la fin des années 1960, post-ultragauche et communisateurs compris, avec lesquels il y eut rupture et sur laquelle ils restent là à répéter leurs bonnes raisons d'avoir encore raison, jamais les mauvaises d'avoir eu tort sur ces questions depuis 40 ans : tous ! Sauf Temps critiques par endroits, désolé. C'est malheureusement encore le cas des textes de Federico Corriente traduits par Adé. Et là c'est l'éternelle question d'une post-ultragauche confinée dans son "milieu", comme ce fut le cas avec le féminisme, le racisme, et donc maintenant les rapports humains-nature dans le capital qui en est la médiation : RS est un âne bâté quand il ironise sur ma formule simplifiée humanité-capital-nature
il est évident qu'entre autres et qu'on l'appelle comme on voudra, l'extractivisme est un enjeu de luttes antagonistes dans le capital parce qu'il draine en même temps toutes ces contradictions, de classe, de genre, de 'race' et de 'nature' : le capital détruit la vie, point barre
les populations indigènes (pas le parti du même nom) dont RS prétend que j'aurais pour eux un attrait "exotique", ils, et elles sont moins con.ne.s que "nous", et moins que lui singulièrement, quand elles parlent de la terre-mère ou vénèrent les arbres : ce forum est sous le signe des SÈVES...
et donc en conséquence pour revenir à la question de pepe, pour toutes ces raisons en poupées russes, oui « l'écologie est une problématique “dynamique” dans la compréhension de l’histoire moderne de l’humanité », et au-delà dynamique dans la lutte pour sa survie : sans écologie pas de mouvement du communisme
alors ramener ça à une dialectique de contradictions simples ou doubles, triples ou complexes, principales, essentielles ou secondaires, personnellement je m'en fous ou plutôt je n'ai pas besoin de ce genre de conceptualisation hérité de Lénine via le diamat (matérialisme dialectique) stalinien. Ces contradictions sont antagoniques et nous les vivrons de plus en plus comme telles, et nous battrons pour cette raison : vitale ! Vitaliste je suis ? Tant pis
mais rendons à Pepe ce qui lui appartient
- je n'ai pas utilisé le terme ("concept" ?) d'intersectionnalité, j'ai réglé ça aussi, je n'en ai pas besoin, peut-être parce que je ne suis pas professeur d'université ? Va savoir
- je ne répondrai à aucune critique de mes considérations comme relevant de la French-Theory et autres conneries pour ou contre le grand fourre-tout du post-modernisme, Foucault and co. Poil auharicotzob
je laisse ça aux "happy few" de Roland Simon
Dernière édition par Patlotch le Sam 23 Fév - 8:05, édité 1 fois
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
pour comprendre de débat, remonter les commentaires précédents. Ce texte reçu via Plateforme d'Enquêtes Militantes @PlatEnqMil me paraît a priori une synthèse bienvenue des questions actuelles, mais je me réserve des commentaires ultérieurs
Les cinq semaines qui nous séparent maintenant du début du mouvement des gilets jaunes nous offrent le recul nécessaire à la formulation de quelques hypothèses sur le rapport qu’il a et, espérons-le, pourra continuer d’entretenir avec l’écologie politique. Ce sont en fait trois hypothèses très générales que nous voudrions à cet égard avancer : la première est que quel que soit l’avenir de ce mouvement, il a d’ores et déjà contribué à politiser de manière décisive la question écologique. La seconde est qu’il répond lui-même à des causes écologiques, ce qui ne prédétermine cependant en rien son devenir émancipateur. La troisième est qu’en conséquence, l’écologie politique se présente plus que jamais comme un 'kampfplatz' au sein duquel s’affrontent différentes tendances entre lesquels il faudra bien trancher.

quelques liens et illustrations à retrouver dans l'original
Force jaune / vert / rouge
F. A. P. de la Pateforme d'Enquêtes Militantes 26 Décembre 2018
F. A. P. de la Pateforme d'Enquêtes Militantes 26 Décembre 2018
Les cinq semaines qui nous séparent maintenant du début du mouvement des gilets jaunes nous offrent le recul nécessaire à la formulation de quelques hypothèses sur le rapport qu’il a et, espérons-le, pourra continuer d’entretenir avec l’écologie politique. Ce sont en fait trois hypothèses très générales que nous voudrions à cet égard avancer : la première est que quel que soit l’avenir de ce mouvement, il a d’ores et déjà contribué à politiser de manière décisive la question écologique. La seconde est qu’il répond lui-même à des causes écologiques, ce qui ne prédétermine cependant en rien son devenir émancipateur. La troisième est qu’en conséquence, l’écologie politique se présente plus que jamais comme un 'kampfplatz' au sein duquel s’affrontent différentes tendances entre lesquels il faudra bien trancher.

quelques liens et illustrations à retrouver dans l'original
Un se divise en deux
Les raisons d’avancer l’hypothèse selon laquelle les gilets jaunes ont fait passer les préoccupations écologistes d’un stade moral à un stade politique ne manquent pas [1]. Commençons par le plus évident : le mouvement s’est constitué en réaction à l’annonce d’une « taxe carbone » censée « libérer les ménages de leur dépendance au pétrole » et favoriser ainsi la « transition écologique » annoncée par Macron depuis sa campagne présidentielle. Très vite, il a cependant fait éclater au grand jour la dimension purement idéologique de cette transition, au double sens que peut recevoir le concept d’idéologie : un discours faux, ou illusoire, dont la fonction principale est de légitimer une politique de classe.
Que la « transition écologique » annoncée par Macron soit illusoire, c’est ce que suffirait à démontrer la disparition du terme même « d’écologie » de l’allocution présidentielle du 11 décembre dernier. Mais c’est également ce qu’ont souligné différents observateurs, en rappelant que la taxation des ménages est écologiquement inutile tant qu’on laisse libre cours au capital des grandes entreprises dont l’accumulation repose sur la consommation exponentielle d’énergies fossiles [2]. Quant au fait que la « transition écologique » invoquée par Macron n’ait guère d’autres fonctions que de justifier une politique de classe, c’est ce qui transparaît du discours même des gilets jaunes, qui ont immédiatement affirmé leur refus de faire payer au travail le coût de la destruction environnementale causée par le capital fossile. C’est ainsi que la mobilisation des gilets jaunes a polarisé le camp écologiste lui-même en une tendance mainstream, pour ne pas dire bourgeoise, et une tendance plus radicale et militante. Un se divise en deux.
Certes, l’hégémonie qu’exerce le gouvernement sur les préoccupations environnementales avait déjà été affaiblie par la démission de Nicolas Hulot, qui n’a pu que reconnaître qu’ « on s'évertue à entretenir et réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres [3] ». On sait cependant que pour transformer une affaire gouvernementale en crise de gouvernementalité, il faut bien plus qu’un changement de personnel politique. Il faut une intervention populaire de masse, possédant une force qui soit à la fois suffisante pour imposer ses revendications au pouvoir et pour marginaliser en son propre sein les relais de ce dernier. Que cette force soit en train de se construire, c’est peut-être ce dont témoignent certains événements qui ont « perturbé » l’habituellement très inoffensive « marche pour le climat » du 8 décembre dernier : WWF n’y a pas participé, à Nancy, on en a interpellé les co-organisateurs et elle a convergé avec les gilets Jaunes à Montpellier comme à Paris, où un cortège de tête notamment animé par les militant.e.s d’Ende Gelände en a disputé la direction aux « colibris » libéraux sous les mots d’ordre : « qui sème le capitalisme, récolte le cataclysme » et « tout brûle déjà » [4].
Au-delà de ces conflits internes à la marche pour le climat, c’est l’intelligence tactique déployée par les gilets jaunes qui annonce un tournant antagoniste de l’écologie politique. Toutes les tendances de la radicalité contemporaine s’accordent à le souligner, de deux manières au moins. Ou bien on soutient à la suite de Joshua Clover et de Lundi Matin que les pratiques des gilets jaunes (incendie de voitures, pillage des magasins, blocage de la circulation) sont intrinsèquement porteuses d’une signification écologique parce qu’elles s’attaquent directement aux conditions matérielles de la destruction de la nature [5]. Ou bien on considère avec Andreas Malm, que ces pratiques définissent un répertoire d’action dans lequel devront puiser à l’avenir les militant.e.s écologistes [6]. Dans les deux cas, on voit se profiler la possibilité de convergences pratiques autour de quelques cibles – entreprises polluantes, GAFA et entrepôts de la logistiques – symbolisant aussi bien l’injustice fiscale que l’injustice sociale et écologique.
Pourtant, on ne saurait s’en tenir à ce relevé des affinités tactique entre gilets jaunes et écologie politique. Il ne suffit en effet ni à rendre compte des motifs écologiques de la révolte, ni à lui ouvrir un horizon stratégique émancipateur.
« On est chez nous »
Que le mouvement des gilets jaunes n’ait pas seulement produit des effets politiques sur l’écologie, mais qu’il réponde lui-même en partie à des causes écologiques, c’est ce dont témoigne éloquemment son ancrage territorial. Car occuper les ronds-points, ce n’est pas seulement bloquer la circulation des personnes et des choses, c’est aussi tenter de se réapproprier les espaces les plus typiques du capitalisme tardif, ceux qu’on croyait définitivement perdus pour la lutte parce que leur fonction est précisément de segmenter les foyers de luttes en « centres » urbains et « en périphérie » péri-urbaines et rurales, avant de les relier par des infrastructures routières sur lesquelles circulent des automobilistes atomisés. Si l’on ajoute que la réappropriation de ces espaces a été l’occasion d’une recomposition, sur un mode contestataire, de formes de sociabilités locales dont la cartographie ne recoupe pas celle des espaces du capital [7] – les sociabilités du quartier, du café ou du club de sport – on en conclura qu’avec le mouvement des gilets jaunes, c’est tout un mode de vie, qui commence à entrer en crise [8].
Au risque d’être schématique, on peut dire que cette crise répond à des facteurs indissociablement matériels, politiques et symboliques. D’un point de vue matériel, elle s’explique tout d’abord par l’épuisement des ressources énergétiques nécessaires pour faire tourner les usines et chauffer les foyers, alimenter les automobiles ou éclairer en permanence les grandes surfaces, bref pour assurer le cycle production – reproduction – circulation – consommation. D’un point de vue politique, elle répond à l’effondrement du compromis keyneso-fordiste et à la perte de légitimité d’un État dorénavant incapable de neutraliser par les salaires et les services publics les effets explosifs des inégalités socio-spatiales. D’un point de vue symbolique, enfin, elle se traduit par l’effritement des représentations du « social » comme d’un ensemble de relations interhumaines se déployant sur le fond neutre d’une « nature » exploitable à merci. Or, c’est précisément l’agonie de ce mode de vie hérité d’une phase dépassée du capitalisme qu’exprime dans toute son ambiguïté l’un des slogans les plus repris par les gilets jaunes : « on est chez nous ! ».
D’un côté, et en se plaçant à un haut niveau de généralité, on peut interpréter ce slogan comme l’expression d’un refus de l’aliénation, puisqu’être aliéné, c’est précisément éprouver le sentiment de ne pas être chez soi dans ce monde que le capital a peuplé d’autoroutes et de centres commerciaux, de banlieues pavillonnaires et d’entrepôts. Dans cette première perspective, le slogan « on est chez nous » exprime donc la revendication d’un pouvoir : celui de décider collectivement des modalités d’organisation et de configuration des territoires qu’on habite, que ce soit à travers des expériences d’auto-organisation radicales, comme sur les ZAD, ou en réclamant des services publics de proximité, voire en invoquant un « Référendum d’initiative citoyenne » qui risque fort de transformer l’énergie politique libérée par les gilets jaunes en simple instance de validation des décisions gouvernementales [9]. Nous y reviendrons.
D’un autre côté, il est difficile de ne pas entendre dans ce slogan l’expression des tendances nationalistes du mouvement, dont témoigne par ailleurs la présence massive de drapeaux bleu-blanc-rouge lors des manifestations des gilets jaunes. Macron ne s’y est d’ailleurs pas trompé, lui qui n’a pas hésité à ressortir la tarte à la crème raciste du « débat sur l’identité nationale » lors de son allocution télévisée [10]. Dans cette seconde perspective, le « on » qui affirme être « chez soi », n’est pas la singularité quelconque dont rêvent aussi bien les populistes que les apôtres de la destitution [11] : c’est le Blanc prolétaire ou en voie de prolétarisation, revendiquant son enracinement dans un territoire national qu’il entend protéger des assauts des « migrants » ou purger de la présence d’une population non-blanche entraînant derrière elle son cortège d’ « assistés ». L’horizon politique de ce slogan n’est alors ni la démocratie locale, ni l’autogestion territoriale, mais un autoritarisme vert se saisissant de l’urgence climatique pour relancer l’accumulation du capital à grand renfort de géo-ingénierie et intensifier la guerre aux pauvres et aux migrants via la militarisation des frontières et la répression policière de toute forme d’opposition.
Ce scénario n’est certes pas le seul possible, mais c’est peut-être le plus probable, tant le Rassemblement National, d’une part, et l’écologie réactionnaire, de l’autre, s’accordent aujourd’hui à associer la défense du Sol à celle de la Famille sous les auspices de la Tradition [12]. Or, on sait depuis Ernst Bloch le prix qu’a historiquement payé le mouvement ouvrier pour avoir abandonné la question du rapport à la terre aux fascismes : le prix de sa propre destruction et, avec elle, de l’extermination des populations jugées « étrangères » au corps sain des nations européennes. Nous n’en sommes sans doute pas là, mais les raisons restent fortes d’intervenir au sein des luttes de tendance qui animent l’écologie politique.
Le kampfplatz écologiste
La question qu’il faut à présent poser est donc la suivante : quelles forces, parmi celles qui se disputent aujourd’hui la formulation d’une écologie progressiste, sont-elles susceptibles de donner corps aux aspirations à une autre manière d’habiter le territoire qu’ont exprimé les gilets jaunes ? Prenant là encore le risque du schématisme, on peut distinguer trois tendances, qui tendent parfois à se recouper.
La première tendance se caractérise par des modalités d’action « citoyennes » : elle place tous ses espoirs dans la formation d’un corps de citoyens éclairés, organisé en associations soutenues par des ONG dont l’objectif est de peser, par la voie de pétitions, du lobbying ou d’actions en justice sur les décisions des gouvernements. À cet égard, il est tout à fait significatif que « l’Affaire du siècle [13] », ce projet lancé par des ONG qui entendent attaquer l’État en justice pour non-respect de ses obligations climatiques, intervienne au moment même où le mouvement des Gilets Jaunes revendique la mise en place d’un « Référendum d’Initiative Populaire ». Certes, là où la campagne « l’Affaire du siècle », dont la pétition a à ce jour récolté plus de 800 000 signatures, vise à faire jouer les tribunaux administratifs pour rendre la politique gouvernementale conforme à son programme et au droit international, le « RIC » vise quant à lui à peser directement sur le gouvernement, en le contraignant à mener une politique décidée par « le peuple ». Mais dans les deux cas, l’État apparaît à la fois comme la cause des obstacles à la justice sociale et environnementale et comme la solution toute trouvée à la résolution de la crise. À cette première contradiction s’en ajoute une seconde : le Référendum comme la Pétition tendent à saper la légitimité de la représentation parlementaire tout en s’adressant au gouvernement dans l’espoir qu’il assure un élargissement des pouvoirs démocratiques. Or, cette nouvelle alliance entre écologie citoyenne et référendum populaire ne risque pas seulement d’étouffer l’inventivité pratique qui s’est déployée dans la rue et sur les ronds-points. Elle est également vouée à l’échec. Car d’un côté, le Référendum vise à produire des lois sans avoir les moyens de les discuter ou de les appliquer. De l’autre, la Pétition vise à contraindre l’État à appliquer la loi sans avoir les moyens de la produire. Une même question se trouve ainsi contradictoirement posée et neutralisée : la question du pouvoir.
C’est précisément cette question qu’affronte directement la seconde tendance, qui cherche à réinventer dans un monde qui se réchauffe la stratégie classique du mouvement ouvrier : celle de la prise du pouvoir d’État dans le but d’assurer la transition écologique et énergétique grâce à une planification de l’économie [14]. Cet objectif stratégique est susceptible de différentes variations tactiques, de la « révolution citoyenne » appelée de ses vœux par la France Insoumise à l’appel à « assiéger et prendre d’assaut les palais » pour lutter contre le « réchauffement climatique global [15] » lancé par Andreas Malm. L’argument selon lequel seul l’État concentre un degré de force suffisant pour exproprier les grands pollueurs ne manque assurément pas de poids, de sorte que cette seconde position apparaît plus adaptée à l’urgence climatique et à l’ampleur des changements économiques et sociaux qu’elle impose. Mais il n’est pas sûr qu’elle soit plus réaliste, et ce pour des raisons aussi bien structurelles que conjoncturelles. D’un point de vue structurel, l’État néolibéral qu’incarne aujourd’hui le gouvernement Macron n’est plus l’État national-social que les institutions du mouvement ouvrier pouvaient investir, et dont on voudrait aujourd’hui s’emparer pour forcer des mesures de justice sociale et climatique. C’est l’État-entreprise ou managérial, simple relais du « capitaliste collectif » dont parlait Engels et qui agit dorénavant à l’échelle de l’Union Européenne. Il n’est donc plus un moment, ou un espace, de la lutte des classes, mais son principal acteur. Or, d’un point de vue conjoncturel, c’est la conscience de ces transformations de la forme-État qu’ont exprimé en pratique les gilets jaunes par leur refus de la représentation et de la négociation. Ignorer ce refus, c’est ouvrir un boulevard aux tendances les plus nationalistes du mouvement, dont on a déjà souligné qu’elles pouvaient aisément déboucher sur un autoritarisme vert face auquel le souverainisme social repeint aux couleurs bleu-blanc-rouge de la FI ferait pâle figure.
Reste donc une troisième tendance, qu’on peut qualifier de « communaliste » : sa tactique, c’est la réappropriation des territoires, l’ouverture d’espaces sur lesquels peuvent s’expérimenter d’autres modes de vie et d’autres rapports à la terre. Le cycle d’occupation des places ou les ZAD en sont des exemples dorénavant classiques, avec lesquels la construction de cabanes sur les ronds-points ou l’occupation d’une ancienne sous-préfecture à Saint-Nazaire entrent aujourd’hui en résonance [16]. On a ici affaire à des modalités d’action par lesquelles la lutte se construit contre l’État, ne serait-ce que parce qu’elle déborde les formes qu’il impose habituellement aux mobilisations. Mais l’horizon stratégique de ces luttes est quant à lui plus flou : s’agit-il d’amorcer un processus d’expansion des communes, voire de l’instituer sous la forme d’un néo-fédéralisme qui se substituerait progressivement au maillage économique du Capital et au zonage administratif de l’État ? Ou s’agit-il plutôt de jouer le second de ces espaces contre le premier, d’investir par exemple les mairies pour les transformer en relais des revendications émises par les gilets jaunes dans l’espoir de briser de l’intérieur l’unité des appareils d’État plutôt que de s’en emparer [17] ? En d’autres termes : faut-il se situer hors et contre l’État, ou dans et contre lui ? La question est ouverte, mais ce qui est sûr, c’est que la stratégie d’occupation communaliste des territoires rencontrera fatalement, lorsqu’elle ne l’a pas déjà rencontré comme à Notre-Dame-Des-Landes, la question communiste de la propriété privée. Car aujourd’hui comme hier, c’est autour de cette question que s’articulent la domination politique et l’exploitation économique. Et aujourd’hui plus qu’hier, seule la résolution de cette question, sous des modalités à réinventer, laisserait espérer une véritable abolition du capitalisme fossile. Soulever la question de la propriété privée du sol et des moyens de production au sein des gilets jaunes ou de ce qu’ils deviendront, faire en sorte que le jaune et le vert tirent vers le rouge, voilà en tout cas la forme que pourrait prendre notre intervention.
[1] Nous avons déjà souligné ce point dans notre éditorial.
[2] Cf. l'article de Maxime Combes.
[3] Pour l'explication des raisons de son démission, voir ici.
[4] Cf. l'article paru sur lundi.matin.
[5] Joshua Clover a souligné ce point sur AgitationAutonome.
[6] Cf. Andreas Malm sur Contretemps.
[7] Voir ici.
[8] Cf. l'article de Pierre Charobonnier sur Mediapart. Pour l’élaboration du concept de « mode de vie », entre marxisme et écologie politique, voir l'entretien avec Ulrich Brand paru sur la revue Période.
[9] Cf. ici et ici.
[10] Cf. notre article.
[11] Cf. les notes de Félix Boggio Éwanjé-Épée sur Contretemps.
[12] Nous renvoyons à l'article de Zoé Carle paru sur Mediapart.
[13] Cf. ici.
[14] Cf. l'article de Cédric Durand et Razmig Keucheyan sur Libération.
[15] Nous renvoyons encore à Andreas Malm.
[16] Cf. ici.
[17] Voir l'article d'Etienne Balibar sur Mediapart.
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
notre guerre à la guerre contre "l'homme" et la "nature"
est une guerre contre le capital, mais pas seulement
dans ce débat fondamental bien que relégué à l'arrière-plan (comme les migrants, au demeurant, et la tragédie en Manche), recension d'un petit livre. Débat refusé par le milieu communisateur, qui n'est pas à un retard de quarante ans près. Dernier avatar, la tentative avortée de Adé d'y revenir chez dndf, avec cette sanction définitive de Pepe : « Aujourd’hui, le Capital, c’est l’humanité… » Je ne partage pas la réponse de Adé : « Mais d’où sort-il ce capital-humanité ? Il sort de l’Occident... la civilisation occidentale capitaliste est responsable, pas l’humanité » qui est le meilleur moyen de s(e faire) enfermer dans un faux problème aujourd'hui
quant à l'étude des "rapports passés entre l'humanité et la nature", puisqu'il y eut le moment de la séparation (cf Camatte...), et pour autant qu'à cette époque on puisse parler de l'humanité comme un tout, la piste anthropologique est un gage de sérieux, y compris scientifique, plus que les inepties de RS/TC dans un jésuitisme dont il a le secret (voir débat plus haut). Je pense néanmoins qu'il a raison concernant les père et fils Mattick, mais cela était sorti du sujet par une citation malencontreuse du Junior : « Si le déclin de l’approvisionnement en pétrole et les catastrophes causées par le changement climatique ne provoquent pas une transformation majeure de la vie sociale, il est difficile d’imaginer ce qui pourra le faire », phrase qui par sa généralité ne mange pas de pain et quitte la question importante posée par Pepe lui-même le 19 décembre ici, qui me semblait digne de poser le débat sur de bonnes bases : « Et c’est vrai que l’écologie, posée comme problématique séparée et autonome, et quand bien même elle traite de ce qui est le plus fondamental (la survie ou pas de la planète), n’apparaît pas vraiment comme une problématique “dynamique” dans la compréhension de l’histoire moderne de l’humanité. »
ce débat essentiel du point de vue de la pensée révolutionnaire reviendra, pour sûr. J'ai préféré ne pas m'en mêler chez dndf (je continue à y être censuré, et ne suis pas maso) parce que l'heure est plutôt à serrer les boulons dans la théorisation du conflit actuel et que nous ne sommes pas trop nombreux à tenir un certain cap commun (cf la théorie communiste honteuse parce que jugée has been, anti-jauniste primaire ?). Disons même qu'il n'est pas étranger aux ressorts les plus profonds quant à la question de la violence dans le conflit "des gilets jaunes" et de l'étrange fascination esthétique qu'elle procure (Riot Porn etc. voir les commentaires de synthèse ces jours derniers). Pour moi, la nature de l'homme, pour autant qu'il en ait une hors ses rapports sociaux (Marx) n'est certainement pas de « faire la guerre à la nature », mais quand il la fait, c'est à lui-même par contrecoup. Il faudra bien qu'un jour il apprenne à faire la guerre contre sa pulsion de mort
La nature de l’homme : faire la guerre à la nature
Jean-Pierre Tuquoi, Reporterre, 11 janvier 2019
Jean-Pierre Tuquoi, Reporterre, 11 janvier 2019
Depuis trois millions d’années, explique Laurent Testot, dans « Cataclysmes », l’humanité fait la guerre à la nature. Mais, si l’homme est « une machine à tuer », il est aussi capable de coopération, qualité qu’il est plus que temps de mettre en branle.

Rendons grâce à la publication de Cataclysmes en format poche. Elle offre au critique l’occasion de se racheter et de parler d’un livre injustement passé sous silence dans ces colonnes à sa sortie en 2018. Car c’est un livre passionnant (couronné par l’Académie française), érudit mais fluide, ambitieux mais solidement étayé — comme on le dirait d’un bâtiment — que nous offre l’auteur, Laurent Testot, un journaliste davantage familier des revues de sciences humaines et d’histoire que de la rubrique sports ou faits divers [1].
Les relations entre l’homme et la nature constituent le fil conducteur de l’ouvrage, qui couvre plus de trois millions d’années, des premiers bipèdes à l’homme du XXIe siècle. La période est démesurée, vertigineuse, pleine de bruits et de fureurs. Les lieux sont infinis, instables, changeants. Pour éviter la noyade éditoriale autant que les raccourcis trompeurs, l’auteur a eu la sagesse de donner des coups de projecteur dans la grotte infinie du temps. Il en a sélectionné sept, pour leur caractère « révolutionnaire ». Ce sont autant de jalons qui permettent de faire le point, de raconter l’émergence et le triomphe d’Homo sapiens, de comprendre la domestication du chien et la place de l’éléphant dans l’histoire, de sauter du continent américain à l’Australie et des Aztèques aux aborigènes, de voir naître sous nos yeux des kyrielles de religions et d’école de pensée sur une période relativement brève, d’assister aux triomphes d’empires guerriers et à leur chute, de voir la végétation d’un continent changer du tout au tout sous l’influence des humains, de saisir les conséquences d’une modification brutale du climat au lendemain d’une éruption volcanique… L’histoire est saucissonnée mais globale.
« Nous sommes devenus les seigneurs du monde »
De ce voyage au long cours, qui s’appuie sur une bibliographie imposante (largement anglo-américaine), émergent deux constats clés. Le premier concerne le lien entre l’homme et la nature, les deux acteurs du livre. Depuis toujours, ces deux-là sont inséparables. L’un ne va pas sans l’autre. L’espèce humaine influence la nature autant que celle-ci pèse sur l’homme. Sauf qu’entre eux, il s’agit moins d’un mariage ou d’une cohabitation que d’un combat permanent. L’humanité « livre une guerre à la planète », écrit Laurent Testot qui, entre deux exemples, ajoute : « Nous avons dompté l’énergie sous forme de feu. Nous avons brûlé les couverts forestiers, détruit les grands animaux, colonisé et altéré tous les biotopes de la Terre (…) Nous sommes devenus les seigneurs du monde » avant de le domestiquer progressivement à notre seul profit.
Mais à quel prix, cette victoire ? Quel est le montant de la facture ? Et qui pour la payer ? « Tel Prométhée, écrit encore Testot, nous avons dompté le feu [avant de] découvrir qu’il nous dévore de l’intérieur. [L’Homme] a terrassé les épidémies, il vit mieux et plus longtemps. Mais il le paye de cancers, de diabètes et de maladies cardio-vasculaires, dont une bonne part est causée par les invisibles altérations qu’il a infligées à l’environnement. »
L’autre idée-force de l’ouvrage touche à la nature de l’homme. L’histoire longue témoigne qu’il est une « machine à tuer », conditionné pour « penser en termes offensifs », « un hyper prédateur [en] état permanent de belligérance » avec l’environnement. Mais, ajoute Testot, l’être humain n’est pas fait d’une seule pâte. Il également capable d’empathie, de compassion, et ce trait spécifique « nous permet d’opérer des miracles de coopération au point de briser les limites naturelles auxquelles le reste du vivant est soumis ».
C’est ce volet positif qu’il faut actionner pour réparer les dégâts commis à l’heure du réchauffement climatique, insiste Laurent Testot, en homme raisonnablement optimiste (ce que le titre de l’ouvrage ne laisse pas deviner). « L’homme doit se réveiller d’urgence, conclut-il. Il lui est encore possible de changer le regard qu’il porte sur le Monde, ce qui revient à mettre en cause sa nature même. Ne plus rêver d’amoralité, mais s’employer à donner la pleine mesure de son altruisme. L’étendre à toute l’humanité et aux animaux. »
[1] À noter que Laurent Testot a depuis publié un autre livre, qui est dans le droit fil de Cataclysmes. Il s’agit de Homo canis. Une histoire des chiens et de l’humanité, édité chez Payot-
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
pour les débats et controverses théoriques, voir plus haut
via tweeter @rebel_workers « La forêt amazonienne victime des mafias capitalistes. Derrière les petits garimpeiros illégaux les capitaux des grandes mafias capitalistes. »
Campaigners release map showing scale of pollution and damage to environment caused by small-scale miners

The Munduruku indigenous lands in Para state in Brazil’s Amazon basin,
where illegal mines have been discovered.
Photograph: Vinicius Mendonca/AP
signalé par Priscillia Ludosky, gilet jaune, noir, vert
1. la transition écologique du capital à l'ancienne : Macron transforme l'or en fric
2. L'exploitation illégale de la forêt amazonienne est devenue une «épidémie»
2. L'exploitation illégale de la forêt amazonienne est devenue une «épidémie»
Illegal mining in Amazon rainforest has become an 'epidemic'
Dom Phillips in Rio de Janiero The Guardian 10 Dec 2018
Illegal mining in Amazon rainforest has become an 'epidemic'
Dom Phillips in Rio de Janiero The Guardian 10 Dec 2018
via tweeter @rebel_workers « La forêt amazonienne victime des mafias capitalistes. Derrière les petits garimpeiros illégaux les capitaux des grandes mafias capitalistes. »
Campaigners release map showing scale of pollution and damage to environment caused by small-scale miners

The Munduruku indigenous lands in Para state in Brazil’s Amazon basin,
where illegal mines have been discovered.
Photograph: Vinicius Mendonca/AP
An epidemic of illegal artisanal mining across the Amazon rainforest has been revealed in an unprecedented new map, pinpointing 2,312 sites in 245 areas across six Amazon countries.
Called garimpo in Brazil, artisanal mining for gold and other minerals in Amazon forests and rivers has been a problem for decades and is usually illegal. It is also highly polluting: clearings are cut into forests, mining ponds carved into the earth, and mercury used in extraction is dumped in rivers, poisoning fish stocks and water supplies. But its spread has never been shown before.
“It has a big impact seeing it all together,” said Alicia Rolla, adjunct coordinator at the Amazon Socio-environmental, Geo-referenced Information Project, or RAISG, which produced the map. “This illegal activity causes as many social as environment problems and we hope there can be coordinated actions from the countries impacted to prohibit it.”
Its publication comes weeks before Brazil’s far-right president-elect, Jair Bolsonaro, takes office on 1 January. Last year Bolsonaro said he practised artisanal gold mining during his holidays in the 1980s and he has won support from garimpeiros (artisanal miners) with promises to help them work with “dignity and security”. He also wants to legalise mining on protected indigenous reserves where it is currently banned.
The map was produced by a network of non-government, environmental groups in six Amazon countries – FAN in Bolivia, Gaia in Colombia, IBC in Peru, Ecociência in Ecuador, Provita and Wataniba in Venezuela, and Imazon and the Instituto Socioambiental in Brazil. It also includes information where available on what was being mined and when, citing sources that vary from government registers to satellite imagery.
In 37 cases, the groups say illegal artisanal mining took place in protected indigenous reserves, 18 of which were in Brazil. Another 78 reserves showed garimpo taking place along their limits and borders – 64 of them in Peru – and 55 nature reserves also had illegal mining.
An accompanying “story map” in English has maps, videos and interviews, detailing cases, such as the Amarakaeri Communal Reserve in Puerto Luz in Peru, where indigenous people said they had been forced into artisanal mining because the devastation it wrought in their region left no other options to survive.
The mercury used in gold extraction is affecting indigenous and local populations who live or work near mine sites, it said. In Venezuela – which has the highest number of mining sites – and Colombia, illegal mining often happens in areas where irregular armed groups operate.
Nilo D’Avila, campaigns director at Greenpeace Brasil, said the map confirmed his own research showing garimpo is increasing in the Amazon.
“There is a garimpo epidemic in Brazil,” he said. “We are talking about impact on biodiversity and forests, we are talking about the use of mercury, we are talking about stealing riches from indigenous people and from Brazil.”
Carlos Young, a professor of economics at the Federal University of Rio de Janeiro and a specialist in environmental economics connected to illegal deforestation and the trade in drugs and arms, said garimpo camps can bring in alcohol and prostitution, causing negative impacts on forest communities.
“It is also a map of crime, of the drug trade, of prostitution. There are diverse nuances of this crime, of this illegality, that demands integrated governance,” he said. The map also shows how prevalent garimpo is in border regions, he noted, adding that Bolsonaro’s plans to neuter environmental agencies will encourage it more.
“If I want to guarantee national sovereignty I need more inspections and control and not the contrary,” he said.
The map also shows how close many illegal sites are to legal mining concessions. That came as no surprise to Laura Sauls, a PhD candidate at the geography school at Clark University in Massachusetts, and one of a group of international scientists behind another report that showed how legal mining and associated infrastructure works increasingly threaten forest cover and community rights by enabling “population movements and agricultural expansion further into the forest”. In some cases, she said, garimpo comes too. “I would expect there to be illegal mining in areas where there is a large mine,” she said.
1. la transition écologique du capital à l'ancienne :
Macron transforme l'or en fric
Macron transforme l'or en fric
signalé par Priscillia Ludosky, gilet jaune, noir, vert
Montagne d'or en Guyane : c'est inédit,
l'ONU accuse la France de non-respect des droits indigènes
Guillaume Balay TerraDarwin 11 janvier
l'ONU accuse la France de non-respect des droits indigènes
Guillaume Balay TerraDarwin 11 janvier
Il fallait s'y attendre. Alors que le projet "Montagne d'or" en Guyane se profile à grands pas, l'Organisation des Nations Unies a décidé de réagir. Elle "somme" la France de suspendre le projet jusqu'à ce que les populations autochtones locales aient pu être consultées correctement. C'est la première fois dans l'histoire que l'ONU intervient directement contre l'État français. La transition énergétique semble bien loin de toute préoccupation politique de ce côté-là de l'océan.
Site d'orpaillage illégal en Guyane. Crédit photo: WWF
Le projet "Montagne d'or", géré par un consortium russo-canadien (Nordgold et Colombus Gold) est au centre d'une polémique aujourd'hui internationale. Alors que l'avenir des populations autochtones semble de plus en plus incertain, la gigantesque mine à ciel ouvert pourrait bien signer l'arrêt de mort de toute une partie de la biodiversité guyanaise, mais également être lourde de conséquences pour les indigènes vivant près du site.
Carte de Guyane. Crédit : WWF
Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l'ONU demande donc au gouvernement français de revoir sa copie. Selon le Comité, les populations locales n'ont pas été consultées, ou du moins que très peu, sur le sujet. Le risque est de voir la situation tourner au conflit. "Ce genre d’infractions est malheureusement courant en Amérique du Sud et en Asie, mais c’est la première fois que Paris est rappelé à l’ordre pour un manque de respect des droits autochtones" souligne Vincent Ploton du Service international pour les droits de l’homme, au sein de l'ONG ISHR.
Un véritable paradoxe quand on sait que depuis maintenant quelques mois, la transition énergétique est sur toutes les lèvres. Rappelons que ce projet, s'il est mis en place, sera responsable d'une pollution massive de la forêt primaire de Guyane. Les sols seront inutilisables pendant des centaines d'années et des milliers d'hectares seront déforestés.
Le Comité souligne qu'aucune mesure éthique n'a été prise pour protéger les terres amérindiennes, "en dépit de l'impact négatif du projet minier sur le contrôle et l'usage des populations indigènes et de leurs terres, notamment les menaces pesant sur les écosystèmes, la déforestation et les sites archéologiques" explique l'ONU. La France a maintenant jusqu'au 4 avril prochain pour démontrer au monde que le droit indigène guyanais ne sera pas bafoué au profit de quelques cailloux dorés...
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
pour les débats et controverses théoriques, voir plus haut
sans commentaire pour l'heure
L’écologie aussi connaît un tournant décolonial. Les travaux – inédits en français – de l’anthropologue Arturo Escobar montrent comment les luttes des indigènes et les mouvements de libération en Amérique latine apprennent à lutter de façon réaliste contre le néolibéralisme, et à favoriser un usage responsable des ressources.
sans commentaire pour l'heure
Pour une écologie décoloniale
À propos de :

Claire Gallien, La vie des idées / Collège de France, le 11 février
À propos de :

Claire Gallien, La vie des idées / Collège de France, le 11 février
L’écologie aussi connaît un tournant décolonial. Les travaux – inédits en français – de l’anthropologue Arturo Escobar montrent comment les luttes des indigènes et les mouvements de libération en Amérique latine apprennent à lutter de façon réaliste contre le néolibéralisme, et à favoriser un usage responsable des ressources.
La publication de Sentir-penser avec la terre. L’écologie au-delà de l’Occident rend disponible en français une partie du travail de l’anthropologue sud-américain Arturo Escobar. Elle marque un moment important dans l’acclimatation en France de la pensée décoloniale, encore largement inconnue et caricaturée. À partir du concept de « Sentir-penser » (néologisme formé à partir des termes sentirpensar ou sentipensar), l’auteur bouscule le cadre épistémologique occidental fondé sur une séparation entre sentir et penser, corps et esprit, objet perçu et sujet pensant. Par contraste avec cette « ontologie binaire » qui fonde les régimes de modernité et de colonialité (souvenons-nous de la Controverse de Valladolid et autres débats à sens unique sur la prétendue absence d’âme des Indiens ou des Noirs), Escobar théorise, notamment à partir des luttes indigènes en Colombie – dont il est originaire – une « ontologie relationnelle » où la pensée n’existe que de façon incorporée et genrée, c’est-à-dire située dans des corps, pensant à partir d’eux et agissant sur eux. Le sujet humain ne surplombe pas un monde d’objets non-humains ou de sujets considérés comme des objets non-humains exploitables. La pensée relationnelle récuse la distinction ontologique entre le moi et les autres, le sujet et son « environnement ». Elle invite à repenser le sujet à partir de ses interactions, et le monde à partir du « plurivers », c’est-à-dire un agencement (ou « design », pour reprendre un autre concept clé d’Escobar) de mondes, chacun engagé dans un processus distinct, relationnel et situé de « faire monde ».
L’autre terre de la pensée décoloniale
Au moins deux raisons d’ordre structurel expliquent sans doute que le travail de ce penseur majeur du tournant décolonial demeure largement inconnu du public français. D’une part, Escobar enseigne à l’université de North Carolina. Le champ académique états-unien a en effet permis, en parallèle avec les études postcoloniales, largement portées par des chercheurs en lien avec l’Asie du Sud et les Caraïbes, et avec les études ethniques (Native American, Black, Chicano and Chicana studies), l’émergence d’un champ décolonial, plus largement représenté par des chercheur.e.s d’origine sud-américaine. Ainsi, les publications d’Escobar font partie d’une constellation décoloniale nord-américaine portée entre autres par Nelson Maldonado-Torres (Rutgers), Walter Mignolo (Duke), et Ramón Grosfoguel (Berkeley).
Arturo Escobar. Sentir-penser avec la Terre. L’écologie au-delà de l’Occident, Paris, Le Seuil, « Anthropocène », 2018, 13, 99 €
D’autre part, en France, le mouvement décolonial est largement identifié aux collectifs de militant.e.s dont les familles sont issu.e.s de l’immigration, et souvent restreint au Parti des Indigènes de la République (PIR), mouvement né en 2005 dans le contexte des émeutes des banlieues, afin de porter un message anti-impérialiste et de lutte contre les discriminations raciales et religieuses en France et de s’attaquer aux survivances du régime de colonialité. Le PIR est régulièrement accusé d’islamo-gauchisme, d’antisémitisme, de racisme (inversé), ou encore d’homophobie et d’anti-féminisme par les tenant.e.s du féminisme laïc français. Ces luttes politiques se situent largement hors du champ académique. Même si les travaux de certain.e.s chercheur.e.s en sociologie s’en réclament ou entrent en résonance avec le programme décolonial du mouvement, comme Nacira Guénif, Éric Macé, Elsa Dorlin, Éric Fassin, Sonya Dayan-Herzbrun, ils ne sont soutenus dans leurs luttes par aucun laboratoire ou programme de recherche. Le Master Euro-Philosophie porté par les universités de Toulouse 2 Jean Jaurès et Louvain en Belgique, financé par le programme ERASMUS + de l’Union Européenne, et à l’origine d’un séminaire d’études décoloniales et d’une université d’été, ou encore le Réseau d’Études Décoloniales, qui se fait l’écho à partir du Nord global des pensées du Sud global se situent par exemple en périphérie de l’institution, ou du moins en marge de la reconnaissance institutionnelle nationale. Dans ce contexte pour le moins tendu, on comprend pourquoi la recherche française n’a pas encore réellement fait son tournant décolonial.
La traduction, lien commun
Sentir-penser est traduit par Anne-Laure Bonvalot, Roberto Andrade Pérez, Ella Bordai, Claude Bourguignon, et Philippe Colin, membres de l’Atelier La Minga, pôle traduction du Réseau d’Études Décoloniales. Il se présente comme un collectif et insiste sur ce mode de travail, car traduire en commun est une intervention concrète visant le dépassement des logiques individualistes inculquées par l’idéologie néolibérale : « Le terme espagnol minga qui vient du quechua minka, désigne un travail collectif d’utilité sociale en vue du bien commun et prend donc à rebours la ‘modernité occidentale’ basée sur l’individualisme, la compétition, et la domination » (21). Ainsi traduire en commun et en tension) permet de revenir et de développer la théorie – en l’occurrence les études décoloniales. On pourrait dire que la méthode employée par le collectif s’inspire d’Escobar, pour qui la théorie ne peut émerger que de la praxis et du terrain, et pour qui la recherche ne peut être qu’engagement des corps et des esprits à la fois.
Il s’agit de traduire Escobar pour repenser les luttes au Nord en général, et en France en particulier, c’est-à-dire non pas juste traduire et comprendre des pensées venues d’ailleurs, comme le voudrait une approche anthropologique classique, mais montrer en quoi la séparation entre un ici et un ailleurs est une construction de la modernité coloniale prise dans des logiques extractivistes et de domination. Au contraire, le texte d’Escobar est remanié par endroits avec le soutien de l’auteur afin de créer du lien, de l’interrelation, avec des luttes locales situées au Nord. On trouve, par exemple, des références aux ZAD et à Notre-Dame-des-Landes en particulier, aux luttes contre la construction d’aéroports ou l’ouverture de site de déchets nucléaires, et une critique de ce que l’on nomme en France les « grands projets utiles ». À ces références s’ajoute un paratexte (notes, préface, postface) permettant de resituer Escobar dans le contexte intellectuel et militant français. Anna Bednik, journaliste, activiste et auteur d’Extractivisme (2016) relit en postface les mobilisations à Notre-Dame-des-Landes à partir d’Escobar.
Les traducteurs ne sont pas sans reconnaître la contradiction d’une approche cibliste : « Exercice de refabulation, en tant qu’elle propose de faire passer ailleurs en les reformulant les formes d’un savoir situé, la traduction court nécessairement le risque de devoir reconduire tacitement une hégémonie et un ethnocentrisme auxquels la lettre du texte prétend précisément s’attaquer » (19). Mais elles et ils y répondent de manière très convaincante, c’est-à-dire en déstabilisant leur propre pratique. L’exercice de traduction collective imposée permet de remettre en cause ou sous tension la notion d’autorité, implique des aménagements, des adaptations, des reformulations, donc permet de faire l’expérience d’une traduction non-autoritaire et qui ne prend pas l’autorisation comme postulat de départ. Le travail collaboratif rend aussi visible le bagage social et culturel de chacun des traducteurs et traductrices dans sa manière d’aborder, de lire et de traduire un texte, et donc permet en quelque sorte de combattre l’invisibilisation des rapports de domination inscrits dans la langue pour celles et ceux qui la pratiquent.
Déconstruire l’idéologie du développement
Une préface très informée resitue le travail d’Escobar dans le tournant ontologique qui a marqué l’anthropologie du début du XXIe siècle avec, nous le rappellent les auteur.e.s, Tim Ingold, Eduardo Viveiros de Castro, Barbara Glowczewski, Mario Blaser, Marisol de la Cadena et, en France, Philippe Descola. Le tournant anthropologique vise une remise en cause profonde du dualisme nature/culture proposée à partir des pensées indigènes. Escobar s’engage quant à lui dans une critique féroce de l’ontologie dualiste moderne occidentale et du régime de domination et d’exploitation du monde qu’il implique (colonisation, extractivisme, monoculture). Comme le rappellent les auteur.e.s de la préface, Escobar est d’abord connu comme analyste du « développement ». Loin d’être neutre ou bénéfique, cette notion, tout comme celle de « progrès », impose aux pays « sous-développés » ou « émergents » une entrée forcée dans le marché néolibéral, creuse les écarts de richesse, déstabilise des tissus sociaux et écologiques.
En tant qu’anthropologue et porteur d’une critique radicale du projet développementiste, son travail entre en résonance avec d’autres penseurs décoloniaux qui pointent du doigt le régime de colonialité opérant depuis 1492 et la conquête « ininterrompue » en Amérique du Sud (Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Bolivar Echevarria), et proposent une sortie de l’hégémonie épistémologique occidentale à partir des « épistémologies du Sud » (Buoventura de Sousa Santos). Ces chercheurs ne travaillent pas sur des mondes mais avec ou à partir de ces mondes, l’idée étant non seulement d’exposer et faire connaître des modalités alternatives d’habiter (non pas des modernités alternatives mais des alternatives à la modernité, comme le rappellent les auteur.e.s de la préface) et de se saisir de ces luttes au Nord, dans l’idée d’une possible convergence internationale. En parallèle à cette critique, Escobar élabore une étude des « ontologies relationnelles » forgée à partir de ses observations de terrain et s’engage, notamment en mettant au jour les luttes des communautés noires du Pacifique sud-colombien (le PCN), dans une « théorie/praxis » décoloniale, point de départ pour une reconnaissance du pluriversel, pour la dénaturalisation de la conception « unimondiste » du monde, et pour la mise en place de rapports symétriques entre mondes.
Ainsi, l’ouvrage nous permet de saisir le cheminement de la pensée escobarienne de la critique du « développement » à l’ouverture décoloniale. L’introduction, tout d’abord, lui permet de définir ses concepts, à commencer par celui d’« ontologie politique » qui « cherche à mettre en lumière à la fois la dimension politique de l’ontologie et la dimension ontologique de la politique ». Elle permet d’appréhender le fait que « tout ensemble de pratiques instaure nécessairement un monde » et consiste à se demander quel type de monde s’instaure, à partir de quelles pratiques, et comment sortir d’un monde pour entrer dans un autre, ou ce qu’Escobar appelle faire « transition » afin de sortir de situations de crises écologiques et sociales. En introduction, il précise également que le concept de « sentipensée » a d’abord été élaboré par Orlando Fals Borda en 1986 à propos des communautés de la côte atlantique colombienne. On retrouve ce concept dans l’expérience zapatiste de « raisonner avec le cœur ». Sentir-penser correspond à un mode d’être avec les territoires qui impliquent simultanément le corps et l’esprit.
L’ouvrage offre une lecture historique des phases de « développement » et « post-développement » telles qu’elles ont pu être subies par les sociétés sud-américaines, et en particulier colombienne qu’Escobar a étudiée dans La invención del tercer mundo. Consctrucción y deconstrucción del desarollo (1988, traduit en anglais en 1995 sous le titre de Encountering Development ? The Making and Unmaking of the Third World). Il élabore une généalogie du discours développementiste et note sa persistance malgré le constat de son échec. Escobar rapporte en dernier lieu les approches critiques au développementisme en Amérique du Sud depuis les années 1950-60 : CEPAL, théorie de la dépendance, théologie de la libération, recherche-action participative, éducation populaire (Paulo Freire, Fals Borda), et alternatives épistémiques proposées par Alberto Acosta (Buen Vivir), Eduardo Gudynas (alternatives au développement) et Maristella Svampa (combat socio-environnementaux).
Escobar propose également cinq pistes de sortie du « développement » et de la « modernité occidentale » imposés par la globalisation néolibérale :
(1) le programme de décolonisation épistémique (autour de Modernité/Colonialité/Décolonialité et d’auteurs comme Quijano, Mignolo, Dussel, Catherine Walsh, Edgardo Lander) ;
(2) les alternatives au « développement » (Gudynas, Acosta, aussi Mario Blaser dans Storytelling Globalization) ;
(3) les transitions postextractivistes ;
(4) les modèles subalternistes, visant à démystifier la modernité sans pour autant remythifier les traditions (Ashis Nandy, Bonfil Batalla, le Colectivo Situaciones et Raúl Zibechi) ;
(5) les différents modèles de « commun ». Escobar s’inspire notamment des expériences communales étudiées par Félix Patsi en Bolivie, de la notion de « maillage » communal (Raquel Gutiérrez), des travaux de Pablo Mamani, au sujet notamment du caractère désinstituant des luttes, de Gustavo Esteva et ses recherches sur les mouvements autonomes au Chiapas et à Oaxaca.
La question du commun permet également d’aborder les questions de « féminisme communautaire », « dépatriarcalisation », et « relationalité », fondée sur l’idée fondamentale selon laquelle il n’existe pas d’entité préexistante à la relation, l’entité se constituant dans la relation et donc demeurant en situation d’ouverture. Ces ontologies relationnelles, qu’on les retrouve en milieu rural ou urbain, ont une forte dimension territoriale.
En s’intéressant en particulier aux luttes menées par les communautés des territoires ancestraux de Yurumangui, Curvaradó, et La Toma, Escobar met au jour d’une part l’accaparement sauvage des terres par les multinationales spécialisées dans les monocultures destinées à l’exportation ou l’extraction minière, les déplacements et massacres de populations prises dans l’étau des groupes paramilitaires et militaires, et démontre comment un nouveau rapport à la terre, une nouvelle géo-graphie, permet à des communautés humaines de ré-exister avec les territoires et non sur les terres. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le mot d’ordre des afro-descendants : « Nous ne voulons pas une terre, nous voulons un territoire » (100). Par le biais de l’ancestralité, elles créent des mécanismes pour que soit reconnue la propriété collective et pour que soit défini un usage responsable et durable des terres et des ressources. Il s’agit d’investir dans une forme d’« utopie réaliste », c’est-à-dire un mode d’être radicalement différent du modèle néolibéral et en même temps hautement réaliste puisque les démarches écologistes et de mise en commun sont les seules à permettre survie et développement du territoire et des communautés qui l’habitent. Escobar convoque ici le Processus des communautés noires (PCN), le mouvement zapatiste, et aussi les travaux de géographes comme Chico Mendes ou Carlos Porto-Gonçalves inspirés de ces luttes.
Escobar s’inspire des travaux de Mario Blaser pour une redéfinition politique de l’ontologie qui serait l’étude de la manière dont des entités entrent dans des processus intersubjectifs de négociations par rapport au pouvoir afin de se construire en tant qu’identités et monde. De fait, l’ontologie politique relationnelle ouvre sur le pluriversel, la reconnaissance des « droits au territoire » et répond efficacement aux crises environnementales. Escobar revient sur le soulèvement zapatiste mais aussi sur certaines expériences de peuples du Pacifique Sud pour exposer les pratiques permettant de créer des mondes relationnels où la distinction nature/culture est désignée comme politique et non comme allant de soi, et où pratiques et cosmovisions permettent de la dépasser. Escobar se sert des travaux de Tim Ingold dans The Perceptions of the Environment (2000) pour distinguer l’ontologie « dualiste », relevant de la modernité séculaire, capitaliste, et libérale, de l’ontologie « relationnelle ». Le piège serait de croire en la domination parfaite de la modernité, alors même que des autres mondes résistent et se déploient à travers des pratiques (Escobar convoque ici la théorie de l’énaction ou « embodied mind » de Francisco Varela), et qu’il incombe au chercheur de radiographier ces mondes ne serait-ce que pour les faire connaître au-delà. Il s’agit de déconstruire le mythe de l’universel moderne et de prendre acte de l’existence du pluriversel. Les études pluriverselles entendent rendre visibles les autres manières de connaitre et de ré-exister au sens où les communautés ne font pas que lutter contre les spoliations mais élaborent d’autres modèles de vie. C’est ce que vise plus globalement la décolonisation épistémique.
Enfin, Escobar s’attache à définir le nouveau domaine de recherche des « transitions » (qui prend de multiples directions : postextractivisme, alternatives au développement, comme le Buen Vivir, droit de la nature) et à préciser la notion de « design », lequel consiste à concevoir les manières de préserver le pluriversel et la symétrie des rapports entre mondes sans pour autant envisager ces mondes comme des isolats et à réinventer la globalisation comme « stratégie de préservation et de promotion du plurivers » (155). Dire et vivre le plurivers ne revient pas à cultiver l’entre-soi, mais au contraire à créer du commun et des liens de solidarité globale. Ainsi, les études de la transition permettent de créer des passerelles entre luttes d’ici et d’ailleurs qui ne s’élaborent pas forcément dans les mêmes termes, car dépendants d’un milieu, mais visent les mêmes objectifs : entrer dans l’ère de la post-croissance au Nord global et du post-développement dans le Sud global.
Comment agencer les mondes ?
Si la pensée d’Escobar permet de faire de la convergence des luttes pour le plurivers antilibéral et écologique une évidence, il semble plus difficile de s’accorder sur la question des points d’agencement de ce plurivers. En effet, à moins d’une sortie immédiate du régime moderne-colonial-libéral, on voit mal comment les mondes cohabiteraient en symétrie. À moins que la symétrie et le plurivers demeurent chez Escobar des horizons plus que des points de départ. Si les cosmovisions pluriverselles sont déjà à l’œuvre chez les communautés étudiées par Escobar, il semble que l’auteur passe sous silence la question de l’agencement entre mondes. Le design escobarien fait le pari de la cohabitation des mondes, mais réfléchit trop peu à la question des points de friction. Il y a une raison théorique à ceci – Escobar n’envisage jamais l’entité comme un pré-construit et les mondes comme des isolats. Au contraire, il indique que les mondes, comme les territoires, ont des frontières non-fixes, poreuses, qui sont en constante redéfinition et mutation en fonction de la manière dont les communautés les habitent et se les approprient. C’est dans la relation que s’esquissent les contours mouvants des communautés. Malgré cela, le maintien du régime de colonialité/modernité, de même que la tension entre le local et le global, la composition in situ des mondes et leur tendance, capacité, besoin d’expansion, demeurent à ce stade des questions laissées en suspens.
Vu d’ici
Puisque la démarche éditoriale est celle d’un ré-ancrage d’Escobar en terrain français, j’aimerais indiquer en conclusion à quel point il permet de repenser, à partir du Sud global, le rôle de l’éducation et de la recherche aujourd’hui en France. Escobar refuse toute position de surplomb et revendique une participation pleine au processus de sortie d’une pensée unique et consensuelle. La recherche n’est pas abstraite. Elle est située – c’est-à-dire portée par des marqueurs sociaux, raciaux, genrés… – et il est fondamental de reconnaître ces situations d’énonciation afin de mesurer les enjeux de pouvoir, de domination, et d’invisibilisation. L’éducation et la recherche ne fonctionnent pas en vase clos et l’Université n’est pas emmurée. Elle est recherche-action, participative et indisciplinée, ou bien faudra-t-il accepter de la réduire à une fonction de reproduction et renforcement des inégalités et discriminations. Escobar rappelle avec force : « la production de savoir passe par l’’engagement intense’ en situation et vis-à-vis de la communauté » (86). Par « engagement intense », il n’entend pas fournir aux communautés des outils de pensée, mais indique que la pensée émerge de la lutte et que le travail académique se nourrit de ces cosmovisions. Par exemple, ce sont les cosmovisions des afro-descendants colombiens qui permettent à la recherche d’opérer une redéfinition de la notion de territoire et de sortir d’une définition unique héritée de la modernité. Ici, le « territoire » ne renvoie pas à la propriété mais à l’appropriation effective par le biais de pratiques culturelles, agricoles, écologiques.
Escobar écrit : « la globalisation néolibérale est une guerre menée contre les mondes relationnels – attaque toujours recommencée contre tout ce qui est collectif et une tentative de plus en plus musclée de consolider l’univers reposant sur le maillage ontologique individu-marché » (83). En dehors du champ universitaire strict, et en contexte de privatisation violente des espaces communs et services publics, il semble urgent non seulement de lire ces propos, mais de se les approprier pour les convertir en moteur de résistance.
Pour citer cet article :
Claire Gallien, « Pour une écologie décoloniale », La Vie des idées , 11 février 2019. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-ecologie-decoloniale.html
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
pour les débats et controverses théoriques, voir plus haut
1. la pêche miraculeuse ? Un quart des stocks de poissons sont trop pêchés en France. Le Monde 2 février 2019
2. les temps du capital contre le vivant : Quel temps fait-il après le capitalisme ? lundimatin#161
2. les temps du capital contre le vivant
voilà qui est en plein dans notre sujet, n'en déplaise à RS :
flou, antonymes : clair, distinct, net, précis. Comme un hachoir conceptueur ?RS a écrit:A la rigueur, « le capital » on peut avoir quelques idées, mais le « vivant » c’est quoi ? Quant à la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, il s’en fout. [...]
[Avec]le « rapport humanité-capital-nature » (Patlotch, 23 novembre)... Le capital devient un concept aussi flou que ceux de « nature » et d’ « humanité ». Il est vrai que Patlotch a annoncé une nouvelle cible : le « conceptualisme », plus de théorie manipulant des concepts, maintenant Patlotch est en connexion directe avec le « réel », le « vivant » et la « nature »
QUEL TEMPS FAIT-IL APRÈS LE CAPITALISME ?
Christophe Bonneuil lundimatin#161, le 16 octobre 2018
Christophe Bonneuil lundimatin#161, le 16 octobre 2018
« L’ennuyeux, observait Hannah Arendt, c’est que nous ne semblons ni équipés ni préparés pour cette activité de pensée, d’installation dans la brèche entre le passé et le futur ». A l’heure des crises de la mondialisation capitaliste et d’un basculement géologique planétaire, il est temps de s’activer dans la brèche des devenirs terrestres.

Une nouvelle revue vient d’être lancée qui s’y emploiera : Terrestres, Revue des livres, des idées et des écologies. Nous partageons ici une des recensions de livres de son n°1, celle de Christophe Bonneuil (co-auteur, avec Jean-Baptiste Fressoz, de L’événement Anthropocène, Points Seuil, 2016 et, avec Sandrine Feydel, de Prédation. Nature, le nouvel eldorado de la finance, Paris, La Découverte, 2015 ) sur le livre de Jérôme Baschet, Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits (La Découverte, 2018). L’enjeu, dans une époque où l’expérience du temps s’est engluée dans les réseaux d’un présent infini et sans avenir, est la réouverture d’un horizon révolutionnaire abandonnant des vieilles lunes modernes du progrès. En s’attaquant aux dimensions temporelles du dépassement du capitalisme à travers un détour par l’expérience Zapatiste, Baschet nous propose une réflexion profonde de notre rapport à l’histoire.
Et si l’avenir était autre chose qu’un présent 2.0 ? Devant nous n’est pas une crise climatique à gérer avec des « solutions » ou une mondialisation économique à réguler, mais la possibilité d’un effondrement. Après l’effacement de tant de systèmes politiques au cours des 50 siècles derniers et alors que de toutes parts nous parviennent des rapports sur les bouleversements qui affectent la Terre, n’est-il pas exagérément téméraire de considérer le capitalisme immortel ?
Certains préfèrent mettre en avant l’apocalypse d’une extinction de l’espèce humaine. Mais ce scénario ne fascine qu’au prix de l’occultation de toute analyse géopolitique et sociale des asymétries de ressources, des singularités et des résiliences différenciées entre groupes humains de par le monde. Face à ce sublime conduisant à obscurcir l’effondrement, Jérôme Baschet, historien émérite à l’EHESS et compagnon de route des zapatistes, est de ceux pour qui « une autre fin du monde est possible [1] ». On disait jusque récemment plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, mais le vent tourne et Défaire la tyrannie du présent est de ces écrits qui ne manquent pas de souffle.
Baschet radiographie notre époque comme un cul-de-sac civilisationnel en proie à cinq transformations : une numérisation qui bouleverse le travail et nos modes d’être ensemble ; une bifurcation néolibérale du capitalisme qui restaure un niveau d’inégalités comparable à l’Ancien régime ; un nouveau régime d’existence de la Terre poussée hors de l’Holocène par un industrialisme et un consumérisme devenus globaux ; un grand partage naturaliste entre Nature et Culture qui s’effrite tandis que l’Occident n’est plus qu’une province du monde ; et, enfin, la crise d’une façon d’articuler passé, présent et futur et de se situer dans la temporalité, née avec la modernité industrielle, et avec elle la fin des certitudes d’un avenir nécessairement meilleur.
Ce constat d’un changement d’époque propice à rouvrir le futur, s’il réfute le déni d’autres mondes possibles du présentisme ambiant, ne fait pas du dépassement du capitalisme un fait garanti par d’inexorables lois de l’Histoire ou du système terre. Ce dépassement passe par un chemin incertain d’insurrection et d’expérimentation de formes d’organisation et de vie émancipées de la triple abstraction de l’état (comme mode totalisant de constitution de la collectivité), de la marchandise et du productivisme, et d’un Universel occidentocentrique, que Baschet avait esquissées dans son livre précédent (Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, 2014). Dans celui-ci, il s’attache à penser une des conditions culturelles de la destitution de la « tyrannie capitaliste » : une mutation de notre rapport au temps (sortie de l’hégémonie du temps abstrait) et aux temps (nouvelles façons de composer passé, futur et présent qui dépassent à la fois le régime d’historicité traditionnel cyclique, le régime d’historicité moderne, et le régime d’historicité présentiste). Ici le désir politique d’affaiblir le mode de production dominant de notre réalité rejoint le désir savant de l’historien accompli, nous offrant une réflexion épistémologique profonde sur le savoir historique, la mémoire et l’historicité. La recherche des chemins d’un au-delà du capitalisme va donc de pair chez Baschet avec une ambitieuse refondation épistémologique de l’histoire, émancipant le savoir historien de conditionnements qui avaient présidés à sa naissance comme discipline au cœur des États-nations impériaux et industrialistes.
La notion de « régimes d’historicité » a été proposée par François Hartog, pour désigner les façons dont les sociétés articulent passé, présent et futur, en vue de se rendre intelligibles à elles-mêmes [2]. Le régime « traditionnel » construit un temps cyclique. Le récit d’actions passées prescrit un devoir-être pour aujourd’hui et demain. L’horizon d’attente concernant le futur est entièrement contenu dans le champ d’expérience légué par le passé. Avec l’entrée dans l’âge industriel, émerge le concept moderne d’histoire par une ouverture du futur (progrès) qui dissocie l’horizon d’attente du seul champ d’expérience, créant la flèche narrative tendue vers un futur de plus en plus différent de ce qui a déjà été et du présent [3]. C’est pour Hartog le « régime d’historicité futuriste », que Baschet nomme plus simplement « moderne ». Le passé y est considéré comme révolu (donc ouvert au savoir objectif de l’historien) et déprécié (idéologie du progrès). Le futur y organise le sens du passé et du présent (point de vue futurocentré). C’est lui qui donne sa direction à l’Histoire, lui conférant un pouvoir de définition, concurremment aux religions, de ce qui est non (encore) advenu mais croyable [4].
On le sait, ce régime moderne de composition des temps a perdu en hégémonie au long du XXe siècle, et 1989 a consacré l’affirmation d’un nouveau régime d’historicité dit présentiste. La chute du mur de Berlin conduisit alors certains à décréter « la fin de l’histoire » et enterrer l’idée communiste comme une « illusion » ravageuse. Mais le reflux de l’idée révolutionnaire et l’affirmation conservatrice de l’absence d’alternative au capitalisme ne sont que les symptômes les plus saillants d’une crise plus large de l’avenir, et donc de l’histoire en tant que savoir susceptible de rendre les sociétés intelligibles à elles-mêmes par l’analyse de leur devenir diachronique [5]. Cet affaissement de la réflexivité historique s’accompagne de la montée de pratiques mémorielles institutionnalisées, par lesquelles l’histoire se trouve gouvernée par la mémoire : politiques du patrimoine, commémorations, discours de l’identité, velléités de légiférer sur le contenu de l’enseignement de l’histoire, etc.
Dans l’expérience quotidienne, il n’y a plus que du présent. Dans la vie professionnelle ou amoureuse, des subjectivités plus oublieuses se forment dans un télescopage de sms, courriels, d’événements auxquels il s’agit de réagir dans l’urgence. Trump ne dirige-t-il pas une superpuissance mondiale par le tweet ? Dans notre condition numérique tout devient contemporain, simultané, de tout. « Tout apparaît sur le même plan dans un présent aussi étendu que le réseau lui-même [6] ». Or, au sens social, le présent est la durée durant laquelle est assurée une relative permanence des conditions de l’action. Et l’accélération contemporaine (cf. Hartmut Rosa) est la compression de ce présent, happé par l’instant d’après et ses nouvelles règles. Notre monde en réseau, liquide, plutôt que d’ouvrir les possibles, fonctionne alors comme une fatalité systémique tentaculaire nous enjoignant à nous « adapter » à des processus globaux sur lesquels nous n’avons pas prise. Le présentisme, loin d’être jouissance du moment présent est donc une dictature de l’instant d’après. Le futurocentrisme du régime moderne d’historicité se trouve comprimé dans l’horizon du futur le plus immédiat. Du futur, ne reste plus que l’arraisonnement du présent par l’immédiat (protension), au détriment de modalités plus projectives, imaginatives ou subversives du futur (p. 105-106).
Au-delà des habituelles lectures idéelles du passage du régime moderne d’historicité au régime présentiste, Baschet en propose une lecture sociale, ouvrant vers une véritable anthropologie temporelle du capitalisme historique. Pour éclairer les inflexions de l’historicité, il explore les temporalités vécues au quotidien dans les réseaux de la marchandise et les rapports de production. Il observe alors que la forme la plus pure et poussée du présentisme contemporain réside dans la rationalité du capitalisme financiarisé : l’agir y est entièrement phagocyté par le futur immédiat de l’anticipation économique. Mais si la financiarisation néolibérale et son infrastructure numérique ont dramatisé sa domination (cf. les normes comptables internationales IFRS qui depuis 2005, aplatissent toute valeur sur une « valeur de marché » à l’instant t), c’est dès l’âge industriel que le temps abstrait a émergé comme vecteur d’optimisation tyrannique des temps vécus du travail comme des loisirs. Baschet en propose la formule générale : un impératif d’augmentation tendancielle des quantités par unité de temps (rapport quantitatif Q/t, par opposition à un temps vécu qualitatif). En même temps que froide logique de gouvernement des usines, des champs et des guerres de l’âge industriel, cet accroissement de Q/t a aussi fonctionné comme une puissante promesse de la modernité, celle d’un surcroît indéfini de savoirs, de confort, de voyages, d’expériences (p. 152-155).
Ce détour par les temporalités permet une lecture autrement plus riche du présentisme, comme logique culturelle du capitalisme contemporain. Premièrement, il se révèle comme le produit du projet même de mobilisation infinie du monde. Plutôt qu’une rupture avec la modernité « futuriste », le présentisme en est radicalisation hyper-moderne, de l’intérieur, par extension hégémonique des logiques d’accélération temporelle propres à la gouvernementalité industrielle. Deuxièmement, le présentisme contemporain résulte d’une logique mortifère d’appauvrissement conjoint des temps vécus, des intériorités et du tissu vivant de la planète (p. 165). Plutôt que les habituels discours de crise de l’histoire ou d’abandon de tout idéal de transformation sociale émancipatrice, il manifeste une crise, un stade effondré du capitalisme, appelant à une « insurrection éthique contre la destruction généralisée des formes de vie » (p. 89) et à la recherche futurs post-capitalistes plus riches de sens.
Défaire la tyrannie du présent, c’est donc extirper nos vies de la glu d’une forme dominante de production de la réalité, d’autant plus rigide qu’on nous abreuve de « flexibilité ». C’est déjouer cette fermeture des possibles de transformation et d’émancipation. Mais, si le présentisme du capitalisme contemporain pose problème, il ne s’agit pas pour autant de revenir au régime d’historicité moderne. A gauche, l’accélérationnisme ou la célébration des vertus de la connexion numérique des multitudes témoignent de la survivance d’une critique du capitalisme reproduisant la grammaire de l’industrialisme moderne. Baschet rejette cette « vision moderniste de l’émancipation » qui « ne peut que contribuer à accentuer les effets destructeurs engendrés par le monde de l’Économie » (p. 81). Entre poursuite du front de modernisation et « devenirs terrestres » [7] il a choisi, et propose pour cela d’équiper les mouvements d’émancipation d’un autre mode de composition des temps, un nouveau régime, pluriel, d’historicité.
On commence à cerner l’ampleur du projet de J. Baschet. Sortir du capitalisme, plus qu’un changement de règles économiques, implique pour lui une rupture avec les formes sociales, et les modes de production des subjectivités propres à la société marchande et industrielle. D’où la nécessité d’une métamorphose civilisationnelle, déjà en germe dans diverses brèches ici et là. Dans Adieux au capitalisme, Baschet développait trois dimensions de cette révolution anthropologique : d’abord, la libération de l’humain de sa supposée nature, égoïste et antisociale, et de toute idée de nature humaine pré ou extra-sociale ; ensuite l’abandon du dogme individualiste coupant la personne de ses liens pour en faire « par lui-même un tout parfait et solitaire » (Rousseau) et de l’idée de prééminence de l’individu sur la société ; et enfin, déserter la posture de maître autoproclamé de l’Univers et le dualisme nature / culture.
Défaire la tyrannie du présent apporte une quatrième élément d’une anthropologie, d’une subjectivation, alternatives à celle de l’Homo capitalistus. Il s’agit de métamorphoser notre rapport au temps en sortant de l’hégémonie du temps abstrait extérieur aux existants, et en organisant politiquement une détente temporelle de nos vies. Il s’agit aussi de transformer notre rapport aux temps, en créant de nouvelles façons poétiques et émancipatrices de composer passé, futur et présent.
Walter Benjamin, dans ses « Thèses sur le concept d’histoire » écrites en 1940, pourfendait la foi dans le « progrès, compris comme une norme historique », et la certitude, à gauche, d’être dans le sens de l’histoire « donné par le développement de la technique » et la « maîtrise de la nature », faisant selon lui le jeu des conservateurs comme « des traits technocratiques qu’on rencontrera plus tard dans le fascisme » [8]. Face aux formes historicistes et modernistes du savoir historien d’alors, il défendait une vision messianique de l’histoire : « attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance [9] », redonner leur puissance d’agir aux vaincus du passé pour éviter qu’ils ne soient piétinés à nouveau au présent. Le messie-historien de Benjamin « sauve » donc, d’un seul jet, un passé et un présent souterrainement reliés par des lignes de fuite échappant à l’histoire orientée « dans un temps homogène et vide » [10].
Si l’adversaire principal de Benjamin était l’historicité moderne et son monde, le nôtre est également le présentisme et son monde. C’est ici qu’un détour par le mode zapatiste de composition des temps nous est proposé puisque la révolution zapatiste a identifié le « présent perpétuel comme adversaire fondamental qui conduit à proposer une alliance stratégique entre passé et futur » (p. 30). Du temps cyclique du régime d’historicité traditionnel, le zapatisme garde la valorisation positive de certains aspects du passé et certains éléments d’économie morale, mais sans se laisser enfermer dans le cercle de la répétition car en quête d’un futur meilleur. Du temps progressiste du régime d’historicité moderne, il reprend l’espérance d’un avenir meilleur mais sans flèche du temps ni lois de l’histoire, ni adhésion à une vision étapiste des devenirs humains qu’avait imposée l’Occident colonisateur. Du présentisme, il retient la critique du Progrès et des lendemains léninistes qui chantent mais en rejette le statu quo conservateur.
Contre la désagrégation post-moderne et présentiste des processus historiques et contre la linéarité évolutionniste de la modernité, les zapatistes « parient sur une récupération conjointe du passé et du futur » (p. 33). Comme chez W. Benjamin, l’activation de futurs et de passés acteurs du présent permet de dénaturaliser l’ordre des choses en convoquant d’autres mondes possibles. Il ne s’agit pas d’essentialiser de bons amérindiens pour sauver l’idée de révolution mais d’expérimenter « d’improbables rencontres entre le passé des communautés indigènes, ayant survécu à l’imposition du Marché, et le destin futur d’une humanité qui se refuse à l’autodestruction » (p. 32). Un tel travail actif et non essentialisateur de « récupération » rejoint les études décoloniales ainsi que la pratique des écoféministes [11]. C’est depuis de multiples territoires, de multiples époques, de multiples genres, de multiples métiers, de multiples peuples (y compris autres qu’humains), que sont à récupérer et transmettre/transformer, à travers les désastres et effondrements en cours, des fragments vivants de monde, des gestes de dignité et de liberté, des économies morales sobres et égalitaires, des sens du beau et du juste, des pratiques communales et des savoirs… qui ont malgré tout, grâce à une inventivité et une détermination permanentes, survécu aux désastres de la colonisation et de l’esclavage, aux ravages de la chasse aux sorcières, aux violences des exploitations et dépossessions capitaliste, patriarcale et coloniale, aux souillures de l’extractivisme et de l’enlaidissement, aux démantèlements néolibéraux, ou à l’hégémonie de l’Économie. Par une sorte de sorcellerie anti-capitaliste, les puissances d’émancipation (re)surgissent de multiples temps, offrant un nouveau mode d’existence à l’idée révolutionnaire. Au-delà d’une historicité moderniste de l’émancipation, Baschet nous donne donc à éprouver des temporalités et historicités révolutionnaires émergentes. De nouvelles géographies aussi puisqu’il n’est plus question d’attribuer une centralité aux seules luttes menées dans les zones centrales du système-monde.
Si la sortie du capitalisme passe par de nouvelles compositions des temps, quelle peut être alors la contribution de l’histoire en tant qu’activité de savoir ? Quel travail historien critique peut-on mener face au présentisme ? Et comment délester l’histoire comme savoir de certains de ses paradigmes forgés dans la modernité industrielle ?
Le diagnostic de la « crise de l’histoire » sous régime présentiste est connu : chute des ventes éditoriales, perte de l’autorité de histoire comme forme de savoir porteuse d’enseignements politiques, paupérisation de la recherche et l’enseignement supérieur, essor de discours de l’identité, instrumentalisations politiques, judiciaires et mémorielles, etc. Ce diagnostic s’est doublé d’un repli jaloux et geignant des professionnels de l’histoire. Alors que les frontières entre spécialistes et profanes, entre savants et militants étaient extrêmement poreuses il y a un demi-siècle – les plus grand.e.s historien.ne.s s’écharpaient sur la Révolution française, la centralité de la classe ouvrière, l’Algérie ou l’avortement – on a assisté depuis 1980 à une dépolitisation du champ et à un durcissement des frontières entre spécialistes et profanes, entre histoire et mémoire... Cette stratégie du repli est-elle adéquate ou bien ne convient-il pas, pour faire front au présentisme, des épistémologies et des alliances sociales différentes de celles héritées des temps modernes ?
La « dé-spécialisation » étant un trait essentiel d’un monde post-capitaliste, Baschet défend d’abord un rapport moins hautain des historien.ne.s avec la société (p. 249). D’un « mode de connaissance par trace » (impliquant une absence de l’agent qui l’a produite), l’histoire devient « mode de connaissance symptomal » (impliquant une coprésence de l’agent et du signe) (p. 257). Baschet trace en outre les contours d’une une anthropo-histoire interculturelle, connectée et comparée échappant à l’eurocentrisme. à une « histoire des dominés » en surplomb, il oppose une histoire par en bas, « du point de vue des dominés » plus fertile en connaissances (p. 267-272). Et la coupure épistémologique érigée entre histoire et mémoire n’a pas lieu d’être car « c’est seulement dans le régime moderne d’historicité que mémoire et histoire s’avèrent antagoniques ». Tout en continuant à être un foyer de résistance au présento-centrisme, « allié de toutes les dominations », l’histoire doit prendre en compte, ne serait-ce que pour la discuter, la puissance d’anachronisme, d’ « irruption du passé dans le présent » qu’est la mémoire (p. 258-260).
Baschet appelle également de ses vœux une histoire « débarrassée des mythologies progressistes » encore souterrainement présentes dans les récits historiens : éloges de modernisations « nécessaires », de salutaires mises en ordre par l’État « là où régnait auparavant de chaos », ou de sociétés dotés de savoirs supérieurs aux croyances, imprécisions ou obscurités de leurs prédécesseurs (p. 261-267). Il propose « à la fois une reconnaissance des promesses de la modernité et (…) une compréhension de celle-ci comme perte, comme destruction de savoirs et dessaisissement de la puissance autonome de faire par soi-même » (p. 263).
En troisième lieu, Baschet défend une histoire ne présupposant plus un temps chronologique uniforme et extérieur aux existants mais attentive aux temporalités plurielles « de chaque chose entendue dans son existence processuelle » (p. 191). De même que Seeing like a state de James Scott (1998) ou Fragmenter le monde de Josep Rafanell (2018) démontent la standardisation, abstraction et mise en commensurabilité des espaces écologiques et sociaux, en vue de les gouverner par en haut depuis l’État ou les firmes transnationales, Baschet, lui, désynchronise le temps, l’éclate en durées dispersées, mais inter-reliées, des existants. Contre tout temps dissocié des devenirs concrets, il propose de penser l’histoire à partir des temporalités et rythmiques propres aux divers existants, capable de concevoir la « pleine contemporanéité de ce par quoi le passé est repris et actualisé » (p. 230). Si toute situation historique résulte d’une conjonction de séries causales en partie indépendantes et hétérochroniques, formant un ensemble complexe et non-linéraire, alors l’histoire n’est pas exempte d’effets papillon ; et les prochaines années de surgissements possibilistes.
Mais, ménager des passages non progressistes entre passé, présent et futur, pluraliser la flèche du temps, ébranle-t-il assez le noyau processualiste hérité d’un paradigme historien forgé au creuset de la modernité industrielle du XIXe siècle ? Nul doute que Baschet approfondira ses coups de burins dans ce noyau dans ses travaux futurs, peut-être en suivant des travaux tels ceux d’anthropologues comme Eduardo Viveiros de Castro ou Barbara Glowczewski [12]. Ceux-ci décrivent en effet, depuis des mondes amérindiens et aborigènes, des jeux quantiques entre le potentiel et l’actuel ; des façons d’éprouver les temps dans lesquelles présent, passé et futur peuvent être en contemporanéité radicale parce qu’il y a irréductibilité du temps du mythe et du temps de l’ « histoire » (au sens qui est le nôtre).
Baschet explore enfin ce que pourrait être une histoire dépassant le grand partage entre nature et société. Au cours des deux derniers siècles, cette coupure fut à la fois ontologique (coupure naturaliste entre les humains, dotés d’intériorité, et tous les autres êtres, supposés ne pas l’être), épistémologique (institutionnalisation des sciences humaines et sociales, comme séparées des sciences, et comme ne devant expliquer les faits sociaux que par des faits sociaux en externalisant les causalités dites « naturelles »), cinétique (une nature supposée statique ou lente relativement à des sociétés humaines dynamiques) et temporelle (une disjonction entre temporalités géologiques longues et temporalités historiques courtes). Avec l’Anthropocène, l’effondrement du partage scalaire entre temporalité historique et temporalité géologique met en crise ce dernier grand partage, instaurant un « trouble dans la temporalité » (p. 88, cf aussi p. 136-137). Dès lors, tandis que Marc Bloch pouvait définir l’histoire comme « science des hommes dans le temps », Baschet la repense comme « science des dynamiques propres aux formations écosociales » et « connaissance critique du devenir collectif des terriens » (p. 238). Une géohistoire postnaturaliste aura alors a cœur d’explorer les résonances des histoires humaines et des processus terrestres, les historicités animales ou les interactions et intelligences unissant tout le vivant. Mettant dos à dos les historiens qui déshabillent un peu vite l’histoire pour la géologie (D. Chakrabarty), et ceux qui barguignent devant l’Anthropocène comme intrusion sur leur territoire
et n’y voit un objet que pour les sciences de la nature, Baschet propose une histoire qui apprenne des sciences naturelles et qui les fertilise en retour pour analyser conjointement les dynamiques autrefois dites « sociales » et celles autrefois dites « naturelles » (p. 253-54).
Bref, loin de la litanie de la « crise de l’histoire » en régime présentiste, Baschet esquisse les lignes d’un savoir historique retrouvant toute sa place à condition de dépasser ses conditionnements modernistes. Une question qui n’intéressera pas que les historiens puisqu’il s’agit de donner forme à des devenirs révolutionnaires non modernes, des devenirs terrestres.
[1] C’est le slogan d’un graffiti illustrant les radicalisations politiques de ces dernières années, et c’est le titre du dernier livre de Pablo Servigne, Raphael Stevens et Gauthier Chapelle (Seuil, 2018).
[2] François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Seuil, 2003.
[3] Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire. Seuil/Gallimard, 1997.
[4] François Hartog, Croire en l’histoire, Flammarion, 2013.
[5] François Hartog, « Vers une nouvelle condition historique », Le Débat 2016/1 (n°188),169-180.
[6] Hartog, op. cit., 2016, p. 180.
[7] La polarité entre terrestres et modernes n’est pas posée en tant que telle par Baschet : elle est reprise de Br
uno Latour, Face à Gaïa (La Découverte, 2015) ; Bruno Latour, Où atterrir ? (La Découverte, 2017). Voir Christophe Bonneuil, « Comment la ZAD nous apprend à devenir terrestres », dans Éloge des mauvaises herbes (LLL, 2018), 103-113. Voir aussi le texte de Sophie Gosselin et David Gé Bartoli dans ce numéro.
[8] Walter Benjamin, Oeuvres III (Gallimard folio, 2000), p. 435-436.
[9] Ibid. p. 431.
[10] Ibid. p. 419.
[11] Reclaim, recueil de textes écoféministes (dir. Emilie Hache), Ed Cambourakis, 2016.
[12] Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales (PUF, 2009) ; Barbara Glowczewski, Les rêveurs du désert : peuple warlpiri d’Australie (Actes Sud, 1996).
repéré par @rebel_workers : "Industrie capitaliste de la pêche = surexploitation"
1. la pêche miraculeuse ?
Un quart des stocks de poissons sont trop pêchés en France
Martine Valo Le Monde 2 février 2019
Un quart des stocks de poissons sont trop pêchés en France
Martine Valo Le Monde 2 février 2019
Selon le bilan présenté le 1er février par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, seuls 48 % des stocks sont gérés de façon durable.

Préparation de la vente de cabillaud à Quiberville (Seine-Maritime).
Jean-Luc et Françoise Ziegler. BiosPhoto
Les poissons français, ou plutôt ceux que ciblent les navires français, sont en petite forme. Selon l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), qui a pour mission d’évaluer les quelques dizaines d’espèces que nous mangeons, moins de la moitié des stocks, 48 %, sont exploités de façon durable, c’est-à-dire en laissant aux adultes assez de temps pour se reproduire efficacement. En revanche, 27 % sont surexploités, et 25 % ne sont pas évalués. Un stock désigne une espèce dans la zone où elle vit. Par exemple, le merlu du golfe du Lion suscite de sérieuses inquiétudes, alors que le merlu du golfe de Gascogne semble mieux se porter. Les eaux métropolitaines comptent cinq stocks de sole, quatre de cabillaud, etc.
Selon le bilan présenté vendredi 1er février par l’Ifremer, les bateaux français ont débarqué 422 588 tonnes de pêche fraîche (non compris les thons qui arrivent congelés de l’océan Indien, par exemple) au total en 2017. Pour établir leurs modèles, les techniciens halieutes s’appuient sur des historiques de capture, des estimations d’abondance, les caractéristiques biologiques de l’espèce. Ils ne se contentent pas des déclarations des près de 7 000 professionnels du secteur, ils observent les débarquements et ont parfois des contrôleurs à bord. En outre, vingt-cinq campagnes scientifiques sont menées chaque année.
Les conclusions de l’Ifremer, qui mène des recherches sur environ 200 stocks, sont mitigées. Au chapitre des bonnes nouvelles, la biomasse – le nombre et le volume – des plies adultes est en forte augmentation. Le lieu noir, lui aussi, frétille. Mais le hareng et le maquereau perdent du terrain depuis trente ans dans la Manche, où la hausse de la température de l’eau a probablement poussé ces derniers à migrer.
La situation de la Méditerranée « globalement préoccupante »
La Manche et la mer du Nord font figure de bonnes élèves, avec 65 % des stocks exploités raisonnablement. Elles, qui représentent environ un quart des débarquements métropolitains, bénéficient d’une saison « exceptionnelle » pour la coquille Saint-Jacques, mais les pêcheurs continuent à puiser trop fort dans les bancs de cabillauds et de bars. La zone Manche Ouest, mer Celtique et Ouest Ecosse présente, elle, 39 % de stocks satisfaisants et 30 % non évalués.La suite est réservée aux abonnés.
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
le capital => fin du vivant => fin du capital
Patlotch a écrit:spéciale dédicace au Savant de Marseille, RS/TC : « À la rigueur, « le capital » on peut avoir quelques idées, mais le « vivant » c’est quoi ? » Disons simplement : sans le vivant pas de capital, détruire le vivant est pour le capital produire sa nécrologie, et c'est pourquoi cette contradiction est antagonique, la plus générale, la plus profonde, la plus essentielle, la plus structurelle en même temps qu'historique
même la contradiction capital-prolétariat est d'un niveau de généralité inférieur (Bertell Ollman d'après Marx et sa méthode dialectique). Marx, idiot écologiste ?, le savait, et la plupart des individus vivants, prolétaires compris, en ont l'intuition, ce qui fait de RS, dans sa prétention à une théorie communiste sérieuse, un fossile "marxiste" mort-vivant, contre Marx
cela ne fait certes pas du vivant un "sujet révolutionnaire", mais comment le prolétariat parce qu'exploité au cœur de la production du capitalisme lui-même pourrait-il comme classe messianique résoudre cette équation ? C'est tout le secret de la révélation communisatrice des croyants en un prolétariat sauveur universel
Vivant, la fin d’un règne ?
France Culture, 25/03/2019
France Culture, 25/03/2019
Qu’est-ce que les évolutionnistes appellent “règne du vivant” ? Comment s’est construite la classification du vivant ? Qu’en est-il de la divergence “règne animal” et “règne végétal ? Quel ancêtre commun partagent-ils ? Quel avenir pour la classification du vivant ?
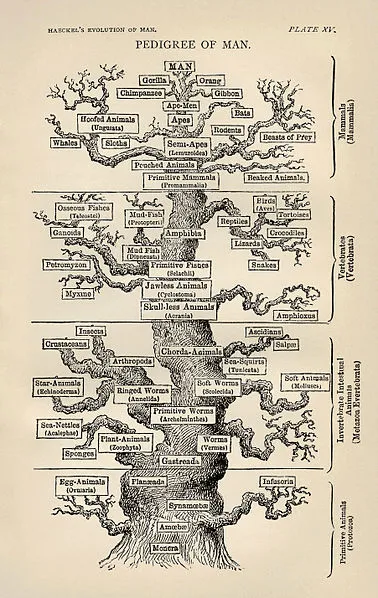
La conception d'un arbre de vie au XIXe siècle,
par Ernst Haeckel dans son "L'évolution de l'Homme" (1879).
Profitez-en quelques secondes encore tant que le monde est simple, organisé, classifié en catégories faciles à se représenter : le règne animal d’un côté, le règne végétal de l’autre, et les champignons quelque part autour. Voilà, c’est fini. Parce que la classification du vivant s’est extraordinairement complexifiée ces dernières années, et que ces termes-là n’ont aujourd’hui en taxonomie presque plus aucun sens. Les règnes, c’est dépassé, c’est has been. Bienvenue dans un monde plus complexe, à 7 règnes, dont il est difficile voire impossible de comprendre qui procède de qui et où va où. C’est au grand casse-tête de la cladistique moderne auquel nous vous invitons aujourd’hui.
Et pour tâcher de comprendre l’organisation du vivant, et de redessiner l’arbre familial de façon plus précise et plus complexe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui Marc-André Selosse, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, professeur à l’université de Gdansk et Kunming, et auteur de « Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » aux éditions Actes Sud et Romain Nattier, maître de conférence au MNHN, chercheur au sein du laboratoire de Systématique, Evolution et Biodiversité.
Le reportage du jour par Céline Loozen
Jean-Paul Saint-Martin est Paléontologue, professeur et chargé de collection fossile au MNHN. Avec sa femme, également paléontologue, ils ont retrouvé des fossiles de métazoaires aux aspects étranges, en forme de feuille ou de tube, dans des gisements en Roumanie.
Écouter
Reportage "fossiles de métazoaïres primitifs" au MNHN
RepèresPour en savoir plusLes premières classifications du vivant se basaient sur la ressemblance entre individus. Depuis que la théorie de l’évolution fait consensus parmi les scientifiques et grâce à la comparaison des génomes, le vivant est aujourd’hui réparti selon les relations de parenté et l’apparition de caractères dérivés d’un ancêtre commun.
La division du vivant en trois domaines - Archées, Eubactéries et Eucaryotes - est remise en question depuis que des recherches ont montré que les Eucaryotes seraient issus de la branche des Archées.
L'endosymbiose, puissant moteur de l'évolution, est à l'origine des mitochondries et des chloroplastes.
Dans l’imaginaire collectif, les végétaux regroupent tous les organismes eucaryotes photosynthétiques. Mais avec cette définition, les “végétaux” ne sont pas un groupe monophylétique et ne partagent pas d’ancêtre commun.
La photosynthèse est apparue à plusieurs reprises et indépendamment dans l’histoire de la vie, grâce aux endosymbioses.
Retrouvez tous les compléments d'informations sur le compte Twitter de La Méthode scientifique
Historique de la classification du vivant (Institut Français de l'Education)
Les archées d’Asgård toujours plus proches des eucaryotes (Pour la Science - 2018)
Les végétaux existent-ils encore ? Par Marc-André Selosse (Pour la Science - 2012)
L'anémone de mer, un animal qui a quelque chose du végétal (FuturaSciences - 2014)
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
ÉCOLOGISER
Patlotch a écrit:écologiser, retenez ce mot, il a autant d'avenir idéologique que le classique développement durable, au cœur de l'idéologie du capitalisme vert, qui, selon le Savant de Marseille, n'existe pas :RS/TC a écrit:la « révolution Macron » du « capitalisme vert ». C’est de la blague, comme le « capitalisme vert » en général, macronien ou non. Il y a des investissements et des profits à attendre (peut-être) des éoliennes, du solaire, etc., c’est le capitalisme tout court. Et les taxes sur le gazole sont là pour rembourser la dette publique, c’est tout. Le mouvement des Gilets jaunes aurait existé sans « capitalisme vert » dans la mesure où le « capitalisme vert » n’existe pas. [...] Quant à la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, il s’en fout.
qu'on se rassure, puisque ce grand patron de la théorie de la révolution prolétarienne, à l'inverse de son supposé maître en critique du capital, économie politique, Karl Marx, n'a aucune connaissance du travail concret des prolétaires concrets en usines concrètes. Autrement dit, au cœur même de sa théorie, la production industrielle de marchandises, le philosophe idéaliste de la communisation démontre son ignorance crasse du capitalisme contemporain comme réalité matérielle fondé sur l'exploitation concrète du travail humain concret, et chez lui tout le reste est concepture
PS le mot-concept ÉCOLOGISER, qui signifie "rendre écologique, plus sensible à la protection de l'environnement", donc à rebours de ce qu'est même l'écologie qui ne sépare pas activité humaine de la vie de la nature, mériterait de figurer dans mon DICTIONNAIRE DES IDÉES QU'ON SUIT. J'y songerai
Nous avons tout industrialisé, maintenant il faut écologiser
Hubert Védrine Reporterre 25 mars 2019
Hubert Védrine Reporterre 25 mars 2019
Comment faire basculer le système ? Pour l’auteur de cette tribune, il faut « alarmer, sans paniquer » et la naissance d’un « mouvement d’opinion inarrêtable » imposera, in fine, la mutation écologique.
Hubert Védrine, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, est l’auteur de Comptes à Rebours (Éditions Fayard, 2018).

un pendant "immédiatiste", mais sans se presser contre le capital, des slogans communisateurs :
en attendant la fin (dndf), il va falloir attendre... le prolétariat (Dauvé/DDT21)
Hubert Védrine a écrit:J’ai toujours aimé la nature : la montagne, la campagne, les forêts, les espaces vierges et les animaux. Avant que Nature meure [1] de Jean Dorst, paru en 1965 (!) m’avait impressionné. Et aujourd’hui, on en est là, il ne s’agit même pas de « sauver la planète » comme on le répète bêtement, (elle nous survivrait !) mais de préserver la vie sur la planète. À deux ou trois générations de distance, ce n’est pas assuré.
Beaucoup ne veulent pas le voir. Mais les preuves sont là. Face à la dégradation accélérée du climat et à l’effondrement de la biodiversité – par surpopulation, hyper productivisme, artificialisation, recours excessif aux énergies carbonées et à la chimie, accumulation de déchets – la seule solution est de tout « écologiser ». Comme on a dit « industrialiser ». Écologiser l’agriculture, l’industrie, la chimie, l’énergie décarbonée, la construction, les transports – voitures, avions, navires. Course de vitesse !
Grâce à l’information et à la pédagogie, l’écologisation doit devenir un impératif vital
Les anticipations sont tellement effrayantes que cela suscite encore beaucoup de déni ou de scepticisme, sur fond d’ignorance écologique et économique, entrecoupé de moments de panique brefs et stériles. Et beaucoup de résistances quand on prétend obliger des gens qui n’y sont pour rien à changer du jour au lendemain de mode de production ou de vie, d’engrais, de désherbants, d’habitudes alimentaires ou de mode de transport. Pire encore quand on prétend les punir, les taxer ou interdire, alors qu’ils n’ont pas encore de solution de remplacement. D’où beaucoup de rébellions, d’énergie gaspillée en batailles inutiles et perdues, sur fond, en France, de manichéisme – les bons et les méchants –, de masochisme affolé alors que nous sommes, grâce au nucléaire, les moins émetteurs de CO2 pour produire de l’électricité. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir à métamorphoser notre agriculture, ce qui a commencé.
Alors ? Si on ne peut pas tout réglementer dans nos démocraties protestataires, que faire ? On va rêver – ou cauchemarder – à une dictature écologique mondiale ? Non. Il faut créer, d’abord en Europe, par une vague d’information et de pédagogie nouvelle sans précédent, fondée sur un langage mobilisateur non agressif, une dynamique, plus forte que toutes les autres, une hégémonie culturelle à la Gramsci, faisant de l’écologisation l’impératif vital. C’est possible. Il faut faire se lever un mouvement d’opinion inarrêtable, impliquant et entraînant tous les acteurs, du simple individu au chef d’État et aux chefs d’entreprise, en passant par tous les acteurs publics et privés, dans leurs actes quotidiens comme dans leurs décisions stratégiques. Un mouvement puissant capable de souplesse, de patience et de compromis pragmatique dès lors que le cap est gardé. Cela déclenchera une course agricole, industrielle, énergétique, urbanistique, à la « compétitivité » écologique, plus efficace que la menace ou des fiscalités punitives (elles doivent être plutôt incitatives) et un basculement – comme au judo – de l’ensemble du système.
Cette mutation écologique va susciter des décennies d’inventions scientifiques et technologiques
C’est la demande, « les gens », qui imposera cette mutation : voyez l’exemple du bio. La mutation va, elle doit, s’amplifier et personne, aucune entité, ne pourra s’y soustraire. Cela suscitera des décennies d’inventions scientifiques et d’innovations technologiques sans précédent, batteries, recyclages, etc. Les pouvoirs publics devront faire pression sans relâche sur les forces de résistance en les obligeant à annoncer des calendriers précis : en combien de temps pourrez-vous vous passer des pesticides chimiques ? Combien de temps vous faudra-t-il pour former tous les professionnels du bâtiment à la construction écologique ? Pour mettre sur le marché des batteries franco-allemandes ? etc. Un « Haut-conseil des générations futures » favoriserait cette transition en signalant chaque année les avancées et les reculs. Et un vice-premier ministre chargé de l’écologisation stimulerait tous ses collègues.
Mais il faut être conscient que le cœur de la bataille se passe ailleurs dans le monde – et c’est frustrant pour de jeunes Européens mobilisés. Stopper la surpopulation ? On ne peut qu’espérer que la transition démographique touchera le plus vite possible l’Afrique... La sortie du charbon ? Il faudrait que l’Inde, la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Australie (sans oublier l’Allemagne et la Pologne) réduisent et captent le CO2 (innovations à prévoir), passent transitoirement par plus de nucléaire, même si cela choquera certains qui ne hiérarchisent pas les risques, en attendant que le solaire soit viable. Que le monde entier reboise au lieu de déboiser (Brésil, Indonésie). Que le Japon limite sa pêche. Que la Chine arrête le trafic de l’ivoire venu d’Afrique, etc. etc. [l'Europe, elle, comme d'hab', explique au monde entier, elle fait de la pédagogie]
Mettons en place un PIB écologique pour évaluer la valeur patrimoniale de la nature
Mais nous ne gouvernons pas, ou plus, le monde ! Et nous n’allons pas faire la révolution écologique et sociale tout seuls, dans notre coin ! Cela ne tiendrait pas. Comment agir ? En saisissant toutes les organisations susceptibles de servir de cadres à des engagements internationaux : cela a été le cas avec la COP21 à Paris sur le climat, il faut obtenir la même chose avec la COP26, en 2020, à Pékin, sur la biodiversité, faire ratifier le Pacte mondial pour l’environnement proposé par Laurent Fabius (en 2021 ?). Cela ne remplacera pas les percées scientifiques mais cela les soutiendra et encouragera tous les changements individuels : tri et recyclage, alimentation moins carnée et plus bio (sans devenir sectaire) ou issue de l’agriculture raisonnée. Il ne faut pas désespérer des nouveaux consommateurs des classes moyennes des pays émergents qui eux-mêmes vont devenir plus conscients et exigeants.
Si on arrivait en plus à évaluer économiquement la valeur patrimoniale de la nature (air pur, eau potable, forêts, océan non pollué, terres vierges) et à partir de là à concevoir un PIB /E (un PIB écologique) qui intégrerait dans la formation des prix l’atteinte portée au patrimoine naturel, alors que le PIB actuel, très fruste, ne mesure que les flux marchands, cela orienterait dans le bon sens des milliards de décisions économiques prises aveuglément chaque jour, plus encore qu’une taxe carbone, indispensable en attendant, et cela mériterait le prix Nobel d’économie ! Il faut alarmer, sans paniquer, et indiquer un chemin, sans mêler à cela toutes les questions sociales, sociétales ou autres, si l’on ne veut pas être paralysés ou marginalisés, alors qu’il y a urgence.
le vieux Morin, grand pourvoyeur d'idées qui ne cassent pas trois pattes au capital, avait lancé le mot en 2016, et fait du slogan le titre de la dernière livraison de La Méthode

L'écologie est une donnée fondamentale de la pensée humaniste d'Edgar Morin. Précurseur dans les années 1970 avec un texte intitulé L'an I de l'ère écologique, le philosophe n'a cessé depuis de réfléchir, ajuster, chercher à convaincre d'une nécessaire « écologisation » de la politique française.
Pour Edgar Morin, l'écologie politique ne doit pas se cantonner à la défense des animaux ou aux effets du réchauffement climatique, mais faire un tout concernant l'avenir de l'individu, de la société et de l'espèce humaine : l'Homme a besoin de la Terre qui a besoin de l'Homme. Face au développement techno-scientifico-économique qui dégrade la biosphère et nous menace, il s'agit désormais de transformer nos vies et nos modes d'organisation. Tel devra être la nature de notre futur.
Éclaireur des questions écologiques, il est aujourd'hui une figure proche d'un Nicolas Hulot. Après les orientations de la COP 21 et devant les défis que ne va pas manquer d'exalter une campagne présidentielle qui s'annonce intense, ce recueil d'articles et de textes peut se lire comme une introduction à une politique écologiste de l'Homme. Edgar Morin nous rappelle que notre pire ennemi c'est nous-mêmes, et propose un peu d'espérance et d'utopie concrète dans ce monde incertain.
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Patlotch a écrit:« Anthropocène », « Capitalocène », « Occidentalocène »..., c'est avec ces nouveaux concepts que se présente souvent les débats mêlant théories et idéologies héritées de la philosophie humaniste et du marxisme avec les recherches des anthropologues et naturalistes.
certains sont fructueux, à mon sens, à condition de ne pas s'enfermer dans ces gros concepts comme s'ils disaient le tout sur le tout, ou de les faire redescendre sur les réalités pour en donner l'explication ultime. On en a vu les récents déboires avec "la lutte des classes" quand la classe supposée devenir révolutionnaire ne le manifeste en rien, ou la "pensée décoloniale" quand elle est opposée à une compréhension de l'histoire du capitalisme comme mode de production et reproduction fondé sur l'exploitation
il n'est pas évident en effet que ces nouveaux concepts, matraqués par une nouvelle génération de penseurs qui découvrent la lune, apportent par eux-mêmes grand chose de plus à une critique du capitalisme qui prendrait en compte ses contradictions spécifiques, dans la mesure où elles sont déterminées aujourd'hui par la contradiction antagonique entre le capital et le monde du vivant
bien qu'elle ne semble pas aborder ce problème, la revue ci-dessous présente un intéressant panorama

« Anthropocène », « Capitalocène », « Occidentalocène » : les mots sont multiples pour désigner une seule et même crise, celle que traverse notre monde, abîmé — abîmé parce qu’en mauvais état, abîmé parce qu’en plein effondrement, pour reprendre le titre d’un essai de Jared Diamond. États du lieu depuis l’arpentage mené dans le dernier numéro de la revue Critique, dirigé par Marielle Macé et Romain Noël.
Dès sa Présentation du volume, Marielle Macé évoque les différents auteurs du numéro comme des « témoins ». Se situer dans ce monde abîmé revient en effet d’abord à l’observer, à enquêter, à attester d’une crise, indéniable. Le témoin est aussi, dans le vocabulaire de la construction et du bâtiment, cette petite pièce de plâtre que l’on place dans une fissure pour surveiller son évolution, les penseurs du monde comme il va sont aussi des témoins en ce sens… Témoins, enfin, parce que les auteurs et artistes ici rassemblés sont pris dans cette aporie plus générale d’un savoir et d’un « que faire ? ». L’impuissance est grande, comment intervenir dans le processus en cours ? En écrivant, en se donnant cette distance que permettent les disciplines nous offrant des clés, en les hybridant, en promouvant des ensembles, des communs qui sont peut-être une part de la solution, ici un collectif d’auteurs.
Il s’agit là, poursuit Marielle Macé, de « documenter des pertes certes, mais surtout de prendre acte des expériences, des essais de réhabilitation et de recomposition » afin « d’inventer des façons de vivre » : « on ne revient pas, on arrive ailleurs, on change de scène, on invente, on reconfigure… ». Comme l’énonce Olivier Cadiot dans son Histoire de la littérature récente, « on dit souvent que la littérature est une thérapie, mais pas du tout », elle n’a pas, quoi qu’en disent certains, une plate fonction de baume, elle n’est pas le confortable et fallacieux outil de réparations, elle témoigne et, ce faisant, construit de nouveaux récits à la mesure des forces et tensions qui traversent le monde, afin de figurer ce qui prolifère et demeure trop souvent invisibilisé, « de nouveaux mondes, incertains, bricolés, insolents, de nouvelles pratiques, de nouvelles alliances surtout, où cohabitent toutes sortes de vivants et d’histoires très embrouillées. Il faut prendre acte de ce qui se tente et parfois se libère dans ce monde abîmé : des façons de faire surprenantes, inventives, pas toujours heureuses, pas toujours aimables, mais qu’il nous revient de penser ».
Ces nouveaux récits sont au centre de l’article de Frédérique Aït-Touati, établissant un pont entre la narratologie de Barthes — « Innombrables sont les récits du monde », en ouverture de l’Introduction à l’analyse structurale des récits — et l’annonce, par Anna Tsing, d’un temps « venu pour de nouvelles manières de raconter de vraies histoires », sur les ruines du capitalisme (Le Champignon de la fin du monde). C’est en soi une révolution puisque longtemps french theory et structuralisme ont été tenus pour responsables du retard français dans l’émergence d’un courant écocritique et écopoétique, pourtant acclimaté depuis des décennies dans le monde anglo-saxon. Il est donc temps d’activer de nouveaux enchevêtrements — je cite là Anna Tsing, sans guillemets, au cœur même de la prose, comme le font Donna Haraway ou Timothy Morton (entre autres…), dès la référence donnée une première fois, manière de dire que ces nouveaux récits sont eux-mêmes des hybrides discursifs, mêlant des textes allographes à leur propre discours.
Si, pour Timothy Morton, la pensée écologique est plus un comment qu’un quoi, Frédérique Aït-Touati relativise : les nouveaux récits prennent pour objet moins la création ou le cours du monde que sa fin, ils partent d’un après et, pour ce faire, ils réinventent leurs régimes narratifs et descriptifs. Il n’est pas d’opposition entre l’objet et la forme du texte, de même que les disciplines qui viennent le nourrir sont multiples : biologie, anthropologie, philosophie, histoire, littérature, etc. Les récits d’un monde abîmé n’opposent pas, ils articulent : la catastrophe et conjuration des fins, mondes humains et non humains, faits et fiction, fable et science. Ainsi le champignon d’Anna Tsing, ce matsutake qui pousse sur les ruines, véritable monade, figuration d’un nouveau rapport au monde et à la manière de l’observer : « À la suite de William Cronon qui en avait rouvert la liste, Anna Tsing renouvelle profondément le répertoire d’intrigues disponibles de l’histoire environnementale (mais aussi de l’histoire tout court) en élargissant la liste de ses actants ». Le bouleversement est tout autant épistémologique et méthodologique que narratologique. Comment écrire comme avant, comment même penser qu’une telle continuité soit possible ?
L’article que Frédérique Aït-Touati consacre à ces « Récits de la Terre » ne se contente pas de l’énoncer, elle liste un certain nombre de procédés : l’enchevêtrement, les nouveaux actants (non humains), la superposition, les changements d’échelles, etc. mais aussi une nouvelle manière d’apparier récit et savoir, partant d’un refus de positions stabilisées, « le récit comme méthode ». « La formule doit être prise au sérieux : le récit n’est pas le moyen de diffusion d’un savoir stabilisé, il participe de la construction de ce savoir en étant une « pratique de connaissance » et, ce faisant, enregistre dans sa forme même les évolutions du rapport à la Terre, à ses vivants et à ses paysages ». Il s’agit bien de revendiquer « un pouvoir épistémique du récit ». En somme, et c’est le second paradoxe fondamental énoncé dans cet article, ces récits n’ont pas la catastrophe pour centre mais un désordre.
Ainsi, il faut sortir du simple « constat d’une extinction » et Marielle Macé le montre à travers les oiseaux (« Comment les oiseaux se sont tus »), il ne s’agit pas de faire table rase d’un avant mais de saisir autrement le monde et les êtres qui l’habitent et le peuplent, de se pencher sur les êtres et choses sans parole, dont le silence est langage. Sans leur « feindre une voix » et c’est important. Les écrivains écoutant ce silence bruissant — et Marielle Macé cite tout particulièrement Parce que l’oiseau de Fabienne Raphoz mais aussi Leopardi ou Eduardo Kohn — « connaissent les façons qu’a la nature de se faire entendre. Ils sont précisément là, même, pour l’entendre et pour en répondre. Ils ne prétendent pourtant pas qu’elles puissent parler, ces choses, ils ne leur prêtent pas le don de parole, ne leur feignent pas une voix. Non, ils font moins, et ils font bien plus : ils les écoutent se taire et les entendent crier, réclamer, protester, rêver, penser même – et en toutes occasions affirmer qu’il est temps de vivre autrement, de vivre franchement autrement ».
« Je crois qu’il faut, pour entendre penser les choses du monde, à la fois plus d’imagination et plus de tact (un tact ontologique, conceptuel, linguistique) ; plus d’imagination, d’audace pour prêter l’oreille à ces choses du monde, les entendre crier, réclamer, penser, rêver ; mais plus de tact devant ces non-paroles, un tact qui puisse retenir les chants sans scrupules (…). À cet équilibre d’audace et de scrupules, la poésie, ou plutôt, certains poèmes, pourvoient. Ils ne s’empressent pas de poser par exemple que les oiseaux parlent – ni même qu’ils chantent ! Ils en disent moins, et ils en disent plus – ils disent pire… » (Marielle Macé).
Il s’agit donc d’écouter et entendre, le sol, « Gaïa ou l’anti-Leviathan », ces vies autres qui nous traversent (Emanuele Coccia), de prendre acte d’un trouble (Thierry Hoquet commentant Donna Haraway), d’être dans le partage et une forme de ré-enchantement une fois constaté l’abîme qui nous fait face, auquel nous devons faire face. Il est une urgence, des combats nécessaires, politiques, d’émancipation et de luttes et les articles moins rassemblés qu’articulés dans ce numéro de Critique (si riche qu’il est impossible de tous les évoquer) en arpentent la cartographie exigeante et passionnante.
« Vivre dans un monde abîmé », Revue Critique, n° 860-861, janvier-février 2019, 160 p., 13 € 50
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
DU PÉTROLE, DES INDIENS, ET DES THÉORICIENS
"capitalisme vert" et luttes radicales contre le capital,
économie politique de la rente énergétique
En Equateur, la lutte des Indiens waorani face à l'exploitation pétrolière
Patlotch a écrit:dans la phase actuelle de la restructuration économique du capitalisme global, confronté à la fin des ressources énergétiques fossiles, qui l'a conduit à envisager le capitalisme vert et la "transition écologique" vers l'exploitation de ressources "durables (soleil, vent...), le pétrole tient une place charnière, en même temps que le charbon n'a pas craché ses dernières fumées, ce qui détermine des aspects importants de la concurrence entre pays ou multinationales, et le bras de fer opposant tenants de la tradition et de la transition, dont le symbole vu de chez nous est l'affrontement Trump-Bolsonaro / Macron, alors que les Chinois, l'Inde et nombre de pays asiatiques jouent sur tous les tableaux, à la fois en retard dans l'usage de l'énergie fossile et prenant de l'avance dans la recherche scientifique et l'application à grande échelle de solutions "propres", car confrontés plus encore que l'Occident à la pollution
la lutte des dits indigènes contre l'exploitation des ressources fossiles dans leur lieu d'habitation est en fait une lutte contre la rente foncière énergétique autant que de minerais utilisés traditionnellement dans la production industrielle ou pour les technologies numériques et la production "verte" d'énergie (métaux rares pour les appareils numériques, les éoliennes, les batteries, etc.)
il serait par conséquent désastreux, sur le plan théorique, de considérer l'intérêt porté à ces luttes comme relevant d'un exotisme qui, il est vrai, ne fut pas absent de la fascination gauchisme et en deçà pour le Chiapas entre autres, ce que n'aura pas manqué de faire RS/TC, le Savant de Marseille, gourou de la communisation selon Sainte Théorie Communiste, prouvant par là encore que son marxisme n'aura saisi de Marx que ce qui pouvait valider ses thèses, et la faiblesse congénitale de sa critique de l'économie politique du capital. Rappelons ce morceau d'anthologie :il y a une autre façon d'affirmer que le capitalisme vert n’existe pas, celle de théoriciens ou militants écologistes pour qui le capitalisme ne peut pas être écologique, ce qui est vrai. Exemple :Roland Simon a écrit:La « révolution Macron » du « capitalisme vert ». C’est de la blague, comme le « capitalisme vert » en général, macronien ou non. Il y a des investissements et des profits à attendre (peut-être) des éoliennes, du solaire, etc., c’est le capitalisme tout court. Et les taxes sur le gazole sont là pour rembourser la dette publique, c’est tout. Le mouvement des Gilets jaunes aurait existé sans « capitalisme vert » dans la mesure où le « capitalisme vert » n’existe pas. Comme l’exposait un récent article du Monde, les banques françaises continuent à investir massivement dans le pétrole et le charbon, tranquillement et sans vagues. La « contradiction entre le capital et le vivant ». A la rigueur, « le capital » on peut avoir quelques idées, mais le « vivant » c’est quoi ? Quant à la dimension écologique du mouvement, que ce soit pour être pour ou contre la planète, il s’en fout.
Réponse aux commentaires de Patlotch dndf 12 décembre 2018mais ces écolos vent en poupe en tirent, à l'inverse du fossile théorique TC, la nécessité de la lutte écologiste pour abolir le capital. Personnellement, si je n'ai jamais dit ou pensé que le capitalisme vert existe comme fossile compatibilité entre économie politique et écologie, mais comme aspect déterminant de concurrence inter-capitaliste comme dynamique autant que la lutte des classes, qu'elle soit prolétarienne et le plus souvent anti-écologiste, ou directement contre la rente foncière et énergétique et donc immédiatement révolutionnaire en essenceQu’est ce que le concept de « capitalisme vert » évoque pour vous ? Que représente-t-il dans la réalité, notamment en termes de poids économique ?
Hervé Kempf. Le « capitalisme vert », c’est la continuation du capitalisme et donc la continuation d’un système qui dans son principe est destructeur de l’environnement et qui, dans sa dernière phase, s’est traduit par une expansion extraordinaire des inégalités. Donc, le capitalisme vert, ce n’est même pas un oxymore, ça n’existe pas. C’est seulement une construction et un habillage idéologique pour faire croire que l’on peut évoluer par rapport à l’environnement sans changer les déterminants fondamentaux de nos régulations sociales, de notre système économique et de la répartition des pouvoirs dans cette société.
Le capitalisme vert, ça n’existe pas ! Europe-Écologie, 30 avril 2009
il va sans dire que même les capitalistes à prétention verte sont confrontés à cette lutte, comme le montrent nombre d'exemples en Amérique latine, à commencer par "chez nous", en Guyane...
En Equateur, la lutte des Indiens waorani face à l'exploitation pétrolière
L'Obs avec AFP 26 avril 2019

Les Indiens waorani Memo Ahua (D) and Tiri Nenquimo marchent près du village de Nemompare,
sur les berges du fleuve Curaray, en Equateur, le 14 avril 2019 (c) Afp)
L'Obs avec AFP 26 avril 2019

Les Indiens waorani Memo Ahua (D) and Tiri Nenquimo marchent près du village de Nemompare,
sur les berges du fleuve Curaray, en Equateur, le 14 avril 2019 (c) Afp)
Nemompare (Ecuador) (AFP) - Lances et flèches empoisonnées sont toujours à portée de main pour faire face à l'envahisseur. Mais cette fois, les Indiens waorani d'Equateur comptent sur la justice pour empêcher l'invasion de leurs terres amazoniennes par des compagnies pétrolières.
Peuple de chasseurs, les Waorani se considèrent comme les gardiens de la forêt amazonienne, qui couvre plusieurs provinces de l'est de l'Equateur. "Vous voulez que les compagnies pétrolières viennent pour tuer la forêt, polluer un territoire propre et des eaux claires ?", lance Debanca, une des chefs du village de Nemompare, à une équipe de l'AFP qui s'est rendue sur place.
Une cinquantaine d'Indiens waorani habitent dans ce village situé en pleine forêt sur les berges du fleuve Curaray. La plupart vivent nus, d'autres sont vêtus de shorts et de chemises.
Pour atteindre Nemompare, 40 minutes de vol en petit avion sont nécessaires depuis Shell à 150 km de Quito. La localité a adopté le nom de la multinationale pétrolière européenne implantée depuis près d'un siècle dans l'Etat de Pastaza, et devenue un symbole de la pénétration des activités d'extraction en Amazonie.
Avec d'autres Waorani, les villageois de Nemompare ont décidé de recourir à la justice pour empêcher l'arrivée des compagnies sur leur territoire.
Vendredi, un tribunal de Puyo, la capitale de l'Etat de Pastaza, doit rendre son jugement en première instance, point de départ d'une bataille judiciaire qui s'annonce longue.
L'exploitation du pétrole est un des piliers de l'économie équatorienne depuis les années 1970, mais elle a laissé des traces de destruction encore visibles dans la forêt : sources d'eau contaminées, montagnes de déchets, disparition de la faune...
A Nemompare, les Waorani stockent l'eau de pluie pour leur consommation, ont accès à l'électricité grâce à des panneaux solaires et dorment dans des hamacs. Ils ont appris à écrire avec des "kowori" (étrangers), mais ils s'accrochent à leur langue, le wao terere.
Assise dans une hutte, Wiña Omaca illustre l'esprit de résistance qui anime son peuple. "Les +tapaa+ (lances) sont prêtes, mais aussi les +campa+ (machettes) et les +aweka+ (haches)", énumère-t-elle.
- Propriété du sous-sol -
Personne ne se risque à parler de guerre, mais ces Indiens pourraient transformer leur territoire en une zone hostile pour les compagnies pétrolières.
"Nous défendons notre forêt, notre culture et le droit à mener notre vie", explique en espagnol Nemonte Nenquimo, présidente du Conseil Waorani de Pastaza (Conconawep) à l'origine de la procédure judiciaire.
Les Waorani (4.800 personnes) sont propriétaires de 800.000 hectares de forêt dans les Etats de Pastaza, Napo et Orellana. La loi équatorienne reconnaît leurs droits de propriété, mais l'Etat conserve celle du sous-sol.
Il y a un mois, le Conconawep a déposé une requête judiciaire pour demander qu'une partie du territoire waorani, soit 180.000 hectares de forêt (1% du territoire équatorien), soit exclu d'un futur appel d'offres pétrolier.
Le gouvernement affirme avoir eu le feu vert pour lancer cet appel d'offres après l'organisation, en 2012, d'une consultation des Waorani comme l'exige la Constitution. De leur côté, les Indiens assurent avoir été trompés par les fonctionnaires venus les interroger.
Pour l'heure, le combat se livre devant la justice, mais l'histoire des Waorani est traversée d'épisodes violents qui font craindre leur réaction. Deux clans nomades, les Taromenane et les Tagaeri, qui vivent en isolement volontaire, se sont parfois affrontés à mort dans les profondeurs de la forêt.
"Ils n'entretiennent pas une relation amicale", confirme à l'AFP Miguel Angel Cabodevilla, un missionnaire espagnol, qui a vécu trente ans auprès des Waorani.
Des exploitants forestiers, qui avait fait usage d'armes pour s'installer sur une partie de leur territoire, ont également été la cible des lances des Waorani. Mais "la violence s'exerce principalement entre eux", souligne M. Cabodevilla.
"Leurs terres leur ont été enlevées, ils ont été persécutés et tués, ils ont été réduits en esclavage, et maintenant leurs sous-sol sont utilisés sans aucune compensation adéquate", estime le missionnaire.
Après des décennies de violences et de manipulations de la part des gouvernements, des pétroliers, des entreprises de caoutchouc et des bûcherons, les Waorani sont devenus très méfiants.
Peke Tokare, un "pekenani" (sage) dont les lobes d'oreilles sont élargis par des disques de bois, pointe du doigt le slogan inscrit sur sa chemise : "Monito ome goronte enamai" (Notre territoire n'est pas à vendre).
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
EXTINCTION DE MASSE DES ESPÈCES
comment "l'humanité" peut-elle se sauver des conséquences d'une nouvelle extinction ?
Patlotch a écrit:si, depuis, 500 millions d'années, cinq extinctions de masses ont provoqué de 60 à 95% de disparition des espèces, d'autres furent produites, la vie n'a pas disparu, le vivant s'est métamorphosé. Il est probable que l'extinction en cours, si elle se confirme, ne détruirait pas complètement la vie, mais quid de l'espèce humaine, de sa survie et mutation, de son activité en tant que telle et comme déterminée par le capital ou surmontant ce facteur par son dépassement ? Telles sont les questions qui se posent, selon l'arc historique considéré dans le passé et vers le futur, dans un enchevêtrement dialectique où mes problèmes sont hiérarchisés
du point de vue de la vie, du vivant, que l'espèce humaine disparaisse ou pas n'est au fond que son problème, le problème de l'humanité, celui qui préoccupe aujourd'hui car la disparition d'espèces animales provoque inévitablement des modifications dans la vie humaine, et pousse à son auto-préservation selon des modèles plus ou moins souhaitables, du transhumanisme et de la robotisation des humains de l'"homme augmenté" à des visions de retour à la "vie sauvage" à l'harmonie universelle d'une communauté humaine réconciliée avec la nature
l'humanité pour éviter sa disparition ne peut qu'envisager autrement son "rapport à la nature", et elle ne peut le faire qu'en programmant la mort du capital. Il est d'une part évident que ce ne peut être la tâche du seul prolétariat, d'autre part qu'abolir le capital ne suffira pas. Par conséquent c'est dès maintenant que doivent être posés les conditions nécessaires, c'est-à-dire les contenus, d'un processus révolutionnaire non réduit à une révolution-insurrection comme moment de rupture court à l'échelle du temps historique
"l'humanité" comme tout, d'où les guillemets, n'existe qu'à travers ses contradictions antagoniques dont celle de classe est structurante et sans doute la seule dont on peut souhaiter le dépassement, à la différence des contradictions de genre, puisqu'il est difficile de souhaiter la disparition des différences non hiérarchiques entre sexes (le débat Federici/abolition du genre que j'ai évoqué en 2014), et d'autres comme les différences entre caractéristiques diverses entre les humains, qu'ils soient génétiques ou culturels : le "communisme" ne peut être envisagé comme un mode universellement homogène d'organisation communautaire et de modes de vie à l'échelle mondiale ou planétaire, car ça, c'est le collectivisme, la supposée émancipation de chacun par celle de tous, la loi du plus fort parce que plus nombreux, du moins en principe, c'est la démocratie de la majorité contre la liberté des minorités et des individus...

Crise écologique : Revivez les cinq dernières extinctions de masse
J.D. avec AFP Twitter 29/04/19
J.D. avec AFP Twitter 29/04/19
Alors que nous allons tout droit vers une nouvelle grande extinction de masse, notre planète en a déjà connu cinq qui ont sérieusement amoché le vivant

Un dinosaure. — Dinosaurs in the Wild
Patlotch a écrit:De nombreux scientifiques estiment que la Terre est au début d’une nouvelle « extinction de masse » marquée par la disparition d’espèces à un rythme alarmant, principalement à cause de l’activité humaine. Mais ce n’est pas la première fois : depuis 500 millions d’années, la planète a vécu cinq précédents épisodes au cours desquels au moins la moitié des créatures vivantes ont été éradiquées en un clin d’œil au regard de l’histoire géologique.
Au total, plus de 90 % des organismes qui ont un jour marché, nagé, volé ou rampé ont aujourd’hui disparu. Comme dans l’épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, tout finit par mourir (oups). Voici un aperçu de ces cinq principales extinctions de masse, au moment où scientifiques et diplomates de plus de 130 pays sont réunis jusqu’à samedi à Paris pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de quinze ans.
Extinction de l’Ordovicien
Quand ? il y a environ 445 millions d’années
Disparitions d’espèces : 60 à 70 %
Cause probable : période glaciaire courte mais intense
A cette (lointaine) période, la vie se trouvait principalement dans les océans. Les experts estiment que la formation rapide de glaciers a congelé la plus grande partie de l’eau de la planète, provoquant une chute du niveau de la mer. Les organismes marins comme les éponges et les algues en ont payé le prix, tout comme des coquillages et des céphalopodes primitifs et des poissons sans mâchoires appelés ostracodermes.
Extinction du Dévonien
Quand ? Il y a environ 360 à 375 millions d’années
Disparitions d’espèces : jusqu’à 75 %
Cause probable : épuisement de l’oxygène dans les océans.
Là encore, les organismes marins ont été les plus touchés. La fluctuation du niveau des océans, le changement du climat ou l’impact d’un astéroïde sont soupçonnés d’en être responsables. D’après une des théories, la prolifération de végétaux terrestres a conduit à une anoxie (manque d’oxygène) dans les eaux de surface. Les trilobites, arthropodes du fond des océans, en ont notamment fait les frais.
Extinction du Permien
Quand ? il y a environ 252 millions d’années
Disparitions d’espèces : 95 %
Causes probables : impacts d’astéroïdes, activité volcanique
Parfois qualifiée de « mère de toutes les extinctions », cette crise biologique de grande ampleur a dévasté les océans et les terres. Elle est la seule à avoir également pratiquement vu la disparition des insectes. Certains scientifiques pensent qu’elle s’est produite sur des millions d’années, d’autres seulement sur 200.000 ans.
Les trilobites qui avaient survécu aux deux premières extinctions ont finalement disparu, tout comme certains requins et poissons osseux. Sur terre, les moschops, des reptiles herbivores de plusieurs mètres de long, ont également fini par mourir.
Extinction du Trias
Quand ? il y a environ 200 millions d’années
Disparitions d’espèces : 70 à 80 %
Causes probables : multiples, toujours en débat
La mystérieuse extinction du Trias a éliminé nombre de grandes espèces terrestres, dont la plupart des archosauriens, les ancêtres des dinosaures et dont descendent les oiseaux et les crocodiles d’aujourd’hui. La plupart des gros amphibiens ont également disparu.
Une théorie évoque des éruptions massives de laves au moment du morcellement de la Pangée, le dernier supercontinent, éruptions accompagnées d’énormes volumes de dioxyde de carbone ayant provoqué un réchauffement climatique galopant. D’autres scientifiques soupçonnent des astéroïdes, mais aucun cratère n’a pour l’instant été identifié.
Extinction de Crétacé
Quand : il y a environ 66 millions d’années
Disparitions d’espèces : 75 %
Cause probable : impact d’un astéroïde
La découverte d’un immense cratère dans ce qui est aujourd’hui la péninsule mexicaine du Yucatan corrobore l’hypothèse selon laquelle l’impact d’un astéroïde est responsable de cette crise ayant vu la disparition des dinosaures non aviaires comme les célèbres T-Rex et les tricératops.
Mais la plupart des mammifères, des tortues, des crocodiles, des grenouilles et des oiseaux ont survécu, tout comme la vie marine, dont les requins, les étoiles de mer et les oursins. Sans les dinosaures, les mammifères ont proliféré, conduisant à la naissance de l’homo sapiens, l’espèce responsable de la probable 6e extinction.
Patlotch a écrit:remarque : le titre de cet article ci-dessous, "Revivez...", comme "Revivez la finale de la Coupe du monde..., Revivez la Conférence de Presse de Macron... Revive les énième acte des Gilets jaunes... » suggère une entrée "REVIVRE" à mon DICTIONNAIRE DES IDÉES QU'ON SUIT...
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
LE VERT ET LE ROUGE,
LA PORTE OUVERTE... OU PAS VERTE
Patlotch a écrit:la critique radicale du capital s'est faite écologique, c'est désormais une évidence comme le fait qu'elle ne fait en ceci que prolonger celle de Marx, d'un capitalisme fondé sur la double exploitation des prolétaires et de la terre. C'en est moins une que la critique écologiste du capital soit majoritairement devenue radicale, prenant les choses à la racine
toujours est-il qu'entre derniers fossiles marxistes attachés à la stricte contradiction principale de l'exploitation de la classe ouvrière et ceux, nombreux, des écologistes, qui la rejettent comme caduque, entre révolutionnaires réacs et réformards écolos, la question est vastement brassées en paroles et parfois dans les luttes quand y surgit la perspective d'une autre monde possible
L'histoire en vert (2/4)
La nature et le Capital
France Culture, 10/09/2019, 52 mn
La nature et le Capital
France Culture, 10/09/2019, 52 mn
Loin d’une histoire naturelle déconnectée des hommes et extérieure aux sociétés, l’histoire environnementale s’applique à révéler les pratiques et les rapports de force qui lient depuis toujours les sociétés humaines à leur environnement.

Planche issue de "La recomposition des mondes" d'Alessandro Pignocchi
Crédits : Alessandro Pignocchi
Dans la première partie de l'émission nous verrons dans quelle mesure l’acte d’appropriation a-t-il caractérisé la relation des sociétés occidentales à leur environnement, avec Fabien Locher, historien au CNRS et au Centre de recherches historiques de l’EHESS, pour Posséder la nature. Environnement et propriété dans l’histoire (dir.), éditions Amsterdam, 2018
Et si les dirigeants de la planète se convertissaient à l'animisme des Indiens d'Amazonie ? Et si notre culture de prédation de l’environnement devenait un mode de vie en voie d’extinction à préserver ? Ce sont des questions que posent Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences cognitives et philosophie, auteur de bande-dessinées, que nous recevons en seconde partie d'émission.
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
DIEU EST MORT, L'HOMME BIENTÔT ?
VIVE LA VIE !
Patlotch a écrit:c'est une façon des plus radicalement écologistes et des moins anthropocentristes d'envisager l'avenir non de, mais sans l'humanité. Une sorte de relativisme sinon tranquille, du moins optimiste : le vivant n'est pas près de crever, alors, avec ou sans l'"Homme", qu'importe ? Avec un avantage collatéral, plus d'humanité, plus de capitalisme
à l'échelle de la vie d'un individu, et des générations suivantes qu'il peut connaître, enfants, petits enfants... après eux le déluge. Ils n'ont aucune raison de s'en préoccuper autrement que de façon morale, et une de se réjouir : avec la fin de l'humanité, celle du capital, le paradis sur terre ?
Extinction de masse :
A quoi ressemblerait la planète si l’homme disparaissait ?
Comme toutes les espèces, l’homme va disparaître… mais quand ?
Laure Beaudonnet 20 minutes 03/10/19
A quoi ressemblerait la planète si l’homme disparaissait ?
Comme toutes les espèces, l’homme va disparaître… mais quand ?
Laure Beaudonnet 20 minutes 03/10/19
L’effondrement de la biodiversité n’est un secret pour personne, mais l’homme fait partie de cette biodiversité.
L’espèce humaine va s’éteindre d’une façon ou d’une autre, même si on ne sait pas quand.
Après la disparition de l’homme, la biodiversité a toutes les chances d’être encore plus riche.

La Terre vue de l'espace. Alexander Gerst/ESA/N.A.S/SIPA
Faut-il craindre la fin de notre civilisation (ambiance collapsologie) ou la disparition de l’espèce humaine ? Yves Cochet, ex-ministre de l’Ecologie et président de Momentum qui publie Devant l’effondrement, ne rejette pas l’hypothèse selon laquelle l’humanité n’existerait plus en tant qu’espèce en 2050. Si cette prédiction semble pessimiste, les études scientifiques ne sont guère plus joyeuses.
Au mois de mai, un rapport du groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) a alerté sur l’effondrement -plus rapide que prévu- de la biodiversité. Environ un million d’espèces animales et végétales sur les quelque huit millions estimées sur Terre sont menacées d’extinction, dont « beaucoup dans les prochaines décennies ». Ces projections correspondent aux mises en garde de nombreux scientifiques qui estiment que la Terre est au début de la sixième « extinction de masse ». L’humanité, qui dépend de la nature pour boire, respirer, manger, se chauffer ou se soigner, est-elle directement menacée ?
Une extinction pour la fin du siècle ?
Ne nous leurrons pas, notre espèce finira par s’éteindre, comme toutes les autres. « Les humains vont disparaître d’une manière ou d’une autre, soit pour devenir autre chose, soit ils disparaîtront sans descendants », explique Jean-Renaud Boisserie, paléontologue au CNRS et directeur du laboratoire Palevoprim. « L’espèce humaine d’aujourd’hui est la survivante de plusieurs espèces humaines qui ont cohabité en même temps sur la planète », complète Francis Duranthon, directeur du Museum de Toulouse qui relève toutefois la gravité de la situation actuelle. Il compare la biodiversité à un avion. Dans cette analogie, l’homme est dans la carlingue. « Un avion a des ailes qui sont rattachées au fuselage par des rivets. Tous les rivets sont des éléments de la biodiversité, si on en enlève un, ce n’est pas trop grave, mais au bout d’un certain nombre d’éléments de biodiversité qu’on enlève, l’aile se détache et comme nous sommes dans la carlingue, nous nous crashons avec le reste du système ».
Qu’ils le veuillent ou non, les humains sont des animaux. Ils font partie de la biodiversité et ils tirent une grande partie de leurs ressources de ces écosystèmes. S’ils altèrent ces écosystèmes, l’impact sur les humains est énorme. De là à envisager leur disparition pour la fin du siècle (ou moins), il ne faut quand même pas pousser… « Je ne vois pas par quels mécanismes, on pourrait éradiquer une espèce aussi répandue et aussi nombreuse que la nôtre en quatre-vingts ans », s’interroge Jean-Renaud Boisserie.
« Après une crise de la biodiversité, la vie reprend »
Dans un monde idéal, après seulement 300.000 ans d’existence, Homo sapiens devrait encore avoir beaucoup de temps à vivre. Mais ne rêvons pas trop vu la rapidité de l’effondrement de la biodiversité… Que se passera-t-il lorsque l’humanité sera balayée de la surface de la Terre ? « Les enseignements qu’on peut tirer des grandes crises de la biodiversité à travers l’histoire de la vie montrent que, de toute façon, la vie reprend », observe Francis Duranthon. Il reste toujours des espèces, en très petit nombre, à partir desquelles une nouvelle biodiversité se crée.
« La vie sur Terre s’est complètement passée de nous pendant quasiment quatre milliards d’années, elle se passera complètement de nous une fois qu’on aura disparu », observe Jean Renaud Boisserie. N’en déplaise à l’ego de l’homme. Des extinctions de masse ont déjà eu lieu dans le passé et elles n’étaient pas liées à l’influence humaine. « Par exemple, il y a 250 millions d’années, au moins 90 % des espèces se sont éteintes et c’est reparti après. Ça met du temps, ça a pris quelques millions d’années pour se rétablir, mais quand ça repart c’est encore plus diversifié et encore plus riche qu’avant », reprend le paléontologue. Même des catastrophes nucléaires en chaîne ne suffiraient pas à détruire le vivant.
En 2016, la chaîne YouTube Mind Warehouse a imaginé dans une vidéo (vues plus de 17 millions de fois) ce qu’il se passerait après la disparition de l’homme. Selon ce scénario, les humains se sont volatilisés d’un seul coup (sans donner d’explication, mais on s’en fiche un peu). Selon cette hypothèse, un mois après l’évaporation des humains, faute de maintenance, les centrales nucléaires finissent par relâcher des vapeurs toxiques et exploser. Mais la vie est extrêmement puissante. « Il y a une composante de la vie qu’il est quasiment impossible à détruire. Vous pouvez faire exploser toutes les bombes atomiques sur la planète, vous n’arriverez pas à détruire les bactéries », insiste Jean Renaud Boisserie. Il n’y a qu’à regarder ce qu’il se passe à Tchernobyl.
Des poulpes à notre place ?
Plus de trente ans après la catastrophe nucléaire, la vie a repris ses droits. Selon la plupart des études menées sur la faune de la région, la zone est peuplée d’ours bruns, de bisons, de loups, de lynx, de chevaux de Przewalski et de plus de 200 espèces d’oiseaux, parmi d’autres animaux, relève un article de The Conversation publié au mois de mai. Comment les animaux, et notamment les grands mammifères, font-ils face à la radiation ? L’une des hypothèses avancée par ces études est… roulement de tambours… l’absence de l’homme. Les pressions générées par les activités humaines seraient plus néfastes pour la faune sauvage à moyen terme qu’un accident nucléaire. En résumé, la biodiversité s’en sortirait très bien sans l’homme, si ce n’est mieux. Ce dernier étant l’un des principaux responsables de la sixième extinction de masse déjà en cours.
On peut même parier qu’il y aurait une diversification de toutes les espèces et une explosion de nouvelles espèces. Avec les poulpes ou les grands singes, aux capacités cognitives remarquables, pour prendre le relais de l’humanité ?
C'EST REPARTI POUR UN TOUR

Jérôme Bosch, Le jardin des délices, vers 1500, détails

Jérôme Bosch, Le jardin des délices, vers 1500, détails
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
je pourrais ajouter au titre : ET LE PROLÉTARIAT ?
théorisation communiste : la catastrophe de Lubrizol nous éclaire sur une contradiction du capital et du prolétariat devenue essentielle. Voir
théorisation communiste : la catastrophe de Lubrizol nous éclaire sur une contradiction du capital et du prolétariat devenue essentielle. Voir
LUTTE ÉCOLOGIQUE CONTRE LE CAPITAL :
le prolétariat peut-il "franchir le pas"?
s'il veut "remettre en cause son existence de classe"
cela passe par la contradiction écologique du capital, qui est aussi la sienne
le prolétariat peut-il "franchir le pas"?
s'il veut "remettre en cause son existence de classe"
cela passe par la contradiction écologique du capital, qui est aussi la sienne
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
du 22 février, ajouts en bas
LE VIEUX EST-IL UN MOMENT DE LA THÉORIE COMMUNISTE ?

texte intégral
Carbure Lutte des classes / Guerre civile / Communisation
qui m'a bloqué, de sénescence, sur Twitter25 février
LE VIEUX EST-IL UN MOMENT DE LA THÉORIE COMMUNISTE ?

texte intégral
Carbure Lutte des classes / Guerre civile / Communisation
qui m'a bloqué, de sénescence, sur Twitter
22 févrieril n'y a pratiquement pas de théorie dans le texte de Carbure, ni problème de nature théorique correspondant à un enjeu révolutionnaire, mais un masque théoriciste habillant une croyance idéologique, la foi en le prolétariat rédempteur, masque à un problème entre le capital et ses ennemis au-delà du prolétariat. Sa rhétorique intellectuelle peut être habilement trompeuse, elle ne cache pas l'indigence du raisonnement logique
pour faire le lien avec le débat #ecologie & #marxisme, le discours condescendant et paternaliste de Carbure à l'égard de Greta Thunberg n'est pas surprenant : « on ne contredit pas un enfant, on l’écoute en souriant.» Cela même que Camatte pointe dans son œuvre
ci-dessous ne retombe-t-on pas dans le dialogue de sourds entre communisateurs et anti-racialisateurs et critiques de la double contradiction classe & genre dans lequel s'enlisent habituellement les discussions de dndf, sans par ailleurs qu'elles ne décollent sur la question des rapports humanité/capital/nature ?Greta 24/02/2020 à 16:46 | #9
@Anonyme
Au contraire, on voit que quand il s’agit de rappeler les bases, la bande de Carbure n’arrive plus à caser la sainte trinité classe/rare/genre de rigueur aujourd’hui et à laquelle elle souscrit pourtant. Peut-être parce que c’est la merde en fait ?
Anonyme 25/02/2020 à 06:31 | #10
@Greta
De mémoire car je n’ai pas relu le texte récemment, pas question de race ou de genre dans celui-ci. Carbure a pu flotter sur ces questions, je n’ai pas toujours saisi la cohérence de sa ligne générale, exemple la “jonction” avec les racisé.e.s qui se serait faite via le Comité Adama et les Cheminots, à Saint-Lazare… Il me semble qu’ici la chute privilégie une révolution strictement prolétarienne :
” La « conscience écologique » prendra alors moins de place dans cette action que le fait de subir directement les conséquences des dégâts laissés derrière lui par le capital. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas décider pour ces individus, au nom d’une commune humanité qui nous rendrait à l’avance maîtres de cette action menée par d’autres. Les raisons n’en sont pas d’abord morales, même si le principe « on ne peut pas décider pour les autres » pourrait bien faire partie d’une morale communiste – encore que pour cela le prolétariat doive auparavant décider pour tout le monde l’abolition des classes, sans quoi « ne pas décider pour les autres » n’est qu’un principe libéral visant à laisser faire les lois du marché. ”
Il se passe avec l’écologie, les luttes écologiques, ou écologistes selon, ce qui s’est passé avec les luttes des femmes et le féminisme à l’époque du programmatisme, tel que l’a par après autocritiqué TC : on verra ça plus tard. Ce qui fait défaut est de les prendre comme faisant partie du mouvement du capital aujourd’hui, ou même si l’on veut de la lutte des classes, “qui n’est pas pure” comme on se plaît à le répéter, mais sans dire tout ce qui fait son inquiétante impureté : les luttes des prolétaires pour sauver leur usine de mort (ses produits comme tel ET son exploitation), les luttes paysannes ou locales pour interdire une mine, sauver une région forestière et les populations en même temps, prolétaires compris, lutte pour la survie donc, contre le capital. Contradictions, on le voit, allant “dans les deux sens”, pour autant qu’il y en ait un à l’histoire répondant à la stricte lutte de classes.
La “conscience écologique” est là, c’est peu de le dire. Entendre la fin de l’interview de Camatte, à propos de Greta Thunberg, où il dément son interviewer sur le fait qu’elle ne serait que “mystification”. Un peu de dialectique ne ferait pas de mal parfois… Reproche-t-on aux luttes prolétariennes de n’être que défensives, de viser l’aménagement du capital (retraites) ? Ce qu’on accepte d’eux considérant qu’ils renverseront la vapeur ne vaut-il pas pour les luttes écologistes, dans la perspective (Camatte) de trouver la voix de la Gemeinwesen comme réconciliation des rapports humanité-nature, but fondamental du communisme selon lui, et qu’il croit lire dans le premier Marx ?
autant, avec "la contradiction de genre" depuis 10 ans, et même avec "la race" depuis 2 ans (TC 26) la théorie de la communisation allait de l'avant en interrogeant ses propres fondements, autant la diffusion en brochure sans réticence ni commentaire critique*, et par tout le "milieu radical", de ce texte d'un seul, carbureblog, assimilant toute lutte écologiste à un combat du capital (le sens du titre), est une régression théorique, une balle dans le pied. Un sacré coup de vieux !
* seuls commentaires en près de 4 mois, les points de vente, via dndf
il y a confusion et assimilation du problème écologique,- à savoir la contradiction, certes capitaliste, du rapport humanité-"nature" -, à ses fausses solutions (Greta Thunberg comme symbole), l'écologisme radical n'existant pas dans cette caricature de critique. Circulez, ya rien à voir ?
une réaction et d'autres attendues ICIPepe@dndf a écrit:Toute critique un peu sérieuse sera bienvenue et relayée ici… A vos claviers…
ben oui, les mecs, et les autrEs, ça dort, ou quoi ? même moi, vous me décevez, alors que vous ne pouviez guère tomber plus bas dans mon estime théorique
pour ma part, c'est une critique déjà contenue dans les précédentes concernant Carbure, et je pense qu'il est impossible de faire "une critique un peu sérieuse" de ce texte en restant scotché au Prolétariat sujet absolu et unique de la révolution, ni même au concept de révolution comme unique voie à la Communauté humaine du vivant, alias pour moi le communisme. Il est donc improbable que Pepe@dndf reçoive des réponses ou que celle-ci mettent le doigt sur le problème puisqu'il est commun au "milieu" interpellé, et que leur habitude est de ne pas en diffuser d'autre
j'informe ma lectorate, Ô Solitude, que ce texte n'a fait l'objet d'aucune réaction sur le compte twitter de son auteur
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
"SECONDARISER" LA SURVIE DE L'ESPÈCE HUMAINE
PAR RAPPORT À LA LUTTE DES CLASSES ?
il n'y a pas dans la post-ultragauche que des imbéciles fermés aux questions écologiques. Tel ici Henri Simon, 98 ans, dans l'éditorial d'Échanges n°169. Voir le dernier paragraphe : « Mais derrière l’ensemble de ces conflits qui ne sont pas dirigés directement contre le mode de production capitaliste se profile un danger pour le capital lui-même et toute la vie sur la Terre, y compris, bien sûr, l’espèce humaine. » Il ne fait pas comme les communisateurs la sourde oreille et la théorie de l'autruche, considérant que seulement en parler reviendrait, comme l'affirmait de "la race" Bernard Lyon de Théorie Communiste en 2012, à « secondariser la contradiction de genre par rapport à "la race" »
Lutter ? Pour ou contre quoi ? Pour ou contre qui ?
Henri Simon, Échanges n°169, février 2020
Henri Simon, Échanges n°169, février 2020
Dans tout débat, il faut avant tout considérer ce qui est inévitablement présent et règle l’ensemble des relations que toute lutte implique, tant dans des attitudes individuelles que dans des unités collectives, celles dans lesquelles on est impliqué ou celles que l’on a créées. Cette omniprésence est celle du régime capitaliste, un mode de production des biens nécessaires ou pas à la survie de l’espèce humaine. Tant que ce système existe sur le plan mondial, il est présent et ne peut être abstrait, quelles que soient les intentions et les volontés agissantes. Dans toutes les réalisations quelconques cherchant à échapper à cette présence contrainte, il est toujours là en embuscade, détruisant, par la violence ou toute forme d’intégration, ces tentatives diversifiées tant par leur forme, leur but limité, leur localisation et leur dimension. Tout ce qui se crée dans un monde capitaliste reste finalement soumis à cette emprise.
Mais, dans la période récente, un phénomène englobé sous le terme « réchauffement climatique », dont certains avaient souligné les prémisses dans un isolement total, est venu se superposer à cette emprise du capitalisme. Dans une sorte de revanche de la Nature contre l’exploitation du vivant comme de toute matière, les conséquences de cette explicitation ont créé une situation qui s’impose au capitalisme lui-même et que, par son fonctionnement même, il est incapable de modifier voire simplement d’endiguer. D’une manière ou d’une autre, tout ce qui vit sur la Terre, y compris le capitalisme, sera contraint de s’adapter ou de disparaître. C’est le grand enjeu de la période présente et si on voit surgir d’innombrables pronostics, en fait personne ne peut dire ce qu’il en sera, même dans une période proche. Et ce ne sont pas les innombrables luttes anciennes ou nouvelles qui permettent d’apporter une réponse quelconque à ce qui touche l’humanité tout entière.
C’est un truisme d’écrire comme le font aujourd’hui les médias que « le monde est en feu ». Parce que, depuis que le capitalisme s’est installé, le monde a toujours été en feu, d’une manière ou d’une autre, depuis les résistances individuelles à la domination ou l’intrusion du capital jusqu’aux conflits armés à l’échelle mondiale, entre grandes unités économiques souvent centrées sur un État plus puissant voulant étendre ou conserver sa domination avant tout économique, même si elle passe par une domination armée. Mais on pourrait dire que la nature du « feu » a changé, passant d’une relative simplicité d’affrontements directs à une complexité d’affrontements de toute nature. De tout temps, la distinction s’est imposée entre luttes sociales et luttes politiques, mais la frontière entre les deux catégories était particulièrement poreuse avec des interférences cachées ou ouvertes. Jusqu’à récemment, la lutte sociale concernait uniquement la domination du capital dans l’exploitation de la force de travail (l’élément central du mode de production capitaliste). Elle allait des attitudes individuelles de résistance (vol de matériel et de temps, sabotage, absentéisme, turnover), qui pouvaient tout autant être collectives, à toutes les formes de grève, une grève générale dans un secteur clé d’un État se transformant inévitablement en lutte politique. Mais le grand rêve du xixe siècle d’une internationale ,unissant dans une même action les prolétaires du monde entier et conduisant à la fin du mode de production capitaliste, a vécu. Ces formes de luttes directes contre la domination du capital sur les lieux de production et leur extension éventuelle existent toujours, mais elles ne semblent plus avoir pour les protagonistes le même impact et surtout ne portent plus l’espoir d’une sortie du mode de production capitaliste. Pour partie, cela est dû au fait que l’organisation présente de la production à l’échelle mondiale rend difficile et inefficace toute action collective globale, même à l’échelle d’un État. Ce qui conduit à considérer ce que représente, à l’échelle mondiale, par-delà ces formes classiques de lutte, la totalité de ces réactions de toutes sortes – sociales et politiques à la fois – « contre », quel qu’en soit le caractère (individuel ou collectif quelconque) , la forme (pacifique ou violente), le tempo (un seul événement ou une récurrence dans le temps), le mode d’organisation (structuré hiérarchiquement ou refusant toute représentation), l’objet (une cellule administrative et/ou territoriale jusqu’à l’univers tout entier), le but (depuis un point précis jusqu’à un thème global limité ou universel, y compris la fin du mode de production capitaliste).
Si l’on devait classer l’ensemble des réactions diverses « contre », on pourrait d’abord les diviser en deux catégories selon leur finalité affichée, entre celles tournées vers un futur et celles tournées vers un passé. Les réactions tournées vers le passé, contre les pouvoirs politiques en place et ses conséquences économiques et sociales, visent à contester ce qu’est le capitalisme aujourd’hui au nom d’un passé qui aurait comporté plus de justice sociale, mais surtout le pouvoir de certaines couches sociales, un mode de vie traditionnel et des « valeurs » mises en pièces par la mondialisation, chaque cadre national et tout ce qui est effectivement balayé par une internationalisation et une uniformisation des modes de vie.
Elles peuvent se référer à deux sortes d’actions. Soit dans un cadre légal en profitant du mécontentement social pour prendre les rênes du pouvoir national et assumer des mesures qui les font entrer en conflit avec les instances internationales. Soit par des guerres ouvertes restant dans un cadre national ou régional, visant à maintenir les intérêts économiques et/ou stratégiques de telles ou telle puissance, ce qui entraîne, comme en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye… d’inextricables situations conflictuelles. Soit des guérillas locales ou régionales comme on peut en voir un peu partout dans le monde. Soit dans des mouvements internationalistes comme Daesh dont les pays capitalistes dominants ont du mal à se dépêtrer. Entre le Rassemblement national de Le Pen et Daesh, ce retour aux « valeurs » du passé leur donne un pôle commun de contestation, non pas du capitalisme mais d’une forme de gestion du système, bien qu’ils apparaissent comme des frères ennemis.
Les réactions vers un futur sont celles qui agissent d’une manière ou d’une autre pour modifier le présent vers une autre orientation dans la dynamique sociale globale.
D’un côté par des manifestations diverses, pacifiques ou violentes visant à contraindre les pouvoirs politiques et/ou économiques à modifier leur orientation et leur pratique. On reste ici dans la sphère politique. On peut classer sous ce titre des manifestations très diverses. Certaines, tout en restant plus ou moins catégorielles, ont pris un caractère international (elles se sont superposées à des mouvements internationaux existant comme la Journée internationale de la femme, le mouvement « me too ») comme celles des jeunes autour de la lycéenne suédoise Greta Thunberg, ou celles de « Extinction Rébellion ». La plupart de ces oppositions politiques restent dans le cadre national mais, en dehors de leur orientation politique, il est difficile de leur trouver un commun dénominateur. Elles peuvent être orientées vers une contestation globale poussée par un délabrement économique accompagné de corruption des élites dirigeants, comme en Algérie, en Egypte, en Irak… Cela peut être plus complexe comme à Hongkong ou en Bolivie. Pacifiques à leur début, elles peuvent devenir violentes par l’effet de la répression, les exemples ne manquent pas. Ce qui complique leur interprétation est que ces mouvements peuvent se diriger contre une dictature, le plus souvent militaire comme au Soudan du Sud, en Algérie ou en Égypte, ou contre des régimes démocratiques comme en Corée du Sud ou dans certains pays d’Europe, y compris la France des « Gilets jaunes ». Le caractère politique de l’ensemble de ces mouvements (la revendication d’un changement de gouvernement ou simplement d’une orientation politique) masque souvent le fait que ce n’est que la forme que prend le mécontentement général sur les conditions de vie d’une majorité de la population. Mais il est rare, sauf dans des expressions très limitées, de trouver dans toutes ces revendications politiques une mise en cause du mode de production capitaliste, pourtant responsable à la base des conséquences de son activité présente, tant dans les conditions de vie de tout un chacun que dans les phénomènes globaux comme le réchauffement climatique et les autres formes de destruction de l’environnement.
D’un autre côté, dans le monde entier on peut voir des tentatives, tout autant orientées vers le futur, de « vivre différemment » soit par des attitude de vie individuelles, soit par des orientations ponctuelles de production hors des sentiers battus du capital, soit par des collectivités tentant d’organiser d’autres formes de production et de vie. Si l’ensemble représente indéniablement une généralisation mondiale, il est bien difficile d’en chiffrer l’importance, en regard du poids des multinationales dominant le monde autour du mode de production capitaliste, et en regard du fait que ces cellules qui se veulent hors du système lui sont en fait indirectement soumises. Tant que ce système domine il peut tout autant les intégrer que les combattre.
Il est pourtant un mouvement tourné vers le futur mais que l’on oublie dans ce débat sur les luttes mondiales, et qui est une véritable guerre qui fait plus de morts que les guerres ouvertes. Nous avons déjà abordé ce problème des « migrations » (1). Le titre devrait être élargi car les migrations se font aujourd’hui tous azimuts et pas seulement Sud-Nord bien que ces dernières prennent plus de place dans notre actualité. Les barrières pour tenter – vainement d’ailleurs – d’endiguer ces vagues renaissantes qui, comme la mer, viennent constamment se briser sur elles, ont proliféré depuis 2014. Si on met en rapport ces protections médiévales des pays plus riches avec les protections internes de ces pays riches où les classes dominantes s’enferment souvent dans des sortes de forteresses intérieures, on peut y voir que la classe capitaliste dominante se voit assiégée par une vague sociale prenant différentes formes. Plus que tous les autres mouvements futuristes ou passéistes, cette guerre sociale rémanente est la véritable menace contre le mode de production capitaliste.
Mais derrière l’ensemble de ces conflits qui ne sont pas dirigés directement contre le mode de production capitaliste se profile un danger pour le capital lui-même et toute la vie sur la Terre, y compris, bien sûr, l’espèce humaine. L’irrépressible dérèglement climatique – auquel le capital, incapable de le contrôler, est contraint de s’adapter de même que l’humanité – fait que tous les autres problèmes en sont entièrement dépendants et/ou exacerbés (par exemple, accentuation des migrations). Ce qui explique que les seuls balbutiements d’une internationalisation de résistance au système viennent de ces luttes contre le réchauffement climatique.
H. S.
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
le vert n'est pas la couleur de Théorie Communiste
TC ne peut accueillir que les malheurs de ses partisans
« ... c’est vraiment sidérant et affligeant.
La “nature” ne fait rien, n’y est pour rien, et à la limite “ne subit rien”,
c’est une réalité inexistante en soi
elle ne peut être un terme en rapport avec le mode de production. »
RS/TC, 19 mai 2020
NI SIDÉRÉ NI AFFLIGÉ :
CONFIRMÉ... ET CONTENT
d'avoir vu juste
Patlotch a écrit:il n'y a pas rapport de l'humanité et du capital À la nature, mais DANS la nature
le reste est anthropocentrisme, qui conduit TC à engager un combat conservateur (de sa théorie)
et réactionnaire contre les luttes écologiques
puisque RS, leader du groupe secte Théorie Communiste, a répondu, véritable cri du cœur, à son camarade François Danel (FD) et à sa proposition d'« intégrer ce qu['il] nomme la question écologique, càd la question du rapport capital / nature / communisation » (ici) à son corpus théorique, par son texte du 11 mai 2020 CONJONCTURE ÉPIDÉMIQUE, crise écologique, crise économique et communisation, voici sa réponse. Mes commentaire dessous, tout sauf une 'réponse à RS'RS a écrit:dndf 19/05/2020 à 17:45, #22
Salut
qu’une grande partie des commentaires sur le texte de FD se focalise sur cette histoire de vaccin c’est vraiment sidérant et affligeant. Les vaccins, on s’en fout en l’occurrence quand le texte soulève l’épineuse question de l’introduction du terme nature dans le rapport entre prolétariat et capital et j’ajouterai dans les rapports conjoints hommes / femmes ; prolétariat / capital, ce qui complique pas mal la question à cause des femmes et de la naturalisation de la construction sociale du “groupe”.
De façon très générale, pour le moment, perso, je demeure sur une conception assez simpliste, j’en conviens : la “nature” n’a d’existence que par et dans un mode de production. En cela, elle ne peut être un terme en rapport avec le mode de production. Si le capital “dévaste la nature”, c’est une contradiction interne du MPC, pas un rapport (ou autre terme) avec la “nature”. La “nature” ne fait rien, n’y est pour rien, et à la limite “ne subit rien”, c’est une réalité inexistante en soi (si on me répond, svp, laissons de côté les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les météorites avec la fin des dinosaures), constamment construite comme élément d’un rapport social. C’est assez “dogmatique” (et certainement pas totalement satisfaisant) mais cela demeure pour le moment mon opinion (en attendant mieux peut-être).
R.S
avec cette courte intervention, RS clôt un non-débat entre lui et moi, davantage qu'avec TC son groupe, puisqu'il est le seul à avoir pris parti explicitement lors de polémiques que j'avais ouvertes contre lui, à l'occasion d'échanges que l'on retrouvera plus haut dans une série de trois interventions en novembre 2018
1) la première chose à dire, c'est que RS me donne raison, et au commentaire où j'affirme : « je pense que la tentative de FD est vouée à l’échec »Patlotch a écrit:FD a raison de demander que son texte soit critiqué “sur l’essentiel”, et il y a deux façons au moins de le faire
1) du point de vue [interne] de la théorie de la communisation existante, dont il propose une refondation sur la base de la version de Théorie Communiste
2) d’un point de vue critique [externe] de la théorie de la communisation dans son ensemble, c’est-à-dire critique de la théorie de la révolution, et plus particulièrement de la théorie du prolétariat (cf Charrier, La Matérielle : Fin de la théorie du prolétariat, 2002-2006, dont FD ne parle pas). Point de vue qui est le mien
2) la deuxième chose porte sur mon appréciation de la proposition de FDPatlotch a écrit:on n’est pas très loin de la critique interne que je faisais à la théorie de la communisation en 2014, et par conséquent, je vois mal comment TC pourrait admettre en 2020 ce qu’il a refusé en 2014, sauf si ça l’arrange...
en relisant mes propos de l'époque, le plancher de terre : écologie radicale, luttes paysannes, environnement, ZAD... , faisant suite à critique du 'courant communisateur' 2014, j'ai vérifié que c'est en termes assez proches de FD que je proposais l'intégration de la question écologique à la théorie de la communisation, pas particulièrement au corpus de TC ni à aucun autre, puisqu'alors je considérais ma critique comme interne à ce courant et je pense qu'elle était encore considérée comme telle par ses théoriciens et partisans. Peu après, j'en ai fait une critique externe et dès lors je n'avais plus rien à leur proposer, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai cessé depuis de les critiquer de plus en plus radicalement, mais en marge de ce qui était pour moi l'essentiel, élaborer ma propre théorisation
3) la troisième chose à préciser, c'est que j'ai trouvé réductrice et sectaire la formule même de FD « rapport capital / nature / communisation »Patlotch a écrit:mais enfin, le rapport humanité-capital-vivant (nature), il se pose au mouvement du communisme au delà d’une théorie, marginale et quasi inconnue, il se pose à l’humanité, et aux communistes parce que le capital est la médiation incontournable
4) la quatrième chose c'est que RS, obsédé par sa seule et étroite problématique, ramène le texte de FD à « l’épineuse question de l’introduction du terme nature dans le rapport entre prolétariat et capital ». D'une part il en modifie la formulation donc le sens, d'autre part il confirme ma critique de son incompréhension de l'œuvre et de la méthode de Marx. Bertell Ollman : VI. La dialectique mise en œuvre. Le processus d’abstraction dans la méthode de Marx. Les trois modes d’abstraction - Les niveaux de généralité, p. 79 à 104.
le tout, au-delà du capital, est immédiatement écologique, par définition, c'est le septième des niveaux de généralité que Bertell Ollman voit chez Marx : « le niveau sept, le plus général de tous, qui fait apparaître les qualités que nous possédons comme parties matérielles de la nature, comme le poids, l’étendue, le mouvement, etc. » Pour peser, y compris dans des luttes, et même des luttes de classes, encore faut-il avoir un corps, un corps physique, biologique, et pas seulement le cerveau d'un être tout de cérébralité pour qui le monde n'est que concepts théoriques
ayant transmis ce livre à TC dès 2007, le fait qu'ils n'en aient rien fait, ni même une critique, participe certes de leur stratégie de l'esquive, ce dont ils ne parlent pas n'existe pas, mais ne l'explique pas. La raison est que ça fout par terre leur vision anthropocentriste du monde existant, une dialectique binaire selon la seule contradiction structurelle prolétariat-capital, à laquelle est "annexée" celle du genre, entre hommes et femmes. Confirmation par ce passage on ne peut plus clair, de l'évacuation de la nature et de l'humanité même, non pas "essence humaine", mais bien rapports sociaux au sein de la nature :RS a écrit: la “nature” n’a d’existence que par et dans un mode de production. En cela, elle ne peut être un terme en rapport avec le mode de production. Si le capital “dévaste la nature”, c’est une contradiction interne du MPC, pas un rapport (ou autre terme) avec la “nature”. La “nature” ne fait rien, n’y est pour rien, et à la limite “ne subit rien”, c’est une réalité inexistante en soi, constamment construite comme élément d’un rapport social.
il est vrai que la formulation est précautionneuse et habile, et je suis d'accord : « la nature est une réalité inexistante en soi » et ce qu' « elle n’a d’existence que par et dans un mode de production. En cela, elle ne peut être un terme en rapport avec le mode de production. » Mais ce rapport, capital-prolétariat, est inclus dans la nature, sans quoi il n'existerait pas. La réalité est inverse : c'est le mode de production qui est en rapport interne à la nature comme tout. Le rapport n'est pas d'extériorité. Comme je l'ai fait remarquer à propos du livre de Jacques "Rapports à la nature, sexe, genre et capitalisme", Temps Critiques, 2014, il n'y a pas rapport de l'humanité et du capital À la nature, mais DANS la nature, le reste est anthropocentrisme. Ce n'est pas parce que l'humanité est séparée de la nature depuis des millénaires (Camatte) qu'elle ne vit pas dedans, et de même le rapport capital-prolétariat (au demeurant rapport interne, capital comme tout, prolétariat comme partie)
laissons de côté la parenthèse : « (si on me répond, svp, laissons de côté les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les météorites avec la fin des dinosaures) », puisque effectivement, en cas de catastrophe majeure détruisant la vie sur terre, le problème ne se posera plus pour personne, et RS a sur ce point raison. Quand j'évoquais une sortie du capitalisme autre que le schéma communisateur, un chaos non réductible aux idéologies de l’effondrement ou de la collapsologie, ce n'était pas à ça que je pensais, mais bel et bien soit à un moyen-âge barbare post-capitaliste, soit à une sortie positive de celui-ci par une voie qui ne soit pas LA révolution. Pour un peu d'imagination prospective, voir les scénarios envisagés en janvier 2019 par Marc Halévy "physicien et philosophe, spécialisé dans les sciences de la complexité tant du point de vue théorique fondamental que du point de vue de leurs applications à l'économie et à la prospective", dans “Un monde en pleine mutation”
par conséquent, RS évacue le problème parce que pour lui, tout ce qui existe est subsumé sous le rapport capital-prolétariat. Non, la nature n'est pas « constamment construite comme élément d’un rapport social », elle existait avant tout rapport social et celui-ci peut disparaître et la nature continuer à exister, changer. Par contre, et bien qu'on ne puisse parler de la nature comme d'un sujet, agissant consciemment et pour soi, son activité réagit sur le rapport social et à sa destruction par le capital, exemple en répondant par une pandémie, partie prenante de la crise écologique, en régissant sur les individus, parties de la nature, et faisant qu'eux se posent la question de la destruction du vivant par le capital, entre en luttes contre ce danger mortel pour eux, l'humanité, au-delà du prolétariat. Aujourd'hui comme toujours « l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre » (Marx). Une théorie qui ne se les pose pas à temps est obsolète
cerise sur le gâteux quand il ajoute à l'« épineuse question / les rapports conjoints hommes / femmes ; prolétariat / capital, ce qui complique pas mal la question à cause des femmes et de la naturalisation de la construction sociale du “groupe”. » Ainsi des rapports hommes-femmes mêmes est évacuée... la nature, pour la raison que la théorie de RS ne peut pas l'expliquer
5) on le voit, rien d'une 'réponse à RS', ni à FD, ni à quiconque de cette bande d'individus du capital qui se pensent hors nature et hors humanité, constituée en micro-secte dans et autour du groupe Théorie Communiste et sous la haute protection de son gourou RS, que j'ai analysée dans vue intérieure et extérieure sur la micro-secte TC Théorie Communiste et ses environs, 16 au 19 mai 2020. La satisfaction d'avoir vu juste. En affirmant « qu’une grande partie des commentaires sur le texte de FD se focalise sur cette histoire de vaccin c’est vraiment sidérant et affligeant. Les vaccins, on s’en fout en l’occurrence quand le texte soulève l’épineuse question de l’introduction du terme nature dans le rapport entre prolétariat et capital », RS signifie que l'essentiel pour lui est sa théorie et son avenir. Alors que le monde entier se préoccupe d'une pandémie qui aux ravages économiques, sociaux et psychologiques pis que directement sanitaires, RS au comble de son narcissisme et de son ego de théoricien, les vaccins et la nature, il s'en fout
6) il sera, ou plutôt il serait car on n'en saura sûrement pas grand chose, intéressant de connaître les réactions de beaucoup (en proportion, car vu le nombre c'est relatif...) qui suivaient TC avec intérêt depuis des années et parfois des décennies, des vieux comme moi et de rares vieilles, comme cette dame, figure du milieu, qui depuis 1968 a bien connu RS et ses « rapports à la nature » :Lola Miesseroff a écrit:« Je n'étais pas, en 1971, à la manifestation de Bugey qui marqua « l'irruption de l'écologie en tant que champ d'activité de toute première importance » et je dois avouer qu'il me fallut très longtemps pour prendre conscience du poids des préoccupations environnementales.»
Voyage en outre-gauche, paroles de francs-tireurs des années 68, Libertalia, février 2018, p.276
« le poids des préoccupations environnementales » (qui seraient mieux dites écologiques), si les mots ont un poids, cela signifie que les luttes écologiques en ont un, et comme dit plus haut, pour peser dans les luttes y compris "de classes", encore faut-il avoir un corps, un corps physique, biologique, et pas seulement le cerveau d'un être tout de cérébralité pour qui le monde n'est que structure du capital et concepts théoriques
7) totalement déconnecté des préoccupations majeurs et massives de la population mondiale, et à rebours du contenu de ses luttes, le groupe Théorie Communiste engage un combat conservateur (de sa théorie) et réactionnaire contre les luttes écologiques
faire référence à "TC" fut une fierté, c'est devenu une tare
intéressante contribution après la fin de non-recevoir de RS/TC à l'idée d'intégrer la question écologique dans son corpus théorique. Elle peut s'interpréter favorable ou non à la position de RS[/color]Nononyme a écrit:dndf 19/05/2020 à 19:51 | #23
La nature est une catégorie sociale qui correspond aux questions que posent les problèmes d’une époque… Aujourd’hui le concept de nature se développe à partir du sentiment que les formes sociales dépouillent l’humain de son essence… Que plus la culture et la civilisation prennent possession de lui, moins il est en état d’être humain et de par cette réification le concept de nature devient le réceptacle où se rassemblent toutes les tendances agissant contre la mécanisation et la réification croissante… À partir de ce sentiment de déshumanisation la nature prend la signification de ce qui par opposition aux formations artificielles de la civilisation humaine a eu une croissance organique « naturelle » qui n’est pas issue de l’activité transformatrice des humains… Au final la nature devient la non-société de la société humaine…
il n'y a pas "réification" que parce qu'il y a eu séparation de l'humanité avec la nature (Camatte) non vision par le péquin d'une "essence humaine" intemporelle. Le péquin ne fait pas de la philosophie humaniste-théorique, il vit, il mange des fruits et légumes, de la viande, se ballade en forêt, va à la pêche, fait l'amour parfois même naturellement, c'est une invariance changeante avec les mœurs dans l'espace et le temps. Mais ce commentaire est néanmoins une façon de reconnaître cette séparation, la "non-société nature", idéalisée, extériorisée, suscite sa compréhension comme environnement et l'idéologie du développement durable, le capitalisme vert, le Greenwashing
la question sérieuse est posée sérieusement dans
- ÉCOLOGIE, ÉTAT, CAPITALISME VERT et CORONAVIRUS
- LES RAPPORTS HUMANITÉ-CAPITAL-NATURE et LA CONJONCTURE PANDÉMIQUE
- discussions dans CAMATTE ET NOUS
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Achille Mbembe : "Le poids de la vie est incalculable"
Emmanuel Laurentin et Rémi Baille, France Culture, 1er juin
Coronavirus, une conversation mondiale |La vie a-t-elle un poids, et si oui, comment la peser ? Achille Mbembe, politiste et historien, analyse l'expression et les conséquences de la crise sur le monde, son mouvement et sa direction. Qui mène la barque entre le capitalisme et le vivant ?

Quel poids mettre dans la balance ? Crédits : ASHRAF SHAZLY - AFP
Face à la pandémie de coronavirus, Le Temps du Débat avait prévu en mars une série d’émissions spéciales « Coronavirus : une conversation mondiale » pour réfléchir aux enjeux de cette épidémie, en convoquant les savoirs et les créations des intellectuels, artistes et écrivains du monde entier. Cette série a dû prendre fin malheureusement après le premier épisode : « Qu'est-ce-que nous fait l'enfermement ? ». Nous avons donc décidé de continuer cette conversation mondiale en ligne en vous proposant chaque jour sur le site de France Culture le regard inédit d’un intellectuel étranger sur la crise que nous traversons. Depuis le 24 avril, Le Temps du débat est de retour à l'antenne, mais la conversation se poursuit, aussi, ici.
Achille Mbembe enseigne l'histoire et les sciences politiques a l'Universite du Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues. Son dernier livre, Brutalisme (Paris, Editions La Decouverte, 2020), a été écrit avant l'actuelle pandémie qu'il anticipe néanmoins sous maints aspects.
Peser les vies : De l’économie et du vivant
Qu’elle soit ou non le résultat d’un acte intentionnel ou qu’elle relève entièrement du hasard, la Covid-19 aura confirmé un certain nombre d’intuitions que beaucoup n’auront eu cesse de répéter au cours du dernier demi-siècle, souvent sans pouvoir être entendu.
La première concerne le statut et la position de l’espèce humaine dans le vaste univers. En effet, nous ne sommes ni les seuls habitants de la Terre, ni placés au-dessus des autres êtres.
Nous sommes horizontalement traversés par des interactions fondamentales avec les microbes, les virus, les forces végétales, minérales et organiques. Mieux, nous sommes composés en partie de ces autres êtres. Mais ils nous décomposent et nous recomposent aussi. Ils nous font et nous défont, à commencer par nos corps, nos habitats et nos manières d’exister.
Ce faisant, ils ne révèlent pas seulement à quel point la structure et le contenu des civilisations humaines reposent sur des fondations à la fois complexes et éminemment fragiles. C’est aussi le vivant lui-même, dans son anarchie et dans toutes ses formes, qui est vulnérable, à commencer par les corps qui l’abritent, le souffle qui le répand, et toutes les subsistances sans lesquelles il finit par s’étioler.
Cette vulnérabilité de principe est le propre de l’espèce humaine. Mais elle est aussi partagée, à des degrés divers, par tout ce qui peuple cette planète que de puissantes forces menacent de rendre sinon inhabitable, du moins inhospitalière pour le plus grand nombre.
Une chaîne planétaire
Pour ceux et celles qui avaient tendance à l’oublier, l’épidémie aura également mis à nu la part de désordre, de violence et des iniquités qui structurent le monde.
En dépit des progrès accomplis ici et là, “la paix perpétuelle” que le philosophe allemand Immanuel Kant appelait de ses vœux demeure, pour beaucoup de peuples, un mirage.
Aujourd’hui comme hier, la souveraineté et l’indépendance de maintes nations sont, in fine, protégées et garanties par le mécanisme de la guerre, c’est-à-dire la possibilité toujours déjà-la de verser du sang de façon disproportionnée. C’est ce que, pudiquement, l’on entend par “l’équilibre des puissances”.
Nous sommes en effet loin d’avoir établi un ordre international solidaire, doté d’une puissance organisée, qui transcenderait les souverainetés nationales. En même temps, le retour a des empires autarciques relève de l’illusion.
Par contre, la technologie, les médias, la finance, bref une constellation de forces aussi bien physiques, naturelles qu’organiques et mécaniques sont en train de tisser des mailles et des fractures entre toutes les régions du monde.
Faisant fi des frontières étatiques ou, paradoxalement, en s’y appuyant, une chaîne planétaire fort différente des cartographies officielles est en train d’émerger et de se consolider.
Faite d’entrecroisements et d’interdépendances, elle n’est pas l’équivalent de la “mondialisation”, du moins dans le sens que l’on donne à ce terme depuis la chute de l’Union Soviétique.
Il s’agit plutôt d’un Tout éclaté, entrelacs de réseaux, de flux et de circuits qui se recomposent sans cesse a des vitesses variables et sur des échelles multiples.
Ce Tout est le résultat d’enchevêtrements divers, à commencer par les territoires humains et sauvages et leurs bordures respectives. Il dessine une trame du monde faite de multiples extrémités et d’une multitude de grands et petits noyaux. Aucun n’est à part. Tous servent, a un moment ou à un autre, de relais à la circulation rapide de toutes sortes de flux.
Certes, tout ne bouge pas au même rythme. Mais mobilité et vélocité régissent désormais l’existence planétaire sous ses multiples déclinaisons (terrestre, maritime, aérienne, satellitaire ou filaire).
En mouvement ne sont pas seulement les flux de capitaux. Les humains, les animaux, les pathogènes et les objets bougent aussi. La mobilité affecte par ailleurs toutes sortes de marchandises, de données ou d’informations.
Extraites ici, les matières premières font, là-bas, l’objet d’une première émondation. Plus loin, a lieu l’assemblage des composants. Mais aussi discontinues qu’elles puissent en avoir l’air, les filières souvent sont les mêmes, qui vont du concret le plus brut a l’abstraction la plus éthérée. Bref, émergent petit a petit des complexes planétaires dont le propre est de varier les échelles et d’opérer en réseaux plus ou moins spatialement discontinus.
Il y a une part de chaos dans le mode d’apparition de ces chaines. Faute d’être maîtrisés, leur développement et leur expansion risquent d’accélérer les brutalités et de déboucher sur une crise irrémédiable des relations entre l’humanité, ses instruments, et le reste du vivant.
Le sang interdit
La Covid-19 aura, enfin, mis en relief l’un des tragiques soubassements de tout ordre politique, sans doute celui que nous sommes le plus enclins à oublier. Afin d’assurer la continuité de la communauté politique, quelles vies peuvent être sacrifiées ? Par qui, à quel moment, pourquoi et dans quelles conditions ?
Il n’existe en effet aucune communauté d’êtres humains qui ne repose, en son fondement, sur une conception ou une autre du “sang interdit”, celui qui ne saurait être versé qu’a certaines conditions.
Qu’elle soit d’origine, de religion ou de race, toute communauté est en réalité faite non point de semblables, mais de dissemblables. L’interdit du sang a pour fonction de conjurer la division interne. Il permet d’éviter que les membres de la même communauté en arrivent à se tuer les uns les autres.
Au demeurant, les communautés humaines se distinguent les unes des autres par la manière dont, menacées dans leur existence, elles répondent à ce dilemme, à savoir, de qui sommes-nous autorisés à nous débarrasser afin que le cours de la vie ne s’arrête point, et que le plus grand nombre de vies soient épargnées ? Est-il possible d’accomplir un tel sacrifice d’une manière qui ne débouche ni sur une aggravation des affrontements intérieurs, ni sur la dissolution du lien social et la destruction pure et simple de l’unité politique ?
Dans un passé proche et à intervalles plus ou moins réguliers, épidémies et famines faisaient remonter ce dilemme au premier rang des décisions souveraines.
Les guerres en particulier étaient le prototype de ces événements historiques qui, pensait-on, exigeaient que certaines vies soient sacrifiées pour que d’autres puissent être protégées, voire, s’épanouir.
Conflagrations dévastatrices, elles requéraient l’usage impitoyable de la force. Il s’agissait alors de donner la mort a des ennemis accusés de mettre en danger l’existence de la communauté et sa continuité dans le temps.
Mais la guerre étant ce qu’elle est, c’est-a-dire un échange généralisé de la mort, qui se lançait a la poursuite d’un ennemi s’exposait, ce faisant, a la possibilité de tomber en retour sous les armes d’autrui.
A partir du XIXe siècle, c’est surtout par le biais de l’économie que s’effectue le comptage et le dénombrement, puis la pesée des vies, et par conséquent la redistribution des potentialités sacrificielles.
Karl Polanyi rappelle à ce propos que l’économie, et en particulier le commerce, n’a pas toujours été lié à la paix. Dans le passé, précise-t-il , “l’organisation du commerce avait été militaire et guerrière. C’était un auxiliaire du pirate, du corsaire, de la caravane armée, du chasseur et du trappeur, des marchands porteurs de l’épée, de la bourgeoisie urbaine en armes, des aventuriers et des explorateurs, des planteurs et des conquistadores, des chasseurs d’hommes et des trafiquants d’esclaves, et des armées coloniales des compagnies a charte” (Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, 52).
De nos jours, la pesée des vies ne se fait pas en fonction de la part de dette, de justice et d’obligation morale que représente l’appartenance de chacun a la société. Elle s’effectue sur la base d’une série de calculs.
Ces calculs découlent d’une même foi et d’une même croyance. La société n’a plus d’autonomie en tant que telle. Elle est devenue un simple appendice du marché. Tel est désormais et le grand dogme, et le grand pari.
Selon ce pari, le gain et le profit tiré des échanges (ou parfois aussi de la conquête) prévalent en toutes circonstances sur tous les autres mobiles humains. Tout gain est le résultat de la vente d’une chose ou d’une autre. Les prix du marché gouvernent l’existence.
Davantage encore, chaque vie humaine est une probabilité, et le calcul des vies s’apparente au calcul des probabilités. Dans ce calcul, seul compte le réquisit d’effectivité. Au demeurant, la vie n’existe que si elle peut être dépensée, et c’est en acceptant de se délester de certaines vies que celle de la multitude peut être assurée.
Dans la mesure ou l’Anthropocène signe notre entrée dans un nouvel âge viral et pathogène, la question de savoir quels corps risquent de contaminer la communauté et de quelles vies se délester afin que celle de la multitude soit assurée risque, ce faisant, de devenir l’objet privilégié du politique dans un futur prévisible.
Néo-malthusianisme et droit au futur
Vu l’état dans lequel se trouve la Terre, des événements comparables à la Covid-19 risquent en effet de se répéter dans un futur relativement proche.
L’expansion de la monoculture, l’industrialisation des marchés de la viande, l’intensification des rapports entre l’espèce humaine et les autres espèces et la catastrophe climatique aidant, de nouvelles générations de pandémies apparaîtront bientôt.
Parce que chacun de ces événements renverra, en dernière instance, à la possibilité de notre destruction, il suscitera de grandes peurs accompagnées de bouffées d’irrationalité. Davantage encore, il posera, d’une manière aiguë, la question du droit à l’existence et du droit à un futur.
Or, de plus en plus, le droit à l’existence sera inséparable de son envers, dépister qui est porteur de germes de contamination, voire qui peut être éliminé afin que puisse survivre la multitude.
Que des décisions apparemment sanitaires finissent par menacer la survie des indésirables, tel est en effet le grand risque du moment que nous traversons. Ce risque est sous-jacent à la fois aux formes qu’emprunte désormais l’économie et aux nouvelles techniques de gouvernement rendues possible par l’épidémie.
Aussi nécessaires qu’elles soient, les technologies déployées dans le cadre de la crise actuelle n’éliminent pas en elles-mêmes ce danger. Au contraire, au nom de l’argument sanitaire, elles pourraient être facilement retournées contre tout être humain défini comme un risque biologique.
D’ores et déjà, nombre de fonctions régaliennes généralement remplies par les appareils d’État font l’objet d’externalisation. Elles sont de plus en plus exercées par des méga-firmes et des entreprises technologiques privées, en pointe dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la science quantique, l’hypersonique et les techniques de localisation, de captage et de traçage.
Il s’ensuit nombre de questions pour l’heure sans réponses convaincantes. Si la réalité ne doit désormais plus être décrite et représentée que par des nombres et des codes abstraits, et si codes et nombres revêtent de plus en plus la dimension d’une cosmogonie, comment faire pour que la logique qui préside au décompte et à la pesée des vies ne se transforme pas en une logique éliminationiste et d’effacement ? A l’âge du calcul sans frontières et s’agissant des nombres, a-t-on affaire à des certitudes rigides ou à des probabilités, et donc à des paris ? Que veut dire la résistance immunitaire si mesurer le risque est la même chose que quantifier le hasard ? A quoi reconnait-on un Etat qui, au lieu de “défendre la société”, se retourne contre sa population ?
Dans plusieurs pays en effet, la décision de confiner la population a été prise au nom de la protection et du soin, dans le but d’éviter la contagion. A première vue, il s’agissait de sauver des vies et de n’en exposer aucune inutilement au sacrifice.
En réalité, il a bel et bien fallu payer, aussi bien en gros qu’en détail. Le gros des activités économiques a peut-être été ralenti, encore que de nombreux ateliers de misère ont continué de fonctionner. Entrepôts, centres de données, fermes industrielles, usines de transformation de la viande et autres dispositifs du capitalisme numérique sont restés ouverts. Tout ne s’est donc pas arrêté.
Beaucoup ont été réduits au chômage, ont perdu leur gagne-pain, voire leur vie tout court. Le Trésor public est déprimé. Une récession est annoncée. Des dettes internationales ont été contractées, et une partie du futur des générations à venir a été hypothéqué.
L’on sait que dans les régions les plus pauvres de la Terre, l’absence d’assurance et de prise en charge en cas de basculement temporaire ou prolongé dans le dénuement et la destitution est une donnée structurante des luttes quotidiennes pour la survie.
Ici, en temps ordinaires, l’égalité devant la mort est un mythe. Le droit a l’existence est sans contenu tant qu’il n’est pas associé à son corollaire, le droit de subsister.
Les subsistances, il faut sortir et, souvent, aller les chercher au loin, à des coûts chaque fois élevés (transports incertains, interminables marches à pied le long de la journée, permis et autorisations de toutes sortes). Il faut marcher, démarcher, négocier et marchander sans cesse, parfois migrer, et les arracher, s’il le faut, par des voies illégales.
Ravitaillement, approvisionnement et accès aux subsistances dépendent de la capacité de mouvement, de déplacement et de circulation. Ils dépendent aussi de la capacité de s’intégrer dans des réseaux sociaux de solidarité, de multiplier allégeances et appartenances, de convertir le provisoire en une ressource nécessaire à la permanence.
Sans la rencontre des corps, leur accumulation, leur proximité, le contact direct avec d’autres humains, voire l’entassement, la lutte quotidienne pour la survie est perdue d’avance.
Elle ne se gagne pas à l’isolement physique, mais au corps à corps. Dans ces conditions, l’immobilisation forcée ne s’apparente pas seulement à une condamnation. C’est aussi une manière d’exposer une partie importante de la population à d’énormes risques. En ses fractions les plus pauvres, celle-ci est placée sans filet dans une position telle qu’elle n’est prise en charge par personne, et en même temps elle n’est plus capable de se prendre elle-même en charge.
Sous le régime du confinement, les catégories les plus vulnérables de la population auront été confrontées à une alternative plus dramatique encore : obéir à l’injonction d’immobilisation, respecter la loi et mourir de faim, ou faire fi de la loi, sortir et courir le risque de contamination.
A l’heure du déconfinement, l’alternative n’est plus entre le virus et la faim, mais les dilemmes ne sont pas moins aigus.
Si l’on prend pour point de départ la perspective des forces du marché, le calcul est le suivant. Il faut, coûte que coûte, relancer l’économie, au besoin au prix de certaines vies.
Tout compte fait, seul un pourcentage infime de l’ensemble de la population périra en conséquence de l’épidémie. Tôt ou tard, cette fraction de la population, au demeurant inactive ou inemployable, aurait inéluctablement été frappée, emportée dans le court terme par le virus ou d’autres facteurs de co-morbidité.
Chercher à la maintenir à tout prix en vie ne coûte pas seulement cher a la société. La survie de cette fraction de la population se paiera, avance-t-on, en un nombre bien plus élevé de vies humaines. Parce que la ruine de l’économie entraînerait la dissolution de la société, un tel coût est insupportable. Il convient par conséquent de la laisser mourir tout de suite.
En effet, dans la perspective du marché libre, le droit à l’existence ou le droit de subsister relèvent purement et simplement de la spéculation et par conséquent des fluctuations du marché.
Tout comme les subsistances, la vie se gagne et nul ne la gagne sans rien faire. L’un des moyens de la gagner est de travailler pour un salaire. N’ont concrètement le droit de vivre que ceux qui y parviennent grâce à leur salaire, à leur emploi ou à leur travail. Le fait, cependant, est que le voudraient-ils, beaucoup, de nos jours, ne trouveraient pas d’emplois salariés. Le gagne-pain, il faut le composer dans l’aléa et l’incertain.
Le temps de la décision
La Covid aura donc mis en relief différents types de dégradation humaine et sociale et différents types de sujétions économiques. À l’ère du capitalisme numérique, il ne suffit plus de mettre sa force de travail sur le marché pour qu’elle soit achetée. Le travail a encore une valeur marchande. Mais de travail salarié, il y en a de moins en moins pour tout le monde.
C’est notamment le cas dans ces régions du globe ou le virus frappe des sociétés d’ores et déjà vulnérables, en voie de dislocation ou encore sous le joug de la tyrannie. Ici, le gouvernement par la négligence et l’abandon est la règle. C’est ici qu’ont lieu les expérimentations (y compris médicales) les plus brutales, à la croisée du vivant et du non-vivant. Ici, par ailleurs, l’économie de marché a tendance à fonctionner sur le mode de la dépense, du gaspillage et du désencombrement.
Le sacrifice, dans ce contexte, ne renvoie pas nécessairement à un meurtre gratuit. Mais il n’a, à la racine, à peu près rien de sacré. Il ne vise point à s’attacher les grâces de quelque divinité que ce soit.
Il exige que l’on se fasse compter, que l’on procède à des décomptes, que l’on mesure, que l’on pèse des vies et que l’on se débarrasse de celles qui, apparemment, ne comptent point.
Aujourd’hui, ces politiques de désencombrement sont supposées s’inscrire dans l’ordre normal des choses, celles que l’on n’interroge plus tant elles vont de soi. La question, aujourd’hui, est de savoir quand viendra le moment de la décision.
Quand jugerons-nous enfin qu’un tel sacrifice est socialement insupportable ? Quand reviendrons-nous a l’idée selon laquelle le vivant, c’est ce qui est sans prix. Et parce que sans prix, il relève fondamentalement de ce qui est au-delà de toute mesure. Ce faisant, il ne peut ni être compté, ni être pesé. Il est simplement incalculable.
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
j'avais déjà importé cet entretien d'avant la crise du coronovirus et qu'elle ne perturbe nos débats. Cet extrait est à lire en relation avec les échanges dans CAMATTE et NOUS à partir du 24 mars, sur la question de la "séparation d'avec la nature"
je souligne en vert quelques réponses de Philippe Descola
je souligne en vert quelques réponses de Philippe Descola
Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas »
Propos recueillis par Hervé Kempf, Reporterre, 1er février 2020
extraits
Propos recueillis par Hervé Kempf, Reporterre, 1er février 2020
extraits
Nous avons interrogé des visiteurs du Ground Control, le partenaire de Reporterre, en leur demandant : La nature a t elle une conscience ? Écoutons leurs réponses
Moi, j’imagine que la nature a une conscience. Parce que la nature respire, la nature vit, la nature grandit, la nature interagit avec ce qui l’entoure. »
— « Cela ne se voit pas peut être autant que chez l’homme, mais les animaux font des erreurs et ils apprennent de leurs erreurs. Pour moi, çà c’est une conscience. »
— « Les femelles ont un instinct maternel qui est assez développé, je pense que cela peut se rapprocher de la conscience. »
— « On a un peu voyagé. On voit que la nature s’adapte en fonction des événements. Et là, elle est complètement perdue. »
— « La nature est assez résiliente parce que quand on voit par exemple Tchernobyl maintenant c’est bourré de nature, il y a des arbres qui ont poussé dans des maisons, il y a des meutes de loups incroyables, il y a des chevaux sauvages. Je pense que la nature nous enterrera tous. »
Philippe Descola, que vous inspirent ces paroles ?
C’est très intéressant parce que la question au départ était un peu déséquilibrée. « La nature a-t-elle une conscience ? » : cela renvoie à des interprétations romantiques parce que la nature est une abstraction. La nature, je n’ai cessé de le montrer au fil des trente dernières années : la nature, cela n’existe pas. La nature est un concept, une abstraction. C’est une façon d’établir une distance entre les humains et les non- humains qui est née par une série de processus, de décantations successives de la rencontre de la philosophie grecque et de la transcendance des monothéismes, et qui a pris sa forme définitive avec la révolution scientifique. La nature est un dispositif métaphysique, que l’Occident et les Européens ont inventé pour mettre en avant la distanciation des humains vis-à-vis du monde, un monde qui devenait alors un système de ressources, un domaine à explorer dont on essaye de comprendre les lois.
Là, ce qui est intéressant dans la façon dont les gens répondent, c’est qu’ils ne parlent pas de la nature, mais des arbres, des loups, des animaux. Ils sont complètement hors de cette idée de la nature comme étant une sorte d’abstraction.
Dans un autre micro-trottoir, on leur a demandé « C’est quoi la nature ? » .
Elle est partout la nature. La nature de l’homme, la spontanéité. Tout est naturel. »
— « Les grands espaces verts, les forêts. Pour moi, c’est tout cela la nature. Les prés, les champs, les animaux. »
— - « L’homme fait partie de la nature. »
— « En définitive, on est des animaux. »
— « On a fait partie de la nature, mais on l’a oublié. »
— « Cela peut être la nature humaine. Cela peut être entre guillemets, la nature “végétale”, la nature ‘animale’, tout ce qui n’a pas été touché par l’Homme. »
— « Tout ce qui fait partie de la création humaine, pour moi ce n’est pas de la nature. »
— « C’est le vivant. C’est ce qui fait que la vie existe. C’est la vie. »
— « C’est un endroit où l’on n’est pas, en fait. »
— « C’est un chaos de feuilles, de branches, de lianes. C’est quelque chose dans lequel on ne peut pas passer. »
Là aussi c’est très intéressant. On voit que la nature n’est pas un domaine d’objets en tant que tel. C’est une construction qui permet de donner une saillance à tout ce à quoi le concept est opposé. Donc, on va parler de la nature et de la société, de la nature et de l’homme, de la nature et de l’art, de la nature et de la religion,… Heidegger avait bien mis en évidence que la nature est une sorte de boîte vide qui permet de donner une saillance à tous les concepts auxquels on va l’opposer. Moi, je m’en sers pour signifier la distance qui s’est établie entre les humains et les non-humains. Les rapports entre humains et non-humains, pour un anthropologue comme moi, sont caractérisés par des formes différentes de continuité et de discontinuité. Les Achuars mettent l’accent - et d’autres peuples dans le monde - sur une continuité des intériorités, sur le fait qu’on peut déceler des intentions chez des non-humains qui permettent de les ranger avec les humains sur le plan moral et cognitif.
Mais les européens ont inventé l’idée d’une nature, - ce n’est pas une invention d’ailleurs -, cela s’est fait petit à petit. C’est une attention à des détails du monde qui a été amplifiée. Et cette attention a pour résultat que les dimensions physiques caractérisent les continuités. Effectivement les humains sont des animaux. Tandis que les dimensions morales et cognitives caractérisent les discontinuités : les humains sont réputés être des êtres tout à fait différents du reste des êtres organisés, en particulier du fait qu’ils ont la réflexivité. C’est quelque chose qui a été très bien thématisé au XVIIe siècle, avec le cogito cartésien : « Je pense donc je suis. » Je suis capable réflexivement de m’appréhender comme un être pensant. Et, en cela je suis complètement différent des autres existants.
Cela, c’est la philosophie européenne. Mais il y a énormément d’autres cultures où on ne pense pas du tout cette opposition. Vous écrivez que les Achuars n’ont pas de mot pour désigner ce que nous appelons la nature.
Non seulement les Achuars n’ont pas de terme pour désigner la nature, mais c’est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaise et chinoise.
Que pensez-vous de cette formule que, personnellement, j’emploie souvent quand j’interviens en public : « Ce que nous occidentaux appelons la nature »
Ce n’est pas une mauvaise formule.
Que diriez-vous ?
Je parle de non-humains. Ce n’est pas non plus une solution parfaitement satisfaisante parce que c’est aussi une définition anthropocentrique. Quand on parle de non-humains on les définit comme privés de la qualité d’humain. Mais je pense qu’il est préférable d’utiliser une expression comme celle là, que de parler de nature, parce qu’avec le mot de nature, on fait entrer dans notre univers métaphysique tous les autres, et on les dépossède de l’originalité par laquelle ils constituent le mobilier qui peuple leur monde.
Vous arrivez à ne pas utiliser le mot nature ?
J’essaye.
Mais c’est difficile
J’ai intitulé ma chaire au Collège de France : « Anthropologie de la Nature », justement pour mettre l’accent sur une contradiction évidente. Comment peut-il y avoir une anthropologie d’un monde où les humains ne sont pas présents ? [Le mot anthropologie signifie Etude de l’homme – NDLR.] Or non seulement que les humains sont présents partout dans la nature, mais la nature est le produit d’une anthropisation, y compris dans des régions qui ont l’air extrêmement peu touchées par l’action humaine. Je prends l’exemple de l’Amazonie. Mes collègues et moi en ethnobotanique, en ethno-agronomie et en archéologie, avons montré que cette forêt a été transformée par les pratiques culturales. L’Amazonie n’est pas une forêt vierge. La pratique de l’horticulture sur brûlis et la domestication des plantes par les Amérindiens depuis douze mille ans ont profondément transformé le matériel végétal et la composition floristique de la forêt. On y trouve une biodiversité très élevée, dont une biodiversité de plantes qui sont utiles à l’Homme. Donc, la nature comme espace vierge n’a aucun sens. Quelquefois cette artificialité de la forêt est reflétée d’une façon singulière : chez les Achuars, la forêt est vue comme une plantation. Mais c’est la plantation d’un esprit. Quand les Achuars coupent la forêt pour faire une clairière, ils brûlent les déchets végétaux, plantent une grande diversité de plantes domestiquées sylvestres, et substituent les plantations des humains aux plantations d’un esprit. Et quand au bout de quelques années, on abandonne la forêt, la plantation des esprits va regagner sur la plantation des humains.
Sont-ce les esprits qui plantent ? Ou les plantes elles-mêmes qui…
Ah non, ce sont les esprits. Le détail exact des opérations par les esprits n’est pas mentionné. Mais cela souligne le fait important que dans un cas pareil, l’opposition entre ‘sauvage et domestique’ n’a pas plus de sens que l’opposition entre ‘nature et société’. Pour les Achuars la forêt n’est pas sauvage. La forêt est une plantation, travaillée par des non-humains, elle n’est pas un endroit vierge.
Dans les interviews qu’on a écouté, la dernière personne citait l’exemple de Tchernobyl, et disait « Tchernobyl, c’est là que la nature est revenue, les loups, les plantes, la forêt… ». Que pensez-vous de ce paradoxe où l’extrême artificialité c’est-à-dire une construction humaine a conduit à un désastre mais aussi, même si c’est dans des conditions malsaines en termes de radioactivité, à un retour de... du mot que je ne prononcerai pas, au retour d’animaux, de plantes, d’insectes, d’oiseaux …
C’est très porteur d’espoir. Je suis toujours ravi quand je vois une plante folle entre des pavés ou de voir un renard en ville. Cela dit, les conditions que nous avons imposées par le réchauffement climatique, vont profondément transformer la capacité régénératrice des milieux. L’un des effets du réchauffement global sera un appauvrissement de la biodiversité considérable. L’anthropisation continue de la planète depuis que Homo sapiens exerce sa sapiens sur la Terre a franchi un point de bascule avec le développement des énergies fossiles et le réchauffement climatique qu’il engendre. On n’est plus du tout dans le même registre que l’anthropisation de la forêt amazonienne ou que la transformation de l’Australie centrale par les feux de brousse des aborigènes.
Comment ressentez-vous cette anthropisation, cette destruction peut-être irréversible ?
Entre l’anthropisation de la forêt amazonienne par les Amérindiens durant les derniers millénaires, qui n’est détectable que par des gens capables de faire la différence entre des parcelles qui n’ont jamais été utilisées et des parcelles anthropisées au cours des millénaires avec le même taux de diversité, peut-être une centaine d’arbres par hectare, entre cela et le défrichement systématique par les grands propriétaires terriens par le feu pour ouvrir des pâturages qui vont ensuite devenir des plantations de palmes à huile ou de cacao, ce n’est pas du tout le même degré d’anthropisation. C’est pour cela que le terme qui est devenu courant d’anthropocène, s’il est intéressant parce qu’il définit un changement profond dans le rapport entre les humains et la Terre, a comme inconvénient qu’il dilue la responsabilité d’un système économique et politique, qui est celui qu’on a mis sur pied en Europe à partir de la révolution industrielle, avec un effet destructeur que n’ont pas les autres formes d’anthropisation.
Ce système, est-ce le capitalisme ou autre chose ?
Oui, c’est le capitalisme. Moi, j’appelle cela le ‘naturalisme‘ parce que le capitalisme a besoin de ce sous-bassement que j’ai appelé le naturalisme ; c’est-à-dire cette distinction nette entre les humains et les non-humains, la position en surplomb des humains vis-à-vis de la nature. Alors là on peut parler de la nature comme une ressource à exploiter, comme un endroit animé par des phénomènes que l’on peut étudier, etc. Le capitalisme s’est greffé là dessus, le naturalisme est un bon terreau pour cela. Mais le capitalisme peut aussi se développer par transposition. C’est le cas en Chine, et même d’une certaine façon dans ce qu’a été l’expérience industrielle de l’Union Soviétique, fondée sur l’idée des humains démiurges transformant et s’appropriant la nature. Il y a là un sous-bassement singulier dans l’histoire humaine et dont le capitalisme est une des manifestations les plus exemplaires.
Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Editions M-Editer a écrit:Présentation : Que l’être humain soit un animal qui partage avec les autres animaux une grande partie de ses traits semble acquis, depuis longtemps déjà ; qu’il manifeste en même temps, en son comportement comme en sa pensée, des qualités spécifiques, personne n’en a jamais douté. Le débat philosophique s’organise donc aujourd’hui autour du statut à donner à ces qualités : sont-elles la marque d’une rupture radicale entre humanité et animalité, d’une exception métaphysique qui pourrait justifier une hiérarchie, et une utilisation du monde animal ? Devrait-on au contraire prôner une forme de continuité absolue entre l’animal humain et l’animal non-humain, avec les conséquences juridiques que cela implique ? Florence Burgat et Étienne Bimbenet, soucieux de ne pas se laisser réduire aux catégorisations contemporaines – spécisme contre antispécisme – ont sur ce point des positions très différentes, mais aussi en commun une approche très concrète de l’animalité : une approche qui pourrait donner lieu à une confrontation très féconde.
Florence Burgat est philosophe. Directrice de recherches à l’Institut National de la Recherche Agronomique et affectée aux Archives Husserl, elle a consacré ses travaux à la condition animale, aux rapports entre hommes et animaux, dans une orientation phénoménologique. Derniers ouvrages parus : L’humanité carnivore (Seuil, 2017) ; Le mythe de la vache sacrée. La condition animale en Inde (Rivages poche, petite bibliothèque, 2017) ; Être le bien d’un autre (Rivages poche, petite bibliothèque, 2018).À paraître en 2020 aux éditions du Seuil : Si le grain ne meurt. Philosophie de la vie végétale.
Étienne Bimbenet est professeur de philosophie contemporaine à l’Université de Bordeaux-Montaigne. Spécialiste de phénoménologie et d’anthropologie philosophique, il a notamment publié : L’Animal que je ne suis plus (Gallimard, 2011) et Le Complexe des trois singes (Le Seuil, 2018).
Olivier Dekens est professeur de philosophie en classes préparatoires littéraires au Lycée Guist’hau de Nantes. Il consacre ses travaux à la philosophie moderne et contemporaine, notamment : Lévi-Strauss, Figures du savoir (Les Belles Lettres, 2010) ; L’intelligence du lointain. La philosophie à l’école de l’anthropologie (Armand Colin, 2012) ; Le structuralisme (Armand Colin, 2015).
Conférence donnée lors des Rencontres de Sophie 2020
Les Rencontres de Sophie se sont déroulées, au Lieu Unique de Nantes, les 7-9 février 2020 et avaient pour thème « Habiter la nature »
Présentation du thème :
Notre époque s’est construite sur le sentiment que nous, êtres humains, sommes dans la nature comme chez nous. Le risque d’une destruction, aujourd’hui prévisible, de la nature et de l’homme fragilise pourtant cette conviction tranquille, qu’il convient donc de repenser en ses fondements comme en ses effets.
Qu’en est-il de la distinction entre l’homme et la nature ?
Quelles nouvelles manières d’habiter la nature, l’art mais aussi la science et la technique nous permettent-ils alors d’imaginer ?
Quelles valeurs éthique et juridique attribuer aux autres êtres naturels, animaux, végétaux ?
A l’horizon de ce travail philosophique, une conviction : une plus juste façon de penser la nature est la condition d’une plus juste façon de l’habiter, dont la dimension politique est encore à inventer.
qu'en pensez-vous ?


Invité- Invité
 Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
Re: L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT ? ET LE CAPITAL ?
à rebours de l'intervention précédente, à l'erreur de datation près, un article en défense de la thèse de Jacques Camatte pour qui tout s'est joué au moment de « la grande séparation opérée avec la pratique de l'agriculture et de l'élevage. » Cela ne vaut pas approbation d'un futur orienté par une inversion, qui fraye à mon sens avec l'anarcho-primitivisme. Relire LA PASSION DU COMMUNISME, Jacques Camatte, Giorgio Cesarano et la « communauté humaine », publié par Endnotes V puis lundimatin
« dix mille ans d'évolution récente prouvent que l'agriculture et l'élevage, a fortiori en mode intensif,
détruisent chaque jour les milieux naturels, et contribuent à polluer l'atmosphère
dans une mesure telle qu'ils en altèrent la composition. »
Homo sapiens, homo destructor ?
Par Loïc Chauveau, Sciences et Avenir, 13.02.2021
détruisent chaque jour les milieux naturels, et contribuent à polluer l'atmosphère
dans une mesure telle qu'ils en altèrent la composition. »
Homo sapiens, homo destructor ?
Par Loïc Chauveau, Sciences et Avenir, 13.02.2021
Tigres à dents de sabre ou marsupiaux géants ont disparu de la surface de la Terre au moment où Sapiens l'a colonisée. Coïncidence ? Non, affirment de nombreux scientifiques, qui accusent l'homme moderne de détruire son environnement… depuis toujours.

Homo sapiens célébrant un rite.Peinture de Francisco Fonollosa. LEEMAGE VIA AFP
Cet article est extrait du n°204 des Indispensables de Sciences et Avenir, daté janvier/mars 2021.
Pyromane, viandard et destructeur. Voilà le portrait peu reluisant qui émerge des travaux de paléontologie les plus récents. Homo sapiens n’a jamais été en paix avec son environnement. Pire, alors qu’il en dépend pour sa survie, il le violente depuis ses origines. "L’espèce humaine a deux caractéristiques principales, détaille Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France. Elle s’attaque à des animaux plus gros qu’elle, et s’oriente de préférence vers des proies jeunes – ce qui n’est pas le cas des autres prédateurs." Il n’existe pas de meilleur moyen d’éradiquer une espèce occupant le haut de la chaîne alimentaire que de tuer ses jeunes. Les plus gros animaux se reproduisent peu, en effet : les gestations sont longues, très espacées dans le temps, et ne donnent naissance qu’à un ou deux petits à la fois. Qu’une génération s'affaiblisse, et toute l'espèce est menacée. Or, la colonisation de la planète par l'Homme, à partir de la dernière sortie d'Afrique (- 70.000 ans), coïncide avec la disparitions en quelques milliers d'années de la mégafaune : tigres à dent de sabre, marsupiaux géants, ours des cavernes… les victimes ?
La question divise la communauté scientifique depuis plus de soixante ans… sans être tranchée. Les uns, comme Stephen Wroe de l'université de Sydney (Australie), estiment que la principale cause de ces extinctions est le changement climatique, et notamment la remontée des températures du début de l'Holocène il y a 11.500 ans, après un maximum glaciaire particulièrement froid. Impossible, selon eux, que le peu d'hommes peuplant alors la Terre - les estimations de la population européenne lors de ce dernier maximum glaciaire oscillent entre 11.000 et 28.000 individus ! - puissent être responsables de la disparition de dizaines de milliers de grands mammifères. L'inadaptation de cette mégafaune à l'élévation des températures, l'incapacité de changer de diète alors que le couvert végétal se modifie paraissent être des explications plus raisonnables.
Les ancêtres des Aborigènes utilisaient des armes à manche pour chasser il y a 50.000 ans
D'autres chercheurs désignent Homo sapiens comme le coupable idéal… avec des arguments plutôt convaincants. Ils soulignent, d'une part, que certaines espèces ont disparu bien avant le réchauffement du climat, d'autre part, que les sites archéologiques montrent que l'Homme se nourrissait bel et bien de ces animaux. Les preuves les plus convaincantes sont à chercher du côté de l'Australie et de l'Amérique du Nord, là où l'extinction de la mégafaune coïncide parfaitement avec l'arrivée des premiers hommes. Ailleurs, et notamment en Europe, le rôle de Sapiens n'est pas établi.
Alors que les estimations précédentes le voyaient débarquer sur l'île-continent il y a 40.000 ans, les plus récentes stipulent que notre grand ancêtre a posé le pied en Australie autour de -50.000. C'est la première information sensationnelle livrée lors de sa découverte, au début des années 2010, par le gisement archéologique de Warratyi, une grotte située dans le centre-est de l'Australie : 4300 objets divers, 200 fragments d'os issus de 16 mammifères différents et d'un reptile. Mieux, dans un article paru dans Nature en novembre 2016, l'archéologue Giles Hamm, de l'université de La Trobe à Melbourne, montre que ces ancêtres des Aborigènes utilisaient déjà des outils et des armes à manche pour chasser. Des os de diprotodon ou wombat géant, un marsupial de trois mètres de long pour deux de haut, ont été retrouvés sur le site, ainsi que des coquilles d'œufs d'un oiseau immense. Cette découverte assoit les convictions des tenants d'une Blitzkrieg - la destruction, en moins d'un millier d'années, d'une mégafaune australienne sans défense face à un nouveau prédateur - sans pour autant convaincre toute la communauté scientifique ! Stephen Wroe réfute cette hypothèse, estimant qu'elle "repose sur des interprétations simplistes de phénomènes biogéographiques et anthropologiques complexes".
Réexaminant les outils découverts sur les sites archéologiques, les données paléoclimatiques, les connaissances sur la végétation de ces époques, les chercheurs les plus sceptiques concluent que "ni les premiers Australiens, ni leurs descendants immédiats n'ont chassé la mégafaune avec l'efficacité requise pour provoquer une extinction de masse aussi rapide". Et de déplorer que ce débat scientifique ait été instrumentalisé au sein du monde politique comme une preuve que les Aborigènes actuels ne sont pas les défenseurs de la nature qu'ils revendiquent être.
Les discussions sont tout aussi vives en Amérique du Nord, où la période même d'arrivée de l'homme est débattue. Dans la grotte de Hall, au Texas, le sol se couvre régulièrement de sédiments depuis 15.000 ans. L'analyse ADN des fragments d'os découverts sur ce site a montré que les espèces animales et végétales ont réagi différemment à la hausse des températures du début de l'Holocène. "Alors que la diversité végétale s'est rétablie, les grands animaux ont disparu, explique Frederik Seersholm, de l'université Curtin (Perth, Australie), principal auteur de l'article paru en juin 2020 dans Nature Communications. Neuf espèces se sont éteintes, et cinq n'ont plus fréquenté la région. Alors que les petits animaux, qu'on pensait pourtant chassés intensément par les hommes, ont survécu et se sont adaptés… en migrant." Un autre facteur que le climat aurait donc contribué à l'extinction des grands mammifères. Cet "autre facteur" ne peut être que l'Homme, selon ce chercheur.
Une analyse de toutes les études consacrées aux sites paléontologiques, effectuée par Christopher Sandom de l'université du Sussex (Royaume-Uni), dresse un schéma global reliant conditions climatiques, extinction de la mégafaune et peuplement humain. Elle montre que les gros animaux n'ont pas disparu du continent d'origine de Sapiens, l'Afrique, alors qu'ils se sont éteints partout ailleurs, notamment en Amérique latine. Une pandémie localisée au continent américain pourrait-elle expliquer ces disparitions ? Pour tester cette hypothèse, Kathleen Lyons, de l'université du Nouveau-Mexique (États-Unis), a modélisé l'impact du virus West Nile sur les populations d'oiseaux d'Amérique du Nord. Sa conclusion est formelle : une maladie ne peut pas provoquer une extinction aussi brutale et rapide que celle de la mégafaune américaine.
Le chasseur-cueilleur serait donc un prédateur irraisonné, incapable de juger des conséquences de ses actes, contrairement à l'Homme du néolithique. Le passage à l'agriculture et à l'élevage, il y a environ 10.000 ans, est en effet souvent présenté comme un immense progrès : l'Homme s'approprie certaines espèces animales et végétales ; il apprend à ressemer les plantes qu'il prélevait auparavant dans la nature et noue des rapports différents avec des animaux, en témoigne la domestication des bovins, ovins et autres caprins. La nature n'est plus pillée mais organisée. Pour le plus grand bien de la planète ? Ces dix mille ans d'évolution récente prouvent le contraire ! L'agriculture et l'élevage, a fortiori en mode intensif, détruisent chaque jour les milieux naturels, et contribuent à polluer l'atmosphère dans une mesure telle qu'ils en altèrent la composition.
Des concentrations élevées de méthane dues à l'essor de l'élevage et de la culture du riz
Tel est le sombre constat dressé par une grande partie de la communauté scientifique. Au point qu'en 2000, le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, de l'institut Max-Planck à Mayence (Allemagne), et le biologiste américain Eugene Stoermer, de l'université du Michigan (décédé en 2012), ont proposé, dans la revue Science, de créer une nouvelle ère géologique baptisée "Anthropocène". Il s'agit de prendre en compte le fait que l'activité humaine a profondément modifié le fonctionnement biologique et physique de la planète. Les deux scientifiques en situent le début en 1784, année de l'invention de la machine à vapeur. Celle-ci nécessite en effet la combustion massive de charbon, contribuant à faire grimper les teneurs en CO2 dans l'atmosphère. Mais un autre chercheur, l'Américain William Ruddiman, paléoclimatologue à l'université de Virginie, a proposé trois ans plus tard de faire remonter l'origine de l'Anthropocène aux débuts de l'agriculture et de l'élevage, soit entre - 6000 et - 8000. En juillet 2020, dans le Quaternary Science Reviews, il réactualisait sa théorie, s'appuyant sur les récents travaux menés sur les émissions de méthane. Ceux-ci démontrent que l'augmentation, ces 8000 dernières années, de la concentration de ce puissant gaz à effet de serre dans l'atmosphère est essentiellement due à l'extension de la culture du riz et à la multiplication des troupeaux d'animaux domestiqués par l'Homme. Est ainsi expliqué pourquoi les teneurs en méthane relevées dans les carottes de glace en Arctique et Antarctique sont plus élevées à l'Holocène que lors du réchauffement intervenu après un maximum glaciaire il y a 140.000 ans.
La déforestation a-t-elle réellement commencé il y a 6000 ans ?
Pour le CO2, les choses sont moins claires… Mais dans ce même article, William Ruddiman estime verser au débat de nouvelles preuves. Sa démonstration s'appuie d'abord sur les découvertes archéologiques permettant d'évaluer la croissance de l'humanité. Les démographes estiment que quelques millions d' Homo sapiens vivaient sur terre il y a 10.000 ans, et que cette population a doublé régulièrement par la suite, environ tous les mille ans. Difficile d'imaginer qu'aussi peu d'humains aient pu enclencher une hausse des gaz à effet de serre. Cependant, de récentes découvertes archéologiques en Chine et en Europe (où vivaient à cette époque une grande majorité des hommes) montrent une croissance moins linéaire, notamment une forte hausse de la population entre -7000 et -5000 ans, corrélée à une augmentation des teneurs en CO2 dans l'atmosphère.
L'équipe de Ruddiman a ensuite évalué la déforestation induite par l'avancée de l'agriculture. Un sujet très controversé du fait du manque de données, source d'interprétations variées. En s'appuyant sur les études des pollens récupérés dans les sédiments des lacs et des tourbières partout dans le monde, elle estime que le couvert forestier a commencé à reculer il y a 6000 ans. Certains chercheurs réfutent cependant l'hypothèse d'une destruction d'arbres de grande ampleur, dans la mesure où le manque d'outils et de force animale ne permet pas à un agriculteur d'exploiter plus d'un hectare. Ils oublient sans doute les éclaircies effectuées sur des pentes non exploitées par la suite, les régions déforestées mais cultivées occasionnellement, et les terres trop dégradées pour l'agriculture, rétorque le paléoclimatologue américain… qui persiste et signe.
75 % de la surface des continents sont altérés par l'Homme
Cette déforestation sur plusieurs millénaires a provoqué, selon lui, des rétroactions en cascade. L'augmentation de CO2 dans l'atmosphère a contribué à réchauffer les océans et l'atmosphère, et stoppé la croissance des glaces des pôles. Par rapport à une évolution naturelle du climat, pilotée par le seul rayonnement solaire, l'activité humaine aurait augmenté la concentration en CO2 de 40 ppm (parties par million de molécules de CO2 par mètre cube d'air). Selon Ruddiman, les émissions préindustrielles anthropiques (de -10.000 ans à 1750) se sont élevées à 343 milliards de tonnes, dont 300 ont été absorbés par les océans, le couvert végétal terrestre et les tourbières. Cet excédent de 43 milliards de tonnes représentant le volume émis tous les ans par les 7 milliards d'humains d'aujourd'hui…
La modification du climat par l'Homme ne serait donc pas seulement due à l'extraction en masse de charbon, de pétrole et de gaz pour des usages non essentiels à la survie de l'humanité, mais également à des activités vitales comme l'agriculture. Celle-ci pèse aujourd'hui pour 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En outre, la destruction de biodiversité qu'implique la mise en culture ou le pacage des animaux sur des espaces toujours plus étendus depuis le néolithique n'est pas prise en compte par Ruddiman. "2/3 des surfaces terrestres sont utilisées par l'agriculture, 75 % de la surface des continents sont altérés par l'Homme, 13 % seulement des océans ne sont pas impactés par les activités humaines, 70 % des zones humides ont été détruites depuis 1970", dénonce ainsi l'organisation non gouvernementale World Wildlife Found (WWF) dans son Indice planète vivante de 2020. Le nombre de vertébrés sauvages, lui, a baissé de 68 % depuis 1970. "Aujourd'hui, 97 % de la biomasse animale est composée de l'Homme et de ses animaux d'élevage, il ne reste plus que 3 % de biomasse sauvage", déplore William Ruddiman. Conclusion : Homo sapiens a achevé sa conquête du monde. Il bute sur ses limites.
Pour la première fois de son histoire, il en a pris conscience. Depuis le sommet de Rio, en 1992, et l'adoption des conventions internationales sur la biodiversité, le climat et, en 1994, la désertification, la communauté internationale tente de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de freiner les destructions d'espèces animales et végétales. Cesser d'être pyromane, viandard, destructeur : c'est bien la nature de l'Homme qu'il s'agit de changer.
Pyromane depuis 35.000 ansOubliez l'image idyllique d'hommes grappillant ici quelques baies, prélevant là un bison après une chasse valeureuse et respectueuse de l'animal. Ce paradis n'a jamais existé. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont utilisé tous les moyens disponibles pour éliminer les obstacles s'opposant à leur volonté. Y compris… le feu. C'est ce que nous apprend l'étude du climatologue Jed Kaplan, de l'université de Lausanne (Suisse), et de l'archéologue Jan Kolen, de l'université de Leyden (Pays-Bas). Ces chercheurs ont voulu comprendre pourquoi, de l'Espagne au nord de l'Allemagne, les traces de pollens et de graines indiquent l'omniprésence il y a 20.000 ans d'une végétation de steppe, alors que les modèles climatiques montrent, sur la majeure partie du continent, des conditions favorables aux forêts. La réponse, donnée dans un article de 2016 paru dans Plos One, c'est l'Homme. Sous un climat très froid, seule l'utilisation du feu peut modifier à ce point l'environnement. La motivation d' Homo sapiens est simple : créer des espaces ouverts, plus favorables à la chasse, à la quête de plantes comestibles et aux déplacements. Cette hypothèse a été largement confortée par la datation de couches de cendres dans les sols. Pour les chercheurs, ces incendies volontaires constituent par ailleurs l'une des plus anciennes modifications du climat par l'Homme. Le CO2 stocké par les arbres a en effet été relâché dans l'atmosphère en grande quantité, provoquant une augmentation des teneurs de gaz à effet de serre.
L'Europe n'a pas été le seul continent affecté. En Australie, les incendies allumés par les premiers occupants remontent même à 35.000 ans, soit 15.000 ans seulement après leur arrivée. C'est dans le cratère Lynch, site archéologique majeur du Queensland, qu'ont été datées au carbone 14 des suies et cendres provenant de la combustion d'une forêt tropicale. L'analyse des pollens fossiles montre que les arbres ont été remplacés par des arbustes sclérophylles semblables aux lauriers. Fulco Scherjon, paléontologue de l'Université de Leyden a voulu savoir si l'on retrouve ces pratiques partout dans le monde. Sa compilation des études scientifiques sur le sujet parue en 2015 dans Current archeology montre que c'est effectivement le cas. Les chasseurs-cueilleurs ont mis le feu à leurs paysages partout dans le monde, sur tout type de végétation… à l'exception de la toundra. Là encore, pour ouvrir des chemins et mieux communiquer, mais aussi augmenter la productivité des plantes, attirer les animaux, et même, c'est une hypothèse…pour s'amuser !
Invité- Invité
 Sujets similaires
Sujets similaires» LE MINÉRAL ET LE VIVANT
» LE CAPITAL À L'ASSAUT DU CIEL
» RÉVOLUTION DANS LE VIVANT
» LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
» I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
» LE CAPITAL À L'ASSAUT DU CIEL
» RÉVOLUTION DANS LE VIVANT
» LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)
» I. LE POUVOIR POLITIQUE de l'ÉTAT du CAPITAL vs L'ADMINISTRATION COMMUNISTE DES CHOSES
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum







» BIEN CREUSÉ, VIEUX TOP ! Histoires d'une mare
» IRONÈMES, poésie minimaliste, depuis 2018
» MATIÈRES À PENSER
» CRITIQUE DE L'UTOPIE, DES UTOPIES, communistes ou non
» I 2. TECHNIQUES et MUSIQUES pour guitares 6, 7 et 8 cordes, IMPRO etc.
» ET MAINTENANT, LA POLITIQUE RESTRUCTURÉE EN MARCHE
» PETITES HISTWEETOIRES IMPRÉVISÉES
» HOMONÈMES, du même au pas pareil
» LA PAROLE EST À LA DÉFONCE
» KARL MARX : BONNES FEUILLES... BONNES LECTURES ?
» IV. COMBINATOIRE et PERMUTATIONS (tous instruments)
» CLOWNS et CLONES des ARRIÈRE- et AVANT-GARDES
» VI. À LA RECHERCHE DU SON PERDU, ingrédients
» CAMATTE ET MOI
» III. LA BASSE et LES BASSES À LA GUITARE 8 CORDES
» L'ACHRONIQUE À CÔTÉ
» LA CRISE QUI VIENT
» MUSIQUE et RAPPORTS SOCIAUX
» PETITE PHILOSOPHIE PAR LA GUITARE à l'usage de toutes générations, classes, races, sexes...